Salim Bachi
Le Chien d’Ulysse
 Salim Bachi vit en France depuis 1997. Il signait là son premier roman. Un texte sombre, désespéré même. Il y déverse, tel un trop plein, une prose abondante et débordante. L’imaginaire, le symbolisme et le réalisme le plus cru s’entrechoquent, le passé bouscule le présent, la quête de sens bute sur le déracinement et l’oubli, les tranches de vie se mêlent, s’emberlificotent dans les ruelles de Cyrtha, « ville-cancer » de ce « pays cannibale ».
Salim Bachi vit en France depuis 1997. Il signait là son premier roman. Un texte sombre, désespéré même. Il y déverse, tel un trop plein, une prose abondante et débordante. L’imaginaire, le symbolisme et le réalisme le plus cru s’entrechoquent, le passé bouscule le présent, la quête de sens bute sur le déracinement et l’oubli, les tranches de vie se mêlent, s’emberlificotent dans les ruelles de Cyrtha, « ville-cancer » de ce « pays cannibale ».
Comme d’autres écrivains algériens (Boualem Sansal, Amin Zaoui...), l’auteur a choisi - mais est-ce un choix ? - de « balancer » son texte entre plusieurs genres et de briser la ligne du temps. L’exercice permet sans doute de traduire la confusion algérienne - et de s’inscrire dans l’héritage d’un Kateb Yacine par exemple -, mais peut aussi parfois donner le tournis au lecteur...
22 juin 1996, quatre ans jour pour jour après l’assassinat du président Boudiaf, nous partageons une journée de la vie d’Hocine. Dans la soirée, l’étudiant a rendez-vous avec le commandant Smard en quête de nouvelles recrues. Acceptera-t-il de devenir une taupe contre l’argent et l’offre alléchante du cynique officier? Au soir de ce 22 juin, Hocine avouera : « je ne suis plus l’enfant que je prétendais être tout à l’heure. Je ne suis plus rien de ce que j’ai été ce matin. Une éternité a passé. Et plus, peut-être ». Entre son réveil dans l’appartement familial « pléthorique » et son retour à la nuit tombée, Hocine vivra des heures déterminantes.
Sa journée se passe avec son ami Mourad, son double et son contraire. Mourad le poète est amoureux d’Amel, l’épouse d’Ali Khan, leur professeur de littérature. Hocine, lui, n’entretient avec les femmes qu’un commerce charnel, utilitaire. Un assouvissement.
Ensemble, entre vérités et mensonges, rêves et réalités, ils embarquent pour une journée particulière. Elle commence chez Ali Khan avec la présence de son ami, le journaliste Hamid Kaïm qui, depuis les lointaines années de révoltes étudiantes et son amour pour Samira traîne le poids terrible d’une ancienne culpabilité. Elle passe par la mort du pauvre clochard descendu parce qu’il ne cessait de brailler « à Ithaque ! à Ithaque! » ce que la police algérienne, qui n’a pas forcément lu Homère ou qui est tout simplement dur de la feuille traduit par « à l’attaque ! à l’attaque ! ». Elle se termine avec Seyf et sa terrible confession. Seyf est un membre des forces de sécurité. Le tortionnaire est devenu une froide mécanique, surnommé « le bourreau de Cyrtha ». La scène de l’hôpital où Seyf s’explique avec Hocine et ses copains étudiants est une des plus fortes du livre.
« Tout ça me dépassait. Les uns égorgeaient, les autres torturaient et assassinaient. Les uns avaient tort, les autres avaient raison. J’aurais voulu ne jamais tomber entre leurs mains, aux uns comme aux autres » dit Hocine avant de se rendre à son rendez-vous nocturne. Hocine ne sortira pas indemne de cette odyssée dans les dédales de Cyrtha et de ces existences broyées. Au moins sait-il maintenant quelle attitude adoptée face à Smard. Mais il ignore encore comment cette journée se terminera.
Edition Gallimard, 258 pages, 14,94 €
-
-
Les républicains espagnols dans le Camp de concentration nazi de Mauthausen.
Pierre et Marie Salou Olivares
Les républicains espagnols dans le Camp de concentration nazi de Mauthausen. Le devoir collectif de survivre
 Quelques jours seulement après la parution de ce livre, le quotidien espagnol El Mundo du 30 octobre 2005 rapportait que le criminel de guerre nazi, Aribert Heim, recherché par les polices allemande et autrichienne, se cacherait en Espagne depuis 1985. La piste sera vite abandonnée au profit d’une piste chilienne puis égyptienne. Cet ancien médecin est surnommé « le petit Mengele » pour avoir torturé et pratiqué des injections de poisons sur des centaines de victimes entre le 8 octobre et le 29 novembre 1941 à Mauthausen. Terrible ironie de l’histoire, c’est dans ce camp que 7297 Espagnols ont été déportés. 4761 n’en sont pas revenus. Combien parmi ces victimes sont passées entre les mains du bourreau Heim ?
Quelques jours seulement après la parution de ce livre, le quotidien espagnol El Mundo du 30 octobre 2005 rapportait que le criminel de guerre nazi, Aribert Heim, recherché par les polices allemande et autrichienne, se cacherait en Espagne depuis 1985. La piste sera vite abandonnée au profit d’une piste chilienne puis égyptienne. Cet ancien médecin est surnommé « le petit Mengele » pour avoir torturé et pratiqué des injections de poisons sur des centaines de victimes entre le 8 octobre et le 29 novembre 1941 à Mauthausen. Terrible ironie de l’histoire, c’est dans ce camp que 7297 Espagnols ont été déportés. 4761 n’en sont pas revenus. Combien parmi ces victimes sont passées entre les mains du bourreau Heim ?
Pierre et Marie Salou Olivares ont consacré des années de travail à ces « Espagnols anti-fascistes » de Mauthausen en colligeant les témoignages des survivants publiés entre le début des années 60 et la première moitié des années 90 dans Hispania le journal de la FEDIP, la Fédération Espagnole des Déportés et Internés Politiques.
« Je suis fille d’un militant actif au sein de la FEDIP, écrit Marie Salou Olivares, et toute mon enfance, j’ai entendu parler du « livre » de la FEDIP sur le Camp de Mauthausen. Mais toujours les urgences de la vie l’ont remisé à plus tard (…) ». C’est donc elle, aidée de son fils, qui, bien plus tard, réalise ce livre « pour que cette terrible expérience ne soit pas engloutie avec le dernier témoin » et pour « transmettre aux générations futures, conformément aux souhaits de tous ces humains meurtris, les pénibles épreuves qu’ils ont affrontées. Leur espoir étant que cela ne se reproduise jamais ! ». Cette volonté de « témoigner » sourd des mille pages de ce livre et des quelque quatre-vingts textes écrits en espagnol et suivis de leur traduction en français. Témoigner comme un hommage collectif rendu à ceux qui n’en sont pas revenus. Témoigner pour que l’histoire ne soit pas falsifiée ni oubliée. Témoigner, pour rester vigilant, pour ne pas voir « diminuer la détermination du monde à combattre » la toujours menaçante « bête immonde » dont parle Brecht. Témoigner enfin comme un acte de résistance, pour dire cette âme de résistance chevillée au corps des Républicains espagnols, éternels combattants de la liberté. Combattants oubliés d’une liberté remisée au clou de l’Histoire.
Aux origines de la déportation
L’histoire des Républicains espagnols fait aussi partie de notre histoire. Pas seulement parce qu’après la « retirada », au cours de cet « exode tragique », ils furent accueillis en « exilés maudits » dans les camps de regroupements (à Argelès sur Mer, Saint Cyprien, Vernet d’Ariège, Bram, Sepfonds, Gurs,…), mais aussi parce que leur arrivée en France a été pour des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, l’antichambre de la déportation dans les camps nazis de concentration ou d’extermination, l’antichambre de la mort. Pour ces exilés, la seconde guerre mondiale n’a pas commencé en 1939, mais le 18 juillet 1936 avec la guerre d’Espagne. Les républicains espagnols n’ont cessé de le répéter : ils ont été aux avants postes de la lutte contre le « fascisme international ». Face à Franco, à Mussolini et Hitler, les « soi-disant démocraties » ont démissionné dans ce qui sur le sol ibérique n’aura été qu’une « répétition ». Pire, pourquoi déporter les Espagnols en Allemagne demande Lazaro Nates ? L’ex-détenu, matricule 3832, parle d’une « complicité » pour se débarrasser des « indésirables », des « rouges espagnols », « complicité entre les xénophobes français de cette époque, les autorités espagnoles franquistes et ceux qui devaient exécuter cette triple complicité : les Allemands ».
Les « triangles bleus » des « apatrides »
Mauthausen a été un camp où 118 000 déportés sur les 198 000 qui y ont été internés entre le 8 août 1938 et le 5 mai 1945 (1), ont été exterminés. « 80 mois consacrés à la mort » comme l’écrit un ancien häftlingen (détenu) dans ce que les rescapés appellent « la machine de destruction », « l’abattoir », « l’enfer » ou « le bagne dantesque ». 1475 morts par mois, 53 morts par jour et ce pendant près de sept ans ! Cette macabre et incertaine comptabilité est peut-être nécessaire pour donner une vague idée de l’horreur.
À leur arrivée, les déportés savaient vite ce qui les attendait : « Vous êtes entrés par cette grande porte et vous ne sortirez que par cette cheminée », assenait, en montrant la fumée qui s’échappait des fours crématoires, le commandant Franz Ziereis ou l’interprète allemand du camp surnommé « Enriquito » ou « Manolita » par les détenus espagnols.
 Mauthausen était un camp d’extermination par le travail. « La célèbre carrière nommée : Wienergraben », carrière de granit, se trouvait en contrebas du camp. Un escalier de 186 marches, « le tragique escalier sur lequel périrent tant d’hommes » y donnait accès.
Mauthausen était un camp d’extermination par le travail. « La célèbre carrière nommée : Wienergraben », carrière de granit, se trouvait en contrebas du camp. Un escalier de 186 marches, « le tragique escalier sur lequel périrent tant d’hommes » y donnait accès.
Déportés en convoi depuis le 6 août 1940 jusqu’à la fin de l’année 1943, les Espagnols ont été les premiers en France à être expédiés dans les camps de la mort, à y être broyés par le monde concentrationnaire nazi. À Mauthausen, un triangle bleu avec la lettre « S » (pour « Spanier », Espagnol) les distinguait des autres détenus.
Pour tuer, les bourreaux n’ont jamais manqué d’imagination : froid, manultrition, épuisement, vermines, tortures, sauvageries, humiliations, sadismes, bastonnades, morsures de chiens, pendaison, expériences médicales, chambres à gaz, crémation... La mort était partout et frappait à chaque instant, le sadisme était sans limites. « Personne, à part ceux qui l’ont vécu, ne peut imaginer jusqu’à quel point le fanatisme amène à des actes extrêmes. Personne ne peut imaginer que la férocité puisse atteindre de telles proportions ». Pourtant, il faut lire les témoignages, tous les témoignages pour, peut-être et seulement, se rappeler de quoi justement les hommes sont capables. « Pour eux, [les SS] il ne s’agissait pas de tuer des êtres humains mais d’exterminer des animaux nuisibles ». « Prolonger l’agonie de ces martyrs était leur amusement, leur jouissance. Nous nous demandions comment ces hommes, appartenant à un des pays les plus civilisés, comme c’est le cas de l’Allemagne, pouvaient-ils commettre quotidiennement tant de crimes et parvenir à la fin de leur journée à rentrer dans leur foyer pour se comporter en amants, époux ou pères affectueux avec leurs enfants ».
Fidélité
Il faut témoigner aussi et surtout pour celles et ceux qui n’en sont pas revenus : « nous leur devons de défendre la mémoire de leur sacrifice, afin qu’ils ne meurent pas assassiner une autre fois » écrit en 1980 un rescapé (matricule 5080). Défendre la mémoire des victimes est un devoir qui va bien au-delà du cercle des rescapés : « si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer et ils seraient anéantis définitivement. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité", disait le philosophe Vladimir Jankélévitch.
Ces hommages et ces témoignages de « fidélité » aux victimes sont écrits avec une étonnante sobriété et une remarquable pudeur. Les horreurs subies sont relatées avec dignité, de cette dignité qui fait les combattants : toujours rester debout et faire face. La lutte ne cesse jamais disent ces rescapés. Elle n’a jamais cessé : en Espagne d’abord. En s’engageant contre l’Allemagne nazie ensuite. Puis dans les camps et, au lendemain de la guerre, en exil, contre le régime franquiste et contre les tentatives révisionnistes et le réveil de la barbarie. Résistance et liberté sont les deux mots qui reviennent le plus souvent sous la plume de ces hommes devenus passeurs de mémoire mais surtout testateurs d’un bien inestimable.
Résister
La résistance à l’intérieur du camp prend des formes multiples. Individuelle ou collective, elle frôle toujours la mort. José Marfil Escaboue, matricule 3394, est à l’origine du premier acte de résistance des Espagnols de Mauthausen. À sa mort, les Espagnols osent demander et obtiennent la permission d’observer une minute de silence en hommage à leur camarade, première victime d’une longue série.
Où trouver « le salut » demande Antonio Velasco ? « En nous préoccupant d’éliminer le négatif pour favoriser le positif. Cette attitude nous permit d’être un petit pourcentage à sortir vivants de Mauthausen. La principale cause fut la chance pour les uns d’être dispensés de dures punitions et pour les autres de recevoir plus de nourriture que la ration prévue. Il n’y a pas de mystère. Mais la mort nous entourait avec insistance (…), il suffisait d’un caprice plus ou moins imbécile des SS ou de la haine d’un quelconque kapo (…) ». Et pour Juan de Portado, cette certitude : « dans une tragédie, il reste toujours quelqu’un pour raconter ce qui s’est passé, nous ne pouvions échapper à cette règle, cette pensée nous réchauffait un peu ».
Pour survivre, il faut se battre quotidiennement, tenter d’améliorer la misérable pitance servie par les SS, éviter les travaux pénibles, en cherchant, comme Pedro Freixa, à travailler à l’infirmerie ou à conquérir certains postes clés de l’administration du camp en luttant contre les « triangles verts », les prisonniers de droits communs, pour « tant que faire se pouvait, humaniser la vie de cet enfer ». « Humaniser » cet enfer à en faire monter les larmes aux yeux de ces hommes qui ont tout vu, tout subi, en organisant, clandestinement une célébration du noël de l’année 1943...
C’est au cours d’une autre nuit, celle du 23 juillet 1941, qu’Antonio Velasco, avec trois autres compagnons, décident de s’évader. Un périple dangereux de quarante-deux jours à travers une Autriche hostile pour tenter de gagner la Suisse. Antonio Velasco sera rattrapé et réexpédié au camp. Il échappera à la mort. Plus que d’autres, si cela est seulement possible, Antonio Velasco est un « miraculé ». C’est en se suicidant que Narcisse Gali choisit, lui, la liberté : « sa mort fut comparable à sa vie écrit P.Pey Sarda. Elle fut un ultime geste de propagande antifascite ». Résister encore et toujours. Résister jusqu’aux derniers jours. Dès le mois d’octobre 1944, les Espagnols participent aux préparatifs d’une défense pour prévenir une extermination massive des détenus par des gardiens prêts à déserter devant l’avancée des troupes alliées.
Le goût de la liberté
On oublie trop souvent cette bannière déployée sur le fronton du portail pour saluer l’arrivée des troupes américaines ce « 5 del 5 del 45 » comme l’écrit Solticio en une heureuse arithmétique et une joyeuse mélopée de chiffres. Sur la toile tendue, ce 5 mai 1945 les détenus espagnols avaient écrit : « Los Españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras ». Mais, à l’instar de « cette banderole de la solidarité » oubliée, les Républicains espagnols ont aussi « la désagréable sensation d’être fréquemment les oubliés de l’histoire ». Pourtant, comme hier, quand il a fallu taire ses déceptions et ses divisions et s’engager dans l’armée française ou dans la résistance, face à « l’ennemi commun », qu’importe aujourd’hui les conflits de mémoires, qu’importe même la désillusion de voir se bâtir « un monde plus humain et plus juste », « notre mission n’est pas terminée ! » écrivait en 1981, un représentant de FEDIP, face aux menaces révisionnistes et au réveil de « l’euro fascisme ». Et les menaces ne manquent pas. Depuis le Rwanda jusqu’à la Tchétchénie en passant par l’ex-Yougoslavie, depuis un certain 21 avril 2001 jusqu’aux drames de Ceuta et Melila en passant par les dangereux amalgames fomentés par des apprentis caudillos de banlieues. Comme l’écrit Michel Reynaud dans sa préface, « en ces temps incertains et quelquefois insultants il est bon de clamer que des « étrangers » nous permirent de retrouver notre liberté. (…). L’histoire, notre histoire, leur est redevable et plus encore ». Oui, l’histoire des Républicains espagnols est bien notre histoire, encore faudrait-il ne pas l’oublier. Le dire et le répéter ne suffit pas, ne sert à rien, si cela ne se traduit pas en acte. Voilà ce que les derniers rescapés encore en vie nous lèguent. Leur dernier acte de résistance et le goût de la liberté.
Edition Tirisias, Collect. Les oubliés de l’histoire, 2005, 910 pages, 36 euros
(1) Selon les chiffres de l’Amicale des déportés de Mauthausen (site : http://www.campmauthausen.org/). Dans le livre de Pierre et Véronique Salou Olivares il est question de 25 000 survivants pour 225 000 détenus (page 126)
-
Histoires intimes de la guerre d’Espagne, 1936-2006, La mémoire des vaincus
Patrick Pépin
Histoires intimes de la guerre d’Espagne, 1936-2006, La mémoire des vaincus
 1936-1939, trois ans d’une guerre civile où les troupes franquistes ont fait de la haine et de la violence une arme de guerre systématique. Quarante années d’une dictature qui jamais n’a relâché la pression ni desserré le garrot : le 2 mars 1974 Salvador Puig i Antich sera garrotté à l’âge de 26 ans et l’année même de la mort du Caudillo, en 1975, cinq opposants basques seront exécutés, le plus jeune avait tout juste vingt et un ans. Pendant quarante ans, Franco a fait de son pays une terre divisée en « vainqueurs » et en « vaincus ». Une Espagne hémiplégique paralysée par la répression, la peur, la dissimulation d’une moitié de sa mémoire. Une chape de plombs s’est abattue sur la félonie des officiers putschistes, sur la sauvagerie des troupes fascistes, les tueries, les charniers, les disparitions, l’exil. Là encore il a fallu taire les camps, en France d’abord, en déportation ensuite dans les camps nazis, comme celui de Mauthausen (1). Après la mort du dictateur et près de trente années de démocratie, le silence a persisté. Malgré quelques initiatives, il a fallu attendre le début des années 2000 pour assister au « réveil » de la mémoire espagnole, celle des victimes du franquisme, celle des Républicains : articles de presse, publications, manifestations, œuvres culturelles mais aussi excavation de charniers, exhumations et identification des corps. Portée par les petits-enfants des Républicains et quelques acteurs encore en vie, cette « mémoire s’est installée durablement dans l’actualité politique et sociale espagnole » écrit Patrick Pépin.
1936-1939, trois ans d’une guerre civile où les troupes franquistes ont fait de la haine et de la violence une arme de guerre systématique. Quarante années d’une dictature qui jamais n’a relâché la pression ni desserré le garrot : le 2 mars 1974 Salvador Puig i Antich sera garrotté à l’âge de 26 ans et l’année même de la mort du Caudillo, en 1975, cinq opposants basques seront exécutés, le plus jeune avait tout juste vingt et un ans. Pendant quarante ans, Franco a fait de son pays une terre divisée en « vainqueurs » et en « vaincus ». Une Espagne hémiplégique paralysée par la répression, la peur, la dissimulation d’une moitié de sa mémoire. Une chape de plombs s’est abattue sur la félonie des officiers putschistes, sur la sauvagerie des troupes fascistes, les tueries, les charniers, les disparitions, l’exil. Là encore il a fallu taire les camps, en France d’abord, en déportation ensuite dans les camps nazis, comme celui de Mauthausen (1). Après la mort du dictateur et près de trente années de démocratie, le silence a persisté. Malgré quelques initiatives, il a fallu attendre le début des années 2000 pour assister au « réveil » de la mémoire espagnole, celle des victimes du franquisme, celle des Républicains : articles de presse, publications, manifestations, œuvres culturelles mais aussi excavation de charniers, exhumations et identification des corps. Portée par les petits-enfants des Républicains et quelques acteurs encore en vie, cette « mémoire s’est installée durablement dans l’actualité politique et sociale espagnole » écrit Patrick Pépin.
Ce livre, au parti pris éditorial assumé d’entrée, reprend une série d’émissions diffusée sur France culture en 2004. Il rassemble des témoignages de « militants de la mémoire ». Rapporté avec sobriété, chacun porte pourtant une charge émotionnelle forte. Tous sont mis en perspective, historique ou replacés utilement par l’auteur dans le contexte des débats et enjeux qui traversent la société espagnole.
Cette mémoire est d’abord portée par les descendants, les petits-enfants des victimes. Ces orphelins d’une histoire familiale et nationale interpellent historiens et responsables politiques. Il y a là par exemple Emilio Silva, le Président de « l’Associacion para la recuperacion de la memoria historica », Asun Esteban, universitaire à Salamanque ; Javier Castan l’historien aragonais de Jaca ; Montsé Armengou, journaliste à la Televisio de Catalunya qui, dans ses reportages plusieurs fois primés, montre la réalité de la répression franquiste et revient sur le sort des enfants disparus, dont certains, enlevés en prison à leur mère, ont été placés dans des familles franquistes ou des orphelinats dirigés par des religieuses, histoire de leur refaire une santé idéologique. Francisco Martinez-Lopez est lui un ancien guérillero qui a combattu la dictature jusqu’en 1951. Il milite aujourd’hui pour que ce combat ne soit pas oublié. Il y a aussi des témoignages d’exilés : Paquita Merchan, quatre-vingt-quatre ans, l’ancienne combattante madrilène qui finit ses jours dans une banlieue parisienne ; Antoine Blanca ci-devant ambassadeur de France ; Aniceto Ménandez, journaliste, né au Mexique et devenu français à l’âge de vingt et un an ou encore Odette Martinez, née en France, professeur de Lettres, qui montre pourquoi les « déconvenues » de l’histoire commune sont à l’origine d’une image « brouillée » de la France.
Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? Comment « l’humiliation de l’oubli » a-t-elle pu perdurer après la mort du dictateur ? Patrick Pépin avance quatre réponses : la durée même de la dictature ; un climat de violence et de peur maintenu durant les quatre décennies du franquisme. Nombre de témoignages confirment cette peur, montrent concrètement comment Franco « avait organisé un cadenassage des esprits, une crainte ontologique, qui ont durablement structuré la société espagnole ». Il y a aussi les conditions mêmes de la transition démocratique qui a vu le régime tombé non pas sous l’action des « vaincus » d’hier mais de la belle mort du dictateur. Enfin, pour qu’un processus démocratique ait pu voir le jour en Espagne, il a fallu en passer par un compromis et respecter la règle de l’omerta sur les crimes et les responsabilités des bourreaux.
Depuis les choses ont bien changé. Cette mémoire longtemps réduite au silence ne cesse de se rappeler au souvenir des Espagnols. « Cette mémoire est comme une boule de neige qui se charge au fur et à mesure qu’elle roule ». Les morts réclament justice. Des familles meurtries exigent des réparations et les descendants militent pour que toute la lumière soit faite sur l’histoire récente de leur pays et qu’enfin sortent de l’ombre cette armée d’hommes et de femmes qui fut non seulement l’honneur de l’Espagne mais aussi celui d’une Europe écrasée sous la botte fasciste. L’enjeu n’est pas d’ouvrir une nouvelle ère de haine ou de réveiller d’anciens démons mais de préparer « un futur plus clair » en commençant par respecter toutes les composantes de l’identité espagnole. Comme le dit Odette Martinez, « si cette mémoire est reliée au présent, c’est de l’or. C’est de la fécondité pour l’avenir ».
Le livre est accompagné de deux CD-Audio, Nouveau Monde Éditions 2006, 208 pages, 26 €
(1) Voir Pierre et Marie Salou Olivares, Les républicains espagnols dans le camp de concentration nazi de Mauthausen. Le devoir collectif de survivre, édition Tirisias, Collection Les oubliés de l’histoire, 910 pages, 36 euros
-
Mémoires de la chair
Ahlam Mosteghanemi
Mémoires de la chair
 Dans un long monologue intérieur, un homme revisite, pour mieux s’en débarrasser, sa passion pour une jeune femme.
Dans un long monologue intérieur, un homme revisite, pour mieux s’en débarrasser, sa passion pour une jeune femme.
L’ancien moudjahid qui a payé une première fois le prix de la chair pour ses illusions, s’apprête sans le savoir à en payer un second tribut. Lui, le maquisard qui a laissé un bras pour que son pays recouvre liberté et dignité, lui le célébrissime peintre algérien qui a préféré l’exil aux compromissions avec le régime et ses affidés ne se doute pas qu’en croisant par hasard cette jeune femme qui pourrait être sa fille, va voir sa vie basculer. Mémoires de la chair ne constitue pas un resucée du lai d’Aristote, une énième version de cette faiblesse qui pousse certains hommes vieillissants à s’amouracher jusqu’au ridicule d’une jeune et fraîche donzelle.
Certes, Hayat est belle, lumineuse, intelligente, désirable dans sa robe blanche, mais, virevoltante, elle reste insaisissable. Khaled l’aime. Ahlam Mosteghanemi décrit les différentes phases de cet amour irréel depuis la première rencontre dans cette galerie parisienne où Khaled expose ses toiles jusqu’aux affres de la jalousie et du dépit qui fait les jours vides et les nuits sans fin. Passion démesurée, envahissante, exclusive et pourtant cet amour ne se nourrira que de rêves et d’illusions. Tout le reste, c’est-à-dire « tout ce qui n’advint pas » ne sera que littérature. Car, entre Khaled et Hayat, il ne se passera rien. Un simple baiser volé à l’intimité d’un couloir qui, un bref et court instant, rapprocha dangereusement deux corps désirants.
Ahlam Mosteghanemi écrit l’histoire d’un amour algérien qui par bien des aspects prend « la forme du pêché ». Pourquoi Khaled s’est-il toqué de cette fille dont il a deux fois l’âge ? Et pourquoi justement Hayat, la fille de Si Tahar, son ancien et vénéré chef de maquis, celle qu’il ira lui-même reconnaître à la mairie de Tunis pour son père resté à se battre ? Non Hayat n’est pas une belle écervelée qui se joue de la passion de Khaled. Elle est la mémoire de son passé de combattant. Elle réveille chez l’exilé, le souvenir de sa ville natale, Constantine. Elle est l’Algérie, autre figure de Nedjma de Kateb Yacine qui, avec Malek Haddad court à travers les pages de ce roman. Hayat symbolise la plénitude d’une vie. L’échec amoureux laisse place au néant. Khaled comme ces ponts de Constantine qu’il ne cesse de peintre sur ses toiles, est au dessus du vide (voilà qui fait penser à Mourad Djebal et à ses Sens Interdits).
A l’image de cet amour sans lendemain, le roman brosse l’histoire d’une génération, « tuée par ses rêves ». Lorsqu’à l’automne de cette terrible année 1988, Khaled doit pour une deuxième fois séjourner en Algérie, le pays, comme lui, « entre dans l’âge du désespoir ».
Pour Mémoires de la chair ou Mémoires du corps, texte écrit en arabe et publié en 1993 à Beyrouth (« Dhakirat al-jassed »), Ahlam Mosteghanemi a reçu le prix Naguib Mahfouz et le Prix Nour de la meilleure œuvre féminine en langue arabe. Réédité dix-sept fois, traduit en plusieurs langues, le livre connaît une renommée exceptionnelle et a fait l’objet de nombreuses études et recherches universitaires de par le monde. La traduction n’est sans doute pas toujours à la hauteur d’un texte dont le grand Naguib Mahfouz a dit son plaisir à lire « ce livre magnifiquement écrit ».
Traduction de l’arabe (Algérie) par Mohamed Mokeddem, Edition Albin Michel, 2002, 331 pages, 20 euros -
Fais voir tes jambes, Leïla !
Rachid el-Daïf
Fais voir tes jambes, Leïla !
 Un spectre hante le monde arabe : le spectre du désir et de la sexualité. Contre lui, tous les censeurs de tous les pays arabes se sont ligués, au diapason d’islamistes hystériques à force de vouloir « cacher ce sein » et le corps tout entier des femmes objets de toutes les (diaboliques) tentations, de tous les fantasmes et… frustrations.
Un spectre hante le monde arabe : le spectre du désir et de la sexualité. Contre lui, tous les censeurs de tous les pays arabes se sont ligués, au diapason d’islamistes hystériques à force de vouloir « cacher ce sein » et le corps tout entier des femmes objets de toutes les (diaboliques) tentations, de tous les fantasmes et… frustrations.
Pour en rester à quelques exemples, ces thèmes occupent des pages entières de salubres romans diffusés parfois sous le manteau. Il y a ainsi Dérèglements (2002) du Syrien Amar Abdulhamid, L’Immeuble Yacoubian (2006) de l’Égyptien Alaa Al-Aswany, L’Amande (2004) de Nedjma, anonyme marocaine ou Ma Boîte noire de Driss Ksikes (2006) également marocain ou encore Un été sans juillet (2004) de l’Algérien Salah Guemriche… Dans son précédent et savoureux Qu’elle aille au diable Meryl Streep !, le Libanais, Rachid el Daïf, posait déjà la question des rapports entre hommes et femmes.
Le lecteur retrouvera avec délices ici le ton de la farce et de la bouffonnerie cher à l’auteur. Professeur de littérature arabe, versé dans les lettres classiques, il est un lecteur attentif du Livre des chansons, écrit au Xe siècle par Abu Faraj al Isfahani. Certaines scènes de ce livre vieux de onze siècles inspirent, aujourd’hui encore, le regard malicieux que porte l’auteur libanais sur la société et ses contemporains. L’ironie ici n’est jamais méchante. Empreinte de tendresse, elle rend les personnages - tous les personnages - sympathiques et émouvants, empêtrés qu’ils sont dans leurs contradictions entre leurs aspirations et le respect des règles sociales, morales et/ou religieuses.
Au volant de sa maudite Subaru que lui a refourguée son pote Rafic, le narrateur de Fais voir des jambes Leïla !, vient d’être victime d’un accident. À son réveil, l’homme se rappelle les déconvenues qui ont précédé l’accident. Cette voiture d’abord : symbole d’une société de consommation effrénée, d’appât du gain et de combines en tout genre. Après son acquisition, le narrateur se rend compte qu’il se retrouve dans une galère sans nom : les pièces de rechange sont introuvables au Liban, prohibitives à l’importation et pour la revendre il faudrait dénicher, après lui, un autre pigeon. Le Beyrouth d’El-Daïf est un Beyrouth matérialiste, on y fait l’amour pour de l’argent, on y vend des livres photocopiés, des logiciels piratés, etc.
Mais là n’est pas son principal souci : son père âgé de soixante-cinq ans entretient une relation avec une jeune femme de trente ans qu’il a décidé d’épouser. Pour ce faire, il a déjà hypothéqué le domicile familial. Pour le fiston « il y a un piège là-dessous, c’est certain ! ». Aussi, va-t-il tout mettre en œuvre pour s’opposer au paternel projet. À commencer par un infantile chantage. Des jours durant, sur le balcon de l’appartement, il s’expose au soleil estival. Pendant que lui brûle et se déshydrate son père, comme indifférent, mange et boit à sa guise. Alors germe une autre idée : offrir à son géniteur - partager plutôt avec lui ! - sa petite amie, la belle Leïla, avec qui il entretient un sporadique commerce amoureux. Ainsi comprendra-t-il que pour assouvir ses désirs charnels, il n’est pas obligé de se marier où alors qu’il le fasse avec une femme de son âge ! de sorte qu’il évitera d’enfanter et le fiston, lui, s’évitera de devoir assumer quelques responsabilités et autres dépenses à l’avenir. Point de morale dans l’affaire, le souci matériel est exclusif.
Mais voilà, peu chaut au père les manœuvres et inquiétudes de son fils. Encore fringant, il semble jouir de la vie quand l’autre se ronge les sens, il fait l’amour, avec empressement et savoir faire avec la jeunette de vingt ans que son fiston lui fourgue entre les mains après l’avoir, lui-même, excitée ! Pragmatique et sensé, il fait en toute chose à la mesure de son humaine condition : « mon Dieu à moi est tout petit, il est juste à la taille de mon cœur, tandis que le tien est trop grand pour toi ! » dit-il à son rejeton gagné par un conformisme religieux de façade.
Alors ultime et diabolique manigance du narrateur : coucher avec Z., la (future) épouse de son père, et ainsi empêcher l’union avec cette femme dont la laideur a déjà repoussé tous les autres hommes de la ville ! « Et dire que les hommes croient comprendre les femmes ! » Lui peut-être moins que les autres encore. « Tu n’es qu’un homme aussi mauvais que les autres » lui assène l’infortunée Z. Empêtré dans son innocente et machiste suffisance, le narrateur s’emberlificote entre ses désirs et ses valeurs : « Leïla est vraiment une fille super (…) si elle avait été un peu moins libérée, j’aurais pu penser à elle plus sérieusement ».
De machination en machination, de suspicion en suspicion - depuis l’homosexualité supposée du père jusqu’à croire être devenu lui-même objet de manipulation par le trio formé de son père, de Leïla et de Z - le narrateur finit par admettre : « rien ne se passait comme je l’avais cru ». Humilié, il croit même être victime d’une injustice : « pourquoi tout ce que je fais finit-il par se retourner contre moi ? ».
Traduit de l’arabe (Liban) pas Yves Gonzalez-Quijano, Actes Sud, 2006, 175 pages, 18 €
-
Bleu blanc vert
Maïssa Bey
Bleu blanc vert
Maïssa Bey s’est attelée à un difficile pari : faire revivre trente années de l’histoire algérienne à travers l’amour de Lilas et d’Ali. En 1998, dans Les Amants désunis, Anouar Benmaleck tissait déjà le tableau de la société algérienne en remontant cette fois jusqu’à la présence coloniale grâce au fil ténu d’un autre amour, celui unissant dans un siècle tourmenté un Algérien et une Suissesse.
Tâche ardue que de restituer l’histoire sociale et politique, depuis 1962 jusqu’en 1992, sans tomber dans un pathos démonstratif ni réduire la consistance des personnages à une peau de chagrin informe. Globalement, Maïssa Bey évite ces deux écueils et signe là peut-être le premier roman de l’Algérie indépendante : depuis les premiers jours de l’indépendance jusqu’aux années quatre-vingt-dix, depuis l’euphorie des premières heures d’un pays retrouvé et gorgé d’un soleil prometteur, jusqu’à la nuit noire qui s’est abattue sur une terre inondée de larmes et devenue rouge du sang des innocents. Premier roman de l’Algérie indépendante parce qu’à la différence des autres et nombreux romans algériens qui n’en finissent pas de disséquer l’histoire contemporaine et lointaine de l’Algérie, Bleu blanc vert - tout un symbole déjà de la volonté de l’auteur dans le titre - revisite quasi chronologiquement les grands moments et les événements de son pays.
Quand Maïssa Bey utilise le grand angle, les grandes avenues de l’Histoire défilent, une histoire rythmée en trois temps : les espoirs de la première décennie d’abord, « l’ombre de la grande désillusion » qui se profile dans les années soixante-dix ensuite et enfin la descente aux enfers, provoquée par un FLN devenu « le parti honni de tous » et des islamistes de plus en plus exigeants et semeurs de peur.
Quand elle se sert d’une focale plus réduite et parfois de la loupe elle est alors au plus près des êtres, de leur quotidien, de leurs espoirs et de leurs souffrances souvent cachées. On retrouve ici la Maïssa Bey intime et sensible, capable de rendre l’intériorité de ses personnages. Celle des femmes bien sûr. Il y a Lilas, mais aussi sa mère, veuve qui seule a élevé ses enfants ou la mère d’Ali, épouse délaissée puis abandonnée par son mari devenu un de ces dignitaires du régime qui se sont appropriés la révolution, le pays et le peuple. « Quand donc l’ambition et la cupidité ont-elles dénaturé le sens qu’il voulait donner à sa vie en s’engageant pour défendre le droit à la liberté de tout un peuple ? Et qu’a-t-il bien pu se passer pour que ces idéaux si chèrement défendus soient aujourd’hui dévoyés à ce point ? » se demande Ali à la mort de son père. Ces pères « auraient-ils failli » ?
Mais, peut-être est-ce une nouveauté dans son œuvre, Maïssa Bey donne ici consistance à un personnage masculin, Ali, décrivant avec vraisemblance et sans caricatures, ses interrogations, ses paradoxes et ses quêtes.
Le récit est rythmé par les perceptions différentes d’Ali et de Lilas. Regards portés in petto par un homme et une femme donc sur la société et leur vie commune. Lui est avocat, témoin des violations des droits de l’homme et des droits politiques ou des dénis identitaires. Elle est psychologue, témoin d’une société malade, au plus proche de la détresse et des dérèglements humains. Chacun raconte les ressorts d’une histoire familiale sur trois générations, et surtout leur amour. Exceptionnel amour peut-être parce qu’unissant deux être libres, jamais entravés par le poids des convenances et des traditions, et respectueux de la liberté de l’autre. Malgré les aléas de la vie à deux…
Il n’est pas question de revenir ici sur cette chronologie, ce compte à rebours tragique qui fait que, « plus nous avançons, plus nos rêves s’éloignent » dit Lilas. D’ailleurs l’essentiel n’est peut-être pas là. Maïssa Bey montre le quotidien déliquescent, les adaptations et les transformations des Algériens eux-mêmes. Elle montre surtout que ces trois couleurs nationales exigent la participation de tous, hommes et femmes et s’interroge dès lors : « comment toute une société peut-elle fonctionner et s’organiser en faisant totalement l’impasse sur un sentiment aussi essentiel, aussi beau que l’amour ? ».
Pourtant s’il faut parfois, dans des moments de détresse et de doute « se délester de l’insoutenable légèreté des rêves », pour Ali et Lilas, personne en Algérie ne parviendra à « assassiner l’espoir ».
Edition de l’Aube, 2006, 284 pages, 19,50 € -
Le jour du Watusi II, Du vent et des bijoux
Francisco Casavella
Le jour du Watusi II, Du vent et des bijoux
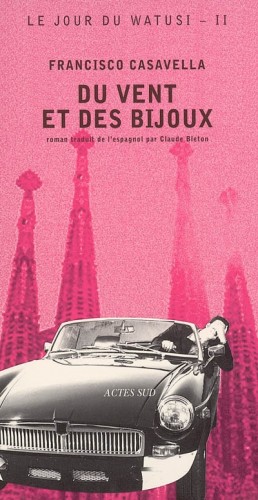 Il s’agit du deuxième volet d’un triptyque commencé avec Les Jeux féroces et qui se refermera avec Le Langage impossible. Dans Du vent et des bijoux, on retrouve le même narrateur, Fernando, qui, tout en relatant l’histoire de sa vie, écrit un étrange rapport pour un mystérieux Lecteur. Il faudra sans aucun doute attendre les dernières pages du troisième et dernier tome pour que tout prenne un sens.
Il s’agit du deuxième volet d’un triptyque commencé avec Les Jeux féroces et qui se refermera avec Le Langage impossible. Dans Du vent et des bijoux, on retrouve le même narrateur, Fernando, qui, tout en relatant l’histoire de sa vie, écrit un étrange rapport pour un mystérieux Lecteur. Il faudra sans aucun doute attendre les dernières pages du troisième et dernier tome pour que tout prenne un sens.
Pour l’heure, Fernando se raconte et à travers lui raconte l’histoire de l’Espagne et de la Barcelone des quarante dernières années. Le 15 septembre 1971, le Jour du Watusi, Fernando, enfant, courait en compagnie de Pepito, à travers la ville pour tenter de retrouver ce Watusi, un mythique et improbable voyou, accusé du meurtre de la fille d’un caïd du quartier de la montagne de Montjuïc. Le gamin et sa mère échapperont à la vindicte du parrain des cabanes mais devront quitter fissa le taudis. C’est ici que commence Du vent et des bijoux qui reste traversé de bout en bout par la mémoire et la quête du Watusi, une « mémoire transformée en une vie inventée » par Fernando mais qui sera aussi détournée, pervertie, salie.
Fernando et sa mère s’installent dans une méchante et triste loge de concierge à Barcelone même. Pour arrondir les fins de mois, Flora s’improvise vendeuse en cosmétique des produits Proust, organisant dans son antre bien peu hospitalier des après-midi vente sans succès. En 1975 elle rencontre Carmelo qui la sortira de sa loge, lui fera deux autres enfants et mettra le pied à l’étriller de l’ascension sociale au jeune Fernando. En ces années 1976-1977, le gamin des rues a grandi. Il a dix-neuf ans et tout à apprendre de la vie d’autant plus qu’il va évoluer dans un milieu, celui de la banque et de la politique, opaque et manipulateur, tripatouillant aussi bien le passé récent que l’avenir d’une Espagne, libérée du Caudillo et ouverte au vent de la démocratie. Il lui faudra pour mériter l’adoubement du sérail faire montre de docilité, de servilité même et de pas mal de cynisme.
Fernando aurait pu être oublié au sous-sol de la Banque citoyenne n’était Ballesto, l’homme à tout faire de l’établissement, qui le sortira d’un quotidien à l’horizon gris et bouché. Ballesto, le ci-devant et énigmatique Boris, sera, un temps, l’idéal et le modèle de Fernando. L’homme a du charisme, de la culture, de l’entregent et de la poigne. Avec les pontes de la banque, Don Carlos Del Escudo et son successeur à la direction générale Don Tomas Del Yelmo, ils décident de créer un parti politique, le « Parti libéral citoyen », moins pour participer à la démocratie naissante qu’histoire de recycler de vieilles casseroles et de tirer les marrons du feu. « Aujourd’hui, tout le monde se lance dans la politique. Peut-être pour ne pas être largué… Piétiner les autres pour ne pas être piétiné… ». Sur cette Espagne de la transition, Casavella porte un regard désenchanté qui laisse un goût amer en bouche : tout ici n’est que faux-semblant, manipulations, mensonges et solitudes. Le whisky coule à flot, les pilules sont ingurgitées ad libitum, les nuits blanches se terminent dans les boîtes et autres bordels de luxe de la capitale catalane ou de sa sœur castillane, les filles sont achetées à coups de Jaguar et de bijoux, « la sous-espèce des journalistes » est graissée avec force et lourdes enveloppes… Le personnel, valets et autres cadets de l’ancien régime, se recycle à gogo, changeant et détournant les règles du jeu : « de la loi à la loi, en passant par la loi, comme au jeu de l’oie, j’ai le droit de rejouer ». À sa façon, Ballesto administre des cours de philosophie politique au jeune Fernando : « tous les enfants de putain qui n’ont pas bougé un petit doigt de vérité de toute leur vie sont en train de bâtir l’Histoire ».
Cette période d’ouverture à la démocratie n’aurait-elle été qu’un vaste courant d’air, du vent dont on se gargarise histoire de taire le passé des uns et des autres et de mystifier le chaland ? Du vent à l’instar de la société de consommation qui elle aussi profile son ombre envahissante : publicitaires et « escrocs intellectuels » commencent à distiller leurs « parfums de pacotille ». On achète les esprits avec du vent et les corps à coups de bijoux. « Nous sommes ici pour enterrer des cadavres (…). Nous avons monté cette machination pour que tout soit bien enterré » dit Ballesto. Ce qu’il ignore encore, lui qui est loin d’être tombé de la dernière pluie, c’est qu’en politique il en est comme dans les gares : une machination peut en cacher une autre…Passionnant ! Francisco Casavella, le jeune prodige de la littérature espagnole, distille le doute et l’inquiétude chez son Lecteur.
Traduit de l’espagnol par Claude Bleton, Edition Actes-Sud, 496 pages, 23 €
-
Le jour du Watusi I, Les Jeux féroces
Francisco Casavella
Le jour du Watusi I, Les Jeux féroces
 Barcelonais de quarante-deux ans et auteur de quatre romans à la sortie de ce premier tome du Jour du Watusi, Francisco Casavella appartient à la jeune génération des romanciers espagnols et la critique hispanique voyaient en lui un des piliers de la nouvelle littérature nationale. Les Jeux féroces est le premier volet d’un triptyque sur « une Espagne de la transition qui titube entre franquisme moribond et démocratie balbutiante » (dixit l’éditeur). Les deux autres tomes, Du vent et des bijoux et Le Langage impossible sont parus la même année. Francisco Casavella écrit dans une langue touffue et chargée, une densité nourrit de précisions et de descriptions, d’allusions, de renvois et de rappels. Il dissèque la ville, les groupes sociaux et l’histoire récente de son pays.
Barcelonais de quarante-deux ans et auteur de quatre romans à la sortie de ce premier tome du Jour du Watusi, Francisco Casavella appartient à la jeune génération des romanciers espagnols et la critique hispanique voyaient en lui un des piliers de la nouvelle littérature nationale. Les Jeux féroces est le premier volet d’un triptyque sur « une Espagne de la transition qui titube entre franquisme moribond et démocratie balbutiante » (dixit l’éditeur). Les deux autres tomes, Du vent et des bijoux et Le Langage impossible sont parus la même année. Francisco Casavella écrit dans une langue touffue et chargée, une densité nourrit de précisions et de descriptions, d’allusions, de renvois et de rappels. Il dissèque la ville, les groupes sociaux et l’histoire récente de son pays.
Cette première livraison s’ouvre sur l’année 1995 et sur une mystérieuse demande de « Rapport » par un non moins mystérieux « Lecteur » qui conduit, Fernando, le narrateur, à évoquer un souvenir personnel : une journée d’août 1971, la plus importante de sa vie où, pendu aux basques de Pépito le boiteux, un petit gitan paria, il court à travers les bas-fonds de la ville à la recherche d’un certain Watusi accusé du meurtre de la petite Julia.
Julia appartenait au clan des de Celso qui s’est empressé de dépêcher ses sbires sur les traces du Watusi, truand bringueur et danseur, figure mythique du quartier, personnage improbable et invisible qui n’apparaît qu’à la toute fin du roman. Une course poursuite s’engage alors entre les deux gamins et les tueurs de la famille. Dans un taudis rendu boueux par une pluie meurtrière, les deux apprentis justiciers naviguent de lieux interlopes en bouges, de chapardages à l’étal en vols de voitures, passent d’un lupanar au zoo de la capitale catalane, s’efforcent de fausser compagnie à une bande de voyous sadiques et d’éviter les envoyés des de Celso.
Cette course justicière et initiatique - l’apprentissage de la peur - révèle la zone barcelonaise, sa faune, « rebuts humains pathétiques de cette montagne » où les paumés, les truands en tout genre et de tous âges, les prostitués au grand cœur et les putes vénales, les flics véreux et les familles des taudis se mêlent, cohabitent tant bien que mal malgré l’énergique injonction maternelle administrée à Fernando d’étudier et de ne pas fréquenter les jeunes du quartier des Bicoques et du Taudis « aux regards et jeux féroces ».
Dans ce récit de la falsification et de la manipulation, Fernando fait d’abord figure du naïf aux côtés de Pépito, son aîné en galère et en expérience de la rue, qui détient, lui, toutes les clefs de cette histoire où le Watusi n’est peut-être qu’un bouc émissaire. Pour Fernando, la scène du pseudo procès se révèle une farce pour travestir la vérité : « je ne compris qu’à ce moment-là, et cette décision mentale allait me durer, Lecteur, presque toute ma vie, que c’était leur façon de faire, mettre en scène et insister jusqu’à ce que le plus bête et le plus courageux, se rendent compte. À partir de ce moment-là, quelle que soit la vérité, c’était cela qui allait être raconté et tous, pour notre bien, nous serions d’accord ». Une farce, mais une farce fondatrice qui devrait se rejouer dans les prochains épisodes de la vie de Fernando qui s’en va, avec sa mère, s’installer dans une loge de concierge à Barcelone même, loin des taudis.
Traduit de l’espagnol par Claude Bleton, éditions Actes-Sud, 280 pages, 19,80 € -
Lettre au président Bouteflika sur le retour des Pieds-Noirs en Algérie
Raphaël Draï
Lettre au président Bouteflika sur le retour des Pieds-Noirs en Algérie
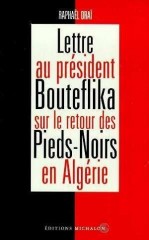 Dans sa lettre, Raphaël Draï, universitaire à Aix-Marseille né à Constantine dit l’espoir à n’en pas douter, mais, plus intéressant, esquisse les cadres d’une réconciliation et d’une fraternisation des différentes communautés algériennes, « juive, arabe, française » - ajoutons berbère, communauté par trop absente ici à l’exception de l’évocation rapide de Mouloud Feraoun et Matoub Lounès.
Dans sa lettre, Raphaël Draï, universitaire à Aix-Marseille né à Constantine dit l’espoir à n’en pas douter, mais, plus intéressant, esquisse les cadres d’une réconciliation et d’une fraternisation des différentes communautés algériennes, « juive, arabe, française » - ajoutons berbère, communauté par trop absente ici à l’exception de l’évocation rapide de Mouloud Feraoun et Matoub Lounès.
Après d’autres, ce juif Constantinois exilé depuis plus de quarante ans en dehors de l’Algérie, ne cache pas l’espérance suscitée par les déclarations de l’ancien ministre du président Boumediene. Notamment le discours présidentiel du 6 juillet 1999 prononcé à l’occasion du deux mille cinq centième anniversaire de l’antique Cirta et reproduit en annexe. Le président y soulignait, entre autres, l’importance de la présence et de l’apport de la communauté juive à cette cité et invitait à une relecture de l’Histoire expurgée de toutes manipulations idéologiques.
C’est donc dans la ville natale de l’auteur que ce discours fut prononcé. Cette ville où naquît et vécût Raymond Leyris, Cheikh Raymond. Le maître du malouf y fut assassiné et son évocation par Raphaël Draï est symbolique : « Raymond Leyris incarnait, personnifiait, la coexistence possible des dimensions juive, européenne et arabe de l’être algérien, par ailleurs tendu jusqu’à la dilacération ».
Mais l’espoir de Constantine demeurerait un leurre sans une réelle volonté politique et sans l’existence de cadres, clairs, acceptés par tous, pour permettre à chacun de se dire, d’entendre et de reconnaître l’autre sans se renier.
Dans ce livre émouvant de sincérité et de droiture, il dit son histoire. La petite comme la grande. Sa présentation du « naufrage tragique du système colonial » et le rôle attribué au général De Gaulle pourraient être discutés. Mais l’essentiel n’est pas là. «Toujours rétrospectifs, les travaux des historiens sont une chose. Ce qui est vécu dans l’immédiateté passionnelle par une population aux origines trop dispersées, à l’histoire trop récente pour être réfléchi et réflexif, en est une autre ». Après tout, il faut ouvrir les débats, dire les histoires et les parcours personnels, se comprendre les uns les autres, pour « panser les blessures du passé » et « construire l’avenir ».
« Les pays de naissance ne se renient jamais. On y demeure identifié, du nombril jusqu’au cerveau ». Voilà pourquoi, après quelques commentaires sur la terrible décennie passée, l’auteur écrit : « tant que vous serez en guerre, nous ne serons pas en paix. Mais cette paix ne peut se concevoir non plus et se parfaire tant que, du côté de l’Algérie, un travail de mémoire analogue et homologue ne sera pas véritablement engagé ». Précisant sa pensée, il ajoute : « le temps de l’idéologie post coloniale ne doit-il pas prendre fin ? » et, évoquant les jeunes générations algériennes, la quasi totalité de la population « celle qui a été soumise à l’uniformisation de son existence, de sa foi, de sa langue, parfois de ses vêtements », il interroge craintivement : « comment ces jeunes algériens conçoivent le retour de ces pieds-noirs et autres juifs d’Algérie ? ».
Poursuivant sa réflexion, il demande au président algérien si : « à présent, [nous ne devons pas] concevoir une formule identitaire vitale qui permette les conciliations intimes et l’ouverture sur ce que l’on n’est pas ? » Ce « remaniement des profondeurs » comme le nomme l’auteur - rappelant l’Amin Maalouf des Identités meurtrières - invite à rompre avec les logiques de divisions pour saisir et accepter les différentes composantes identitaires des uns et des autres.
« C’est à partir de cette réconciliation réussie que nos enfants, Monsieur le Président, construiront la nouvelle Méditerranée ». L’ambition est grande. Les
« dernières générations charnières » doivent aider à impulser une autre révolution. Pas celle des « systèmes abstraits, incontrôlables, invérifiables à vue humaine, à vie humaine », mais celle qui « doit affecter nos comportements ».
« Nous viendrons vers vous sans autre désir que celui de vous revoir écrit R. Dray. Notre absence a été très longue. (...) Un des chants les plus poignants du malouf déplore le ouah’ch, c’est-à-dire l’absence insupportée, celle qui ne vous laisse pas en paix, une absence présente. Lorsqu’elle n’est pas comblée, elle finit par vous rendre absent à vous-même, par vous faire vivre en marge de votre vie ».
Cette lettre sera-t-elle lue par son destinataire et avec lui par la classe politique algérienne ? Saura-t-il y répondre avec la même sincérité, le même désintérêt, la même fragilité ? Rien n’est moins sûr. R. Draï, bien éloigné des shows médiatiques algérois, esquisse les cadres de la réconciliation des mémoires et de la fraternisation des hommes. Reste la volonté politique. Sans esquiver les réelles difficultés et les sourdes mais efficaces oppositions, il n’est pas certain qu’elle existe en Algérie.
Edition Michalon, 2000, 141 pages -
Le Pied-rouge
François Muratet
Le Pied-rouge Ouvrez Le Pied rouge, vous le refermerez la dernière page lue. Pour son premier roman documenté et inspiré en partie de faits réels, justement récompensé du Prix Polar SNCF 2000, François Muratet signe là un coup de maître. Le livre baigne dans les remugles de la guerre d’Algérie et les souvenirs du gauchisme tendance mao des années soixante-dix. Il s’ouvre sur une scène doublement fondatrice. Frédéric, âgé de six ans, surprend une altercation entre son père et un inconnu. Alors qu’il cherche à s’interposer, dans la confusion et la mêlée, il reçoit un coup. À son réveil, il devine que la vie a quitté à jamais le corps qui gît à ses côtés. Scène doublement fondatrice car elle sera le terrible substrat émotionnel sur lequel Frédéric devra se construire et le point de départ d’une enquête qu’il mènera des années plus tard pour élucider la mort de son père.
Ouvrez Le Pied rouge, vous le refermerez la dernière page lue. Pour son premier roman documenté et inspiré en partie de faits réels, justement récompensé du Prix Polar SNCF 2000, François Muratet signe là un coup de maître. Le livre baigne dans les remugles de la guerre d’Algérie et les souvenirs du gauchisme tendance mao des années soixante-dix. Il s’ouvre sur une scène doublement fondatrice. Frédéric, âgé de six ans, surprend une altercation entre son père et un inconnu. Alors qu’il cherche à s’interposer, dans la confusion et la mêlée, il reçoit un coup. À son réveil, il devine que la vie a quitté à jamais le corps qui gît à ses côtés. Scène doublement fondatrice car elle sera le terrible substrat émotionnel sur lequel Frédéric devra se construire et le point de départ d’une enquête qu’il mènera des années plus tard pour élucider la mort de son père.
Entre temps, l’enfant refoule ce souvenir. Le traumatisme le laisse même un temps muet. Il grandit dans l’amnésie partielle, le non-dit et le mensonge entretenus par sa mère remariée. Mais, de profondes crises d’angoisse et des accès de violence inexpliquée rythmeront toute son existence.
Trente ans plus tard, en vacances à Paimpol avec Nadia, épouse délaissée par son chercheur de mari, Frédéric croise Max, l’ancien dirigeant de l’OCP, un groupuscule maoïste où il a milité. Max est alors un vieux militant qui a derrière lui la guerre d’Algérie, le militantisme des années soixante et soixante-dix, les causes internationales, le soutien aux Palestiniens et tant d’autres actions plus ou moins secrètes, troubles, clandestines.
Il est descendu dans le même hôtel que le couple d’amoureux. Comme il ne supporte pas le bruit, il a demandé à son ancien camarade de changer leurs chambres respectives. Dans la nuit, Max est sauvagement assassiné.
La police nationale, la presse mènent l’enquête, mais Frédéric veut aussi retrouver l’assassin de Max qui, au temps de l’OCP, a été son père spirituel.
Ses investigations exhument des souvenirs de la guerre d’Algérie où la victime a non seulement déserté mais choisit de devenir un « pied-rouge » c’est-à-dire de servir dans les rangs du FLN. Elles révèlent surtout que Max était toujours en activité. Frédéric croise les services peu amènes de la DST, ceux plus compréhensifs de l’Algérie. Il emprunte des chemins tortueux qui le conduisent au FIS et à un étrange complot où des islamistes s’acoquineraient avec une formation d’extrême droite. Les services de Franco et quelques barbouzes interfèrent.
François Muratet, professeur d’histoire en banlieue parisienne, est lui-même un ancien gauchiste. Son récit, où convergent quatre histoires, est parfaitement maîtrisé et jamais le lecteur ne cherche sa route ou ne s’ennuie. L’originalité est de coupler au genre politico-historique inspiré de faits réels une convaincante approche psychologique où la personnalité perturbée de l’enquêteur doit démêler un double imbroglio meurtrier. Le tout est mâtiné d’un soupçon d’exotisme et/ou de spiritualité où la pratique du kung-fu se prolonge par la mise en place d’une grille de lecture inspirée du jeu de go dont Frédéric est un amateur éclairé.
Edition Le Serpent à plumes, 1999, 261 pages. Réédité en poche chez Gallimard (Folio)