Maïssa Bey
Entendez-vous dans les montagnes...
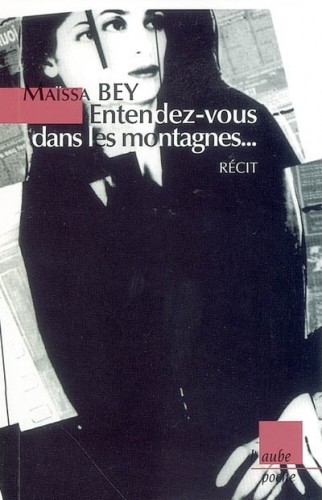 Évidemment, “Entendez-vous dans les montagnes... ” de Maïssa Bey résonne comme en écho aux paroles de Rouget de l’Isle et, d’un point de vue strictement national, les montagnes algériennes valent bien les campagnes françaises. Pourtant, dans ce court récit en partie autobiographique, où trois personnages partagent le même compartiment d’un train filant dans la nuit, le lecteur trouvera autre chose à moudre que la condamnation des exactions de l’armée française en Algérie et la posture morale qui l’accompagne et sied si avantageusement, et surtout si facilement aujourd’hui, à tout un chacun.
Évidemment, “Entendez-vous dans les montagnes... ” de Maïssa Bey résonne comme en écho aux paroles de Rouget de l’Isle et, d’un point de vue strictement national, les montagnes algériennes valent bien les campagnes françaises. Pourtant, dans ce court récit en partie autobiographique, où trois personnages partagent le même compartiment d’un train filant dans la nuit, le lecteur trouvera autre chose à moudre que la condamnation des exactions de l’armée française en Algérie et la posture morale qui l’accompagne et sied si avantageusement, et surtout si facilement aujourd’hui, à tout un chacun.
Les trois voyageurs ont tous à voir avec l’Algérie. La narratrice d’abord. Algérienne, réfugiée un temps dans l’hexagone pour souffler et respirer loin des massacres, mais déjà lasse de ce qu’en France, lorsqu’il est question de son pays, on ne retient que sa face sanglante renvoyant toujours au passé sa part de lumière. Face à elle, un vieil homme, plutôt engageant. Trop au goût de la première, perturbée d’abord par les questions de son importun interlocuteur, lui-même ancien combattant en Algérie. Avec eux, Marie. Jeune fille décontractée, écouteurs sur les oreilles, elle ne s’imagine la présence française en Algérie qu’à travers le seul souvenir des parties de pêche rapporté par son pied-noir de grand-père !
Si le nœud de cette histoire est l’évocation par la narratrice - et pour la première fois par l’auteur elle-même - de son père torturé et abattu par la soldatesque française, l’objet de la conversation, difficile et hachée, entre la fille de fellaga, l’ancien appelé et la petite-fille de pied-noir porte, mais entre les lignes, sur la confrontation des mémoires. Cette confrontation tourne au détriment du vieil homme. Par un jeu subtil, l’Algérienne, avec qui Marie va se solidariser, s’applique à acculer le vieil homme “au bord d’un gouffre” et à lui faire “perdre l’équilibre”.
Ce texte, certes sensible et chargé en émotions, peut paraître quelque peu décalé à l’heure où l’action des historiens et la multiplication des témoignages tendent à restituer un peu de complexité à cette page des relations franco-algériennes. Il semble même, en France du moins, que nombre d’acteurs de cette tragique histoire rompent avec cette “culture du silence” ici dénoncée. De ce point de vue, les personnages qui campent l’ex-appelé du contingent ou la descendante de pied-noir paraissent par trop caricaturaux.
Mais enfin on ne peut pas reprocher à Maïssa Bey de ne pas avoir pu placé toute l’Algérie coloniale dans un seul et unique compartiment de la SNCF !
Editions de l’Aube, 2002, 72 pages, 9,50€
BEY Maïssa
-
Entendez-vous dans les montagnes...
-
Sous le jasmin la nuit
Maïssa Bey
Sous le jasmin la nuit

L’univers romanesque de Maïssa Bey est sombre. Sombre comme un statut de femme algérienne. Sombre comme des blessures de l’enfance. Les femmes sont au cœur de dix des onze nouvelles de ce recueil. Femmes “ au corps jamais désiré seulement pris ”. Femme à qui l’homme, maître au pouvoir de répudiation, impose une seconde épouse. Femme qui pour devenir, une journée seulement, “ le centre du monde ” doit attendre l’heure de sa mort. Jeune fille qui va au mariage comme on mène une bête à l’abattoir et cette autre, toujours contrainte de louvoyer, de contourner, d’esquiver le mur syntaxique et péremptoire du “ parce que !”, cette réponse-injonction qui ponctue les refus et les interdictions familiales. Alors, il faut mentir. Mentir pour voler “ la peur au ventre ” quelques instants de liberté. Mentir jusqu’à trahir le langage. Jusqu’à se trahir. Cette autre gamine a quinze ans et déjà elle n’ignore rien de l’horreur, l’horreur de la barbarie islamiste. Enlevée, martyrisée et violée, elle porte le “ mal” et ne désire qu’une chose : mourir pour en finir avec la honte et le déshonneur, mourir pour en finir avec la nuit et le silence...
Les récits de Maïssa Bey ne cachent pas la part des rêves, les fuites hors du réel, les libertés prises pour échapper au joug du quotidien. Rêves d’amour ou de départ pour Sarah et pour ces sept sœurs qui, sur une terrasse, la nuit, énoncent à tour de rôle un vœux jusqu’au retour de l’aube. Quand résonne l’appel du muezzin, il est temps pour chacune de rentrer “ affronter le jour ”. Illusions portées jusqu’à la limite de la déraison face à une main de femme aperçue à la fenêtre d’un rez-de-chaussée. Main tendue que l’on voudrait saisir pour se raccrocher à la vie. Complicité secrète et charnelle de deux co-épouses qui transforment l’impossible cohabitation en une douce solidarité. En contrepoint des espaces publics réservés aux seuls hommes, les corps et les âmes des femmes restent pour les maris ou pour les fils, une inconnue, une interrogation, un vide insondable et angoissant. Enfin, La mort elle-même peut devenir libération.
La guerre d’Algérie, dans sa dimension humaine, s’insinue ici à travers un cahier d’écolier abandonné en 1962 dans un appartement de Belcourt. Marie avait dix-huit ans, elle y consignait en secret son amour pour Jean-Paul. Plus de quarante ans ont passé. Dans une Algérie secouée par une autre guerre, c’est au tour de Sarah d’avoir dix-huit ans. À travers ce cahier, à travers les confidences de Marie, elle vit par procuration ce chant d’amour, ce chant d’amour qu’elle espère et qui pourtant jamais ne résonnera en elle, ne serait-ce qu’un instant pour l’aider à supporter ce qui l’attend.
Edition De l’Aube-Barzakh, 2004, 155 pages, 14 €
Illustration : Femmes d'Alger dans mon appartement, huile sur toile, Gilles Chambon, 2009 -
Bleu blanc vert
Maïssa Bey
Bleu blanc vert
Maïssa Bey s’est attelée à un difficile pari : faire revivre trente années de l’histoire algérienne à travers l’amour de Lilas et d’Ali. En 1998, dans Les Amants désunis, Anouar Benmaleck tissait déjà le tableau de la société algérienne en remontant cette fois jusqu’à la présence coloniale grâce au fil ténu d’un autre amour, celui unissant dans un siècle tourmenté un Algérien et une Suissesse.
Tâche ardue que de restituer l’histoire sociale et politique, depuis 1962 jusqu’en 1992, sans tomber dans un pathos démonstratif ni réduire la consistance des personnages à une peau de chagrin informe. Globalement, Maïssa Bey évite ces deux écueils et signe là peut-être le premier roman de l’Algérie indépendante : depuis les premiers jours de l’indépendance jusqu’aux années quatre-vingt-dix, depuis l’euphorie des premières heures d’un pays retrouvé et gorgé d’un soleil prometteur, jusqu’à la nuit noire qui s’est abattue sur une terre inondée de larmes et devenue rouge du sang des innocents. Premier roman de l’Algérie indépendante parce qu’à la différence des autres et nombreux romans algériens qui n’en finissent pas de disséquer l’histoire contemporaine et lointaine de l’Algérie, Bleu blanc vert - tout un symbole déjà de la volonté de l’auteur dans le titre - revisite quasi chronologiquement les grands moments et les événements de son pays.
Quand Maïssa Bey utilise le grand angle, les grandes avenues de l’Histoire défilent, une histoire rythmée en trois temps : les espoirs de la première décennie d’abord, « l’ombre de la grande désillusion » qui se profile dans les années soixante-dix ensuite et enfin la descente aux enfers, provoquée par un FLN devenu « le parti honni de tous » et des islamistes de plus en plus exigeants et semeurs de peur.
Quand elle se sert d’une focale plus réduite et parfois de la loupe elle est alors au plus près des êtres, de leur quotidien, de leurs espoirs et de leurs souffrances souvent cachées. On retrouve ici la Maïssa Bey intime et sensible, capable de rendre l’intériorité de ses personnages. Celle des femmes bien sûr. Il y a Lilas, mais aussi sa mère, veuve qui seule a élevé ses enfants ou la mère d’Ali, épouse délaissée puis abandonnée par son mari devenu un de ces dignitaires du régime qui se sont appropriés la révolution, le pays et le peuple. « Quand donc l’ambition et la cupidité ont-elles dénaturé le sens qu’il voulait donner à sa vie en s’engageant pour défendre le droit à la liberté de tout un peuple ? Et qu’a-t-il bien pu se passer pour que ces idéaux si chèrement défendus soient aujourd’hui dévoyés à ce point ? » se demande Ali à la mort de son père. Ces pères « auraient-ils failli » ?
Mais, peut-être est-ce une nouveauté dans son œuvre, Maïssa Bey donne ici consistance à un personnage masculin, Ali, décrivant avec vraisemblance et sans caricatures, ses interrogations, ses paradoxes et ses quêtes.
Le récit est rythmé par les perceptions différentes d’Ali et de Lilas. Regards portés in petto par un homme et une femme donc sur la société et leur vie commune. Lui est avocat, témoin des violations des droits de l’homme et des droits politiques ou des dénis identitaires. Elle est psychologue, témoin d’une société malade, au plus proche de la détresse et des dérèglements humains. Chacun raconte les ressorts d’une histoire familiale sur trois générations, et surtout leur amour. Exceptionnel amour peut-être parce qu’unissant deux être libres, jamais entravés par le poids des convenances et des traditions, et respectueux de la liberté de l’autre. Malgré les aléas de la vie à deux…
Il n’est pas question de revenir ici sur cette chronologie, ce compte à rebours tragique qui fait que, « plus nous avançons, plus nos rêves s’éloignent » dit Lilas. D’ailleurs l’essentiel n’est peut-être pas là. Maïssa Bey montre le quotidien déliquescent, les adaptations et les transformations des Algériens eux-mêmes. Elle montre surtout que ces trois couleurs nationales exigent la participation de tous, hommes et femmes et s’interroge dès lors : « comment toute une société peut-elle fonctionner et s’organiser en faisant totalement l’impasse sur un sentiment aussi essentiel, aussi beau que l’amour ? ».
Pourtant s’il faut parfois, dans des moments de détresse et de doute « se délester de l’insoutenable légèreté des rêves », pour Ali et Lilas, personne en Algérie ne parviendra à « assassiner l’espoir ».
Edition de l’Aube, 2006, 284 pages, 19,50 €