Leïla Djitli
Lettre à ma fille qui veut porter le voile
 Nawel a 17 ans et annonce à sa mère Aïcha qu'elle entend désormais porter le voile. Aïcha décide de lui écrire une longue lettre. L'idée de ce livre présenté comme un "docu-fiction" est née du travail en banlieue de la journaliste Leïla Djitli. À travers la voix d'Aïcha, c'est la parole d'une femme qui s'est battue en Algérie, au nom de la liberté, qui se donne à entendre ici, mais c'est surtout la parole d'une mère, intime, aimante, blessée, une mère qui voit s'écrouler ce qu'elle a bâti, avec constance et patience, pour et autour de sa fille, consciente sans doute de la fragilité de la construction. Là est l'originalité de cette lettre : des mots que l'on entend rarement sur les tribunes publiques à commencer par cette fêlure : "Mais, jamais comme aujourd'hui, je ne me suis sentie si loin de toi. Jusque-là, j'ai toujours trouvé les mots, recollé les morceaux, renoué notre complicité. Aujourd'hui, c'est différent, c'est comme une crevasse au beau milieu de la maison...".
Nawel a 17 ans et annonce à sa mère Aïcha qu'elle entend désormais porter le voile. Aïcha décide de lui écrire une longue lettre. L'idée de ce livre présenté comme un "docu-fiction" est née du travail en banlieue de la journaliste Leïla Djitli. À travers la voix d'Aïcha, c'est la parole d'une femme qui s'est battue en Algérie, au nom de la liberté, qui se donne à entendre ici, mais c'est surtout la parole d'une mère, intime, aimante, blessée, une mère qui voit s'écrouler ce qu'elle a bâti, avec constance et patience, pour et autour de sa fille, consciente sans doute de la fragilité de la construction. Là est l'originalité de cette lettre : des mots que l'on entend rarement sur les tribunes publiques à commencer par cette fêlure : "Mais, jamais comme aujourd'hui, je ne me suis sentie si loin de toi. Jusque-là, j'ai toujours trouvé les mots, recollé les morceaux, renoué notre complicité. Aujourd'hui, c'est différent, c'est comme une crevasse au beau milieu de la maison...".
Bien sûr, Aïcha dit sa colère contre "les fous de Dieu", contre l'instrumentalisation du voile, contre les échecs de la République. Elle explique à sa fille ce que ce triste tissu signifie. Elle tente de lui parler de la tolérance dont est aussi porteur le Coran, la place que tenaient hier l'école et l'éducation chez les aînées. Elle cherche à l'aider à se dépatouiller avec ces notions-pièges que sont l'identité et les origines. Mais le plus juste, le plus émouvant, ce ne sont pas ces arguments (par ailleurs connus), mais le vacillement, la fragilité, le désarroi provoqués par cette fracture existentielle et, malgré tout, les mots d'amour d'une mère pour sa fille, unique à ses yeux, unique aux yeux de la création elle-même. A contrario de cet amour bien réel, les propos d'Aïcha révèlent la logique du voile : un islam abstrait, une communauté désincarnée et robotisée, la négation de l'individualité de chacun pour l'asservissement de tous. "Confusément, je te sens, je nous sens, toutes les deux, tomber dans un piège", dit Aïcha qui explique à sa fille que sa propre mère, sa propre grand-mère n'ont jamais porté le voile. Qu'il s'agit là d'une "greffe". Une "greffe" rendue possible par une éducation faite "dans le silence" empêchant la transmission d'une mémoire et d'une histoire familiale, empêchant l'établissement d'une filiation. C'est avec des mots de mère qu'elle fait comprendre la signification du voile : "ton voile, devant mes yeux, nie l'histoire, mon histoire, celle de mes parents, les cinquante années de vie qui se sont écoulées avant toi. Il nie le déroulement du temps, ce temps que nous avons vécu, éprouvé, passé. Il nie la réalité de l'exil qui nous précède. Il réduit tout cela à zéro."
Et c'est encore et toujours en mère qu'elle tend la main : "Quoi qu'il m'en coûte, je préfère te voir voilée plutôt que de ne plus te voir du tout." Dans cette relation à deux, on se prend à rêver la présence d'un Salomon pour rendre justice à celle qui n'ignore pas le sens du mot aimer...
Edition La Martinière, 2004, 126 pages, 10 €
islam
-
Lettre à ma fille qui veut porter le voile
-
Racaille
Karim Sarroub
Racaille
 Sans vouloir médire de Gide, il n’est pas certain que l’on ne puisse pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments ; mais d’évidence on ne fait pas un bon livre en accumulant des poncifs, même de bon aloi, mâtinés de vérités assenées à la hussarde et d’inutiles provocations. C’est malheureusement l’impression que laisse Racaille après en avoir fini la lecture. Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’auteur, qui semble plus qu’estimable, ni ses prises de position qui pour être parfois exagérées renferment aussi leur part de vérité et de courage (on pense à Taslima Nasreen, à Mina Ahadi en Allemagne ou Chahdortt Djavann en France). Non ! le hic concerne d’abord et exclusivement la littérature. On ne croit pas à cette histoire qui voit un certain Mohamed s’échapper de l’asile d’aliénés dans lequel il est enfermé et, après un passage par Skikda (sa ville), Constantine puis Alger, embarquer clandestinement pour la France où, l’infortuné retournera à la case départ. Pourtant ce Mohamed a une savoureuse idée : créer une association humanitaire et rapatrier en Algérie « les Juifs, les harkis et les bons pieds-noirs, sauf un », dont on taira ici volontairement l’identité. Cette idée bien sûr ne peut que le rendre suspect aux yeux des gardiens de la loi et de la foi.
Sans vouloir médire de Gide, il n’est pas certain que l’on ne puisse pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments ; mais d’évidence on ne fait pas un bon livre en accumulant des poncifs, même de bon aloi, mâtinés de vérités assenées à la hussarde et d’inutiles provocations. C’est malheureusement l’impression que laisse Racaille après en avoir fini la lecture. Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’auteur, qui semble plus qu’estimable, ni ses prises de position qui pour être parfois exagérées renferment aussi leur part de vérité et de courage (on pense à Taslima Nasreen, à Mina Ahadi en Allemagne ou Chahdortt Djavann en France). Non ! le hic concerne d’abord et exclusivement la littérature. On ne croit pas à cette histoire qui voit un certain Mohamed s’échapper de l’asile d’aliénés dans lequel il est enfermé et, après un passage par Skikda (sa ville), Constantine puis Alger, embarquer clandestinement pour la France où, l’infortuné retournera à la case départ. Pourtant ce Mohamed a une savoureuse idée : créer une association humanitaire et rapatrier en Algérie « les Juifs, les harkis et les bons pieds-noirs, sauf un », dont on taira ici volontairement l’identité. Cette idée bien sûr ne peut que le rendre suspect aux yeux des gardiens de la loi et de la foi.
Évidemment, pour Mohamed, c’est l’Algérie qui est devenue folle et, s’il ne s’agit pas de revenir en arrière (que les nostalgiques de l’Algérie de papa ne piaffent pas), du moins serait-il temps de réparer le gâchis. Iconoclaste à souhait, Mohamed inscrit d’ailleurs sur le monument aux morts érigé sur les hauteurs d’Alger : « De Gaulle, on t’a bien pourri la vie et repris l’Algérie de force, n’est-ce pas. Mais, gros malin, si tu voyais l’état du pays aujourd’hui… une vraie poubelle. Pour ça, chapeau, tu as su te venger et tu continues encore à te venger des décennies après. Tu n’aurais pas pu faire pire, tu sais… ». Jusqu’ici l’histoire pourrait fonctionner mais la démonstration pêche par l’inconsistance des personnages (Mohamed et son pote Mustapha ou encore la veuve de Boudiaf, le vieux moudjahid, Moh l’immigré, Alexandre, etc.) et l’enfilade des dénonciations (la barbarie de la circoncision, l’islam, les terroristes, le pouvoir algérien, l’antisémitisme, la discrimination dont sont victimes les Kabyles en Algérie ou les « Beurs » en France, le sexisme et autre misère sexuelle…) comme si l’auteur avait été emporté par ce qu’il avait sur le cœur. Un trop plein de silences et de souffrances. L’empathie peut jouer, mais le lecteur reste sur sa faim. Quand il n’est pas surpris voir interloqué.
Ainsi Karim Sarroub veut sans doute faire son Houellbecq quand il affirme d’entrée : « je m’appelle Mohamed, j’ai seize ans (…), je déteste les religions surtout l’islam (…) ». Le ton est ainsi donné, mais il n’est pas certain que cette charge sans discernement (c’est du moins l’impression qui se dégage) fasse mouche. D’autant plus quand le livre apostrophe les « intellectuels arabes » pour leur manque de courage quand il est question d’islam. Voilà qui est faire peu de cas des Abdelwahab Meddeb, Maleck Chebel ou Fethi Benslama (pour en rester à la France), et des critiques émises au sein même de l’islam (voir par exemple Ghaleb Bencheikh et son frère Soheib) ou des perspectives ouvertes par certains penseurs rationalistes (Mohamed Arkoun ou Youcef Seddik)
Reste que sur cette question religieuse, notre Mohamed, s’adressant à Moh, ci-devant immigré de Lille, voit juste : « Vous savez ce que vous êtes, là-bas [en France] ? La communauté musulmane. L’islam. En France, on vous appelle les musulmans. C’est scandaleux. C’est pire que racaille. Vous nous faîtes franchement pitié. Si ce n’est pas ça le mépris, mon vieux, faudra me l’expliquer ». Zahia Rahmani laissait entendre la même chose dans son Musulman, roman paru en 2005 chez Sabine Wespieser. Voilà qui est sûrement plus pertinent que de céder à cette facilité qui consiste à comparer les banlieues aux ex-colonies ou de prédire que, demain, les « beurs » reconnaîtront la France pour leur patrie. Ils le savent et depuis longtemps a t-on envie de rappeler. C’est n’est plus eux qu’il faut convaincre mais ceux qui traitent ces « beurs » de « racailles » avec qui Mohamed le clandestin ne veut surtout pas être confondu…
Edition Mercure de France, 2007, 155 pages, 14 €
-
Le Livre de l’Emir
Waciny Laredj
Le Livre de l’Emir
 L’émir Abdelkader n’en finit pas d’inspirer historiens et poètes. Après les volumineuses biographies que lui ont consacré Bruno Etienne (chez Hachette en 1994) et Ramdane Redjala aidé de Smaïl Aouli et Philippe Zoummerof (chez Fayard en 1994), ce fut au tour de Kebir Ammi de se pencher sur le père du nationalisme algérien pour mettre en valeur sa dimension spirituelle et mystique (1). Ainsi, en une dizaine d’années, quelque mille cinq cents pages ont été écrites sur l’Emir et le lecteur pouvait se demander ce qu’il pourra trouver de nouveau dans le pavé publié par l’Algérien Waciny Laredj, auteur d’une dizaine de romans et d’essais dont La Gardienne des ombres ou Les Balcons de la mer du Nord.
L’émir Abdelkader n’en finit pas d’inspirer historiens et poètes. Après les volumineuses biographies que lui ont consacré Bruno Etienne (chez Hachette en 1994) et Ramdane Redjala aidé de Smaïl Aouli et Philippe Zoummerof (chez Fayard en 1994), ce fut au tour de Kebir Ammi de se pencher sur le père du nationalisme algérien pour mettre en valeur sa dimension spirituelle et mystique (1). Ainsi, en une dizaine d’années, quelque mille cinq cents pages ont été écrites sur l’Emir et le lecteur pouvait se demander ce qu’il pourra trouver de nouveau dans le pavé publié par l’Algérien Waciny Laredj, auteur d’une dizaine de romans et d’essais dont La Gardienne des ombres ou Les Balcons de la mer du Nord.
Roman historique, Le Livre de l’Emir court de la pénétration militaire française dans ce qui deviendra l’Algérie jusqu’au départ de l’Émir pour l’Orient, après avoir été pendant cinq années prisonnier de la France à Toulon d’abord puis à Pau et Amboise. Exit ici les années de formation du jeune Abdelkader même si son goût pour la mystique et la sagesse embaume chacune des pages de ce récit, exit aussi l’épisode syrien qui a vu l’exilé algérien et les siens sauvé avec courage des milliers de chrétiens promis à la mort par des foules fanatisées.
Waciny Laredj offre, pour la première fois, selon son éditeur, une version romanesque de l’épopée abdelkaderrienne. Si quelques longueurs et répétitions sont sans doute à déplorer, le texte suit au plus près l’histoire de la guerre (cette « charge acceptée sans l’avoir désirée ») menée par l’Émir face à l’envahisseur français. Événements, batailles, négociations, victoires, défaites, ralliements et autres trahisons sont relatés par le menu.
L’originalité du livre du professeur de littérature moderne installé en France depuis 1994 est double. Tout d’abord, il inscrit la vie de l’Emir en vis-à-vis d’un autre parcours singulier de la conquête française. Celui de Monseigneur Dupuch, le premier évêque d’Alger, présenté comme l’ami et même l’alter ego en humanité de l’Émir depuis ce 19 mai 1841 où, grâce aux deux hommes, il fut procédé à un premier échange de prisonniers. Plus tard, alors que la France prive l’Émir de sa liberté, en violant sa promesse de lui permettre de s’établir en terre musulmane, Monseigneur Dupuch visitera plusieurs fois l’illustre prisonnier. Avec lui, il s’entretiendra de religion et cherchera à éclaircir certains drames de la conquête. Les dialogues, un brin ampoulés, laissent de temps à autre, exhaler quelques relents de bondieuserie qui pourraient chatouiller les narines sensibles de certains lecteurs. Quoi qu’il en soit, Monseigneur Dupuch ne ménagera pas ses efforts pour plaider en faveur de sa libération. Ce qui dans le roman est présenté comme la rédaction d’une lettre est en fait un livre achevé le 15 mars 1849 intitulé Abd el-Kader au château d’Amboise dans lequel l’homme d’église défend l’honneur du prisonnier et se porte garant de sa loyauté. À sa libération, l’Emir rendra hommage à l’action de Monseigneur Dupuch : « c’est toi le premier Français qui m’ait compris, le seul qui m’ait toujours compris. Ta prière est montée vers Dieu ; c’est Dieu qui a éclairé l’esprit et touché le cœur du grand prince qui m’a visité et rendu libre. »
L’autre originalité du Livre de l’Emir trouve sa source en terre algérienne. Waciny Laredj revient plusieurs fois sur les desseins de l’émir Abdelkader d’en finir avec le tribalisme, les divisions, l’arbitraire et les violences pour mettre sur pied un véritable État. Insistant sur la nécessité de « changements radicaux dans la vie de la société et la conduite des affaires », il montre, comment dans l’esprit du pieux musulman, la religion ne suffira pas à établir les conditions de l’unité, de la centralisation et de la stabilité (« la religion rassemble, mais elle divise aussi »).
En ressuscitant la figure d’Abdelkader, Waciny Laredj adresse un double message à ses contemporains. À la France - et à quelques musulmans - il semble dire, ne vous méprenez pas sur une religion et ses fidèles et préférez l’héritage d’Ibn Arabi à celui d’Ibn Taymiya. Aux adeptes de la supériorité d’une civilisation, d’une culture ou d’une foi (le colonialisme hier, l’intégrisme religieux aujourd’hui) il rappelle que « la certitude de posséder la vérité aveugle et conduit à la perdition ».
Aux Algériens, toujours englués dans les soubresauts inquiétants d’une interminable fin de guerre civile et privés depuis des décennies d’un véritable État de droit et d’une véritable démocratie, il montre que « le temps où nous prenions le bien des gens sans en avoir le droit est révolu. Avec les tribus, nous formons un seul corps et nous faisons partie de la même chair ; la fraternité nous lie pour le meilleur et pour le pire ».
Liberté (pour les Algériens et pour l’Emir), égalité (des peuples, des croyances et des cultures) fraternité (entre les Algériens et entre les peuples) le triptyque républicain perce sous la figure de l’Émir. Entre l’implacable sauvagerie de la conquête coloniale et les affres de l’exil, Waciny Laredj montre bien une autre actualité de l’œuvre et du message de l’Émir.
(1) Abd el-Kader, Presse de la Renaissance, 2004
Traduit de l’arabe (Algérie) par Marcel Bois en collaboration avec l’auteur, Edition Sindbad-Actes-Sud, 2006, 544 pages, 25 €
-
Rose noire sans parfum
Jamel Eddine Bencheikh
Rose noire sans parfum
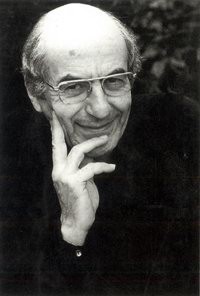 Jamel Eddine Bencheikh, universitaire, poète, traducteur, essayiste, intellectuel de renom qui n’hésitait pas à prendre part aux débats de son temps, s’adonna, avec Rose noire sans parfum, à un nouvel exercice : le roman .
Jamel Eddine Bencheikh, universitaire, poète, traducteur, essayiste, intellectuel de renom qui n’hésitait pas à prendre part aux débats de son temps, s’adonna, avec Rose noire sans parfum, à un nouvel exercice : le roman .
L’échappée littéraire ne doit pas faire illusion. Si J.E.Bencheikh s’était penché sur une histoire lointaine ce n’était que pour mieux se rapprocher de ses contemporains et donner sens à un monde moderne sans ordre apparent.
Rose noire sans parfum est un roman polyphonique à cheval sur le IXe et le XXe siècle. J.E.Bencheikh brosse avec minutie, dans le scrupuleux respect des récits anciens, et sous des angles multiples, l’histoire d’une révolte d’esclaves noirs au IXe siècle dans l’actuel Irak. Dirigé par un certain Ali, fils de Yahya, la révolte est d’importance. Les insurgés parviennent à couper l’empire abbasside en deux, s’emparent et ravagent plusieurs villes comme Bassorah, al Ahwaz et Wasit, règnent sur le Khazistan et menacent même Baghdad.
J.E.Bencheikh, dissèque les ressorts psychologiques et historiques de l’action, les dessous d’une mobilisation et de l’engagement au nom de Dieu.
Il dévoile le pacte qui va lier les esclaves Zandjs à celui qui se prétend sixième descendant en ligne directe de Ali, le cousin et gendre du prophète : « j’ai besoin d’hommes, les hommes que j’ai ont besoin de Dieu, Dieu a fixé les termes du contrat, Il exige que je le remplisse. Je n’ai plus qu’à mettre en contact l’Un et les autres ».
Sur l’étendard il fait inscrire le verset 8 de la sourate 9 (Le repentir). Un verset qui « annule le passé des hommes et les appelle à mériter leur avenir » et d’ajouter : « A moi qui ose abattre leurs maîtres, il ne peuvent que remettre leur puissance. Puisqu’ils me doivent tout, ils me donneront tout. Ils ne raisonnent pas assez pour penser autrement, et d’ailleurs ils ne pensent pas, ils attendent ».
La révolte sera d’abord victorieuse avec pour point d’orgue la prise de Bassorah, ville de « savoir et de culture » qui « mit la raison au service de la foi » grâce à An Nazzam et aux mutazilites. Bassorah la ville d’al Djahiz, d’Abu Nuwas ou encore d’Ibn el Muqaffa’ - celui qui prôna la subordination de la Shari’a à l’autorité politique - tombe. Elle est ravagée, suppliciée par cette armée d’anciens esclaves. Les historiens et autres chroniqueurs dressent un bilan de 300 000 morts et 15 000 maisons brûlées. Mais aux yeux des survivants que vaut ce froid bilan chiffré : « nous savons bien, nous autres survivants que quelque chose de profond a cédé. Une menace mortelle a surgi, venue de loin. Elle ronge ce monde et n’arrêtera pas de le ronger ».
Les horreurs et abominations rapportées par l’auteur n’ont rien d’exceptionnelles dans l’histoire de l’humanité. J.E.Bencheikh se plait à le rappeler. Mêlant sa voix à celles de ces personnages - quand il ne la leur prête pas ou qu’il n’emprunte pas la leur - il égrène les morts de Srebrenica, les 15 millions de massacrés en 40 ans aux Indes, les récits de Las Casas sur la soumission du Mexique et du Pérou... : « Ah, théâtre de sang et de rire, violence par delà, violence en deçà ! ».
Comprendre le pourquoi, le mécanisme même de ce déchaînement de violence semble être l’une des interrogations de l’auteur. J.E.Bencheikh dissocie alors chez le Maître des Zandjs le « je » du « il », le « je » du « prophète » devenu chef d’une révolte qui pourrait, au nom de Dieu, faire vaciller l’empire abbasside. Le récit prend alors des allures d’étude psychologique où J.E.Bencheikh décrit avec force le lent dédoublement de la personnalité, la lente dépossession de soi, d’oubli et de mutilation du « je » au profit d’une « forme » en émergence qui finira pas acquérir une totale "liberté".Edition Stock, 1998, 265 pages.