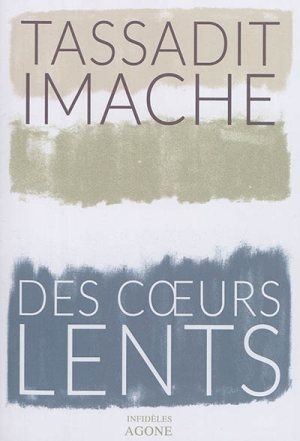Tassadit Imache, Des cœurs lents
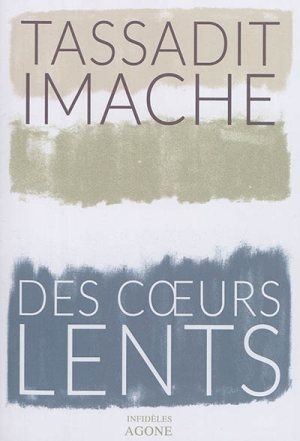 Depuis Une fille sans histoire paru en 1989, Tassadit Imache a publié quatre romans : Le Dromadaire de Bonaparte (1995), Je veux rentrer (1998), Presque un frère (2000) et Des nouvelles de Kora (2009). Dans Une fille sans histoire, elle brosse le portrait d’une gamine née en pleine guerre d’Algérie d’un père algérien et d’une mère française. Récit de trajectoires franco-algériennes mêlées. Depuis, elle interroge le devenir de ces bâtards nés de couples mixtes, ballotés par les vents de l’histoire ; rejetons du populo doublement frappés par les exclusions et les injustices, guettés - quand ils n’y succombent pas - par la dépression. Tassadit Imache explore ces nœuds de la société française et de l’histoire qui étranglent, laissent sans voix, aussi muet qu’invisible. Ou le cœur lent.
Depuis Une fille sans histoire paru en 1989, Tassadit Imache a publié quatre romans : Le Dromadaire de Bonaparte (1995), Je veux rentrer (1998), Presque un frère (2000) et Des nouvelles de Kora (2009). Dans Une fille sans histoire, elle brosse le portrait d’une gamine née en pleine guerre d’Algérie d’un père algérien et d’une mère française. Récit de trajectoires franco-algériennes mêlées. Depuis, elle interroge le devenir de ces bâtards nés de couples mixtes, ballotés par les vents de l’histoire ; rejetons du populo doublement frappés par les exclusions et les injustices, guettés - quand ils n’y succombent pas - par la dépression. Tassadit Imache explore ces nœuds de la société française et de l’histoire qui étranglent, laissent sans voix, aussi muet qu’invisible. Ou le cœur lent.
Elle explore, méthodiquement ; patiemment ; implacablement ; les effets et interactions du culturel, de l’histoire, du social et du psychologique. L’histoire renvoie à la guerre d’Algérie, au racisme désormais feutré mais hérissés de préjugés de plus en plus tranchants, acérés, pointus. Le social évoque les injustices, la relégation, la marginalisation. Ses personnages ce sont ces réprouvés des histoires nationales, des structures mentales et sociales qui n’en finissent pas d’emprisonner des hommes et des femmes derrière les barbelés d’une pensée sèche, indifférente ou haineuse. L’Histoire et l’intime donc, où comment la première peut broyer les âmes et les corps et comment le second peut s’extraire d’un combat inégal. Ou pas.
« Une tâche impossible m’occupe : sculpter la phrase qui contiendra une chose sans avoir voué au néant son contraire »
Comme souvent chez Tassadit Imache, l’expression est implacable. Des cœurs lents est un court roman, ramassé comme le sont les phrases, sans doute travaillées et retravaillées pour extraire des mots ce si particulier suc. Ici, la brièveté ne masque pas le vide d’une pensée passe-partout et tout-terrain, un copier-coller de moraline et d’égo. Cette concision, d’une étonnante densité, condense en partie les choix littéraires de l’auteur et sans doute son expérience – biographique bien sûr mais aussi professionnelle (assistante sociale). Brève, dense, lapidaire, la phrase ne revêt pas pour autant la grise vareuse ou le raide uniforme, mais plutôt l’habit, chamarré et mobile, d’Arlequin. Une densité tout en couleurs, en variations, en mouvement, jamais univoque.
Car il faut lire Tassadit Imache avec en tête cette phrase extraite d’ « Ecrire tranquille » (Esprit, 2001) : « Une tâche impossible m’occupe : sculpter la phrase qui contiendra une chose sans avoir voué au néant son contraire ». Alice Zéniter vient d’offrir une variation du thème en écrivant à propos de certaines situations, circonstances ou « états », « que l’on ne peut pas décrire comme ça, (…) des états qui demanderaient des énoncés simultanés et contradictoires pour être cerné ». Dans Des cœurs lents, le propos comme les existences balancent, sur le fil du rasoir, instables, insécures, fragiles. Créatifs ou vaincus. Imache fraye dans les interstices de ces existences tourmentées, là où les âmes tristes et les corps mutilés se raidissent, s’enragent, cèdent. Ou se révoltent.
« Tout ce temps, ils n’avaient été qu’en liberté surveillée »
Une fois de plus, Tassadit Imache raconte une histoire de famille. Sur trois générations. Une histoire où les femmes (sup)portent tantôt le poids des héritages tantôt les dynamitent (ah ! le regretté Kateb Yacine). Femmes comme autant d’atomes de vie aux trajectoires faites de bifurcations, de clinamen existentiel créateur de nouvelles généalogies.
Le roman s’ouvre sur des perruches enfermées dans une cage portée par François. Il est avec sa sœur, Bianca. Le frère et la sœur s’étaient perdus, évités. Ils se retrouvent dans « cette ville de riches pour les riches », où Tahir, le marginal, le paumé, le cadet est venu s’enterrer ; et mourir. Rien de mieux en littérature que la mort d’un proche pour « faire revenir l’enfance ». C’est le temps du bilan. On fait ou règle les comptes. On est rattrapé par une histoire que l’on a tenue à distance, cherchée à oublier (citons notamment Nadia Berquet (La Guerre des fleurs), Martin Melkonian (Arménienne), Abdelkader Railane (Chez nous ça s'fait pas) ou Boualem Sansal (Rue Darwin). L’histoire revient avec d’autant plus de violence qu’on s’est efforcé, sur plusieurs générations, de l’enfouir et de la fuir : « Tout ce temps, ils n’avaient été qu’en liberté surveillée » écrit Imache.
Quinze ans plus tôt, Marceline - alias Iris - a abandonné ses trois enfants. Besoin de prendre l’air. D’aimer. D’être aimer. « Une question de vie ou de mort ». L’explication est confuse et Imache construit son roman sur ce flou. Laisse le lecteur avec ce qui - lecture par trop moraliste sans doute – ressemble à une faute. Une culpabilité. François et Bianca se charge de Tahir. Le premier renonce aux Beaux-Arts, quand la seconde poursuit des études supérieures. Le sacrifice sera finalement libérateur pour l’un quand le succès de l’autre restera empreint de culpabilité et d’angoisse. Les regrets et le ressentiment n’aident pas à s’abstraire d’une enfance difficile. Tahir, celui qui sur les photos de famille a l’air d’un immigré, celui qui porte un prénom autre, « qui détonne », « le préféré de maman » va sombrer dans la dépression, la délinquance, la drogue. Faisait-il seulement partie de la famille ce môme à la gueule et au prénom de bicot ? « Titi avait toujours eu peur de ne pas faire partie de la famille. »
Il faut alors remonter le fil de cette chaotique histoire familiale, remonter jusqu’à cette rencontre au Jardin des Plantes à Paris de deux solitudes, celle d’une jeune bretonne débarquée dans la capitale et d’un immigré kabyle « qui portait bien sa casquette de prolo français la semaine ». « C’était pendant la dernière guerre coloniale de la France ». Une guerre « sans le sourire de Gandhi. A la balle, au couteau, puis au napalm. » Marie Chesneau et Mohammed Irraten deviendront les improbables grands parents des trois gamins. A l’origine de cette famille française, il y a « une soif de justice et une soif d’amour entrecroisées par hasard. Voyez-vous, le bicot ne savait rien de la justice. Marie ne savait rien de l’amour (…) ». Histoire d’une rencontre donc. Histoire d’un gâchis aussi fait de manques et de silences. D’absences et de vides. D’enfermements. D’émancipations aussi.
L’Algérien va grever « seul à l’hôpital avec son nom. C’est qu’on ne les aimait pas beaucoup dans nos hôpitaux à cette époque, les Maghrébins ». Quant au père des gamins, Marco Jean, pupille de l’Etat, né sous X « on ne connaîtrait jamais ses origines », il se tue dans un accident de moto, laissant Marceline avec trois orphelins. Les hommes ne vivent pas longtemps ici. Ou sont absents. Répétitions généalogiques : orphelins de père sur trois générations. Sentiment d’injustice, manque d’amour, invisibilité, bâtardise, font les cœurs durs, lents, les bouches également lentes et les langues lourdes. Des êtres « fermés mais fiers », préférant « la vérité aux sentiments ». On se refile la peur de la misère de mère en fille et l’on hérite d’une colère dont on ignore l’origine, mais voilà, « de branche cassée en branche cassée, de trou en trou, on vous y pousse dedans… la dépression. »
« Elle a peur : ça a recommencé. Elle est de nouveau dans l’Histoire »
Depuis quinze ans au moins, François et Bianca n’ont pas revu leur mère. Viendra-t-elle seulement à l’enterrement ? Le flou qui entoure Marceline s’estompe alors, progressivement. Imache dessine les contours d’une réalité plus complexe. Insoupçonnée. Le lecteur découvre une femme rongée, tourmentée, révoltée, triste. Hantée par un cauchemar et par une question qu’elle ne posera jamais à Marie, sa mère : « et si c’était à refaire ? ». Et pourtant, Marceline inscrit ses pas dans les presque invisibles traces laissées par son père, Mohammed Irraten, elle en revendique, jusqu’à la confusion parfois, sa part ou sa charge d’héritage. Si elle a d’abord donné à ses deux premiers enfants « une identité sans arabesques ni circonvolutions », c’est par fidélité qu’elle appelle son dernier Tahir… « Si j’avais su la suite, je l’aurais appelé Toni – avec ses yeux de biche, sa peau dorée, ses boucles italiennes, il avait toutes les chances devant lui. » Marceline, qui se fait appelé Iris, qui signe ses cartes postales Fatma, recommande d’aller voir Elise ou la vraie vie : « c’est une preuve. Comme le radeau de la Méduse au Louvre ou la chaloupe du Titanic à New-York. »
Une preuve, oui ! Et pourtant, la mort de Tahir réveille ses vieux démons. « Elle a peur : ça a recommencé. Elle est de nouveau dans l’Histoire », elle qui toute sa vie a cherché à s’en abstraire et épargner les siens. Que “L’HISTOIRE de nous s’abstienne” crie le poète algérien Mourad Djebel, car le passé “crible l’instant de shrapnels”. Vivre libre n’est pas aisé à l’heure où « certains rêvaient de vous ausculter les gênes » ! Dans le barnum médiatique hexagonal, les shrapnels ce sont les « obsessions du pays » : banlieue, islam, identité, appartenance, fidélité, immigration, etc., c’est ce paternalisme qui renvoie, enferme, le vulgum pecus - ou les poètes (on pense à Magyd Cherfi) - à « sa » communauté : « Qu’ils ne prétendent pas exprimer un avis personnel, ils parlaient au nom de leur communauté. On les faisait taire ainsi facilement ». Dans le pays de Descartes, pas le droit de penser, pas le droit de penser par soi-même ! Marceline, Iris, ou Fatma ; Bianca, François ou Tahir… quelle importance. Ouvrir la cage ! Vivre libre, se libérer, retrouver « la source qui bat dans la poitrine et irrigue la personne humaine en une multitude de ruisseaux rouges, le désir qui naît en premier et meurt en dernier » comme l’écrit Driss Chraïbi (Le Monde à côté, Denoël, 2001).
« On ne cherche pas ses clefs dans la main d’un mort »
L’écriture de Tassadit Imache est pudique, élégante, en nuances. Il faut s’arrêter sur les épisodes du départ de la mère, de l’enterrement ou la magnifique lettre de Marceline à Bianca pour en mesurer la charge expressive et émotionnelle. Comme les « cœurs lents », cette écriture est pétrie de silences et de signes. Rien de commun avec la modernité tapageuse, nombriliste et larmoyante, des écrans, de la toile et des étals de libraire. Oui l’univers de Tassadit Imache reste sombre. Difficile. Parfois revêche. Mais rien de victimaire. Même pas de désespéré. Et cela est encore et peut-être plus vrai ici. Car « on ne cherche pas ses clefs dans la main d’un mort » et « il y a encore tant à découvrir. Il y a des personnes chères, en vie. » Serait-ce une évolution dans la travail de Tassadit Imache ? Peut-être pas, juste une autre façon de « placer la lumière… », d’ « éclairer les visages et les mouvements des gens » à l’image de la naissance de cette « jolie petite métisse qui va reprendre, vaillante, la chaine des peines et des vexations » mais qui est aussi celle par qui « la grâce et la couleur sont entrées officiellement dans la famille. »
Des cœurs lents est un petit bijou d’horlogerie, miniaturisée, parfaitement huilée, dont le tic tac régulier et implacable rythme les existences de trois générations. Et leur devenir. Il faut juste (ré)apprendre à placer la lumière.
Agones, 2017, 183 pages, 16 euros
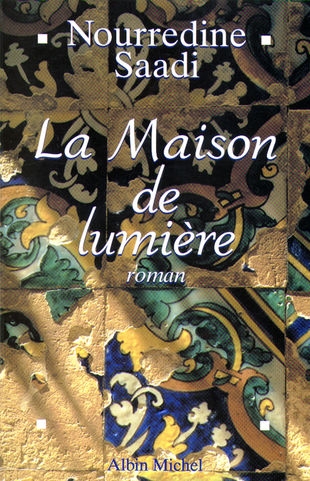 Brasser en quelque 300 pages l’histoire de l’Algérie depuis la période ottomane jusqu’à nos jours à travers une demeure algéroise, telle est la difficile tâche à laquelle s’est attelé l’universitaire algérien pour son deuxième roman. Des esprits chagrins trouveront certainement que l’auteur enjambe allégrement les siècles et les événements historiques ou que le récit pèche par une intrigue par trop dépouillée, du moins jusqu’à la période contemporaine qui voit des existences prendre corps, des destins se croiser, des vies se mêler. Une telle lecture serait injuste. Primo, Nourredine Saadi aime écrire. Le plaisir certain que l’universitaire prend à conter se communique au lecteur. D’autant plus que par rapport à Dieu-le-fit, son premier roman, le style s’est allégé, épuré. Saadi a laissé de côté un vocabulaire trop riche et trop savant. Libéré de son corset lexical, le récit devient plus fluide. Secundo et sur le fond cette fois, ce qui intéresse Nourredine Saadi, ce n’est pas une recension méticuleuse et exhaustive des faits et personnages qui ont marqué les quelques cinq derniers siècles. À travers l’histoire d’une demeure mauresque, La maison de lumière montre la richesse humaine et le potentiel d’amour – et de haine – que renferme la terre algérienne.
Brasser en quelque 300 pages l’histoire de l’Algérie depuis la période ottomane jusqu’à nos jours à travers une demeure algéroise, telle est la difficile tâche à laquelle s’est attelé l’universitaire algérien pour son deuxième roman. Des esprits chagrins trouveront certainement que l’auteur enjambe allégrement les siècles et les événements historiques ou que le récit pèche par une intrigue par trop dépouillée, du moins jusqu’à la période contemporaine qui voit des existences prendre corps, des destins se croiser, des vies se mêler. Une telle lecture serait injuste. Primo, Nourredine Saadi aime écrire. Le plaisir certain que l’universitaire prend à conter se communique au lecteur. D’autant plus que par rapport à Dieu-le-fit, son premier roman, le style s’est allégé, épuré. Saadi a laissé de côté un vocabulaire trop riche et trop savant. Libéré de son corset lexical, le récit devient plus fluide. Secundo et sur le fond cette fois, ce qui intéresse Nourredine Saadi, ce n’est pas une recension méticuleuse et exhaustive des faits et personnages qui ont marqué les quelques cinq derniers siècles. À travers l’histoire d’une demeure mauresque, La maison de lumière montre la richesse humaine et le potentiel d’amour – et de haine – que renferme la terre algérienne. 
 Sans être un familier de Nourredine Saadi, Nono pour ses proches, j’ai eu le privilège de le croiser plusieurs fois dans les années 90, à son arrivée en France. C’était dans le cadre des activités de l’Association de culture berbère où, avec l’ami André Videau, nous l’avions accueilli une ou deux fois pour présenter ses premiers romans. Nourredine Saadi s’est très tôt intéressé à l’association, au point d’en devenir, depuis 2000, un de ses membres actifs et d’en éclairer, par son œuvre, son engagement et sa pensée, la marche.
Sans être un familier de Nourredine Saadi, Nono pour ses proches, j’ai eu le privilège de le croiser plusieurs fois dans les années 90, à son arrivée en France. C’était dans le cadre des activités de l’Association de culture berbère où, avec l’ami André Videau, nous l’avions accueilli une ou deux fois pour présenter ses premiers romans. Nourredine Saadi s’est très tôt intéressé à l’association, au point d’en devenir, depuis 2000, un de ses membres actifs et d’en éclairer, par son œuvre, son engagement et sa pensée, la marche. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les cafés de l’exil algérien vont se multiplier dans l’hexagone. Les années 20 sont prospères et la métropole réclame de la force de travail. Ça tombe bien, la colonisation, qui génère bien plus de misère que de civilisation, pousse ses enfants à venir chercher ailleurs le pain qui manque.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les cafés de l’exil algérien vont se multiplier dans l’hexagone. Les années 20 sont prospères et la métropole réclame de la force de travail. Ça tombe bien, la colonisation, qui génère bien plus de misère que de civilisation, pousse ses enfants à venir chercher ailleurs le pain qui manque. Mais l’inimitié ou l’inhospitalité des hommes, l’hostilité des lois et des institutions n’ont pas eu raison de l’humanité et de la verticalité de l’immigration algérienne. Mieux, «Il faut imaginer Sisyphe heureux » comme dit Camus ! Face à la dureté des temps, la plus grande victoire de cette histoire reste son plus prometteur enseignement. Victoire que ces rencontres et ces amitiés du populo à l’atelier, sur les chantiers ou sur le zinc. Victoire que ces amours transfrontières – encore et toujours subversives – comme celui de Lucette et de Mouloud. Victoire que ces mélanges où les hommes et les femmes, les cultures, les langues, les expressions artistiques, etc. s’entrelacent pour dessiner les contours de mondes insoupçonnés. Victoire que cette disponibilité à décentrer le regard et se rendre disponible à l’Autre. Toutes ces victoires sur l’adversité ont transformé le visage de la France aussi sûrement qu’elles ont transformés le visage des Algériens de France. Se réapproprier cet esprit de fraternité et de création, c’est se détourner des apprentis sorciers du ressentiment, de la colère, de la haine de l’autre qui conduisent à la haine de soi et au chaos.
Mais l’inimitié ou l’inhospitalité des hommes, l’hostilité des lois et des institutions n’ont pas eu raison de l’humanité et de la verticalité de l’immigration algérienne. Mieux, «Il faut imaginer Sisyphe heureux » comme dit Camus ! Face à la dureté des temps, la plus grande victoire de cette histoire reste son plus prometteur enseignement. Victoire que ces rencontres et ces amitiés du populo à l’atelier, sur les chantiers ou sur le zinc. Victoire que ces amours transfrontières – encore et toujours subversives – comme celui de Lucette et de Mouloud. Victoire que ces mélanges où les hommes et les femmes, les cultures, les langues, les expressions artistiques, etc. s’entrelacent pour dessiner les contours de mondes insoupçonnés. Victoire que cette disponibilité à décentrer le regard et se rendre disponible à l’Autre. Toutes ces victoires sur l’adversité ont transformé le visage de la France aussi sûrement qu’elles ont transformés le visage des Algériens de France. Se réapproprier cet esprit de fraternité et de création, c’est se détourner des apprentis sorciers du ressentiment, de la colère, de la haine de l’autre qui conduisent à la haine de soi et au chaos.