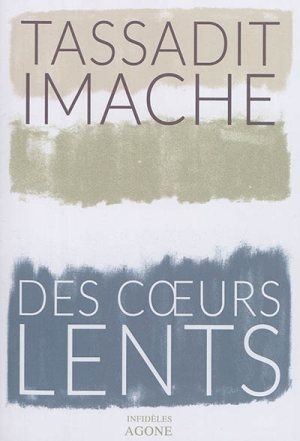Rencontre avec Francis Dupuis-Déri et Ben Mohamed à propos de Mohamed Saïl, L’étrange étranger. Ecrits d’un anarchiste kabyle, ici
Voici regroupés une trentaine de textes de ce Kabyle, né en 1894 à Taourirt, dans les environs de Sidi Aïch et mort en banlieue parisienne en 1953. Mohamed Saïl fait partie des rares qui ont pu fréquenter, un temps, l’école primaire ; suffisamment pour devenir un lecteur autodidacte. Chauffeur mécanicien puis réparateur de faïences, il a traversé la première moitié du siècle 20 en antimilitariste (insoumis et déserteur en 14-18), en anticapitaliste et bien sûr en anticolonialiste virulent.
 Mohamed Saïl n’a cessé de rappeler l’injustice d’un système d’exploitation et les conditions de vie inhumaine imposées aux « indigènes », inversant les rôles civilisation/barbarie : la civilisation ? « C’est le vol, la piraterie, le viol qui l’accompagnent toujours ! » « Le missionnaire laïque ou religieux cache sous son froc et dans sa main la chaîne de l'esclavage. » C’est dit et bien dit, car l’homme a du style et du plus plaisant, percutant et persifleur. Dans son combat contre le colonialisme, combat d’une vie entière il n’hésite à faire, en 1924 !, cette comparaison : « Le fascisme italien n’est pas plus odieux que les méthodes de la colonisation employées par les fonctionnaires de la République française ».
Mohamed Saïl n’a cessé de rappeler l’injustice d’un système d’exploitation et les conditions de vie inhumaine imposées aux « indigènes », inversant les rôles civilisation/barbarie : la civilisation ? « C’est le vol, la piraterie, le viol qui l’accompagnent toujours ! » « Le missionnaire laïque ou religieux cache sous son froc et dans sa main la chaîne de l'esclavage. » C’est dit et bien dit, car l’homme a du style et du plus plaisant, percutant et persifleur. Dans son combat contre le colonialisme, combat d’une vie entière il n’hésite à faire, en 1924 !, cette comparaison : « Le fascisme italien n’est pas plus odieux que les méthodes de la colonisation employées par les fonctionnaires de la République française ».
La même année, alors que le mouvement national algérien n’a pas encore vu le jour (l’ENA, créée par Imache et consorts, ne verra le jour qu’en 1926), prémonitoire, il met en garde : “Prenez garde qu’un jour les parias en aient marre et qu’ils ne prennent les fusils que vous leur avez appris à manier pour les diriger contre leurs véritables ennemis, au nom du droit à la vie, et non comme autrefois pour une soi-disant patrie marâtre et criminelle. » Mais, en 1951, il en appelle à se méfier des « guignols nationalistes », des « canailles prétendants à la couronne ». Saïl, qui s’est engagé sur le front antifasciste espagnol au sein de la colonne Durutti reste un antimilitariste mais surtout hostile à toute idée nationale. La libération des Algériens ? Oui. Le nationalisme – à commencer par celui de « la bande des quarante voleurs ou charlatans politiciens » ? Non ! Soutien donc à la lutte pour la libération des Algériens mais refus des « récupérations » nationalistes « pour fonder des états-nations capitalistes » : « Pensez donc, un bon petit gouvernement algérien dont ils seraient les caïds, gouvernement bien plus arrogant que celui des roumis, pour la simple raison qu’un arriviste est toujours plus dur et impitoyable qu’un « arrivé » ! Rien à faire, les Algériens ne veulent ni de la peste, ni du cholera, ni d’un gouvernement de roumi, ni de celui d’un caïd. » On pense ici à quelques notes du Journal de Mouloud Feraoun.
Mohamed Saïl, s’est trop tôt engagé. Ainsi, dès 1923, il fonde avec Sliman Kiouane, Le Comité d’action pour la défense des indigènes algériens ; en 1929, pour protester contre l’expo coloniale, il lance le Comité de défense des Algériens contre les provocations du centenaire de 1931. Cet engagement, en actes et par écrits, il en payé le prix puisqu’il passera plusieurs années en prison… Intraitable contre les colons et l’exploitation capitaliste, il condamne avec la même énergie les suppôts du régime : cadi, bachaga, marabouts et autres « dieux du bled » : « La domination française n'est pas assez dure et injuste en elle-même, il faut qu'il se trouve des lâches parmi les indigènes (se réclamant de plus des principes moralisateurs de la religion) qui, pour un morceau de pain se chargent de la besogne des maîtres, en bons chiens de garde, pour tyranniser et juguler leurs coreligionnaires. »
Si, selon Francis Dupuis-Déri, Mohamed Saïl a commencé à fréquenter les cercles anarchistes en 1911 à Alger, c’est dans l’immigration, en France métropolitaine, dans « la gueule du loup » selon l’expression de Kateb Yacine, qu’il versera dans le militantisme actif, soutenant ses « frères » d’exil : « Quand il arrive, même s’il est sans travail, il trouve près des Algériens une assistance qui ne se pratique guère dans d’autres milieux. Il tombe évidemment, sous une exploitation, mais tout de même moins sauvage que celle qu’il subit dans son pays ». Pour autant, ce n’est pas la tarte à la crème de l’Eldorado : « nos camarades indigènes algériens, élevés au rang de grand prolétariat par le séquestre [et] les expropriations de la mercante, n'ont même plus la suprême ressource de procurer à leur marmaille famélique une maigre galette d'orge en louant leur bras hors de la colonie, dans les usines de cette France qu'ils ont pourtant contribué à sauver, comme l'ont dit, de la « horde germanique ». » Ou encore, « L’émigrant se trouve souvent arrêté par les barricades administratives élevées par les serviteurs dociles du coffre-fort. Les « baudets » de l'administration s'efforcent d’arrêter l'exode et repoussent, autant que faire se peut, les malheureux indigènes sous l'exploitation de la flibuste du monde ». Autre temps mais pas autres mœurs… Et si en 14/18 « on exaltait alors l'héroïsme des enfants d'Afrique… quand il s'agissait de crever, ils étaient des héros. Maintenant qu'il s'agit de vivre, ils sont redevenus des « bicots » (1933).
Saïl n’a de cesse d’accuser, et avec quel brio, les cocos staliniens mais aussi la gogoche à papa, celle du Front populaire, sans oublier « la grrrrande presse d’information », « les folliculaires appointés des grands bourreurs de crânes » qui ne cessent d’inventer des « ignominies (…) pour diviser la classe ouvrière » : « qu’un Français coupe une femme en morceaux, viole sa fille ou martyrise un enfant, la presse pourrie trouve cela presque normal tant elle en a l'habitude, mais qu’un « sidi » vole un croissant parce qu'il ne trouve pas de travail, ou qu'il oppose un peu de virilité à la brutalité d'un flic, les journaux titrent en gros caractères et la radio crie au scandale ». Tout cela est écrit avant « nos » « grrrrandes » chaines d’infos en continue…
 Dans son utile préface, Francis Dupuis-Déri écrit que « la voix de l'anarchiste kabyle fait écho à celle des anarchistes aujourd’hui engagé-e-s dans les luttes décoloniales. En Occident et ailleurs ».« Décoloniale » ? Peut-être. Mais avec cette précision : chez Saïl, en ménage avec la militante anarchiste Madeleine Sagot, point d’ambigüité, de victimisation et autre essentialisation. Avec des accents shakespeariens, il rappelle simplement que « comme tout être humain, nous sommes nés pour vivre librement : de même constitution organique, de même composition de corps, notre chair souffre comme la leur lorsqu'elle est meurtrie par la faim et notre esprit ressent la douleur atroce de l'oppression lorsqu'elle sévit ». Pour lui, « Français et Algériens n’ont qu’un ennemi : leur maitre. Fraternellement unis, ils sauront s’en débarrasser pour fêter ensembles leur affranchissement. » M. Saïl fait la différence, ne cède à aucune généralisation ou essentialisation : « Camarades nord-africains, il existe une catégorie de « roumis » totalement désintéressés qui luttent sans merci pour le bien-être et la justice sociale, contre les discriminations raciales ». Ou encore : « mes compatriotes, malgré les déboires qui les aigrissent, savent qu’en cette « doulce France », il y a des hommes susceptibles de leur tendre la main. ». Et lorsque face aux injustices, aux discriminations, au racisme, il évoque, en retour, la « méfiance » de ces frères « vis-à-vis des « roumis », il précise, dans une parenthèse, « sans toutefois généraliser » (1952).
Dans son utile préface, Francis Dupuis-Déri écrit que « la voix de l'anarchiste kabyle fait écho à celle des anarchistes aujourd’hui engagé-e-s dans les luttes décoloniales. En Occident et ailleurs ».« Décoloniale » ? Peut-être. Mais avec cette précision : chez Saïl, en ménage avec la militante anarchiste Madeleine Sagot, point d’ambigüité, de victimisation et autre essentialisation. Avec des accents shakespeariens, il rappelle simplement que « comme tout être humain, nous sommes nés pour vivre librement : de même constitution organique, de même composition de corps, notre chair souffre comme la leur lorsqu'elle est meurtrie par la faim et notre esprit ressent la douleur atroce de l'oppression lorsqu'elle sévit ». Pour lui, « Français et Algériens n’ont qu’un ennemi : leur maitre. Fraternellement unis, ils sauront s’en débarrasser pour fêter ensembles leur affranchissement. » M. Saïl fait la différence, ne cède à aucune généralisation ou essentialisation : « Camarades nord-africains, il existe une catégorie de « roumis » totalement désintéressés qui luttent sans merci pour le bien-être et la justice sociale, contre les discriminations raciales ». Ou encore : « mes compatriotes, malgré les déboires qui les aigrissent, savent qu’en cette « doulce France », il y a des hommes susceptibles de leur tendre la main. ». Et lorsque face aux injustices, aux discriminations, au racisme, il évoque, en retour, la « méfiance » de ces frères « vis-à-vis des « roumis », il précise, dans une parenthèse, « sans toutefois généraliser » (1952).
« Puisque nous nous côtoyons journellement, cherchons plutôt à nous comprendre pour mieux nous unir face à l'ennemi commun : le capitalisme et l'Etat. » « Se comprendre » exige de l’instruction - il dénonce l’« ignorance voulue et entretenue par l’administration française » et la pseudo scolarisation des indigènes. Il croit au « rapprochement des peuples » pour « faire disparaître » le nationalisme, « comme il fera disparaître les religions ». A dieu ne plaise…
Enfin, dans cette anthologie figure son fameux texte sur « La mentalité kabyle », son « testament politique », paru en février 1951 dans lequel il souligne que ses compatriotes jouissent d’un « tempérament indiscutablement fédéraliste et libertaire ». Dans ce texte, écrit Francis Dupuis-Déri « il rejoint la longue tradition anarchiste initiée par Pierre Kropotkine avec L'entraide et reprise par ses héritiers Pierre Clastres, David Graebner et James Scott, entre autres, et qui consiste à retrouver dans l'histoire et l'anthropologie des expériences de sociétés humaines qui se rapprochent de l'idéal anarchiste. (…) Pierre Kropotkine soulignait d'ailleurs l'importance politique de la djemaa, cette assemblée communautaire traditionnelle de la Kabylie ».
« Le Berbère est très sensible à l’organisation, à l’entraide, à la camaraderie mais, fédéraliste, il n’acceptera d’ordre que s’il est l’expression des désirs du commun, de la base » écrit M.Saïl. En cela, ces écrits conservent une part d’actualité, à tout le moins de pertinence, eu égard aux mobilisations kabyles (mouvements citoyens des Aarchs), aux recherches en cours (voir les travaux d’Alain Mahé), ou encore, dans un contexte d’essoufflement de la démocratie représentative, aux réflexions et expérimentations en matière de démocratie participative.
Mort en 1953 l’anarchiste kabyle a été enterré dans le carré musulman de Bobigny ! « Après une dispute entre sa compagne et des membres de sa famille, qui insistait pour faire observer un cérémonial religieux ». « L’étrange étranger » est bien sûr un clin d’œil au célèbre poème de Prévert, poème qu’il aurait justement dédié à Mohamed Saïl.
Mohamed Saïl, L’étrange étranger. Ecrits d’un anarchiste kabyle. Textes réunis et présentés par Francis Dupuis-Déri, éd. Lux, 176 pages, 10 euros.
 L’ouvrage satisfera les familiers ou les curieux de l’écrivain autrichien, né en 1894 dans une famille juive de Galicie, témoin des dernières heures de l’Empire austro-hongrois, qui vécut exilé avant de se réfugier à Paris où il mourut en mai 1939. Les deux récits qui le composent - Mendel, le porteur d’eau et Au neuvième jour d’Av - constituent les prémisses de romans à venir. On y retrouve les thèmes chers à Joseph Roth : le déracinement, la nostalgie d’un monde disparu, le shtetl et son condensé d’humanité, l’errance et l’exil politique.
L’ouvrage satisfera les familiers ou les curieux de l’écrivain autrichien, né en 1894 dans une famille juive de Galicie, témoin des dernières heures de l’Empire austro-hongrois, qui vécut exilé avant de se réfugier à Paris où il mourut en mai 1939. Les deux récits qui le composent - Mendel, le porteur d’eau et Au neuvième jour d’Av - constituent les prémisses de romans à venir. On y retrouve les thèmes chers à Joseph Roth : le déracinement, la nostalgie d’un monde disparu, le shtetl et son condensé d’humanité, l’errance et l’exil politique. Comme Abdelkader Djemaï ou Kamel Daoud, Yahia Belaskri est un né à Oran, en 1952, deux ans avant le déclenchement de la guerre de Libération. Dans le tumulte des dernières déflagrations, alors que déjà des pleurs et des cris de souffrance déchirent l’aurore qui pointe, le gamin a dix ans. Les fantômes d’une décennie de ténèbres et de lumière s’installent, bientôt ils hanteront les mémoires. Le gamin marche vers son adolescence, l’enfance est derrière lui. A l’instar d’Amray, le narrateur de son dernier roman, Yahia est sans doute le premier de la famille a décroché quelques titres scolaires. C’est d’ailleurs bardé d’un diplôme de sociologie, qu’il s’en va, comme Amray, offrir ses services à plusieurs entreprises du pays. En vain, semble-t-il, ou alors serait-ce par goût des mots - et de la vérité – qu’il embrasse la carrière de journaliste ? Quelques mois après le sanglant acte de naissance algérien des révolutions dites arabes, en octobre 1988, Belaskri débarque en France. Pendant une vingtaine d’années, il travaille comme journaliste (à RFI notamment) et participe à des ouvrages collectifs. En 2008, la cinquantaine bien entamée, Belaskri publie son premier roman, Bus dans la ville (Vents d’ailleurs). Un romancier est né. Il va tracer son sillon, affirmer sa singularité. Deux ans plus tard paraît Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut (Vents d’ailleurs) gratifié du Prix Ouest France-Etonnants Voyageurs et du Prix Coup de cœur de Coup de Soleil Languedoc-Roussillon. En 2012, sort Une longue nuit d’absence (Vents d’ailleurs) et, en 2014, Les Fils du Jour (Vents d'ailleurs) récompensé par le Prix Beur FM-TV5 Monde et du Prix Coup de cœur des Journées du Livre Européen et Méditerranéen.
Comme Abdelkader Djemaï ou Kamel Daoud, Yahia Belaskri est un né à Oran, en 1952, deux ans avant le déclenchement de la guerre de Libération. Dans le tumulte des dernières déflagrations, alors que déjà des pleurs et des cris de souffrance déchirent l’aurore qui pointe, le gamin a dix ans. Les fantômes d’une décennie de ténèbres et de lumière s’installent, bientôt ils hanteront les mémoires. Le gamin marche vers son adolescence, l’enfance est derrière lui. A l’instar d’Amray, le narrateur de son dernier roman, Yahia est sans doute le premier de la famille a décroché quelques titres scolaires. C’est d’ailleurs bardé d’un diplôme de sociologie, qu’il s’en va, comme Amray, offrir ses services à plusieurs entreprises du pays. En vain, semble-t-il, ou alors serait-ce par goût des mots - et de la vérité – qu’il embrasse la carrière de journaliste ? Quelques mois après le sanglant acte de naissance algérien des révolutions dites arabes, en octobre 1988, Belaskri débarque en France. Pendant une vingtaine d’années, il travaille comme journaliste (à RFI notamment) et participe à des ouvrages collectifs. En 2008, la cinquantaine bien entamée, Belaskri publie son premier roman, Bus dans la ville (Vents d’ailleurs). Un romancier est né. Il va tracer son sillon, affirmer sa singularité. Deux ans plus tard paraît Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut (Vents d’ailleurs) gratifié du Prix Ouest France-Etonnants Voyageurs et du Prix Coup de cœur de Coup de Soleil Languedoc-Roussillon. En 2012, sort Une longue nuit d’absence (Vents d’ailleurs) et, en 2014, Les Fils du Jour (Vents d'ailleurs) récompensé par le Prix Beur FM-TV5 Monde et du Prix Coup de cœur des Journées du Livre Européen et Méditerranéen. Le Livre d’Amray raconte l’histoire de son pays. Son passé métissé, sa mémoire lointaine où s’entremêlent les influences et les trajectoires, les aïeux, les siens mais aussi ceux d’Octavia, de Shlomo et de Paquito, ces figures vers qui il faut se tourner pour retrouver le cours d’un fleuve détourné. Ici se croisent Augustin le chrétien, Kahina la païenne et Abdelkader le musulman. « Cette terre a été foulée par des hommes venus d’ailleurs qui y ont laissé quelques fugaces empreintes. Effacées par les imposteurs, il n’en reste rien, sinon les toiles tissées par des charlatans et leurs obscurs combats. Nulle part je n’ai pressenti ce qui allait advenir, alors je suis retourné aux vastes palais de la mémoire. Je creuse, je fouille, j’examine. » « Je ne vous cèderai rien de mes ancêtres » dit Amray qui peut honorer un père de l’église, une résistante berbère, un émir soufi, si ce n’est en païen, du moins en adorateur de la vie, en célébrateur de l’immanence. Exit ici les promesses de la transcendance et surtout celles agitées par les « nouveaux maîtres des deux mondes » : « Je ne désire rien qu’une certaine sensation à mes tempes et dans mon ventre, ce fourmillement qui prend racine au bout des orteils avant d’inonder tout le corps, l’émerveillement du jour qui naît, l’enveloppe de la nuit sur mes songes » écrit Amray, dans une veine inspirée par Driss Chraïbi. Il revendique, comme nombre de ses semblables, le droit à la fragilité, à la faillibilité, à la vulnérabilité, le droit même de pêcher. « C’est bégayer qu’il faut, au trébuchet de l’âme » disait déjà Abû Nuwâs : « je suis un homme. Sais-tu ce que cela signifie ? Le droit à la fragilité de l’être, le droit de se tromper, de fauter même, mais de ne pas, de ne jamais renoncer à son humanité. Et les assassins que disent-ils ? Il n’y a pas de faute, il n’y a pas de libre arbitre, ni de pensée affranchie, il n’y a qu’une conscience unique ; celle omniprésente et omnisciente qui s’impose à tous sans distinction. Il n’y a pas l’ombre d’un doute et la vérité est une. La leur. »
Le Livre d’Amray raconte l’histoire de son pays. Son passé métissé, sa mémoire lointaine où s’entremêlent les influences et les trajectoires, les aïeux, les siens mais aussi ceux d’Octavia, de Shlomo et de Paquito, ces figures vers qui il faut se tourner pour retrouver le cours d’un fleuve détourné. Ici se croisent Augustin le chrétien, Kahina la païenne et Abdelkader le musulman. « Cette terre a été foulée par des hommes venus d’ailleurs qui y ont laissé quelques fugaces empreintes. Effacées par les imposteurs, il n’en reste rien, sinon les toiles tissées par des charlatans et leurs obscurs combats. Nulle part je n’ai pressenti ce qui allait advenir, alors je suis retourné aux vastes palais de la mémoire. Je creuse, je fouille, j’examine. » « Je ne vous cèderai rien de mes ancêtres » dit Amray qui peut honorer un père de l’église, une résistante berbère, un émir soufi, si ce n’est en païen, du moins en adorateur de la vie, en célébrateur de l’immanence. Exit ici les promesses de la transcendance et surtout celles agitées par les « nouveaux maîtres des deux mondes » : « Je ne désire rien qu’une certaine sensation à mes tempes et dans mon ventre, ce fourmillement qui prend racine au bout des orteils avant d’inonder tout le corps, l’émerveillement du jour qui naît, l’enveloppe de la nuit sur mes songes » écrit Amray, dans une veine inspirée par Driss Chraïbi. Il revendique, comme nombre de ses semblables, le droit à la fragilité, à la faillibilité, à la vulnérabilité, le droit même de pêcher. « C’est bégayer qu’il faut, au trébuchet de l’âme » disait déjà Abû Nuwâs : « je suis un homme. Sais-tu ce que cela signifie ? Le droit à la fragilité de l’être, le droit de se tromper, de fauter même, mais de ne pas, de ne jamais renoncer à son humanité. Et les assassins que disent-ils ? Il n’y a pas de faute, il n’y a pas de libre arbitre, ni de pensée affranchie, il n’y a qu’une conscience unique ; celle omniprésente et omnisciente qui s’impose à tous sans distinction. Il n’y a pas l’ombre d’un doute et la vérité est une. La leur. »  A l’occasion de deux séjours en Amérique du Nord, d’abord, à l’été 2015, aux Etats-Unis, en Californie et dans le Nevada puis, un an plus tard, du côté de Montréal au Canada avec deux excursions à Ottawa et à New York, Arezki Métref, journaliste et écrivain algérien, note méticuleusement, consciencieusement, ses expériences, rencontres et impressions de voyage. Depuis les années 90, Métref a rejoint et enrichit cette diaspora algérienne disséminée désormais « aux quatre coins » de la ronde planète. Lui du côté de Paris, quand ses « cousins » s’enracinent de l’autre côté de l’Atlantique. Est-ce le goût pour un ailleurs élargi ou seraient-ce les frilosités de l’hospitalité française, en tout cas, de la colonisation à la mondialisation, l’algérien, cultive à son tour le don d’ubiquité. Il y aurait-il alors une façon algérienne de faire son trou, sur les « espoirs et désenchantements » de l’exil ?
A l’occasion de deux séjours en Amérique du Nord, d’abord, à l’été 2015, aux Etats-Unis, en Californie et dans le Nevada puis, un an plus tard, du côté de Montréal au Canada avec deux excursions à Ottawa et à New York, Arezki Métref, journaliste et écrivain algérien, note méticuleusement, consciencieusement, ses expériences, rencontres et impressions de voyage. Depuis les années 90, Métref a rejoint et enrichit cette diaspora algérienne disséminée désormais « aux quatre coins » de la ronde planète. Lui du côté de Paris, quand ses « cousins » s’enracinent de l’autre côté de l’Atlantique. Est-ce le goût pour un ailleurs élargi ou seraient-ce les frilosités de l’hospitalité française, en tout cas, de la colonisation à la mondialisation, l’algérien, cultive à son tour le don d’ubiquité. Il y aurait-il alors une façon algérienne de faire son trou, sur les « espoirs et désenchantements » de l’exil ?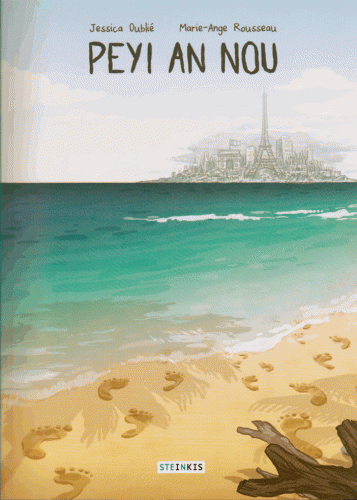
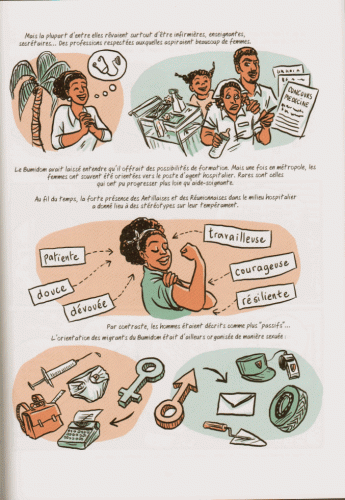 Il faut dire que sous les cocotiers la pression démographique, plus encore que le savoureux ty punch, avait de quoi faire tourner la tête de nos « responsables » politiques. Pas loin de six enfants en moyenne par martiniquaise et guadeloupéenne
Il faut dire que sous les cocotiers la pression démographique, plus encore que le savoureux ty punch, avait de quoi faire tourner la tête de nos « responsables » politiques. Pas loin de six enfants en moyenne par martiniquaise et guadeloupéenne  En ouvrant l’album, on craint une présentation par trop didactique et démonstrative mais très vite, la bédé, texte et dessins, trouve son rythme et dégage un parfum de… familiarité. Familiarité avec « nos » deux protagonistes qui, d’entrée et tout du long, se mettent en scène et mettent en scène leur travail, sa progression, les rencontres, entretiens et voyages. Cela donne une bande dessinée colorée, vives, pétillantes d’informations et de spontanéité. Quinze chapitres, tous introduits en créole, structurent le récit. Le découpage, en mode vivace, est servi par une ligne épurée, légère. Les dessins, où dominent portraits et visages, participent de l’humour de cet album.
En ouvrant l’album, on craint une présentation par trop didactique et démonstrative mais très vite, la bédé, texte et dessins, trouve son rythme et dégage un parfum de… familiarité. Familiarité avec « nos » deux protagonistes qui, d’entrée et tout du long, se mettent en scène et mettent en scène leur travail, sa progression, les rencontres, entretiens et voyages. Cela donne une bande dessinée colorée, vives, pétillantes d’informations et de spontanéité. Quinze chapitres, tous introduits en créole, structurent le récit. Le découpage, en mode vivace, est servi par une ligne épurée, légère. Les dessins, où dominent portraits et visages, participent de l’humour de cet album.  Ce Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? a été publié après les attentats de janvier 2015, avant que la photo du petit Aylan ne fasse le tour de la planète, avant l’arrivée de réfugiés et l’érection sur le sol européen de barrières de barbelé et de murs, avant les attentats du 13 novembre. Et depuis, de drame en drame, de tragédie en tragédie, d’urgence en urgence, la lecture de ce « petit livre » comme dit son auteur, devient, jour après jour, cruciale, vitale. Car il s’agit de contenir cette terreur en nous qui, sondage après sondage, semble se répandre et avec elle ces idées de fermeture et de protection, de forteresse à défendre, de passé à protéger, d’identité menacée et malheureuse, de mémoire figée ; la crainte du grand remplacement. Une terreur contagieuse, qui se nourrie de fantasmes, de peurs irraisonnées, disproportionnées. Une terreur qui conduit à la résurgence des idéologies de division, de classement, aux « relents tristes de la vieille souveraineté » qui s’autorise le droit de vie et de mort, le bannissement, la production de bouc émissaires et le retour de la race. Le tout emballé dans une pseudo morale – car il en faut une - imprégnée de certitudes républicaines ou civilisationnelles, du « tout n’est pas possible » ou pire du « mieux faut rester chez vous, mieux faut rester vous mêmes et vous nous remercierez ».
Ce Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? a été publié après les attentats de janvier 2015, avant que la photo du petit Aylan ne fasse le tour de la planète, avant l’arrivée de réfugiés et l’érection sur le sol européen de barrières de barbelé et de murs, avant les attentats du 13 novembre. Et depuis, de drame en drame, de tragédie en tragédie, d’urgence en urgence, la lecture de ce « petit livre » comme dit son auteur, devient, jour après jour, cruciale, vitale. Car il s’agit de contenir cette terreur en nous qui, sondage après sondage, semble se répandre et avec elle ces idées de fermeture et de protection, de forteresse à défendre, de passé à protéger, d’identité menacée et malheureuse, de mémoire figée ; la crainte du grand remplacement. Une terreur contagieuse, qui se nourrie de fantasmes, de peurs irraisonnées, disproportionnées. Une terreur qui conduit à la résurgence des idéologies de division, de classement, aux « relents tristes de la vieille souveraineté » qui s’autorise le droit de vie et de mort, le bannissement, la production de bouc émissaires et le retour de la race. Le tout emballé dans une pseudo morale – car il en faut une - imprégnée de certitudes républicaines ou civilisationnelles, du « tout n’est pas possible » ou pire du « mieux faut rester chez vous, mieux faut rester vous mêmes et vous nous remercierez ». Question : quel pays a connu au cours de la seconde moitié du XXème siècle des déplacements de populations à hauteur de deux millions trois cent cinquante mille hommes, femmes et enfants ? Deux millions trois cent cinquante mille anonymes représentant plus d’un quart d’une de ses soi-disant composantes nationales ? Une migration interne, voulue, organisée, forcée aux conséquences individuelles et collectives désastreuses. Deux millions trois cent cinquante mille hommes, femmes et enfants, expulsés manu militari au petit jour, de leur gourbi (un indice) pour se retrouver enfermés dans un millier de camps (dits de regroupement) ceints souvent de barbelés, parfois électrifiés ! Ce pays a vu encore plus grand que la grande Amérique qui, dès 1942, avait expédié, sans autre forme de procès, 110 000 Nippo-Américains derrière d’identiques barbelés (voir
Question : quel pays a connu au cours de la seconde moitié du XXème siècle des déplacements de populations à hauteur de deux millions trois cent cinquante mille hommes, femmes et enfants ? Deux millions trois cent cinquante mille anonymes représentant plus d’un quart d’une de ses soi-disant composantes nationales ? Une migration interne, voulue, organisée, forcée aux conséquences individuelles et collectives désastreuses. Deux millions trois cent cinquante mille hommes, femmes et enfants, expulsés manu militari au petit jour, de leur gourbi (un indice) pour se retrouver enfermés dans un millier de camps (dits de regroupement) ceints souvent de barbelés, parfois électrifiés ! Ce pays a vu encore plus grand que la grande Amérique qui, dès 1942, avait expédié, sans autre forme de procès, 110 000 Nippo-Américains derrière d’identiques barbelés (voir 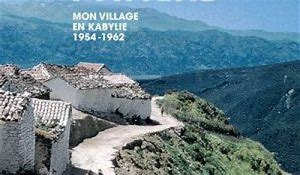 La plume alerte et affûtée, la pensée subtile et mordante, le regard sombre, l’esprit indépendant, l’essayiste et journaliste remonte le temps pour retrouver l’enfant né à l’orée de l’année 1954, dans une famille modeste, au cœur d’un village kabyle haut perché et encore épargné - pour le meilleur et pour le pire - par la modernité, et où langue et traditions, tout autant païennes que musulmanes, nimbaient de sacralité - pour le meilleur et pour le pire - chaque instant de l’existence. 1954, la guerre d’Algérie éclate, ou se poursuit, après « le divorce sans appel » du 8 mai 1945. « Mes premiers pas ont coïncidé avec ses bruits de bottes » écrit Zeghidour qui souligne que « c’est la guerre d’indépendance qui nous a fait rencontrer les Français. » Mise en présence paradoxale : « d’une main la torture, de l’autre l’écriture (…) ; l’avers et le revers d’une même médaille, soit, en même temps et tout d’une pièce, le pire et le meilleur de la France ». Thème déjà présent chez un Jean Amrouche et que l’on retrouve dans bien des textes écrits par quelques métèques devenus écrivains français qui ont d’abord découvert une Marianne méconnaissable leur claquer la porte au nez. Il aura donc fallu 1954 pour que des Algériens pur sucre tombent sur des Français (plutôt l’inverse ici). Pourtant au XIXe siècle, l’armada tricolore ne s’est pas gênée pour « retourne[r] le bled comme un gant ». Quant aux colons, qui « affluent en masse (…) ; ces prolétaires soudain devenus propriétaires » ils ont été « insatiables » et… sourds aux mises en garde visionnaires du pourtant colonialiste Jules Ferry. Lorsque Zeghidour évoque son père, Belkacem, sa mère Mériem, lorsqu’il revient sur la mort de son frère et de sa sœur Houria ou sur la disparition d’Amar, son frère d’adoption, il le fait avec pudeur, sans taire l’amour pour les siens ni cacher des larmes qu’il ne peut, aujourd’hui encore, contenir. Trois enfants morts ! Voilà, plus que de longs discours, le résultat d’une colonisation injuste et indifférente qui a laissé des hommes et des femmes vivre sans le soin, loin de la civilisation promise, sans autres recours que des croyances et des traditions vaines, inefficaces et parfois mortelles. L’Algérie de papa ? « Deux peuples qui vivent au sein du même territoire, mais pas dans le même pays ». Et parmi les ressorts souterrains des ruptures et violences, il y a peut-être le poids de la sexualité : « les intimités entravées » car « qu’est-ce qu’un voisinage qui met à l’index l’amour, une coexistence, une mixité qui interdit le mariage mixte, un mélange qui refuse le brassage ? Voilà tout le drame de l’Algérie française, l’alpha et l’oméga de son impasse. » Où quand Slimane Zeghidour rejoint
La plume alerte et affûtée, la pensée subtile et mordante, le regard sombre, l’esprit indépendant, l’essayiste et journaliste remonte le temps pour retrouver l’enfant né à l’orée de l’année 1954, dans une famille modeste, au cœur d’un village kabyle haut perché et encore épargné - pour le meilleur et pour le pire - par la modernité, et où langue et traditions, tout autant païennes que musulmanes, nimbaient de sacralité - pour le meilleur et pour le pire - chaque instant de l’existence. 1954, la guerre d’Algérie éclate, ou se poursuit, après « le divorce sans appel » du 8 mai 1945. « Mes premiers pas ont coïncidé avec ses bruits de bottes » écrit Zeghidour qui souligne que « c’est la guerre d’indépendance qui nous a fait rencontrer les Français. » Mise en présence paradoxale : « d’une main la torture, de l’autre l’écriture (…) ; l’avers et le revers d’une même médaille, soit, en même temps et tout d’une pièce, le pire et le meilleur de la France ». Thème déjà présent chez un Jean Amrouche et que l’on retrouve dans bien des textes écrits par quelques métèques devenus écrivains français qui ont d’abord découvert une Marianne méconnaissable leur claquer la porte au nez. Il aura donc fallu 1954 pour que des Algériens pur sucre tombent sur des Français (plutôt l’inverse ici). Pourtant au XIXe siècle, l’armada tricolore ne s’est pas gênée pour « retourne[r] le bled comme un gant ». Quant aux colons, qui « affluent en masse (…) ; ces prolétaires soudain devenus propriétaires » ils ont été « insatiables » et… sourds aux mises en garde visionnaires du pourtant colonialiste Jules Ferry. Lorsque Zeghidour évoque son père, Belkacem, sa mère Mériem, lorsqu’il revient sur la mort de son frère et de sa sœur Houria ou sur la disparition d’Amar, son frère d’adoption, il le fait avec pudeur, sans taire l’amour pour les siens ni cacher des larmes qu’il ne peut, aujourd’hui encore, contenir. Trois enfants morts ! Voilà, plus que de longs discours, le résultat d’une colonisation injuste et indifférente qui a laissé des hommes et des femmes vivre sans le soin, loin de la civilisation promise, sans autres recours que des croyances et des traditions vaines, inefficaces et parfois mortelles. L’Algérie de papa ? « Deux peuples qui vivent au sein du même territoire, mais pas dans le même pays ». Et parmi les ressorts souterrains des ruptures et violences, il y a peut-être le poids de la sexualité : « les intimités entravées » car « qu’est-ce qu’un voisinage qui met à l’index l’amour, une coexistence, une mixité qui interdit le mariage mixte, un mélange qui refuse le brassage ? Voilà tout le drame de l’Algérie française, l’alpha et l’oméga de son impasse. » Où quand Slimane Zeghidour rejoint  Dans, La nuit des origines,
Dans, La nuit des origines,  Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les cafés de l’exil algérien vont se multiplier dans l’hexagone. Les années 20 sont prospères et la métropole réclame de la force de travail. Ça tombe bien, la colonisation, qui génère bien plus de misère que de civilisation, pousse ses enfants à venir chercher ailleurs le pain qui manque.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les cafés de l’exil algérien vont se multiplier dans l’hexagone. Les années 20 sont prospères et la métropole réclame de la force de travail. Ça tombe bien, la colonisation, qui génère bien plus de misère que de civilisation, pousse ses enfants à venir chercher ailleurs le pain qui manque. Mais l’inimitié ou l’inhospitalité des hommes, l’hostilité des lois et des institutions n’ont pas eu raison de l’humanité et de la verticalité de l’immigration algérienne. Mieux, «Il faut imaginer Sisyphe heureux » comme dit Camus ! Face à la dureté des temps, la plus grande victoire de cette histoire reste son plus prometteur enseignement. Victoire que ces rencontres et ces amitiés du populo à l’atelier, sur les chantiers ou sur le zinc. Victoire que ces amours transfrontières – encore et toujours subversives – comme celui de Lucette et de Mouloud. Victoire que ces mélanges où les hommes et les femmes, les cultures, les langues, les expressions artistiques, etc. s’entrelacent pour dessiner les contours de mondes insoupçonnés. Victoire que cette disponibilité à décentrer le regard et se rendre disponible à l’Autre. Toutes ces victoires sur l’adversité ont transformé le visage de la France aussi sûrement qu’elles ont transformés le visage des Algériens de France. Se réapproprier cet esprit de fraternité et de création, c’est se détourner des apprentis sorciers du ressentiment, de la colère, de la haine de l’autre qui conduisent à la haine de soi et au chaos.
Mais l’inimitié ou l’inhospitalité des hommes, l’hostilité des lois et des institutions n’ont pas eu raison de l’humanité et de la verticalité de l’immigration algérienne. Mieux, «Il faut imaginer Sisyphe heureux » comme dit Camus ! Face à la dureté des temps, la plus grande victoire de cette histoire reste son plus prometteur enseignement. Victoire que ces rencontres et ces amitiés du populo à l’atelier, sur les chantiers ou sur le zinc. Victoire que ces amours transfrontières – encore et toujours subversives – comme celui de Lucette et de Mouloud. Victoire que ces mélanges où les hommes et les femmes, les cultures, les langues, les expressions artistiques, etc. s’entrelacent pour dessiner les contours de mondes insoupçonnés. Victoire que cette disponibilité à décentrer le regard et se rendre disponible à l’Autre. Toutes ces victoires sur l’adversité ont transformé le visage de la France aussi sûrement qu’elles ont transformés le visage des Algériens de France. Se réapproprier cet esprit de fraternité et de création, c’est se détourner des apprentis sorciers du ressentiment, de la colère, de la haine de l’autre qui conduisent à la haine de soi et au chaos.