Ha Jin
La liberté de vivre
 C’est une longue et minutieuse chronique que livre Ha Jin. Elle se dessine en minces chapitres qui sont autant d’épisodes de la vie du couple formé par Nan Wu et son épouse Pingping, immigrés aux Etats-Unis, avec leur fils Taotao. La narration, linéaire, colle au quotidien des Wu, au plus près de leur lutte pour « s’enraciner » ; par le travail bien sûr, par la scolarité de leur enfant aussi. C’est là une priorité, et les parents redoublent d’efforts pour qu’il n’intègre pas une classe réservée aux étrangers. Ha Jin décrit la rupture avec le pays d’origine, les distances maintenues avec les représentants de la communauté chinoise, le regard critique, amusé, sceptique, séduit aussi, sur la société américaine. La part des frustrations, les transformations, visibles et intimes.
C’est une longue et minutieuse chronique que livre Ha Jin. Elle se dessine en minces chapitres qui sont autant d’épisodes de la vie du couple formé par Nan Wu et son épouse Pingping, immigrés aux Etats-Unis, avec leur fils Taotao. La narration, linéaire, colle au quotidien des Wu, au plus près de leur lutte pour « s’enraciner » ; par le travail bien sûr, par la scolarité de leur enfant aussi. C’est là une priorité, et les parents redoublent d’efforts pour qu’il n’intègre pas une classe réservée aux étrangers. Ha Jin décrit la rupture avec le pays d’origine, les distances maintenues avec les représentants de la communauté chinoise, le regard critique, amusé, sceptique, séduit aussi, sur la société américaine. La part des frustrations, les transformations, visibles et intimes.
En quelques années, Nan accomplira « le parcours qui prenait une vie entière à la plupart des immigrés ». Entre le « struggle for life » et le rêve américain, les Nan feront leur « trou » comme dit Marcel Detienne. Entre Boston, New York et enfin Atlanta, de petits boulots en petits boulots, d’emprunts en sacrifices, de capacités d’adaptation en illusions perdues, ils réussiront à ouvrir un petit restaurant (le Gold Wok) et à acheter une maison en Géorgie. Nan, l’ancien étudiant a du abandonner la science politique et une improbable carrière universitaire pour les fourneaux, ce qui laisse d’heureuses odeurs de cuisine s’exhaler de page en page.
Sans être un réfugié politique, Nan n’a pas voulu retourner en Chine après ses études. Très vite, il s’est efforcé de « se délester du bagage de la Chine pour voyager plus léger, (…) devenir un homme indépendant ». Nan largue les amarres, refuse de vivre dans le passé, de moisir dans sa communauté d’appartenance : « Il lui fallait trouver sa voie dans ce pays, vivre non pas tant en tant qu’expatrié ou exilé mais en tant qu’immigré ». Autrement dit devenir citoyen de cette société américaine où le racisme se manifeste ici ou là, où l’argent est un « dieu », cette société obsédée par « les deux S » : « le Soi et le Sexe », intraitable pour les faibles, les « losers », une société multiculturelle et multireligieuse où la diversité s’expose aussi sous la forme des conversions et des bricolages identitaires.
Nan assistera à des rencontres, des colloques sur la Chine, il côtoiera, toujours sur la réserve, quelques cercles communautaires malgré les recommandations de Pingping. Il n’est dupe de rien des comportements des uns et des autres, des intellectuels dissidents, des artistes et autre vulgum pecus chinois. Sans illusions, ilse tient à l’égard des officiels chinois, des associations relais et autres taupes. Intraitable, Nan n’est pas un homme de compromis et encore moins de compromissions. Et surtout, qu’on ne lui serve pas de vieilles lunes patriotiques : « La Chine n’est plus mon pays. Je lui crache dessus, à la Chine ! Elle traite ses citoyens comme des enfants crédules et les empêche constamment de grandir, de devenir des individus à part entière. Elle ne veut qu’une chose la soumission. Pour moi la loyauté ça marche dans les deux sens. La Chine m’a trahi, alors je refuse de rester plus longtemps son sujet. (…) Je me suis arraché la Chine du cœur. »
Pourtant aux JO d’Atlanta, il se montre attentif aux performances des athlètes chinois, « il comprit qu’il ne parvenait pas à se couper affectivement de tous ces gens ». Nan se situe au point de rencontre des deux pays, aussi, « pour voir clair dans ses émotions », il s’imagine la Chine comme étant « sa mère » et les USA « sa bien aimée »: si un conflit devait survenir, il devra « les aider à se comprendre, sans pour autant espérer qu’elles partagent un jour les mêmes opinions ». C’est Camus chez les sino-américains.
Nan aime Pingping, mais sans passion. Bon père et bon mari, son cœur est tout entier à Beina, un amour platonique de jeunesse qui lui en fit voir de toutes les couleurs pourtant. Ainsi va la vie ! L’amour fantasmé est plus difficile à chasser de son esprit qu’un échec sans rappel ni retour. Entre les époux, l’ombre de Beina toujours s’insinue. Il recherche cette passion, convaincu qu’elle serait le moteur de sa force créatrice et poétique. Car gagner de l’argent n’intéresse pas Nan. Sa seule vraie passion est la poésie.
Tirailler entre ses responsabilités d’époux, de père et sa vocation, il doit apprendre à se débarrasser de ses « peurs » comme dit Faulkner, de ses doutes sur son travail. « Je ne dois pas vivre dans la passé, mais me concentrer sur le présent et sur l’avenir ». Après bien des hésitations, il décide d’écrire en anglais malgré les avis contraires et définitifs d’une rédactrice en chef d’une revue de poésie. Il évoque la xénophobie et oppose le fait que « la vitalité de l’anglais résulte en partie de sa capacité à absorber toutes sortes d’énergies étrangères. » Ces pages sur le cheminement créatif de Nan constituent aussi le sel de ce roman. Le livre se referme sur quelques uns de ses poèmes.
Professeur à l’université de Boston, Ha Jin émaille son texte de références à des poètes américains, à Faulkner et à Pasternak. La Liberté de vivre est son cinquième roman et le quatrième à être traduit en langue française (au Seuil) après La Longue Attente (2002), La Démence du sage (2004) et La Mare, (2004). La Liberté de vivre (paru en 2007 aux USA) est le premier récit de l’auteur à se situer hors de Chine et à plonger au cœur de l’immigration chinoise aux Etats-Unis.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Isabelle Perrin, Seuil, 2011, 669 pages, 24€
 Attention : âmes sensibles s’abstenir ! Les plus émotifs et imaginatifs parmi les jeunes lecteurs risquent de se faire des frayeurs en lisant le livre concocté par Janne Teller, danoise d’origine austro-allemande par sa famille. Chez les aînés – car ce livre peut, et doit être lu, par tous – il aidera les uns à réfléchir et les autres à vivre une expérience par procuration. Quand aux blasés, qu’ils continuent à ruminer dans leur coin !
Attention : âmes sensibles s’abstenir ! Les plus émotifs et imaginatifs parmi les jeunes lecteurs risquent de se faire des frayeurs en lisant le livre concocté par Janne Teller, danoise d’origine austro-allemande par sa famille. Chez les aînés – car ce livre peut, et doit être lu, par tous – il aidera les uns à réfléchir et les autres à vivre une expérience par procuration. Quand aux blasés, qu’ils continuent à ruminer dans leur coin ! Rachid Santaki est né en 1973 à Saint-Ouen, a grandi à Saint-Denis, c’est sans doute ce qui lui a donné l’énergie nécessaire pour être à la fois entrepreneur, journaliste, scénariste et romancier. Il a signé La petite cité dans la prairie (Bords de l'eau, 2008), Les anges s'habillent en caillera (Moisson rouge, 2011) et Flic Ou Caillera, chez Masque en 2013. En 2014, il signe pas moins de quatre parutions : Putain D'amour (un recueil de textes au Livre De Poche), Business Dans La Cité (Seuil), deux recueils de nouvelles : Gueule De Bois (Gallimard) et Triple XL (Folie d'encre).
Rachid Santaki est né en 1973 à Saint-Ouen, a grandi à Saint-Denis, c’est sans doute ce qui lui a donné l’énergie nécessaire pour être à la fois entrepreneur, journaliste, scénariste et romancier. Il a signé La petite cité dans la prairie (Bords de l'eau, 2008), Les anges s'habillent en caillera (Moisson rouge, 2011) et Flic Ou Caillera, chez Masque en 2013. En 2014, il signe pas moins de quatre parutions : Putain D'amour (un recueil de textes au Livre De Poche), Business Dans La Cité (Seuil), deux recueils de nouvelles : Gueule De Bois (Gallimard) et Triple XL (Folie d'encre). Dans ce premier roman que l’on pourrait qualifier d’hybride, Sophie Schulze raconte l’histoire de Walter, jeune allemand immigré en France au lendemain de la Première Guerre mondiale, en émaillant le récit de références et de citations d’Hannah Arendt, Husserl ou Robert Schumann, mêlant petite et grande histoire. Allée 7, rangée 38 tangue entre roman, reportage journalistique et essai (nombreuses et parfois longues citations pour un récit dégraissé).
Dans ce premier roman que l’on pourrait qualifier d’hybride, Sophie Schulze raconte l’histoire de Walter, jeune allemand immigré en France au lendemain de la Première Guerre mondiale, en émaillant le récit de références et de citations d’Hannah Arendt, Husserl ou Robert Schumann, mêlant petite et grande histoire. Allée 7, rangée 38 tangue entre roman, reportage journalistique et essai (nombreuses et parfois longues citations pour un récit dégraissé).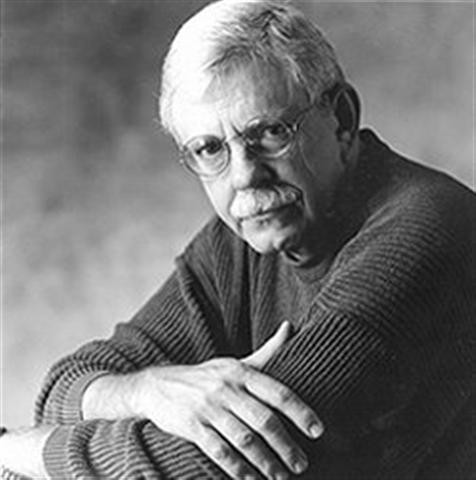 Il y aurait deux façons pour un Cubain de débarquer aux USA. Il y a la voie royale, celle où les Gringos vous déroulent le tapis rouge avec permis de séjour et autorisation de travail à la clef, et l’autre, où l’accueil se fait plus suspicieux, du bout des lèvres, comme à regret. Le même pays fera alors attendre le même exilé cubain une bonne année pour daigner le gratifier d’un permis et d’autorisations diverses. Il faut faire ses preuves. Dans le premier cas, le Cubain, perché ou vautré sur une méchante embarcation ou un radeau de fortune a réussi à s’esbigner de son île, éviter les humeurs des requins et échapper aux caprices des vents et des courants du détroit de Floride, pour s’en aller poser un pied salvateur du côté de Key West. Dans l’autre cas, le bougre est passé par le Mexique, comme le vulgum pecus des migrants de sorte qu’il sera soumis au commun législatif.
Il y aurait deux façons pour un Cubain de débarquer aux USA. Il y a la voie royale, celle où les Gringos vous déroulent le tapis rouge avec permis de séjour et autorisation de travail à la clef, et l’autre, où l’accueil se fait plus suspicieux, du bout des lèvres, comme à regret. Le même pays fera alors attendre le même exilé cubain une bonne année pour daigner le gratifier d’un permis et d’autorisations diverses. Il faut faire ses preuves. Dans le premier cas, le Cubain, perché ou vautré sur une méchante embarcation ou un radeau de fortune a réussi à s’esbigner de son île, éviter les humeurs des requins et échapper aux caprices des vents et des courants du détroit de Floride, pour s’en aller poser un pied salvateur du côté de Key West. Dans l’autre cas, le bougre est passé par le Mexique, comme le vulgum pecus des migrants de sorte qu’il sera soumis au commun législatif. Peut-on écrire qu’il y a des romans d’anciens combattants comme, au temps déjà lointain des « cheveux longs et des idées courtes », la jeunesse acnéique de France se montrait imperméable aux antiennes des anciens qui s’en allaient répétant, ad libitum, ce que fut leur 20 ans héroïque dans le bruit et la fureur des hommes ? Cela est sans doute un peu sévère, mais les premières pages du nouveau roman d’Azouz Begag font penser à d’autres, déjà lues et moult fois encore. Car enfin le livre annonce une semaine de vacances d’un père avec ses filles, une semaine pour se rabibocher et se rassurer après un divorce difficile qui a vu les gamines sembler se détacher de leur géniteur, et lui faire payer sa décision de quitter leur mère. Les filles auraient préféré l’Algérie ensoleillée et chaleureuse des origines quand le père décida, au seul et vague souvenir d’un ami d’enfance, natif du cru mais exilé à Lyon, de louer une maison sur l’île froide et pluvieuse d’Ouessant. Et du coup, pendant que la parentèle traverse le bras de mer qui sépare l’ile du continent, pendant que notre trio s’apprête à débarquer sur cette île exotique, le narrateur, évoque sa jeunesse, l’école et le racisme de ses petits camarades, il se souvient d’un autre temps, celui des voyages d’immigrés entre la France et l’Algérie, en bateau, en famille, aux valises surchargées… On embarque aujourd’hui pour Ouessant et on se retrouve dans les années 60 sur le Ville-de-Marseille ou le Ville-d’Alger en partance pour le bled. Ah ! le bled ! L’épée de Damoclès. La question toujours sans réponse. Le vis-à-vis incontournable, l’évocation de l’autre pays, le pendant à qui il faut, d’une manière ou d’une autre, rendre des comptes, comme s’excuser de lui avoir préféré Madame la France, et pire, un « cul-de-sac » à la majesté de Tipasa, le kouign-amann au khobs eddar (la galette kabyle) de la grand-mère. Voilà pour l’aspect « ancien combattant » de ce roman écrit par un auteur qui, pour avoir les pieds bien ancrés dans le réel, conserve cet « esprit d’enfance » qui toujours ramène vers ce big bang des origines où brille l’astre paternel.
Peut-on écrire qu’il y a des romans d’anciens combattants comme, au temps déjà lointain des « cheveux longs et des idées courtes », la jeunesse acnéique de France se montrait imperméable aux antiennes des anciens qui s’en allaient répétant, ad libitum, ce que fut leur 20 ans héroïque dans le bruit et la fureur des hommes ? Cela est sans doute un peu sévère, mais les premières pages du nouveau roman d’Azouz Begag font penser à d’autres, déjà lues et moult fois encore. Car enfin le livre annonce une semaine de vacances d’un père avec ses filles, une semaine pour se rabibocher et se rassurer après un divorce difficile qui a vu les gamines sembler se détacher de leur géniteur, et lui faire payer sa décision de quitter leur mère. Les filles auraient préféré l’Algérie ensoleillée et chaleureuse des origines quand le père décida, au seul et vague souvenir d’un ami d’enfance, natif du cru mais exilé à Lyon, de louer une maison sur l’île froide et pluvieuse d’Ouessant. Et du coup, pendant que la parentèle traverse le bras de mer qui sépare l’ile du continent, pendant que notre trio s’apprête à débarquer sur cette île exotique, le narrateur, évoque sa jeunesse, l’école et le racisme de ses petits camarades, il se souvient d’un autre temps, celui des voyages d’immigrés entre la France et l’Algérie, en bateau, en famille, aux valises surchargées… On embarque aujourd’hui pour Ouessant et on se retrouve dans les années 60 sur le Ville-de-Marseille ou le Ville-d’Alger en partance pour le bled. Ah ! le bled ! L’épée de Damoclès. La question toujours sans réponse. Le vis-à-vis incontournable, l’évocation de l’autre pays, le pendant à qui il faut, d’une manière ou d’une autre, rendre des comptes, comme s’excuser de lui avoir préféré Madame la France, et pire, un « cul-de-sac » à la majesté de Tipasa, le kouign-amann au khobs eddar (la galette kabyle) de la grand-mère. Voilà pour l’aspect « ancien combattant » de ce roman écrit par un auteur qui, pour avoir les pieds bien ancrés dans le réel, conserve cet « esprit d’enfance » qui toujours ramène vers ce big bang des origines où brille l’astre paternel. Laura Reeck est professeure de français à l’Allegheny College de Meadville (Pennsylvanie). Elle publie ici son premier ouvrage consacré à quelques écrivains français classés - relégués ? - par la doxa dans le rayon des auteurs « beurs » ou « écrivains de banlieue ». A chacun, elle consacre un chapitre. Elle ne se contente pas d’y analyser les œuvres des uns et des autres mais se livre également à des mises en perspectives théoriques, sociales et biographiques. Elle illustre ainsi, avec rigueur et conviction, la fameuse opinion qui veut que la littérature en dise plus sur nos sociétés et sur leur devenir que nombre de doctes traités, lourdement lestés de statistiques. A l’ère du chiffre-roi, les poètes ne seraient pas tout à fait morts…
Laura Reeck est professeure de français à l’Allegheny College de Meadville (Pennsylvanie). Elle publie ici son premier ouvrage consacré à quelques écrivains français classés - relégués ? - par la doxa dans le rayon des auteurs « beurs » ou « écrivains de banlieue ». A chacun, elle consacre un chapitre. Elle ne se contente pas d’y analyser les œuvres des uns et des autres mais se livre également à des mises en perspectives théoriques, sociales et biographiques. Elle illustre ainsi, avec rigueur et conviction, la fameuse opinion qui veut que la littérature en dise plus sur nos sociétés et sur leur devenir que nombre de doctes traités, lourdement lestés de statistiques. A l’ère du chiffre-roi, les poètes ne seraient pas tout à fait morts…
 « Je marche seule dans la vie, sans savoir où je vais. Ma vie ne m’appartient pas. Mais à qui appartient-elle ? Je me sens comme une feuille qui vole au gré du vent (…) ». Qu’il est donc dur d’être métis ! Du moins tant que l’on reste aimanté par l’un des deux pôles du métissage, tant que l’on n’a pas inventé une autre façon d’être au monde, libérée des chimères de l’attachement et autres illusions identitaires. Ce n’est pas Ayélé, la « fille de l’ombre » qui le démentira. Ce roman raconte l’histoire dramatique et tragique d’une jeune fille née des amours d’une Française et d’un Togolais. Tout va pour le mieux, mais pourtant pas question pour Marie-Eleonor de présenter Pierre Epiphane Akwune à ses parents ! Pas question de franchir la ligne jaune : un « nègre » n’a rien à faire dans la famille et Adèle, la mère, impitoyable, veille à la pureté, sociale et raciale, des siens !
« Je marche seule dans la vie, sans savoir où je vais. Ma vie ne m’appartient pas. Mais à qui appartient-elle ? Je me sens comme une feuille qui vole au gré du vent (…) ». Qu’il est donc dur d’être métis ! Du moins tant que l’on reste aimanté par l’un des deux pôles du métissage, tant que l’on n’a pas inventé une autre façon d’être au monde, libérée des chimères de l’attachement et autres illusions identitaires. Ce n’est pas Ayélé, la « fille de l’ombre » qui le démentira. Ce roman raconte l’histoire dramatique et tragique d’une jeune fille née des amours d’une Française et d’un Togolais. Tout va pour le mieux, mais pourtant pas question pour Marie-Eleonor de présenter Pierre Epiphane Akwune à ses parents ! Pas question de franchir la ligne jaune : un « nègre » n’a rien à faire dans la famille et Adèle, la mère, impitoyable, veille à la pureté, sociale et raciale, des siens ! C’est un long et riche entretien que donnent ici Yves Lacoste, géographe, historien, célèbre figure de proue de la géopolitique française et fondateur en 1976 de la revue Hérodote et Pascal Lorot, président de l’institut Choiseul et directeur des revues Géoéconomie et Sécurité globale. Riche parce que les discussions portent aussi bien sur la vie d’Yves Lacoste depuis l’origine quercynoise de la famille, les amis, ses lectures jusqu’au Maroc natal et les nombreux pays visités, pays d’études ou de résidence, en passant par les domaines de recherche de l’universitaire et les controverses qui ont émaillé plus de cinquante ans de vie intellectuelle hexagonale, de la question coloniale au récent débat sur l’identité et la nation.
C’est un long et riche entretien que donnent ici Yves Lacoste, géographe, historien, célèbre figure de proue de la géopolitique française et fondateur en 1976 de la revue Hérodote et Pascal Lorot, président de l’institut Choiseul et directeur des revues Géoéconomie et Sécurité globale. Riche parce que les discussions portent aussi bien sur la vie d’Yves Lacoste depuis l’origine quercynoise de la famille, les amis, ses lectures jusqu’au Maroc natal et les nombreux pays visités, pays d’études ou de résidence, en passant par les domaines de recherche de l’universitaire et les controverses qui ont émaillé plus de cinquante ans de vie intellectuelle hexagonale, de la question coloniale au récent débat sur l’identité et la nation.