Renaud de Rochebrune, Benjamin Stora
La Guerre d’Algérie vue par les Algériens. 1.Le Temps des armes (Des origines à la bataille d’Alger)
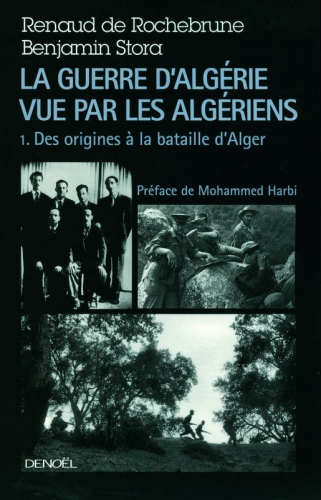 Il y aurait-il un art algérien de la guerre, pour paraphraser le remarquable L’Art français de la guerre (Gallimard 2011) signé Alexis Jenni ? Une façon bien à soi de régler les conflits et les problèmes et surtout - tout l’intérêt du livre de Jenni est là - de s’ingénier, de se fourvoyer, des années après que les armes se soient tues, à creuser le même, le tragique et fatal sillon de la force et de la violence. De cette terrible Guerre d’Algérie, déclenchée il y a tout juste soixante ans cette année, sont nées bien des mémoires, des controverses, des interrogations et autant de regrets. Si, selon la formule de Baltasar Gracián, « faire comprendre est bien meilleur que faire souvenir », le rôle et la fonction de l’historien sont essentiels. Pour peu qu’on lui fiche la paix et singulièrement que les politiques évitent de lui donner des leçons, de lui tenir la jambe et accessoirement le crayon, l’historien peut aider chacun à forger les outils indispensables pour non pas se souvenir, mais comprendre, pour non pas choisir entre le paradis ou l’enfer, mais mieux distinguer l’un de l’autre et en mesurer les enchevêtrements. « Les Algériens en général, cultivent un rapport singulier à leur histoire. C’est à la fois leur paradis et leur enfer » écrit en préface Mohamed Harbi.
Il y aurait-il un art algérien de la guerre, pour paraphraser le remarquable L’Art français de la guerre (Gallimard 2011) signé Alexis Jenni ? Une façon bien à soi de régler les conflits et les problèmes et surtout - tout l’intérêt du livre de Jenni est là - de s’ingénier, de se fourvoyer, des années après que les armes se soient tues, à creuser le même, le tragique et fatal sillon de la force et de la violence. De cette terrible Guerre d’Algérie, déclenchée il y a tout juste soixante ans cette année, sont nées bien des mémoires, des controverses, des interrogations et autant de regrets. Si, selon la formule de Baltasar Gracián, « faire comprendre est bien meilleur que faire souvenir », le rôle et la fonction de l’historien sont essentiels. Pour peu qu’on lui fiche la paix et singulièrement que les politiques évitent de lui donner des leçons, de lui tenir la jambe et accessoirement le crayon, l’historien peut aider chacun à forger les outils indispensables pour non pas se souvenir, mais comprendre, pour non pas choisir entre le paradis ou l’enfer, mais mieux distinguer l’un de l’autre et en mesurer les enchevêtrements. « Les Algériens en général, cultivent un rapport singulier à leur histoire. C’est à la fois leur paradis et leur enfer » écrit en préface Mohamed Harbi.
En France, la recherche historique progresse entre les écueils des conflits mémoriels, les vacarmes législatifs, les silences officiels et autres éructations révisionnistes et nostalgiques vociférées à contre courant de la marche du temps et des hommes. En Algérie, il faudrait que « le métier d’historien, encore balbutiant, cesse d’être soumis à surveillance comme le prône la Constitution ». L’un des enjeux de ce livre est là : en finir avec l’instrumentalisation - idéologique, nationaliste ou mémorielle - dénoncée ici par le préfacier, grognard de l’indépendance algérienne et de historiographie franco-algérienne.
Si le livre ne renouvelle par la recherche et les savoirs sur l’histoire de la guerre d’Algérie, il offre l’occasion de la remettre en perspective, non pas depuis 1954 mais depuis l’irruption de l’armada française sur la terre algérienne jusqu’en 1957, année où se termine ce premier tome. Nos deux auteurs montrent que l’opposition algérienne à la conquête, puis au colonialisme et enfin la revendication d’indépendance, n’a jamais cessé. C’est peut-être le premier enseignement de ce livre : la présence étrangère sur cette terre fut toujours perçue, de manière plus ou moins tranchante, comme illégitime.
Nos deux historiens sont partis en reportage au-delà des lignes, dans les chambres d’appartements modestes où une poignée d’hommes, souvent inexpérimentés, improvisent, « avec les moyens du bord », - plus qu’ils ne décident - l’avenir de l’Algérie et de la France. On les retrouve dans les maquis de Kabylie, des Aurès ou du Constantinois où les quelques centaines de maquisards, sans armes et déguenillés, deviendront quelques milliers qui donneront du fil à retordre à l’une des plus puissantes armées du monde. Ils sont aussi dans les caches de la Casbah avec le commandant Azzedine pour comprendre, expliquer, comment et pourquoi est prise la décision de s’attaquer aux civils.
Les dates qui rythment ce récit ne sont pas choisies au hasard. L’attaque en 1949 de la poste d’Oran, le 1er novembre 1954, le 20 août 1955 et l’insurrection dans le Constantinois, août 1956 et le Congrès de la Soummam et enfin la bataille d’Alger en 1957. Du point de vue algérien, ce sont des moment clefs, des dates charnières. Le hold-up de la poste d’Oran survient deux ans après la création de l’OS (Organisation spéciale) qui montre l’existence d’un groupe d’indépendantistes algériens partisans de la lutte armée. « La nuit de la Toussaint » de 1954 sonne l’heure du passage à l’acte : les hommes qui créent le FLN rompent avec les tergiversations d’hier et décident d’écrire une nouvelle page. Août 1955, Zighout Youcef, le commandant de la wilaya 2 (Constantinois) décide de frapper fort et d’engager la population. Plus que l’insurrection, les représailles de l’armée et des milices creuseront un fossé entre les communautés. Pour les auteurs, le déclenchement de la révolution date de ce 20 août 1955. Au Congrès de la Soummam, où sont repensés les liens entre les membres du FLN de l’extérieur et ceux de l’intérieur, la question du rapport entre politique et militaire, Abane Ramdane offre à l’Algérie les premières lignes programmatiques et organisationnelles de la révolution. Exit ici les références à la religion… Tout cela, sur fond de course au leadership, ne plaira pas à tous, à commencer à Ben Bella, affublé, en France, depuis le début, d’un chapeau bien trop large pour lui. Enfin, la fameuse bataille d’Alger se solde par la « victoire » des paras, mais politiquement, diplomatiquement, sur le plan de l’organisation, le FLN s’est renforcé, même s’il est à la veille de nouveaux conflits internes.
Lorsque l’on parle de cette guerre, on n’évoque pas la même histoire, en France et en Algérie. Et la liste est longue des ignorances réciproques et parfois partagées.
« L’art français de la guerre »
 Ainsi, connaît-on en France les horreurs commises en Algérie au nom de la mission civilisatrice par les troupes de Bugeaud ? Sait-on combien de morts sont à mettre au crédit de ce que les Algériens appelèrent la « syphilisation » ? Entre les années 1830 et 1870, il y eut entre un et trois millions de morts selon les sources, soit entre un tiers et les deux tiers de la population globale, suivant là encore des estimations.
Ainsi, connaît-on en France les horreurs commises en Algérie au nom de la mission civilisatrice par les troupes de Bugeaud ? Sait-on combien de morts sont à mettre au crédit de ce que les Algériens appelèrent la « syphilisation » ? Entre les années 1830 et 1870, il y eut entre un et trois millions de morts selon les sources, soit entre un tiers et les deux tiers de la population globale, suivant là encore des estimations.
Sait-on que ces « indigènes » s’opposèrent continuellement au régime colonial et militèrent, les armes à la main puis politiquement pour que les choses changent. En vain. Toujours en vain…
Sait-on que « la tradition des tripatouillages électoraux » dont on se gausse aujourd’hui quand il sont pratiqués de l’autre côté de la Méditerranées fut inaugurée, mise en place et développée par la France en Algérie ?
Sait-on en France que des Algériens avaient pris le maquis dès 1945 ? Que la torture était pratiquée bien avant la bataille d’Alger ? Que des Algériens ont été liquidés, à Paris, bien avant le 17 octobre 1961 ?
Sait-on aussi que la première revendication officielle d’indépendance remonte à 1927 ?
Sait-on la responsabilité des « civils européens » et de quelques officiels dans le déclenchement des émeutes du 8 mai 1945[i] ? On peut ignorer le nombre de victimes algériennes de la « répression » - de 15 000 à 35 000 morts selon les historiens, 45 000 pour le FLN – mais sait-on que cela se fit au prix de sauvageries, de bombardements aveugles, de villages passés à la mitrailleuse, de « charniers remplis à ras bord », de corps brûlés dans des fours à chaux, et tout cela, avec pour toile de fond, un peuple en liesse qui fêtait la victoire sur la barbarie nazie !? Les Algériens ont-ils tort d’évoquer ici la qualification de « crimes contre l’humanité » ?
Sait-on que la guerre d’Algérie aurait pu commencer dès 1949 ? Sait-on que les consignes données aux militants du 1er novembre 1954 interdisaient l’usage de la violence contre les civils européens (voir page 97 les circonstances rapportées sur la mort des époux Monnerot) ?
Qui connaît en France Ahmed Zahana ? La place que tiendra son exécution, guillotiné le 19 juin 1956, dans le déclenchement de la bataille d’Alger ? Quid d’Abane Ramdane ? De Ben M’hidi (assassiné sur ordre par le commandant Aussaresses[ii] )?
Sait-on que la première bombe à Alger qui vise aveuglément des civils innocents explosa rue de Thèbes en aout 1956 et est l’œuvre des ultras de l’Algérie française ? Que les auteurs étaient connus et qu’ils n’ont jamais été inquiétés ? Se doute-t-on, ici, que le « contre-terrorisme » a pu précéder les « terroristes » ? Qui connaît en France celui qui seul incarna l’honneur de son pays aux heures sombres où les soldats de la République torturaient : Paul Teitgen[iii] ?
Sait-on la part de l’intransigeance des ultras, les responsabilités des autorités dans l’inéluctabilité de la lutte armée ; et des monstruosités ? Se doute-t-on, en France, à quel point les responsables français, de la métropole et plus encore ceux d’Alger, ne comprirent rien à cette lutte algérienne, la renvoyant à un panarabisme piloté depuis le Caire ou à l’avant poste du communisme international ?
Sait on en France que dans l’Algérie de papa « à peine 15% des hommes et 6% des femmes parlent plus ou moins bien le français » ? Qu’il existait des « camps d’hébergement » que les Algériens appelaient « camps de concentration », que des villages entiers étaient « nettoyés », vidés de leurs populations[iv] ?
Se placer du côté algérien c’est déjà, en ces années 1945-1957, montrer la disproportion des méthodes utilisées, l’aveuglement et la surdité politiques, les horreurs infligées aux populations au nom de la « responsabilité collective » et la torture érigée en système d’un régime colonial devenu insurrectionnel, bafouant et défiant l’Etat de droit [v].
« Le paradis et l’enfer »
Mais cette « guerre d’Algérie vue pas les Algériens » révèlera ou rappellera au lecteur d’autres faits d’importance : sait-on, en Algérie cette fois, que le nationalisme algérien fut pluriel ? Qu’il fut traversé par moult conflits opposant réformistes et indépendantistes ; politiques et partisans de l’action armée, politiques et militaires ? Que ces oppositions se réglèrent souvent dans une « atmosphère de méfiance et de règlements de comptes » ? Il y eut certes le FLN, mais quid du MNA de Messali Hadj ? Quid des voix démocrates ? Quid des alternatives pluriculturelle et laïque portées aussi par des militants indépendantistes ? De ce point de vue, ce livre pointe aussi les absences et les amnésies de l’histoire officielle, algérienne cette fois.
C’est par la violence que les Algériens règleront leurs désaccords, et très tôt, avant même la création du FLN, (voir par exemple la crise dite « berbériste » de 1949). Qu’en est-il alors de la violence exercée contre le peuple, contre les mous, les pacifistes et ceux qui ne partageaient pas la ligne dictée par le FLN ? Quelle place le peuple algérien tenait-il pour les cadres du FLN ? N’était-il qu’un simple pion que l’on pouvait exposer au moindre risque, voir sacrifier (en août 55 dans le nord-constantinois, ou en octobre 61 à Paris ) ? Que sait-on en Algérie des massacres de Ioun-Dagen (Bejaïa) en 1956 et de Melouza en 1957 ? Comment, entre étonnement, réserve, indifférence, hostilité, peur, adhésion, évolua l’attitude des populations algériennes ? Quid de la responsabilité de Zighout Youcef dans l’usage de la violence contre les civils ? Des règlements de compte ordonnés par Abane Ramdane contre les militants algériens du MNA ? Se doute-t-on en Algérie du service que les Français ont rendu en organisant, le 22 octobre 1956, le premier détournement d’avion de l’histoire, évitant ainsi au mouvement nationaliste sa première guerre des chefs ?
Alexis Jenni repère dans la façon dont la société française se penche sur ses problèmes, un lourd héritage belliciste et, disons-le, suicidaire. De Rochebrune et Stora en pointant, côté algérien, les bifurcations de l’histoire, les choix retenus, les rivalités de personnes, de pouvoir, d’orientation, le parti pris de la violence, l’instrumentalisation sacrificielle du peuple, les mystères qui entourent encore certaines dates et certains événements, montrent que la société algérienne a sans doute aussi hérité d’un art particulier de faire la guerre. L’histoire rejoint ici la littérature dans le processus d’édification démocratique. Et ce par delà les frontières.
Sans doute ce ne sont ni les mêmes dates, ni les mêmes personnalités que l’histoire des deux pays retient. Ce ne sont pas non plus les mêmes causes qui sont associées à tel ou tel effet. En montrant où et en quoi la guerre d’Algérie ne recouvre pas, en France et en Algérie, les mêmes vérités, ce livre contribue à comprendre les différences de focale pour, peut-être, demain, contribuer au projet d’un manuel d’histoire franco-algérien, commun aux élèves des deux pays.
Préface de Mohammed Harbi. Edition Denoël, 2011, 446 pages, 23,50€
[i] Voir le livre de Jean Pierre Peyroulou, Guelma, 1945. Une subversion française dans l’Algérie coloniale. Préface de Marc Olivier Baruch, éd. La Découverte, 2009
[ii] Lire le roman de Jérôme Ferrari, Où j’ai laissé mon âme, Actes Sud 2010
[iii] Lire, une fois de plus, les pages fortes que lui consacre Alexis Jenni, dans L’Art français de la guerre, Gallimard, 2011
[iv] Voir Sylvie Thénault, Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence, éd. Odile Jacob, 2012
[v] Il faut lire là aussi le livre de Claire Mauss-Copeaux intitulé Algérie, 20 août 1955. Insurrection, répression, massacres, éd. Payot 2011.
 Ce Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? a été publié après les attentats de janvier 2015, avant que la photo du petit Aylan ne fasse le tour de la planète, avant l’arrivée de réfugiés et l’érection sur le sol européen de barrières de barbelé et de murs, avant les attentats du 13 novembre. Et depuis, de drame en drame, de tragédie en tragédie, d’urgence en urgence, la lecture de ce « petit livre » comme dit son auteur, devient, jour après jour, cruciale, vitale. Car il s’agit de contenir cette terreur en nous qui, sondage après sondage, semble se répandre et avec elle ces idées de fermeture et de protection, de forteresse à défendre, de passé à protéger, d’identité menacée et malheureuse, de mémoire figée ; la crainte du grand remplacement. Une terreur contagieuse, qui se nourrie de fantasmes, de peurs irraisonnées, disproportionnées. Une terreur qui conduit à la résurgence des idéologies de division, de classement, aux « relents tristes de la vieille souveraineté » qui s’autorise le droit de vie et de mort, le bannissement, la production de bouc émissaires et le retour de la race. Le tout emballé dans une pseudo morale – car il en faut une - imprégnée de certitudes républicaines ou civilisationnelles, du « tout n’est pas possible » ou pire du « mieux faut rester chez vous, mieux faut rester vous mêmes et vous nous remercierez ».
Ce Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? a été publié après les attentats de janvier 2015, avant que la photo du petit Aylan ne fasse le tour de la planète, avant l’arrivée de réfugiés et l’érection sur le sol européen de barrières de barbelé et de murs, avant les attentats du 13 novembre. Et depuis, de drame en drame, de tragédie en tragédie, d’urgence en urgence, la lecture de ce « petit livre » comme dit son auteur, devient, jour après jour, cruciale, vitale. Car il s’agit de contenir cette terreur en nous qui, sondage après sondage, semble se répandre et avec elle ces idées de fermeture et de protection, de forteresse à défendre, de passé à protéger, d’identité menacée et malheureuse, de mémoire figée ; la crainte du grand remplacement. Une terreur contagieuse, qui se nourrie de fantasmes, de peurs irraisonnées, disproportionnées. Une terreur qui conduit à la résurgence des idéologies de division, de classement, aux « relents tristes de la vieille souveraineté » qui s’autorise le droit de vie et de mort, le bannissement, la production de bouc émissaires et le retour de la race. Le tout emballé dans une pseudo morale – car il en faut une - imprégnée de certitudes républicaines ou civilisationnelles, du « tout n’est pas possible » ou pire du « mieux faut rester chez vous, mieux faut rester vous mêmes et vous nous remercierez ». Certains prétendent réduire l’arrivée annuelle des immigrés à 10 000 gugusses et autres enamourés de Français(es), naturalisé(e)s ou pas. D’autres annoncent vouloir diviser par deux (pourquoi par deux ?) le nombre de ces entrées pour le ramener à quelques 90 000 par an. Il semble que l’immigration soit un sujet trop sérieux – parce que d’abord et avant tout une question humaine – et compliqué pour le laisser entre les mains des politiques et autres experts qui le rabaissent à la seule dimension statistique, elle-même ravalée à une vulgaire addition de bistro. En fait, derrière ces chiffres, grossiers et/ou fantaisistes, se cachent des mécanismes complexes et une histoire pour le coup quasi linéaire. Au fondement de ces chiffres rabâchés à longueur de temps et de tribune, qui agitent régulièrement l’inconscient collectif, il y eut (et il y a) la fécondité puis la race ! C’est ce que montre Hervé Le Bras qui, dans L’Invention de l’immigré, interroge les notions d’ « immigrant », d’ « immigré », d’ « étranger », remonte leur généalogie, traque les idéologies (et oui !) qui ont présidé à leur genèse, jauge les outils statistiques (et politiques) au regard de leur pseudo neutralité scientifique… C’est finalement un coup de gueule que pousse le docte démographe contre… la démographie, ou plutôt le rôle prépondérant qu’elle tient aujourd’hui dans « cette simplification des idées sur la migration ». Un coup de gueule aussi contre une certaine « idéologie molle » qui depuis des décennies gangrène le débat, phagocyte l’entendement sur les questions migratoires et empêche la société d’aller de l’avant en distillant doutes et surtout craintes en matière d’immigration. « Ne craignez rien ! » dit le démographe il n’y a pas et il n’y aura pas d’invasion et l’immigration d’aujourd’hui n’a rien à voir avec l’immigration de papa.
Certains prétendent réduire l’arrivée annuelle des immigrés à 10 000 gugusses et autres enamourés de Français(es), naturalisé(e)s ou pas. D’autres annoncent vouloir diviser par deux (pourquoi par deux ?) le nombre de ces entrées pour le ramener à quelques 90 000 par an. Il semble que l’immigration soit un sujet trop sérieux – parce que d’abord et avant tout une question humaine – et compliqué pour le laisser entre les mains des politiques et autres experts qui le rabaissent à la seule dimension statistique, elle-même ravalée à une vulgaire addition de bistro. En fait, derrière ces chiffres, grossiers et/ou fantaisistes, se cachent des mécanismes complexes et une histoire pour le coup quasi linéaire. Au fondement de ces chiffres rabâchés à longueur de temps et de tribune, qui agitent régulièrement l’inconscient collectif, il y eut (et il y a) la fécondité puis la race ! C’est ce que montre Hervé Le Bras qui, dans L’Invention de l’immigré, interroge les notions d’ « immigrant », d’ « immigré », d’ « étranger », remonte leur généalogie, traque les idéologies (et oui !) qui ont présidé à leur genèse, jauge les outils statistiques (et politiques) au regard de leur pseudo neutralité scientifique… C’est finalement un coup de gueule que pousse le docte démographe contre… la démographie, ou plutôt le rôle prépondérant qu’elle tient aujourd’hui dans « cette simplification des idées sur la migration ». Un coup de gueule aussi contre une certaine « idéologie molle » qui depuis des décennies gangrène le débat, phagocyte l’entendement sur les questions migratoires et empêche la société d’aller de l’avant en distillant doutes et surtout craintes en matière d’immigration. « Ne craignez rien ! » dit le démographe il n’y a pas et il n’y aura pas d’invasion et l’immigration d’aujourd’hui n’a rien à voir avec l’immigration de papa. Marocain et batave d’adoption, Fouad Laroui est ingénieur de formation, docteur en sciences économiques, installé à Amsterdam où après y avoir enseigné l'économétrie puis les sciences de l'environnement, il professe aujourd’hui la littérature. Son premier roman, Les Dents du topographe (Julliard, 1996) lui valut le Prix Découverte Albert Camus, deux ans plus tard il reçoit le prix Méditerranée des Lycées et le prix Beur FM pour De quel amour blessé (Julliard). Auteur prolixe, son sixième roman Une année chez les Français (Julliard 2010) est retenu parmi la première sélection du Prix Goncourt.Il est aussi l’auteur de nombreux recueils de nouvelles et de chroniques dont Des Bédouins dans le polder. Histoires tragi-comiques de l’émigration (Zellige, 2010) ou Le Jour où j’ai déjeuné avec le Diable (Zellige, 2011).
Marocain et batave d’adoption, Fouad Laroui est ingénieur de formation, docteur en sciences économiques, installé à Amsterdam où après y avoir enseigné l'économétrie puis les sciences de l'environnement, il professe aujourd’hui la littérature. Son premier roman, Les Dents du topographe (Julliard, 1996) lui valut le Prix Découverte Albert Camus, deux ans plus tard il reçoit le prix Méditerranée des Lycées et le prix Beur FM pour De quel amour blessé (Julliard). Auteur prolixe, son sixième roman Une année chez les Français (Julliard 2010) est retenu parmi la première sélection du Prix Goncourt.Il est aussi l’auteur de nombreux recueils de nouvelles et de chroniques dont Des Bédouins dans le polder. Histoires tragi-comiques de l’émigration (Zellige, 2010) ou Le Jour où j’ai déjeuné avec le Diable (Zellige, 2011).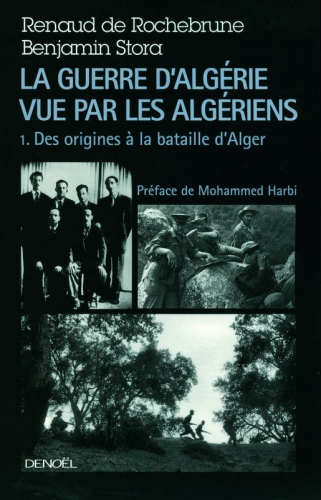 Il y aurait-il un art algérien de la guerre, pour paraphraser le remarquable L’Art français de la guerre (Gallimard 2011) signé
Il y aurait-il un art algérien de la guerre, pour paraphraser le remarquable L’Art français de la guerre (Gallimard 2011) signé  Ainsi, connaît-on en France les horreurs commises en Algérie au nom de la mission civilisatrice par les troupes de Bugeaud ? Sait-on combien de morts sont à mettre au crédit de ce que les Algériens appelèrent la « syphilisation » ? Entre les années 1830 et 1870, il y eut entre un et trois millions de morts selon les sources, soit entre un tiers et les deux tiers de la population globale, suivant là encore des estimations.
Ainsi, connaît-on en France les horreurs commises en Algérie au nom de la mission civilisatrice par les troupes de Bugeaud ? Sait-on combien de morts sont à mettre au crédit de ce que les Algériens appelèrent la « syphilisation » ? Entre les années 1830 et 1870, il y eut entre un et trois millions de morts selon les sources, soit entre un tiers et les deux tiers de la population globale, suivant là encore des estimations. Directeur de recherche au CNRS, auteur de L'Etat en Afrique (Fayard 1979), de L’Illusion identitaire (Fayard, 1996), de La Politique du ventre (Fayard, 2006), de L’Islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar (Albin Michel, 2010), Jean-François Bayart se livre ici à une descente (argumentée) en flèche, une critique tous azimuts des études postcoloniales en France. Ce courant en vogue dans l’Hexagone depuis les années 90 voit « dans la "situation coloniale" et dans sa reproduction l’origine et la cause des rapports sociaux contemporains, qu’ils soient de classe, de genre ou d’appartenance communautaire, tant dans les anciennes colonies que dans les anciennes métropoles » selon la définition de l’auteur.
Directeur de recherche au CNRS, auteur de L'Etat en Afrique (Fayard 1979), de L’Illusion identitaire (Fayard, 1996), de La Politique du ventre (Fayard, 2006), de L’Islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar (Albin Michel, 2010), Jean-François Bayart se livre ici à une descente (argumentée) en flèche, une critique tous azimuts des études postcoloniales en France. Ce courant en vogue dans l’Hexagone depuis les années 90 voit « dans la "situation coloniale" et dans sa reproduction l’origine et la cause des rapports sociaux contemporains, qu’ils soient de classe, de genre ou d’appartenance communautaire, tant dans les anciennes colonies que dans les anciennes métropoles » selon la définition de l’auteur. Laura Reeck est professeure de français à l’Allegheny College de Meadville (Pennsylvanie). Elle publie ici son premier ouvrage consacré à quelques écrivains français classés - relégués ? - par la doxa dans le rayon des auteurs « beurs » ou « écrivains de banlieue ». A chacun, elle consacre un chapitre. Elle ne se contente pas d’y analyser les œuvres des uns et des autres mais se livre également à des mises en perspectives théoriques, sociales et biographiques. Elle illustre ainsi, avec rigueur et conviction, la fameuse opinion qui veut que la littérature en dise plus sur nos sociétés et sur leur devenir que nombre de doctes traités, lourdement lestés de statistiques. A l’ère du chiffre-roi, les poètes ne seraient pas tout à fait morts…
Laura Reeck est professeure de français à l’Allegheny College de Meadville (Pennsylvanie). Elle publie ici son premier ouvrage consacré à quelques écrivains français classés - relégués ? - par la doxa dans le rayon des auteurs « beurs » ou « écrivains de banlieue ». A chacun, elle consacre un chapitre. Elle ne se contente pas d’y analyser les œuvres des uns et des autres mais se livre également à des mises en perspectives théoriques, sociales et biographiques. Elle illustre ainsi, avec rigueur et conviction, la fameuse opinion qui veut que la littérature en dise plus sur nos sociétés et sur leur devenir que nombre de doctes traités, lourdement lestés de statistiques. A l’ère du chiffre-roi, les poètes ne seraient pas tout à fait morts… C’est un long et riche entretien que donnent ici Yves Lacoste, géographe, historien, célèbre figure de proue de la géopolitique française et fondateur en 1976 de la revue Hérodote et Pascal Lorot, président de l’institut Choiseul et directeur des revues Géoéconomie et Sécurité globale. Riche parce que les discussions portent aussi bien sur la vie d’Yves Lacoste depuis l’origine quercynoise de la famille, les amis, ses lectures jusqu’au Maroc natal et les nombreux pays visités, pays d’études ou de résidence, en passant par les domaines de recherche de l’universitaire et les controverses qui ont émaillé plus de cinquante ans de vie intellectuelle hexagonale, de la question coloniale au récent débat sur l’identité et la nation.
C’est un long et riche entretien que donnent ici Yves Lacoste, géographe, historien, célèbre figure de proue de la géopolitique française et fondateur en 1976 de la revue Hérodote et Pascal Lorot, président de l’institut Choiseul et directeur des revues Géoéconomie et Sécurité globale. Riche parce que les discussions portent aussi bien sur la vie d’Yves Lacoste depuis l’origine quercynoise de la famille, les amis, ses lectures jusqu’au Maroc natal et les nombreux pays visités, pays d’études ou de résidence, en passant par les domaines de recherche de l’universitaire et les controverses qui ont émaillé plus de cinquante ans de vie intellectuelle hexagonale, de la question coloniale au récent débat sur l’identité et la nation.  Face à face l’historien et le journaliste. Le temps long et l’actualité. Ce sont deux regards sur le monde qui se déploient ici. D’un côté l’œil pétillant, perçant, curieux de l’homme d’information, de l’autre, le regard calme, attentif, presque introspectif de l’universitaire. Deux intelligences aussi, l’une plus théorique,
Face à face l’historien et le journaliste. Le temps long et l’actualité. Ce sont deux regards sur le monde qui se déploient ici. D’un côté l’œil pétillant, perçant, curieux de l’homme d’information, de l’autre, le regard calme, attentif, presque introspectif de l’universitaire. Deux intelligences aussi, l’une plus théorique, 
 Nos deux auteurs se sont, pendant plus d’un an, immergés dans l’univers antillais francilien : chatoiement des madras, velouté et volupté des danses caraïbéennes, force et parfum du ti punch, acras appétissants et roboratif boudin, rendez-vous festifs mais aussi mémoriels et enfin des dizaines de rencontres qui font sans doute le sel de cette initiative. Cela donne un livre-album à la tonalité « amicale », presque « familiale » : les photos sont pour la plupart des portraits, accompagnés de quelques scènes collectives : fêtes, manifestations publiques ou solennelles commémorations. Le tout offre autant de rendez-vous riches en émotion et convivialité. Les dix-huit témoignages, écrit à la première personne, ajoutent au sentiment d’intimité. Ces hommes et ces femmes sont responsables associatifs, élus locaux ou national (Christiane Taubira), artiste-peintre, travailleur social, enseignant, salariés de la Ratp, de La Poste ou retraités. En quelques pages, ils racontent leur arrivée « en France », livrent un peu d’eux-mêmes et de leurs préoccupations, tracent le trait d’une trajectoire existentielle qui a connu des hauts et des bas.
Nos deux auteurs se sont, pendant plus d’un an, immergés dans l’univers antillais francilien : chatoiement des madras, velouté et volupté des danses caraïbéennes, force et parfum du ti punch, acras appétissants et roboratif boudin, rendez-vous festifs mais aussi mémoriels et enfin des dizaines de rencontres qui font sans doute le sel de cette initiative. Cela donne un livre-album à la tonalité « amicale », presque « familiale » : les photos sont pour la plupart des portraits, accompagnés de quelques scènes collectives : fêtes, manifestations publiques ou solennelles commémorations. Le tout offre autant de rendez-vous riches en émotion et convivialité. Les dix-huit témoignages, écrit à la première personne, ajoutent au sentiment d’intimité. Ces hommes et ces femmes sont responsables associatifs, élus locaux ou national (Christiane Taubira), artiste-peintre, travailleur social, enseignant, salariés de la Ratp, de La Poste ou retraités. En quelques pages, ils racontent leur arrivée « en France », livrent un peu d’eux-mêmes et de leurs préoccupations, tracent le trait d’une trajectoire existentielle qui a connu des hauts et des bas. Une introduction donne quelques repères historiques, culturels et politiques ainsi qu’un éclairage littéraire fournit par deux textes du chantre de la « Négritude », Aimé Césaire. On aurait aimé qu’une petite place soit faite à des auteurs plus récents et surtout à cet autre sommet de la littérature et de la pensée, Edouard Glissant, dont l’œuvre demeure indispensable.
Une introduction donne quelques repères historiques, culturels et politiques ainsi qu’un éclairage littéraire fournit par deux textes du chantre de la « Négritude », Aimé Césaire. On aurait aimé qu’une petite place soit faite à des auteurs plus récents et surtout à cet autre sommet de la littérature et de la pensée, Edouard Glissant, dont l’œuvre demeure indispensable. Karine Berger et Valérie Rabault sont aujourd’hui députées socialistes. La première élue des Hautes Alpes la seconde du Tarn et Garonne et tout nouveau rapporteur général du budget à l'Assemblée. Toutes deux se trouvent aux avants postes de la fronde, à tout le moins des tentatives de bémol apportées par quelques députés socialistes au plan d’économies de 50 milliards défendu par le Premier ministre. Discussion et vote prévus mardi 29 avril à l’Assemblée nationale.
Karine Berger et Valérie Rabault sont aujourd’hui députées socialistes. La première élue des Hautes Alpes la seconde du Tarn et Garonne et tout nouveau rapporteur général du budget à l'Assemblée. Toutes deux se trouvent aux avants postes de la fronde, à tout le moins des tentatives de bémol apportées par quelques députés socialistes au plan d’économies de 50 milliards défendu par le Premier ministre. Discussion et vote prévus mardi 29 avril à l’Assemblée nationale.