Jean Paul Gourévitch, L’Immigration ça coûte ou ça rapporte ?
Michèle Tribalat, Les Yeux grands fermés. L’immigration en France
 Il n’est pas d’usage de commencer la recension d’un livre en citant sa concierge ! Pourtant, le livre de Jean-Paul Gourévitch rappelle cette populaire expression selon laquelle « qui veut noyer son chien, l’accuse de la rage ». Monsieur Gourévitch manie la plume avec habileté : il use de la prétérition comme pas deux. Bien sûr ! Qui oserait mettre en doute la bonne volonté et l’absence de partie pris d’un auteur qui, en posant cette candide question, entend, de toute bonne foi, faire le point sur la présence de l’immigration dans ce pays ? Un pays qui s’est construit depuis au moins deux siècles par et avec l’immigration. Un pays dont les sillons ont été abreuvés du sang et de la sueur de millions d’immigrés aussi profondément que du « sang impur » des illustres petits-fils et arrières petits-fils du Gaulois Vercingétorix ; dont les ancêtres venaient eux aussi d’ailleurs. De cela et de tant d’autres choses, l’esprit comptable ne tient pas compte. Reconnaissons le : tout ne peut être enfermé dans des formules algébriques. « De fait, reconnait l’auteur, les hommes politiques d’extrême droite ont été les premiers à soulever la question des coûts de l’immigration. Leur discours visait explicitement à contingenter voire à supprimer l’immigration. »
Il n’est pas d’usage de commencer la recension d’un livre en citant sa concierge ! Pourtant, le livre de Jean-Paul Gourévitch rappelle cette populaire expression selon laquelle « qui veut noyer son chien, l’accuse de la rage ». Monsieur Gourévitch manie la plume avec habileté : il use de la prétérition comme pas deux. Bien sûr ! Qui oserait mettre en doute la bonne volonté et l’absence de partie pris d’un auteur qui, en posant cette candide question, entend, de toute bonne foi, faire le point sur la présence de l’immigration dans ce pays ? Un pays qui s’est construit depuis au moins deux siècles par et avec l’immigration. Un pays dont les sillons ont été abreuvés du sang et de la sueur de millions d’immigrés aussi profondément que du « sang impur » des illustres petits-fils et arrières petits-fils du Gaulois Vercingétorix ; dont les ancêtres venaient eux aussi d’ailleurs. De cela et de tant d’autres choses, l’esprit comptable ne tient pas compte. Reconnaissons le : tout ne peut être enfermé dans des formules algébriques. « De fait, reconnait l’auteur, les hommes politiques d’extrême droite ont été les premiers à soulever la question des coûts de l’immigration. Leur discours visait explicitement à contingenter voire à supprimer l’immigration. »
Pour autant, « l’information sur les coûts (…) peut-être utile aussi bien à ceux qui favorisent ou considèrent comme un fait acquis le développement (sic) de l’immigration dans la société française qu’à ceux qui souhaitent l’encadrer, la freiner, voire inverser le cours de l’histoire en encourageant les retours au pays ou l’immigration du Nord vers le Sud. » Que les mauvais esprits n’imaginent pas là justement une prétérition, l’art de se mouiller sans prendre une goutte d’eau. Non ! Monsieur Gourévitch appartient peut-être et tout simplement à son temps : le chiffre est omniscient et la suspicion généralisée. Ils tiennent lieu de politique et de savoir-vivre, ce sont là les nouveaux fondements du vivre ensemble.
Mais puisque le président Mitterrand lui-même aurait prédit qu’après lui il n’y aurait que des comptables, eh bien! comptons ! Première surprise à la lecture du livre dont le titre invite à fouiller son porte-monnaie, seuls deux chapitres sur les cinq (faisons grâce de l’intro et de la conclusion) sont là pour tenir la caisse. Il faut dire que l’auteur, et là il est convainquant, commence par recadrer les débats, rappeler quelques définitions, il contextualise et explique sa méthode. Moins convainquant sont les deux derniers chapitres où il évoque « les coûts immatériels » divisés en « défis » (les migrations illégales le racisme et la xénophobie, l’islam, l’échec du métissage social et les risques de ghettoïsation) et en « promesses » qui sonnent parfois comme autant de « défis » : la jeunesse de la population immigrée, l’accès au pouvoir des élites de la diversité, l’importance et le rôle des diasporas en matière d’intégration et d’aide au pays d’origine, la reconnaissance de la diversité culturelle et l’apparition d’une culture alternative.
Autre surprise : qui sont les « immigrés » pour monsieur Gourévitch ? Les immigrés de plus de 18 ans : 4,87 millions ; les enfants d’immigrés de moins de 18 ans nés en France (eh oui) qu’il estime selon une extrapolation personnelle à 2,21 millions et enfin « la population immigrée en situation illégale » estimée, elle, à 535 000. Résultat, pour M. Gourévitch il y aurait en France 7,54 millions d’hommes, de femmes et d’enfants d’origine étrangère soit 12,08 % de la population totale et l’auteur de souligner « on notera que les communautés maghrébines (3,4 millions de membres) et d’Afrique subsaharienne (2,4 millions de membres) représentent à elles deux 5,8 millions de personnes, soit les trois quarts de la population d’origine étrangère et près de 10% de l’ensemble de la population nationale ». Peut lui chaut qu’environ 40% des immigrés sont français par la loi, que les enfants d’immigrés vont se fondre dans le devenir national, ce ne sont, semble-t-il, en fait et en chiffres, que des « Français de papiers », des Français de seconde zone, des Français « entièrement à part », le second collège de la communauté nationale ! Et pourquoi alors ne pas remonter plus avant et compter tous ces Français d’origine étrangère qui étaient, a minima et selon Michèle Tribalat, quelques 14 millions en 1999 ?
Alors ? Les chiffres donc ! Plus exactement « LE » chiffre. Celui qui court sur les blogs et autres forums de discussions. « Eh ! L’immigration ! ça coûte ou sa rapporte ? » Et bien l’immigration, d’après les calculs de monsieur Gourévitch, ça coûte et comme diraient les jeunes de banlieues : « ça coûte grave ! » : 27 milliards d’euros de déficit annuel sans compter les quelques 10 milliards d’euros recensés par l’auteur au titre d’investissements pour réduire la facture « immigration » : l’Aide publique au développement et la politique d’intégration qui comprend le budget de la politique de la ville, celui de l’Education pour les ZUS et autre dépenses de santé (AME).
Pour arriver à ces 27 milliards d’euros, monsieur Gourévitch se veut exhaustif, scientifique, mesuré. Il manie ces chiffres comme de la dynamite, il met des gants, utilise des baguettes et tout le toutim. Et quand il ne possède pas de données ou des approximations nationales, il extrapole à partir de la Seine Saint-Denis, le 93 donc, le 9-3. Le sujet est explosif !
Résumons : côté coût l’auteur arrive à la somme de 72 milliards d’euros. Il additionne les coûts en matière de sécurité et de budget ministériel (5,2 milliards), les coûts de la fraude fiscale (13,6 milliards y compris la contrefaçon et la resquille à la RATP !), le coût de la protection sociale (51,6 milliards, dont plus de 20 milliards pour des dépenses de santé que l’auteur suppose au même niveau que l’autochtone et plus de 16 milliards au titre des prestations vieillesse), enfin il retient des coûts éducatifs pour les étudiants étrangers (1,8 milliard d’euros, des étudiants que bien des pays développés cherchent à attirer chez eux, on se demande pourquoi ?).
Quid des recettes ? Elles s’élèveraient à 45,2 milliards d’euros. Elles comprennent un peu plus de 12 milliards de contributions sociales et 33,2 milliards de recettes fiscales (dont 16,7 milliards de TVA et 6,8 milliards de fiscalité locale).
Premier constat, sauf erreur, monsieur Gourévitch additionne torchons et serviettes. En l’occurrence contribuables et salariés. Il y a d’un côté la fiscalité, ce que chaque contribuable paie en impôt à l’Etat ou aux collectivités locales, quand ils ne s’esbignent pas à l’étranger, et de l’autre le Régime général (avec ses branches « maladie », « vieillesse », « famille »…) et le régime d’assurance chômage dont les caisses sont alimentées par les cotisations sociales acquittées notamment par les salariés et leurs employeurs.
Qu’apporte cette distinction ? Elle montre d’abord que sur le plan fiscal, et compte tenu même des chiffres de monsieur Gourévitch, l’immigration rapporte (12,3 milliards). La somme des dépenses (sécurité, ministère, fraudes fiscales et autres cout éducatifs) s’élève à 20,7 milliards là où les contributions fiscales dépassent les 33 milliards d’euros.
Elle montre aussi que le « déficit d’exploitation » de l’entreprise « immigration » porte sur les dépenses sociales et notamment sur les dépenses de santé et de vieillesse.
Elle montre enfin que, et toujours selon les chiffres de monsieur Gourévitch, les 51,6 milliards de dépenses au titre de la protection sociale correspondent à 9,8 % des 526,2 millions des dépenses nationales donc, en deçà des 12,08 % de la population d’origine étrangère ici comptabilisée et même légèrement en deçà des 10% des seules « communautés maghrébines et d’Afrique subsaharienne » qu’affectionne l’auteur. Si, à croire notre auteur, le budget des dépenses sociales des populations d’origine étrangères est déficitaire, il ne l’est pas outre mesure. Il participe, à hauteur de son poids démographique, au déficit général : alors sont ce les immigrés et demain peut-être les retraités, les malades, les actifs, les femmes ou les jeunes qui sont responsables ou la logique et les ressorts d’un système qui a besoin d’être redynamisé ? Et en matière d’immigration, ne conviendrait-il pas aussi de se pencher sur l’efficacité des politiques mises en œuvres depuis des décennies ? C’est d’ailleurs une initiative prise par des députés de l’opposition mais aussi de la majorité, en lançant « un audit de la politique d’immigration ».
Non ! Monsieur Gourévitch, lui, insiste : « une analyse plus fine montrerait que ce sont les familles originaires du continent africain qui génèrent la presque totalité du déficit des comptes de l’Etat. C’est aussi la population la plus touché par le chômage, qui a le plus faible taux d’activité, le moins de revenus et le plus grand nombre d’enfants ». A ce compte, les chiffres étant de dociles marionnettes aux mains d’habiles ventriloques, on finirait pas applaudir à la récente proposition des 125 députés algériens visant à criminaliser le colonialisme ou les militants qui en appellent à l’ouverture d’un fonds de compensation pour les descendants de victimes de l’esclavage et du colonialisme.
L’auteur aurait peut-être pu orienter la réflexion en ce qui concerne les étrangers et autres immigrés, tenter d’expliquer des situations particulières. Non ! Rien sur le vieillissement d’une population qui, avant de subir le poids de l’âge, a été jeune et dynamique, a travaillé (et cotisé !) et qu’on est même parfois allez « recruter » de l’autre côté de la Méditerranée ou en Asie (voir le récent livre de Pierre Daum, Immigrés de force. Les travailleurs indochinois en France 1939-1952 paru chez Solin-Actes-Sud). Rien sur les heures de travail et les heures supplémentaires non déclarées par les employeurs comme témoignent aujourd’hui d’honorables chibanis. Rien sur l’espérance de vie des immigrés comparée à la moyenne nationale. Rien ou pas grand chose sur les emplois et le niveau des rémunérations des immigrés qui pourrait éclairer le faible volume des cotisations sociales. Rien non plus sur le travail clandestin (Gourévitch estime tout de même le manque à gagner en cotisations à 7,1 milliards d’euros) qui est moins le résultat d’un choix que d’une situation souvent imposée. Rien ou si peu sur les discriminations pour expliquer les taux d’inactivité et de chômage. Rien sur les quelques sept millions d’emplois qui sont fermés aux étrangers non communautaires. Rien sur les conditions de travail et cette aujourd’hui fameuse « pénibilité » qui pourraient expliquer bien des problèmes de santé (monsieur Gourévitch chiffre bien le « stress » que l’immigration causerait spécifiquement aux forces de l’ordre, policiers et gendarmes, soit 79,6 millions d’euros). Rien sur les allégements des charges sur les bas salaires payées par les entreprises et son incidence sur le montant des cotisations, rien demain sur le manque à gagner pour les caisses de l’auto-entreprenariat, etc.
 Mais le plus troublant, c’est sans doute l’originalité des conclusions et de la démarche de l’auteur. A lire Les Yeux grands fermés, le dernier livre de Michèle Tribalat, auteur rigoureux, qui ne dédaigne pas croiser le fer et que l’on ne peut soupçonner « d’immigrationnisme », force est de constater que toutes les études sur ces questions, études européennes ou nord-américaines, en arrivent à la conclusion que les incidences de l’immigration sur les comptes publiques, mais aussi sur la croissance, sont quasi inexistantes, dérisoires, marginales. « Globalement, qu’il soit positif ou négatif, l’effet sur les finances publiques est faible, quel que soit le scénario » (page 92).
Mais le plus troublant, c’est sans doute l’originalité des conclusions et de la démarche de l’auteur. A lire Les Yeux grands fermés, le dernier livre de Michèle Tribalat, auteur rigoureux, qui ne dédaigne pas croiser le fer et que l’on ne peut soupçonner « d’immigrationnisme », force est de constater que toutes les études sur ces questions, études européennes ou nord-américaines, en arrivent à la conclusion que les incidences de l’immigration sur les comptes publiques, mais aussi sur la croissance, sont quasi inexistantes, dérisoires, marginales. « Globalement, qu’il soit positif ou négatif, l’effet sur les finances publiques est faible, quel que soit le scénario » (page 92).
Et côté méthode, Michèle Tribalat s’appuie sur des études autrement sérieuses. Même si la multiplication des hypothèses fragilise d’autant les résultats de ces modèles économétriques, les économistes et autres démographes cités prennent en compte, eux, bien des variables pour déterminer l’effet de l’immigration sur les comptes publiques, sur la richesse nationale ou sur les salaires : nombre de générations, distinction entre le court et le long terme, caractéristiques des différentes immigrations, niveau de qualification, âge, sexe, taux d’emploi, fixité ou non de certaines dépenses publiques (comme le budget de la défense), âge d’arrivée dans le pays d’accueil, comportement d’épargne, de consommation etc. Finalement, comme l’écrit Michèle Tribalat « l’immigration prise globalement, ça n’existe pas ». Des distinctions sont à opérer dans le temps, entre les différentes vagues d’immigration comme dans les caractéristiques de chaque migration. Elle rappelle notamment que le niveau de qualification détermine des différences en terme de taux d’emploi et de niveau de rémunération qui expliquent à leur tour, les incidences positives ou négatives sur les comptes de la nation. Rien de vraiment surprenant en soi.
En résumé, à la différence des conclusions de monsieur Gourévitch, pour Michèle Tribalat, l’immigration ne rapporterait rien… mais ne coûterait rien non plus. Ces modèles d’une autre complexité, ces équations aux multiples variables finissent par faire ressembler les comptes de monsieur Gourévitch à des additions sur un coin de nappe en papier(1).
Conséquente avec elle-même, Mme Tribalat en tire comme enseignement le fait que si l’immigration n’est ni une charge ni une aubaine, on ne peut dès lors prétendre que les immigrés seraient la solution aux problèmes du financement des retraites, au vieillissement de l’Europe ou un recours pour « booster » la croissance. Monsieur Gourévitch lui, cherche au contraire, une solution.
« L’immigration apparaît comme une charge financière pour l’Etat qui l’accueille (sic) » une charge de 37,7 milliards (27,075 milliards + 10,245 milliards au titre des dépenses d’investissement en intégration et en APD). Alors l’auteur y va de ses propositions pour parvenir à équilibrer les comptes et sans doute justifier la présence de ces hommes et de ces femmes venus d’ailleurs. Pour combler les déficits, il retient quatre hypothèses : réduire le chômage des immigrés (1 point par an), augmenter le revenu de la population immigrée (+ 1% par an), faire venir 100 000 nouveaux migrants de plus de 18 ans, célibataires bien sûr, et actifs (mais il faudrait 7 millions d’immigrés et attendre … 70 ans) ou régulariser chaque année quelques 30 000 Sans-papier, toujours célibataires et toujours aussi vaillants ! A l’arrivée il faudrait régulariser plus d’1,3 millions de Sans-papiers et attendre 44 ans pour, selon l’auteur, résorber le déficit initial.
Comme tous ces scénarios sont irréalistes, absurdes ou insuffisants en soi, pourquoi ne pas les combiner ? Il ne faudrait plus alors que huit années pour rétablir les comptes de l’immigration, et pour le reste, faire baisser le chômage, augmenter les rémunérations, facile, non ? Après la prétérition, monsieur Gourévitch qui vient de participer aux « assises contre l’islamisation de l’Europe » organisées par les associations Riposte laïque et le Bloc identitaire, devient un maître de l’apagogie ! Puisqu’il ne peut ou ne veut dire ouvertement que les immigrés seraient une charge pour les Français pure sucre, il démontre, sans en avoir l’air, qu’aucune solution n’existe pour retourner la situation. Alors que fait-on de ces pauvres bougres, Français de papiers et autres étrangers ?
 Sur ce sujet, Abdelmalek Sayad écrivait : « rationaliser dans le langage de l’économie un problème qui n’est pas (ou pas seulement) économique mais politique, revient à convertir en arguments purement techniques des arguments éthiques et politiques. » Et pour être tout à fait clair, il ajoutait : « l’exercice comptable (…) ne saurait se réduire à ce qu’il croit et veut être, une simple technique visant à « rationaliser les choix » des décisions à prendre. Parce qu’il s’applique à une population jouissant d’un statut particulier, il n’a rien de commun avec tel ou tel exercice analogue portant sur un autre groupe : alors que, quand il s’agit, par exemple, de la petite enfance, des jeunes ou des personnes âgées, la question posée est seulement de prévoir et de dégager les moyens que requiert le traitement qu’on veut réserver à la population concernée, dans le cas de la population immigrée, il s’agit de juger des profits et des coûts qui consiste à recourir à l’immigration, c’est-à-dire de l’existence ou de la « disparition » de la population immigrée. » Sayad le disait mieux, beaucoup mieux. Mais il ne disait pas autre chose que ce que dit ma concierge !
Sur ce sujet, Abdelmalek Sayad écrivait : « rationaliser dans le langage de l’économie un problème qui n’est pas (ou pas seulement) économique mais politique, revient à convertir en arguments purement techniques des arguments éthiques et politiques. » Et pour être tout à fait clair, il ajoutait : « l’exercice comptable (…) ne saurait se réduire à ce qu’il croit et veut être, une simple technique visant à « rationaliser les choix » des décisions à prendre. Parce qu’il s’applique à une population jouissant d’un statut particulier, il n’a rien de commun avec tel ou tel exercice analogue portant sur un autre groupe : alors que, quand il s’agit, par exemple, de la petite enfance, des jeunes ou des personnes âgées, la question posée est seulement de prévoir et de dégager les moyens que requiert le traitement qu’on veut réserver à la population concernée, dans le cas de la population immigrée, il s’agit de juger des profits et des coûts qui consiste à recourir à l’immigration, c’est-à-dire de l’existence ou de la « disparition » de la population immigrée. » Sayad le disait mieux, beaucoup mieux. Mais il ne disait pas autre chose que ce que dit ma concierge !
1- Mentionnons aussi le rapport dirigé par le professeur X. Chojnicki, maître de conférence à Lille 2, remis en juillet 2010 au ministère des Affaires sociales qui aboutit lui, pour l’année 2005, à un impact positif de l'immigration sur le budget de 4 milliards d'euros...
Édition Larousse. Collection « À dire vrai », 2009, 160 pages, 9, 90 €
Édition Denoël, 2010, 222 pages, 19 €
 L’année 1998 voit l’équipe nationale de football remporter pour la première fois la coupe du monde. Victoire tricolore dans une France Black-Blanc-Beur pour les uns, victoire Black-Blanc-Beur dans une France tricolore pour les autres. L’événement constitue un moment fort de l’état des relations interculturelles dans l’hexagone, un moment riche aussi d’ambiguïtés. Yves Gastaut lui donne ici à la fois de la perspective historique et le recul que lui confère le fait d’écrire dix ans après. L’auteur, chercheur et maître de conférence à l’université de Nice, s’arme d’une revue de presse conséquente.
L’année 1998 voit l’équipe nationale de football remporter pour la première fois la coupe du monde. Victoire tricolore dans une France Black-Blanc-Beur pour les uns, victoire Black-Blanc-Beur dans une France tricolore pour les autres. L’événement constitue un moment fort de l’état des relations interculturelles dans l’hexagone, un moment riche aussi d’ambiguïtés. Yves Gastaut lui donne ici à la fois de la perspective historique et le recul que lui confère le fait d’écrire dix ans après. L’auteur, chercheur et maître de conférence à l’université de Nice, s’arme d’une revue de presse conséquente.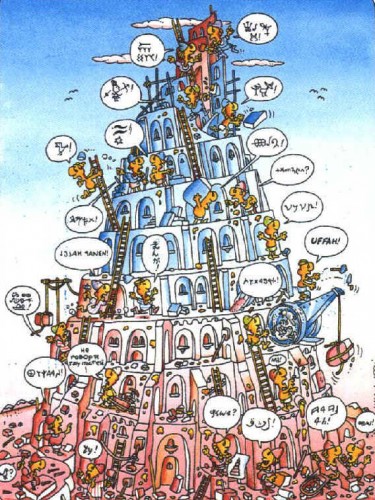 Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation.
Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation. Éric Savarèse, docteur en science politique, remonte aux sources de l’invention de l’étranger pour décrypter comment la peur de l’étranger se projette aujourd’hui sur l’immigré et, tout particulièrement, sur le Maghrébin. En somme et après d’autres études, il rappelle que nombre de stéréotypes dont l’immigré est affublé trouvent leur origine dans ceux qui hier stigmatisaient l’indigène, le colonisé. Il puise dans la littérature et la presse coloniales et surtout dans le cinéma hexagonal et ses réalisations récentes marquées par l’émergence de cinéastes maghrébins et Français d’origine immigrée pour y débusquer ces représentations de l’Autre mais aussi leur dénonciation.
Éric Savarèse, docteur en science politique, remonte aux sources de l’invention de l’étranger pour décrypter comment la peur de l’étranger se projette aujourd’hui sur l’immigré et, tout particulièrement, sur le Maghrébin. En somme et après d’autres études, il rappelle que nombre de stéréotypes dont l’immigré est affublé trouvent leur origine dans ceux qui hier stigmatisaient l’indigène, le colonisé. Il puise dans la littérature et la presse coloniales et surtout dans le cinéma hexagonal et ses réalisations récentes marquées par l’émergence de cinéastes maghrébins et Français d’origine immigrée pour y débusquer ces représentations de l’Autre mais aussi leur dénonciation.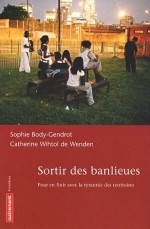 De quelle « tyrannie » parlent S. Body-Gendrot, professeur et directrice d'études urbaines à l'université Sorbonne-Paris IV et C.Wihtol de Wenden directrice de recherche au CNRS, par ailleurs membre du comité de rédaction d'Hommes et Migrations ? Et comment « sortir » de ces banlieues qui occupent les unes de la presse nationale, alimentent parfois les promesses sécuritaires d'estrades électorales et mobilisent les pouvoirs publics depuis près d'une trentaine d'années ? La « tyrannies des territoires » tient dans la contradiction observée par ces deux spécialistes entre les aspirations à la mobilité géographique des individus d'une part et des politiques publiques qui visent à maintenir ces mêmes populations dans ces banlieues d'autre part. Alors que de nombreux pays mettent en place des politiques en direction d'abord des populations, la France privilégierait ses « territoires » : cette politique de « bonnes intentions », « élaborée au sommet de l'Etat à partir d'utopie de mixité sociale est inadaptée à la réalité (beaucoup de familles déménagent dès qu'elles le peuvent). C'est ce que nous appelons la « tyrannie des territoires ».
De quelle « tyrannie » parlent S. Body-Gendrot, professeur et directrice d'études urbaines à l'université Sorbonne-Paris IV et C.Wihtol de Wenden directrice de recherche au CNRS, par ailleurs membre du comité de rédaction d'Hommes et Migrations ? Et comment « sortir » de ces banlieues qui occupent les unes de la presse nationale, alimentent parfois les promesses sécuritaires d'estrades électorales et mobilisent les pouvoirs publics depuis près d'une trentaine d'années ? La « tyrannies des territoires » tient dans la contradiction observée par ces deux spécialistes entre les aspirations à la mobilité géographique des individus d'une part et des politiques publiques qui visent à maintenir ces mêmes populations dans ces banlieues d'autre part. Alors que de nombreux pays mettent en place des politiques en direction d'abord des populations, la France privilégierait ses « territoires » : cette politique de « bonnes intentions », « élaborée au sommet de l'Etat à partir d'utopie de mixité sociale est inadaptée à la réalité (beaucoup de familles déménagent dès qu'elles le peuvent). C'est ce que nous appelons la « tyrannie des territoires ».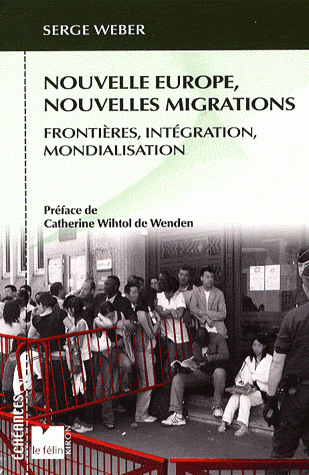 Dans ce petit livre, Serge Weber, maître de conférences en géographie à l'université de Paris-Est présente les nouvelles tendances des migrations internationales et les politiques d'immigration menées par les États européens. Il souligne surtout les contradictions de ces politiques au regard des besoins et tord le coup à quelques idées reçues qui obscurcissent l'entendement et empuantissent certains programmes électoraux.
Dans ce petit livre, Serge Weber, maître de conférences en géographie à l'université de Paris-Est présente les nouvelles tendances des migrations internationales et les politiques d'immigration menées par les États européens. Il souligne surtout les contradictions de ces politiques au regard des besoins et tord le coup à quelques idées reçues qui obscurcissent l'entendement et empuantissent certains programmes électoraux. Ce "voyage" à Dreux par l'auteur de Faire France est une enquête de terrain réalisée en 1997, un important appareil statistique doublé de plus de 200 entretiens. À ces données locales s'ajoutent de nombreuses références à d'autres travaux. Mais l'enquête, qui prend parfois une tournure journalistique, n'est pas une froide recension. Les convictions, le sens de l'engagement et les perspectives avancées par l'auteur enrichissent ce travail. Ainsi, ses critiques de la gestion municipale, de l'image et de l'action de la police, des discriminations sociales et professionnelles ou ses mises en garde, fermes et claires, contre certaines attitudes des jeunes des cités ou organisations musulmanes lui donnent plus de poids. Selon Michèle Tribalat, Dreux, déjà symbolique pour avoir la première ouvert ses portes au FN, "va plus mal que la France en général, son contexte démographique est plus exigeant, la situation sociale plus explosive et la dégradation plus marquée". Avec 36 800 habitants et un taux de chômage estimé à 24,8 % en 1997, Dreux est une ville ouvrière et jeune, marquée par une inquiétante tendance à la paupérisation. Son tissu industriel est non seulement fragile mais aussi dépendant, pour plus de deux tiers de ses emplois, de décisions extérieures. Avec 48,6 %, Dreux enregistre "la plus forte concentration de populations d'origine étrangère". Un tiers de cette population est originaire du Maghreb (19,9 % du Maroc, 8,9 % d'Algérie et 2,2 % de Tunisie), le reste se répartissant entre populations d'origine turque (5,4 %) portugaise (5 %), noire africaine (3,4 %) ou pakistanaise (1,3 %). Dixième circonscription par ordre d'importance du taux de délinquance, estimé à 116 ‰ (contre 60 ‰ en moyenne nationale), à Dreux, "tant en termes d'évolution que de niveau réel, la délinquance s'avère légitimement préoccupante". Rappelant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre immigration et délinquance, Michèle Tribalat souligne que "seule la condition objective de 'nécessité', de 'besoin' reflétée par le taux de chômage se révèle liée au niveau global de délinquance et plus particulièrement à ses composantes prédatrices". La concentration de cette "population d'origine étrangère" est variable. De 15,7 %, dont près de 9 % de population d'origine portugaise dans le centre-ville, elle est, par exemple de 79,1 % dans le quartier des Charmards, dont plus de 45 % de population d'origine marocaine. À cette "segmentation ethnique du territoire", avec au centre les "populations d'origine française" et à la périphérie celles "d'origine étrangère", s'ajoutent les oppositions entre nantis et déshérités, entre vieux et jeunes. "Dreux n'est plus le lieu d'une structure sociale collective cohérente", note Michèle Tribalat, qui montre que cette "segmentation" est devenue constitutive de "l'identité locale, individuelle et collective", au point que l'autorité publique elle-même est perçue comme partie prenante de cette opposition. Plus grave, elle alimente une dangereuse "logique de coupables-victimes" qui, ignorance aidant, conduit à la radicalisation des uns et des autres, à l'exacerbation réciproque d'un racisme anti-arabe et d'un racisme anti-français doublé d'un repli identitaire centré sur la religion musulmane. Dans un chapitre quelque peu caricatural et par trop généraliste, Michèle Tribalat analyse l'influence et la dégradation du modèle parental maghrébin - où le père fait figure de satrape domestique ! - sur le rapport des plus jeunes à l'école et à l'autorité notamment et, de façon plus pertinente, sur l'influence des valeurs transmises au sein des familles sur la vie en société. Distinguant nettement la pratique de la religion, de la "propagande active" d'une doctrine hostile à la séparation du politique et du religieux, l'enquête montre que "l'islamisme est en gestation à Dreux". À l'opposé des conclusions optimistes d'autres travaux (Isabel Taboada-Léonetti ou F. Khosrokhavar), Michèle Tribalat est extrêmement critique quant à l'influence d'associations qui, comme les Jeunes Musulmans de France, distillent "une idéologie islamiste sous le masque de la laïcité". Pour l'auteur, "ces associations n'ont abandonné ni la dimension communautaire, ni le caractère totalisant de la doctrine islamique". L'action de ces structures - comme la sous-traitance des problèmes sociaux confiée par les pouvoirs publics à des médiateurs religieux ou associatifs mal identifiés - aggrave les oppositions et la déréliction du lien social, dont les manifestations sont ici détaillées : tendance au repli sur soi, affaiblissement des contrôles sociaux, non-intériorisation des normes collectives, multiplication des incivilités, désaffiliation institutionnelle... Le tableau présenté ici est sombre, peut-être un peu trop. L'ethnicisation des rapports sociaux, si ce n'est sur Dreux, du moins en France, peut être discutée, voire contestée. Par ailleurs, de ces quartiers émergent aussi des initiatives qui justement recréent des liens sociaux, ce que montre, avec insistance aussi, Michèle Tribalat pour Dreux. Les trop noires perspectives ici esquissées ne sont pas inéluctables, semble dire l'auteur, pour peu que l'on se donne réellement les moyens de comprendre la réalité et surtout d'élaborer des politiques globales. "Penser l'avenir de Dreux, c'est faire des projets pour les jeunes Drouais, aujourd'hui majoritairement d'origine étrangère. À Dreux, on bute encore sur ce fait, qu'on n'arrive pas à dépasser. Mais il nous semble que c'est toute la société française qui bute sur cette réalité. Les enfants des immigrés maghrébins sont partie intégrante du peuple français, et ont une légitimité égale à celle des autres Français." On ne saurait être plus clair et dégager, par l'énoncé de cette évidence, qui n'est pas encore présente dans toutes les têtes, autant de perspectives nouvelles.
Ce "voyage" à Dreux par l'auteur de Faire France est une enquête de terrain réalisée en 1997, un important appareil statistique doublé de plus de 200 entretiens. À ces données locales s'ajoutent de nombreuses références à d'autres travaux. Mais l'enquête, qui prend parfois une tournure journalistique, n'est pas une froide recension. Les convictions, le sens de l'engagement et les perspectives avancées par l'auteur enrichissent ce travail. Ainsi, ses critiques de la gestion municipale, de l'image et de l'action de la police, des discriminations sociales et professionnelles ou ses mises en garde, fermes et claires, contre certaines attitudes des jeunes des cités ou organisations musulmanes lui donnent plus de poids. Selon Michèle Tribalat, Dreux, déjà symbolique pour avoir la première ouvert ses portes au FN, "va plus mal que la France en général, son contexte démographique est plus exigeant, la situation sociale plus explosive et la dégradation plus marquée". Avec 36 800 habitants et un taux de chômage estimé à 24,8 % en 1997, Dreux est une ville ouvrière et jeune, marquée par une inquiétante tendance à la paupérisation. Son tissu industriel est non seulement fragile mais aussi dépendant, pour plus de deux tiers de ses emplois, de décisions extérieures. Avec 48,6 %, Dreux enregistre "la plus forte concentration de populations d'origine étrangère". Un tiers de cette population est originaire du Maghreb (19,9 % du Maroc, 8,9 % d'Algérie et 2,2 % de Tunisie), le reste se répartissant entre populations d'origine turque (5,4 %) portugaise (5 %), noire africaine (3,4 %) ou pakistanaise (1,3 %). Dixième circonscription par ordre d'importance du taux de délinquance, estimé à 116 ‰ (contre 60 ‰ en moyenne nationale), à Dreux, "tant en termes d'évolution que de niveau réel, la délinquance s'avère légitimement préoccupante". Rappelant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre immigration et délinquance, Michèle Tribalat souligne que "seule la condition objective de 'nécessité', de 'besoin' reflétée par le taux de chômage se révèle liée au niveau global de délinquance et plus particulièrement à ses composantes prédatrices". La concentration de cette "population d'origine étrangère" est variable. De 15,7 %, dont près de 9 % de population d'origine portugaise dans le centre-ville, elle est, par exemple de 79,1 % dans le quartier des Charmards, dont plus de 45 % de population d'origine marocaine. À cette "segmentation ethnique du territoire", avec au centre les "populations d'origine française" et à la périphérie celles "d'origine étrangère", s'ajoutent les oppositions entre nantis et déshérités, entre vieux et jeunes. "Dreux n'est plus le lieu d'une structure sociale collective cohérente", note Michèle Tribalat, qui montre que cette "segmentation" est devenue constitutive de "l'identité locale, individuelle et collective", au point que l'autorité publique elle-même est perçue comme partie prenante de cette opposition. Plus grave, elle alimente une dangereuse "logique de coupables-victimes" qui, ignorance aidant, conduit à la radicalisation des uns et des autres, à l'exacerbation réciproque d'un racisme anti-arabe et d'un racisme anti-français doublé d'un repli identitaire centré sur la religion musulmane. Dans un chapitre quelque peu caricatural et par trop généraliste, Michèle Tribalat analyse l'influence et la dégradation du modèle parental maghrébin - où le père fait figure de satrape domestique ! - sur le rapport des plus jeunes à l'école et à l'autorité notamment et, de façon plus pertinente, sur l'influence des valeurs transmises au sein des familles sur la vie en société. Distinguant nettement la pratique de la religion, de la "propagande active" d'une doctrine hostile à la séparation du politique et du religieux, l'enquête montre que "l'islamisme est en gestation à Dreux". À l'opposé des conclusions optimistes d'autres travaux (Isabel Taboada-Léonetti ou F. Khosrokhavar), Michèle Tribalat est extrêmement critique quant à l'influence d'associations qui, comme les Jeunes Musulmans de France, distillent "une idéologie islamiste sous le masque de la laïcité". Pour l'auteur, "ces associations n'ont abandonné ni la dimension communautaire, ni le caractère totalisant de la doctrine islamique". L'action de ces structures - comme la sous-traitance des problèmes sociaux confiée par les pouvoirs publics à des médiateurs religieux ou associatifs mal identifiés - aggrave les oppositions et la déréliction du lien social, dont les manifestations sont ici détaillées : tendance au repli sur soi, affaiblissement des contrôles sociaux, non-intériorisation des normes collectives, multiplication des incivilités, désaffiliation institutionnelle... Le tableau présenté ici est sombre, peut-être un peu trop. L'ethnicisation des rapports sociaux, si ce n'est sur Dreux, du moins en France, peut être discutée, voire contestée. Par ailleurs, de ces quartiers émergent aussi des initiatives qui justement recréent des liens sociaux, ce que montre, avec insistance aussi, Michèle Tribalat pour Dreux. Les trop noires perspectives ici esquissées ne sont pas inéluctables, semble dire l'auteur, pour peu que l'on se donne réellement les moyens de comprendre la réalité et surtout d'élaborer des politiques globales. "Penser l'avenir de Dreux, c'est faire des projets pour les jeunes Drouais, aujourd'hui majoritairement d'origine étrangère. À Dreux, on bute encore sur ce fait, qu'on n'arrive pas à dépasser. Mais il nous semble que c'est toute la société française qui bute sur cette réalité. Les enfants des immigrés maghrébins sont partie intégrante du peuple français, et ont une légitimité égale à celle des autres Français." On ne saurait être plus clair et dégager, par l'énoncé de cette évidence, qui n'est pas encore présente dans toutes les têtes, autant de perspectives nouvelles. Vincent Cespedes est professeur de philosophie « dans un lycée en zone sensible » comme le précise l'éditeur. Si, dans son style décapant et parfois fatigant, il rejoint certaines analyses et conclusions du livre d'Yves Michaud paru la même année (incohérence des mesures, nécessité de la sanction...), il s'en démarque en faisant de la violence la résultante de « la globalisation néo-libérale » et ses conséquences : déshumanisation des rapports ; avènement de « démocraties-marchés » et de régimes ploutocratiques où « l'argent explique, dirige, affirme, impose » ; « marchandisation de l'Etre » ; primat de l'Avoir sur l'Etre... Il y a aussi ce que l'auteur nomme l'«hamstérisation » de la jeunesse où les ravages d'une culture de masse présentée comme un mélange détonant d'américanisation, de manipulation mentale par la pub et la TV, d'idéologie consumériste et d'abrutissement par le culte des nouvelles technologies (la « cybermeute »). Ici, les médias ne sont pas épargnés qui en médiatisant les violences impunies, « loin de les congédier, les entérine et leur donne droit de cité », l'école non plus où se pratiquerait la ségrégation en faveur des élèves nantis, des « Français d'origine française » et « blancs ». Ajoutons à cette liste non exhaustive « le complexe de Brazzaville » du Français moyen « qui peine à considérer Mourad ou Fatou instantanément comme d'authentiques concitoyens, comme des gens pouvant prétendre au pouvoir, comme des supérieurs hiérarchiques légitimes ».
Vincent Cespedes est professeur de philosophie « dans un lycée en zone sensible » comme le précise l'éditeur. Si, dans son style décapant et parfois fatigant, il rejoint certaines analyses et conclusions du livre d'Yves Michaud paru la même année (incohérence des mesures, nécessité de la sanction...), il s'en démarque en faisant de la violence la résultante de « la globalisation néo-libérale » et ses conséquences : déshumanisation des rapports ; avènement de « démocraties-marchés » et de régimes ploutocratiques où « l'argent explique, dirige, affirme, impose » ; « marchandisation de l'Etre » ; primat de l'Avoir sur l'Etre... Il y a aussi ce que l'auteur nomme l'«hamstérisation » de la jeunesse où les ravages d'une culture de masse présentée comme un mélange détonant d'américanisation, de manipulation mentale par la pub et la TV, d'idéologie consumériste et d'abrutissement par le culte des nouvelles technologies (la « cybermeute »). Ici, les médias ne sont pas épargnés qui en médiatisant les violences impunies, « loin de les congédier, les entérine et leur donne droit de cité », l'école non plus où se pratiquerait la ségrégation en faveur des élèves nantis, des « Français d'origine française » et « blancs ». Ajoutons à cette liste non exhaustive « le complexe de Brazzaville » du Français moyen « qui peine à considérer Mourad ou Fatou instantanément comme d'authentiques concitoyens, comme des gens pouvant prétendre au pouvoir, comme des supérieurs hiérarchiques légitimes ». L'opinion est unanime, les violences prennent des proportions inacceptables. Toutes les violences. Des plus anodines, on parle alors d'incivilités (mais ce sont elles qui alimentent ce climat d'insécurité qui empoisonne le quotidien et empuantit les urnes) aux plus monstrueuses, les homicides, les viols et bien sûr les attentats à commencer par ce 11-Septembre. De plus comme chante le poète, « tout fout le camp » : l'autorité est bafouée, la justice encombrée patine, les valeurs sont flouées à qui mieux mieux, la famille se délite, l'école prend des allures de défouloir, les législateurs légifèrent à tire-larigot et paralysent les institutions chargées de la répression... Et comme si cela ne suffisait pas, force est de constater que ce que l'on qualifie plus ou moins pompeusement d'individualisme contemporain, hier, était tout simplement taxé d'égoïsme. Un chacun pour soi qui a tôt fait de transformer notre belle et si vertueuse société, présentée au monde comme un modèle universel, en une jungle ou tous les coups sont permis pour se faire sa petite place au soleil. Cette « impression » générale nous est servie à longueur de colonnes et de journaux télévisés. Tout cela n'est pas totalement faux. Tout cela n'est pas non plus totalement vrai. Qu'importe d'ailleurs, ce qui compte n'est pas le diagnostic - y a-t-il aujourd'hui plus ou moins d'actes violents et de délinquance qu'hier ? - mais le sens, la grille de lecture qui permet à chacun de comprendre cette violence et peut-être d'influer sur ses mécanismes générateurs.
L'opinion est unanime, les violences prennent des proportions inacceptables. Toutes les violences. Des plus anodines, on parle alors d'incivilités (mais ce sont elles qui alimentent ce climat d'insécurité qui empoisonne le quotidien et empuantit les urnes) aux plus monstrueuses, les homicides, les viols et bien sûr les attentats à commencer par ce 11-Septembre. De plus comme chante le poète, « tout fout le camp » : l'autorité est bafouée, la justice encombrée patine, les valeurs sont flouées à qui mieux mieux, la famille se délite, l'école prend des allures de défouloir, les législateurs légifèrent à tire-larigot et paralysent les institutions chargées de la répression... Et comme si cela ne suffisait pas, force est de constater que ce que l'on qualifie plus ou moins pompeusement d'individualisme contemporain, hier, était tout simplement taxé d'égoïsme. Un chacun pour soi qui a tôt fait de transformer notre belle et si vertueuse société, présentée au monde comme un modèle universel, en une jungle ou tous les coups sont permis pour se faire sa petite place au soleil. Cette « impression » générale nous est servie à longueur de colonnes et de journaux télévisés. Tout cela n'est pas totalement faux. Tout cela n'est pas non plus totalement vrai. Qu'importe d'ailleurs, ce qui compte n'est pas le diagnostic - y a-t-il aujourd'hui plus ou moins d'actes violents et de délinquance qu'hier ? - mais le sens, la grille de lecture qui permet à chacun de comprendre cette violence et peut-être d'influer sur ses mécanismes générateurs.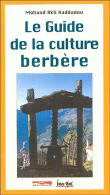 Mohand Akli Haddadou est professeur de lexicologie berbère à l'université de Tizi-Ouzou. Son Guide de la culture berbère est marqué par sa formation : l'ouvrage fourmille d'informations, de données lexicales sur la langue berbère dans ses différentes acceptions : chaoui, chenoui, chleuh, kabyle, mozabite rifain, tamazight, touareg... Il est toujours périlleux de se lancer dans une aventure éditoriale de cette ambition. Ce guide entend fournir aux lecteurs davantage que des petits fascicules comme Les Berbères de G. Camps, mais beaucoup moins qu'une réelle encyclopédie, qui exige d'autres moyens et une théorie de spécialistes, à l'instar de l'Encyclopédie berbère, toujours en cours de parution (ces deux ouvrages sont édités par Édisud). Ainsi, Mohand Akli Haddadou brosse en quelque trois cents pages le tableau des origines et de l'histoire des Berbères, en fait de l'Afrique du Nord jusqu'à la colonisation française, mais aussi des croyances, de l'organisation de la société traditionnelle, des activités quotidiennes, de l'art, de la littérature et de la langue berbères. Se livrer au jeu des absences ou des oublis, qu'une telle initiative induit presque toujours, est inutile. En revanche, la valeur inégale des chapitres ne peut être passée sous silence. Si les pages consacrées aux origines des Berbères - inspirées des travaux et des synthèses de G. Camps - fournissent au lecteur, même néophyte, des indications précieuses, il n'est pas certain que ce dernier ait une vision claire de la partie historique qui, de la fondation de Carthage à la prise d'Alger, brasse plus de 2 600 ans d'histoire en vingt-deux pages. Le récit est événementiel et chronologique, et sans originalité. Il se dérobe à toute logique interprétative qui aurait donné du nerf au texte et matière à réfléchir. N'aurait-il pas été plus pertinent, par exemple, de poser la question du rapport entre les structures traditionnelles de la société berbère et l'incapacité historique à voir émerger des États centralisés et fédérateurs stables ? De faire la part des facteurs endogènes et exogènes qui ont historiquement concouru à l'échec des tentatives d'unification "nationale", à commencer par la première, celle de Massinissa ? De même, aborder comment cette terre berbère est devenue, idéologiquement du moins, le Maghreb arabe, n'aurait pas été déplacé dans le cadre d'un tel guide.
Mohand Akli Haddadou est professeur de lexicologie berbère à l'université de Tizi-Ouzou. Son Guide de la culture berbère est marqué par sa formation : l'ouvrage fourmille d'informations, de données lexicales sur la langue berbère dans ses différentes acceptions : chaoui, chenoui, chleuh, kabyle, mozabite rifain, tamazight, touareg... Il est toujours périlleux de se lancer dans une aventure éditoriale de cette ambition. Ce guide entend fournir aux lecteurs davantage que des petits fascicules comme Les Berbères de G. Camps, mais beaucoup moins qu'une réelle encyclopédie, qui exige d'autres moyens et une théorie de spécialistes, à l'instar de l'Encyclopédie berbère, toujours en cours de parution (ces deux ouvrages sont édités par Édisud). Ainsi, Mohand Akli Haddadou brosse en quelque trois cents pages le tableau des origines et de l'histoire des Berbères, en fait de l'Afrique du Nord jusqu'à la colonisation française, mais aussi des croyances, de l'organisation de la société traditionnelle, des activités quotidiennes, de l'art, de la littérature et de la langue berbères. Se livrer au jeu des absences ou des oublis, qu'une telle initiative induit presque toujours, est inutile. En revanche, la valeur inégale des chapitres ne peut être passée sous silence. Si les pages consacrées aux origines des Berbères - inspirées des travaux et des synthèses de G. Camps - fournissent au lecteur, même néophyte, des indications précieuses, il n'est pas certain que ce dernier ait une vision claire de la partie historique qui, de la fondation de Carthage à la prise d'Alger, brasse plus de 2 600 ans d'histoire en vingt-deux pages. Le récit est événementiel et chronologique, et sans originalité. Il se dérobe à toute logique interprétative qui aurait donné du nerf au texte et matière à réfléchir. N'aurait-il pas été plus pertinent, par exemple, de poser la question du rapport entre les structures traditionnelles de la société berbère et l'incapacité historique à voir émerger des États centralisés et fédérateurs stables ? De faire la part des facteurs endogènes et exogènes qui ont historiquement concouru à l'échec des tentatives d'unification "nationale", à commencer par la première, celle de Massinissa ? De même, aborder comment cette terre berbère est devenue, idéologiquement du moins, le Maghreb arabe, n'aurait pas été déplacé dans le cadre d'un tel guide.