Jean Mattern
Les Bains de Kiraly
 Mémoire et quête des origines sont censées constituer le fil conducteur de ce premier roman, court mais dense, écrit avec élégance et sensibilité par Jean Mattern, par ailleurs directeur de collection chez Gallimard. Mémoire et quête des origines mais aussi et peut-être surtout, les ravages que le silence, les non-dits, les trous de mémoire infligent à une vie. A l’identité qui, pour être un devenir, a aussi besoin de s’accrocher à quelques certitudes.
Mémoire et quête des origines sont censées constituer le fil conducteur de ce premier roman, court mais dense, écrit avec élégance et sensibilité par Jean Mattern, par ailleurs directeur de collection chez Gallimard. Mémoire et quête des origines mais aussi et peut-être surtout, les ravages que le silence, les non-dits, les trous de mémoire infligent à une vie. A l’identité qui, pour être un devenir, a aussi besoin de s’accrocher à quelques certitudes.
De certitudes, Gabriel, le narrateur n’en a aucune. Il ne sait rien des origines judéo-hongroises de sa famille. Et la mort accidentelle de sa sœur a laissé chez l’enfant un vide nourri d’absence et de culpabilité. Le silence de ses parents, ces « blancs », toujours là, enfermeront Gabriel lui-même dans un silence maladif, lesté pour tout héritage paternel de la parole de Job : « Dieu a donné, Dieu a repris ». Un peu court pour faire le deuil de sa sœur, un peu court pour vivre, un peu court pour « être un père pour notre enfant ». Car Gabriel, après s’être réfugié derrière les mots et les langues des autres - comme traducteur -, a cru que la sémillante Laura le convertirait au bonheur. « Et jusqu’à l’annonce de sa grossesse, elle avait presque réussi sa mission. » L’arrivée de cet enfant provoque chez Gabriel un sentiment où la panique se mêle à l’absurdité et au réveil des peurs enfouies. Il s’enfuit, abandonnant épouse, enfant, et l’ami Léo.
Difficile de saisir les ressorts qui poussent Gabriel vers de lointaines et incertaines origines. De deux choses l’une, où ici le livre ne convainc pas ou alors, cette faiblesse indique justement que le véritable propos de l’auteur est ailleurs. « On ne devient pas juif par trois certificats de baptême » dit Gabriel lui-même. Il semble plus instructif alors de déplacer la question : peut-on se remettre d’un défaut de mémoire, d’un traumatisme laissé à vif faute d’attentions, et passer à autre chose, c’est-à-dire rester disponible à la vie ? A soi ? Jean Mattern répond ici par la négative. Faute de savoir que faire de ces « ombres » surgies du passé familial, faute de « comprendre », Gabriel est condamné à l’errance.
Edition Sabine Wespieser 2008, 133 pages, 17€
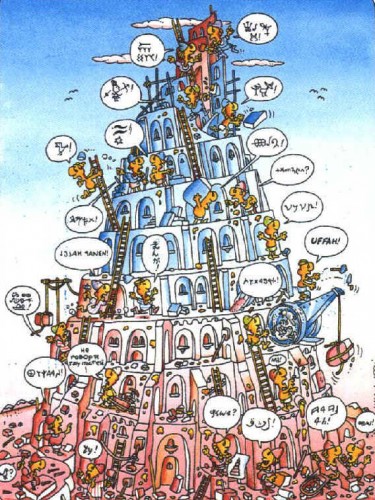 Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation.
Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation. Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2),
Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2),