Brian Chikwava
Harare Nord
 Et si, au Sud comme au Nord, les bringuebalements du monde débouchaient dans une impasse, sans autre issue que la folie ou la mort ? Quid aussi du mythe de l’Eldorado qui flatte tant l’ego des « insiders » ? Ne commencerait-il pas à prendre du plomb dans l’aile ? Du plomb tiré en salves régulières de mots acérés par quelques écrivains visionnaires. A l’instar de ce Brian Chikwava. Londonien, originaire du Zimbabwe, lauréat en 2004 du Caine Prize pour un recueil de nouvelles, il signe avec Harare Nord son premier roman. Ecrit en anglais, il vient confirmer le dynamisme des écrivains africains, qu’ils soient pérégrins ou non.
Et si, au Sud comme au Nord, les bringuebalements du monde débouchaient dans une impasse, sans autre issue que la folie ou la mort ? Quid aussi du mythe de l’Eldorado qui flatte tant l’ego des « insiders » ? Ne commencerait-il pas à prendre du plomb dans l’aile ? Du plomb tiré en salves régulières de mots acérés par quelques écrivains visionnaires. A l’instar de ce Brian Chikwava. Londonien, originaire du Zimbabwe, lauréat en 2004 du Caine Prize pour un recueil de nouvelles, il signe avec Harare Nord son premier roman. Ecrit en anglais, il vient confirmer le dynamisme des écrivains africains, qu’ils soient pérégrins ou non.
C’est d’ailleurs la langue de l’auteur qui, en premier lieu, attire l’attention. Par quelques tournures et formules, Brian Chikwava s’ingénie à rendre l’oralité de ses personnages qui baragouinent un anglais d’immigrés, à la syntaxe malhabile et approximative, aux formes métissées, aux phrases dégraissé mais efficaces. Un Broken (ou Fractured) English, un mauvais anglais, littéralement une langue « cassée », un peu à l’image des personnages de ce livre sombre et ironique, construit sur le mode d’un douloureux mais irrémédiable taraudage concentrique.
Harare Nord est le pendant septentrional d’Harare, la capitale du Zimbabwe. Pour s’extraire du bourbier zambabwéen, le héros sans nom du roman débarque à Londres. Il tient un journal dans lequel il consigne, non sans humour, le récit de sa condition et le regard qu’il porte sur son nouvel environnement, social et humain..
D’entrée, Paul et Sekaï, ses cousins, se montrent hostiles. La solidarité communautaire a ses limites et les « blédards » deviennent vite des importuns. D’ailleurs, les obstacles que les autorités britanniques (ou françaises…) s’échinent à placer sur le chemin des quémandeurs de visa arrangent bien les « Zimbabwéens de Harare Nord », ceux qualifiés ici d’« Africains renégats ».
Mieux vaut se débrouiller seul et rejoindre Shingi, l’ami d’enfance, qui partage un squat avec deux autres types (Aleck et Farayi) et Tsitisune, une jeune fille déjà lesté d’un bébé. « Je peux sniff sniff leurs vies d’indigènes-là accroupis sous leur plafond bas et humide comme des voleurs qui viennent d’être pris ».
Brian Chikwava raconte la vie de ce clandestin zimbabwéen échoué dans le Brixton londonien et interlope des déclassés, des marginaux et autres SDF, des « ratés de la vie » et des migrants surexploités, tous relégués « dans des trous-là ». Le récit file sans rebondissements, nullement plat pour autant, mais en pente, une pente qui s’enfonce inexorablement. L’horizon se rétrécie et le ciel s’assombrie au-dessus des têtes. Un rat devient le double hostile du narrateur.
Pourtant « notre » sans-papiers ne tenait pas à faire de vieux os à Londres (encore un argument en faveur de la libre circulation…) : « je veux juste me trouver un bon boulot très vite, travailler comme une bête, économiser un tas d’argent et hop, je repars chez moi. » Le gars veut gagner 5000 dollars américains et retourner fissa au pays régler ses petites et louches affaires. « Je suis étendu sur mon lit à écouter et à porter mon passé comme si c’était une robe très moulante ; je veux que personne tire dessus ». Il ne tient pas à être rattrapé par ce passé et encore moins par un ou deux énergumènes de son ancienne milice à qui il doit de l’argent.
Après Samba pour la France de Delphine Coulin (Seuil, 2011), on retrouve ici les thèmes, classiques, associés à la clandestinité : l’invention d’une autre identité, la dépossession de soi, la question lancinante et vitale des papiers (lire aussi sur le sujet Klaus Mann), la surexploitation salariale, les employeurs véreux et tutti quanti. C’est pas en devenant un « BBC » entendre un « Brosseur de culs Britanniques », de ceux « qui s’occupent de vieillards qui font popo dans leurs pantalons toutes les heures » qu’il pourra mettre un peu d’argent de côté.
Résultat, la perspective de rassembler les 5 000 dollars se rétrécie. Et pendant ce temps, les prétentions de ceux restés au pays croissent : de l’argent toujours plus d’argent, des cadeaux toujours plus de cadeaux, des exigences, toujours plus d’exigences… « Harare Nord c’est une grosse arnaque ».
Alors toutes les combines et toutes les manigances sont bonnes pour faire entrer de l’argent, améliorer le quotidien et atteindre l’objectif fixé. Chikwava ne fait pas de ce sans papiers un héros sympathique, une victime émouvante, un être à qui le lecteur puisse s’identifier. Il en est de même d’ailleurs de la plupart des autres personnages, défigurés par l’avarice, l’avidité, la jalousie ou emberlificotés dans leur soucis ou leurs mentalités… Tout fout le camp ! D’Harare à Harare Nord, de la périphérie au centre, du particulier à l’universel, le monde écrase et broie les uns et les autres. Il est peut-être temps de changer de monde.
Edition Zoé, 2011, 267 pages, 20€
 Dans Salaam London, le journaliste et globe-trotter Tarquin Hall brosse une formidable fresque historique, sociologique et humaine d’un quartier : Brick Lane. Ce East End londonien accueille, depuis des siècles, des hommes venus d’ailleurs : des huguenots français au XVIIe et XVIIIe siècle, des Juifs et des Irlandais, plus tard des migrants chinois, éthiopiens, flamands ou allemands avant de devenir ce « Banglatown » où se sont installés des immigrés asiatiques, bangladais, afghan ou indiens… Brick Lane, c’est aujourd’hui l’univers des cockneys qui se métisse, le monde ouvrier londonien gagné (envahie ?) par ces « New East Enders », ces citadins branchés ou yuppies sorte de bobos version british. Certes, ces altermondialistes, artistes et autres trublions anti-autoritaristes firent monter le prix de l’immobilier mais leur l’arrivée « s’accordait, selon l’auteur, avec l’esprit de l’East End ».
Dans Salaam London, le journaliste et globe-trotter Tarquin Hall brosse une formidable fresque historique, sociologique et humaine d’un quartier : Brick Lane. Ce East End londonien accueille, depuis des siècles, des hommes venus d’ailleurs : des huguenots français au XVIIe et XVIIIe siècle, des Juifs et des Irlandais, plus tard des migrants chinois, éthiopiens, flamands ou allemands avant de devenir ce « Banglatown » où se sont installés des immigrés asiatiques, bangladais, afghan ou indiens… Brick Lane, c’est aujourd’hui l’univers des cockneys qui se métisse, le monde ouvrier londonien gagné (envahie ?) par ces « New East Enders », ces citadins branchés ou yuppies sorte de bobos version british. Certes, ces altermondialistes, artistes et autres trublions anti-autoritaristes firent monter le prix de l’immobilier mais leur l’arrivée « s’accordait, selon l’auteur, avec l’esprit de l’East End ». Xiaolu Guo, jeune écrivaine et cinéaste chinoise, rapporte ici le journal intime d’une jeune étudiante chinoise à Londres écrit sous la forme d’un abécédaire durant son année d’étude. Au centre de ces notes : la relation que la jeune fille entretient avec un Anglais pur sucre, de vingt ans son aîné, végétarien, indépendant et un brin marginal. L’originalité de ce premier roman tient d’abord à l’écriture : Xiaolu Guo écrit comme parle cette jeune étudiante, avec les mêmes fautes, les mêmes maladresses, les mêmes contresens. Tout cela donne un texte frais et pétillant, candide et sans faux-semblant, impertinent et souvent de bon aloi quand l’observateur étranger pointe du doigt des us inconscients et des coutumes déroutantes
Xiaolu Guo, jeune écrivaine et cinéaste chinoise, rapporte ici le journal intime d’une jeune étudiante chinoise à Londres écrit sous la forme d’un abécédaire durant son année d’étude. Au centre de ces notes : la relation que la jeune fille entretient avec un Anglais pur sucre, de vingt ans son aîné, végétarien, indépendant et un brin marginal. L’originalité de ce premier roman tient d’abord à l’écriture : Xiaolu Guo écrit comme parle cette jeune étudiante, avec les mêmes fautes, les mêmes maladresses, les mêmes contresens. Tout cela donne un texte frais et pétillant, candide et sans faux-semblant, impertinent et souvent de bon aloi quand l’observateur étranger pointe du doigt des us inconscients et des coutumes déroutantes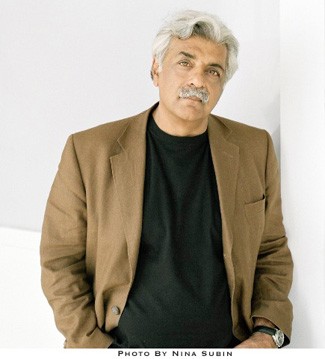 Tariq Ali est une figure importante de l'extrême-gauche antilibérale britannique. Écrivain, historien, journaliste, éditeur et producteur d'origine pakistanaise, il est né à Lahore en 1943. Il est difficile de croire que, quand ce militant, engagé depuis des décennies dans les luttes de son temps, en passe par le roman historique ce n'est pas d'abord pour entretenir ses contemporains de faits et de débats bien actuels.
Tariq Ali est une figure importante de l'extrême-gauche antilibérale britannique. Écrivain, historien, journaliste, éditeur et producteur d'origine pakistanaise, il est né à Lahore en 1943. Il est difficile de croire que, quand ce militant, engagé depuis des décennies dans les luttes de son temps, en passe par le roman historique ce n'est pas d'abord pour entretenir ses contemporains de faits et de débats bien actuels. Adam Zameenzad est un auteur anglo-pakistanais qui a grandi entre le Pakistan et le Kenya et enseigne aujourd'hui en Angleterre après avoir traîné ses guêtres sur le vaste continent américain. Meilleur prix du premier roman en Angleterre en 1987 pour La Treizième maison, son univers romanesque est plutôt sombre ou peut-être simplement réaliste : les enfants des rues en Amérique latine en proie à la misère et aux "escadrons de la mort" dans Pepsi et Maria (paru la même année chez le même éditeur), l'Afrique des tortures et des massacres, de la corruption et de la famine dans Mon ami Matt et Hena la putain.
Adam Zameenzad est un auteur anglo-pakistanais qui a grandi entre le Pakistan et le Kenya et enseigne aujourd'hui en Angleterre après avoir traîné ses guêtres sur le vaste continent américain. Meilleur prix du premier roman en Angleterre en 1987 pour La Treizième maison, son univers romanesque est plutôt sombre ou peut-être simplement réaliste : les enfants des rues en Amérique latine en proie à la misère et aux "escadrons de la mort" dans Pepsi et Maria (paru la même année chez le même éditeur), l'Afrique des tortures et des massacres, de la corruption et de la famine dans Mon ami Matt et Hena la putain. Quel est donc le don de ce jeune garçon qui s’évertue tout au long de ce roman à rabibocher ses parents tout juste séparés ? Le gamin à certes des talents multiples : bon dessinateur, doué pour le cinéma, il sait aussi se débrouiller dans la vie et son aptitude à manipuler - au sens positif, nous pourrions écrire à mettre en scène - n’est pas le moindre dans l’affaire qui occupe le lecteur. Avec tendresse et humour, Hanif Kureishi raconte l’histoire de Rex et Christine. Lui, guitariste de rock doué mais qui n’a pas fait carrière, elle, serveuse dans un bar qui en a eu assez de son « bon à rien » de compagnon, « gaspilleur, paresseux et lent » aussi prompt à « boire toute la journée » qu’à désespérer et à s’apitoyer sur son sort.
Quel est donc le don de ce jeune garçon qui s’évertue tout au long de ce roman à rabibocher ses parents tout juste séparés ? Le gamin à certes des talents multiples : bon dessinateur, doué pour le cinéma, il sait aussi se débrouiller dans la vie et son aptitude à manipuler - au sens positif, nous pourrions écrire à mettre en scène - n’est pas le moindre dans l’affaire qui occupe le lecteur. Avec tendresse et humour, Hanif Kureishi raconte l’histoire de Rex et Christine. Lui, guitariste de rock doué mais qui n’a pas fait carrière, elle, serveuse dans un bar qui en a eu assez de son « bon à rien » de compagnon, « gaspilleur, paresseux et lent » aussi prompt à « boire toute la journée » qu’à désespérer et à s’apitoyer sur son sort. Dans un va-et-vient entre démence et mémoire, Leone Ross, romancière anglaise d’origine jamaïcaine, retisse les fils délicats et emberlificotées des émotions. De celles qui remontent loin dans l’enfance et dont on ne peut jamais tout à fait se débarrasser. C’est une plongée dans la folie et dans le sexe avec pour toile de fond le racisme anti-noir de la société américaine. Dans sa version la plus dramatique, celle des Etats du Sud dominés par le Ku Klux Klan, comme dans sa version plus « soft », new-yorkaise :
Dans un va-et-vient entre démence et mémoire, Leone Ross, romancière anglaise d’origine jamaïcaine, retisse les fils délicats et emberlificotées des émotions. De celles qui remontent loin dans l’enfance et dont on ne peut jamais tout à fait se débarrasser. C’est une plongée dans la folie et dans le sexe avec pour toile de fond le racisme anti-noir de la société américaine. Dans sa version la plus dramatique, celle des Etats du Sud dominés par le Ku Klux Klan, comme dans sa version plus « soft », new-yorkaise : «
«  Londres. Cités du sud de la capitale. Au cœur de la communauté immigrée jamaïcaine. Dans ce magma urbain où le désœuvrement et l'absence de future colle à la peau, émerge la figure de Biscuit. Le jeune ado traîne sa misère entre deal, braquages
Londres. Cités du sud de la capitale. Au cœur de la communauté immigrée jamaïcaine. Dans ce magma urbain où le désœuvrement et l'absence de future colle à la peau, émerge la figure de Biscuit. Le jeune ado traîne sa misère entre deal, braquages La littérature anglaise ne cesse de s’enrichir de ses auteurs du cru (et qui souvent se revendiquent comme tels) mais dont les origines élargissent les horizons de l’île britannique. Monica Ali a ajouté son nom à la longue et prestigieuse liste des Hanif Kureishi,
La littérature anglaise ne cesse de s’enrichir de ses auteurs du cru (et qui souvent se revendiquent comme tels) mais dont les origines élargissent les horizons de l’île britannique. Monica Ali a ajouté son nom à la longue et prestigieuse liste des Hanif Kureishi,