Faris Chidyaq
La Jambe sur la jambe
 La femme (l'homme) ne serait-elle pas le sujet essentiel de nos réflexions les plus intimes, de nos pensées inavouées, de nos rêves les plus fous comme de nos désirs les plus ardents, de nos plus intenses bonheurs et de nos plus cruelles désillusions ?
La femme (l'homme) ne serait-elle pas le sujet essentiel de nos réflexions les plus intimes, de nos pensées inavouées, de nos rêves les plus fous comme de nos désirs les plus ardents, de nos plus intenses bonheurs et de nos plus cruelles désillusions ?
C'est du moins l'un des enseignements du livre volumineux et rabelaisien de Faris Chadyaq, très largement consacré aux jeux de l'amour et du désir, aux relations conjugales et extraconjugales, à l'éloge de la femme comme à son statut dans les sociétés musulmanes de la première moitié du XIXe siècle. Car La Jambe sur la jambe de Faris Chadyaq date de plus de 160 ans ! et l'on y trouve davantage de vérités, d'audaces et d'intelligence, de tolérance et de plaisirs que dans nombre de publications récentes. L'ouvrage est d'ailleurs considéré comme le texte fondateur de la modernité dans le monde arabe et nord africain.
Faris Chadyaq est né en 1804 au Liban. Maronite, il se convertira au protestantisme puis à l'islam et quittera cette terre en 1887, à Constantinople, agnostique et tolérant. Il voyagea beaucoup - Syrie, Egypte, Malte, Tunisie, Angleterre, France, Turquie - et exerça plusieurs métiers.
La Jambe sur la jambe conte, à travers le personnage de Faryaq (abréviation du nom de l'auteur) la première partie de cette vie.
Souvent l'auteur interpelle le lecteur pour le mettre en garde, l'avertir, le féliciter, le morigéner voire pour s'excuser de clore rapidement un chapitre pressé qu'il est par un besoin urgent. Le lecteur aurait d'ailleurs mauvaise grâce à ne pas respecter ces recommandations pour un livre écrit « dans nul autre intérêt que de [le] distraire, de chasser de [son] esprit l'affliction, d'y verser à grands flots le plaisir. »
En matière religieuse, l'auteur prêche la tolérance : « (...) cessez de prohiber les bonnes choses que Dieu a rendu licites pour vous et abstenez vous de scruter la conduite des autres pour voir si, à la faveur d'une distraction, il n'aura pas failli. Ne vendez pas les titres de propriété sur les domaines du Ciel, quand vous, sur terre, vous vous roulez les pouces. »
Fustigeant les tartuffes, la bigoterie, « la paresse », « la débilité mentale » des « clercs cléricants » - des écoles plutôt que des églises ! - il souhaite l'entente entre les religions et la fraternité entre les hommes pour qu'enfin cesse l'opposition entre « le chaud partisan de la petite peau » à « celui qui en tient pour l'ôter » (1).
La femme, « parfum de l'existence divine » en ce monde, occupe la plus grande part de ce récit qui appartient par bien des pages à la littérature libertine. Mais, davantage que ces libéralités et audaces - savoureuses au demeurant - ce sont les réflexions de Faryaq et de Faryaqa, son épouse, sur le statut réservé par l'islam et la société à la gent féminine qui, plus d'un siècle et demi après, demeurent de circonstance et qui, malheureusement, et de manière étonnante, en choqueront plus d'un(e). Ainsi, en matière de séparation conjugale, plutôt que la répudiation des musulmans ou le mariage sans divorce des chrétiens, l'auteur avance l'idée d'une sorte de divorce par consentement mutuel. Pour rendre toute sa place à la femme dans la société, il condamne leur claustration et demande qu'elles accèdent à l'instruction : « peux-tu sérieusement espérer voir la lumière pénétrer l'esprit de ton épouse et de tes filles, quand elles sont confinées dans cette prison dorée où tu les enfermes ? Comment pourrais-tu accepter pour elle - Dieu t'en préserve ! - l'ignorance et la bêtise ? »
Quant au voile - ce fameux voile ! - il avertit le naïf : « ne crois pas qu'une femme ayant caché son nez / sous des voiles épais n'en soit pas moins à son aise / dans le déduit d'amour et les jeux qui lui plaisent... ».
Sans doute, l'auteur excelle dans la description des femmes « bien plus en tout cas que s'il nous parlait des particularités des plantes, des pierres, des climats, des hommes et du régime politique de la région. Cela il n'y entend goutte. » Ce qui reste à voir. A lire les commentaires rapportés de ses pérégrinations, anglaise et française notamment, il est fort aisé d'en conclure que « notre » Fadyaq fait, en l'occurrence, le modeste. Qu'on en juge.
S'il est prompt à condamner l'injustice sociale - « les ouvriers anglais sont ceux qui enrichissent le monde, tout en étant frustrés des fruits de leurs efforts » - il ne cède pas pour autant au vertige totalitaire d'une société égalitaire révélant ainsi une pensée subtile et complexe : « oui on ne peut décidément ignorer que l'inégalité est un fait auquel on n'échappe pas, comme l'existence du beau et du laid. Sans cela le monde ne serait pas en mouvement, les activités utiles perdraient leurs sens, de même que la contestation, ce ferment de l'action. A ceci près que la pauvreté n'implique aucun progrès, aucune évolution vers le luxe et l'absence de retenue. » Voilà une belle définition de l'idéal démocratique fondé sur l'expression des contraires.
Il y aurait beaucoup à dire et à écrire sur ce magnifique et spirituel ouvrage servi par une traduction haute en couleurs et érudite de René R.Khawam.
Un conseil tout de même : pour lire et découvrir Faris Chidyaq, il faut prendre le soin de s'installer confortablement au fond d'un fauteuil et, la jambe sur la jambe, apprécier page par page, ligne à ligne, les réflexions, digressions, poèmes, bons mots, contes et autres historiettes.
(1) Le lecteur comprendra l'opposition entre le chrétien et le musulman (ou le juif) quant à l'obligation ou non de la circoncision.
Traduit de l'arabe par René R.Khawam, édition Phébus, 1991, 745 pages
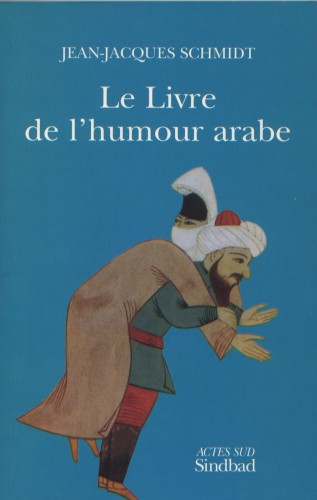 «
«  Entre 1991 et 2001, Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel faisaient paraître en poche chez Folio une traduction des Mille et une nuits. Les contes présentés par les deux éminents spécialistes ne constituaient qu’une partie du vaste ensemble de ce joyau de la littérature universelle (et pas seulement arabe). Tel était le seul désagrément de cette édition : l’absence de plus de 550 nuits. Ce premier travail préfigurait en fait la parution en 2005 dans la Bibliothèque de la Pléiade du premier des trois tomes d’une édition complète des Mille et une nuits. Le lecteur francophone disposera désormais, et pour la première fois, non seulement de l’ensemble des contes et poèmes du recueil mais aussi de LA référence, indispensable à tout « honnête homme » curieux de littérature.
Entre 1991 et 2001, Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel faisaient paraître en poche chez Folio une traduction des Mille et une nuits. Les contes présentés par les deux éminents spécialistes ne constituaient qu’une partie du vaste ensemble de ce joyau de la littérature universelle (et pas seulement arabe). Tel était le seul désagrément de cette édition : l’absence de plus de 550 nuits. Ce premier travail préfigurait en fait la parution en 2005 dans la Bibliothèque de la Pléiade du premier des trois tomes d’une édition complète des Mille et une nuits. Le lecteur francophone disposera désormais, et pour la première fois, non seulement de l’ensemble des contes et poèmes du recueil mais aussi de LA référence, indispensable à tout « honnête homme » curieux de littérature. Abü l-‘Atâhiya est né pauvre, en 748, à Kufa, capitale intellectuelle de renommée. Après une vie de débauche partagée entre sa ville natale, les cabarets de Hira ou les faubourgs de Bagdad fondée en 762, l’homme se repent et retourne en religion. La « trajectoire » existentielle est connue. Ils ne sont pas rares, aujourd’hui encore ceux qui, après une vie bien remplie, se rachètent une conduite avant de comparaître devant le Très Haut... Le basculement d’ Abü l-‘Atâhiya survint quelque vingt-cinq années avant sa mort en 825. Oubliés alors les poésies de jeunesse, libertines, bachiques ou satiriques et autres panégyriques. D’ailleurs, à la différence de la prose également bachique et libertine d’Abu Nuwas, son contemporain (747-815) originaire de Bassorah, elles ne nous sont pas parvenues, peut-être ont-elles été détruites par leur auteur.
Abü l-‘Atâhiya est né pauvre, en 748, à Kufa, capitale intellectuelle de renommée. Après une vie de débauche partagée entre sa ville natale, les cabarets de Hira ou les faubourgs de Bagdad fondée en 762, l’homme se repent et retourne en religion. La « trajectoire » existentielle est connue. Ils ne sont pas rares, aujourd’hui encore ceux qui, après une vie bien remplie, se rachètent une conduite avant de comparaître devant le Très Haut... Le basculement d’ Abü l-‘Atâhiya survint quelque vingt-cinq années avant sa mort en 825. Oubliés alors les poésies de jeunesse, libertines, bachiques ou satiriques et autres panégyriques. D’ailleurs, à la différence de la prose également bachique et libertine d’Abu Nuwas, son contemporain (747-815) originaire de Bassorah, elles ne nous sont pas parvenues, peut-être ont-elles été détruites par leur auteur. Il n'est pas fréquent de commencer la recension d'un livre en saluant le travail du traducteur. Mais enfin il est juste de rendre hommage à René R. Khawam infatigable traducteur d'une quarantaine d'ouvrages appartenant à la littérature arabe, classique en particulier. Celui à qui l'on doit notamment une traduction des
Il n'est pas fréquent de commencer la recension d'un livre en saluant le travail du traducteur. Mais enfin il est juste de rendre hommage à René R. Khawam infatigable traducteur d'une quarantaine d'ouvrages appartenant à la littérature arabe, classique en particulier. Celui à qui l'on doit notamment une traduction des