Nadia Khouri-Dagher
Hammam & Beaujolais
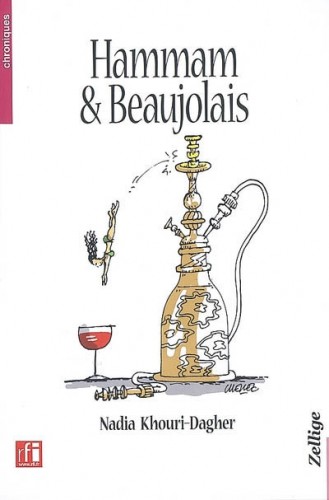 Libanaise vivant en France, Nadia Khouri-Dagher est journaliste et essayiste. Spécialisée dans le monde arabe, auteur de nombreux reportages sur les « émigrants » (elle préfère ce terme à celui d'immigrés), elle interroge depuis une vingtaine d'années les questions culturelles et identitaires. Hammam & Beaujolais est un lexique où depuis le mot « accent » jusqu'au mot « zut » en passant par « Andalousie », « épices », « femmes », « islam », « manif » « quartiers », « Sans-culottes »... elle revient sur ces questions, sur un mode plaisant et personnel, en s'appuyant sur un dictionnaire subjectif, intime parfois et, in fine, utile à tous. Car la légèreté du propos ne doit pas masquer le fait que le prétexte de ce livre est un sujet essentiel pour nos contemporains : le dialogue du particulier et de l'universel, la question des appartenances plurielles, des identités composites et changeantes. Comment tout en respectant l'universalisme de l'humanité ne pas nier les différences, les formes particulières d'être au monde et à soi ?
Libanaise vivant en France, Nadia Khouri-Dagher est journaliste et essayiste. Spécialisée dans le monde arabe, auteur de nombreux reportages sur les « émigrants » (elle préfère ce terme à celui d'immigrés), elle interroge depuis une vingtaine d'années les questions culturelles et identitaires. Hammam & Beaujolais est un lexique où depuis le mot « accent » jusqu'au mot « zut » en passant par « Andalousie », « épices », « femmes », « islam », « manif » « quartiers », « Sans-culottes »... elle revient sur ces questions, sur un mode plaisant et personnel, en s'appuyant sur un dictionnaire subjectif, intime parfois et, in fine, utile à tous. Car la légèreté du propos ne doit pas masquer le fait que le prétexte de ce livre est un sujet essentiel pour nos contemporains : le dialogue du particulier et de l'universel, la question des appartenances plurielles, des identités composites et changeantes. Comment tout en respectant l'universalisme de l'humanité ne pas nier les différences, les formes particulières d'être au monde et à soi ?
Avec simplicité - mais non sans profondeur - Nadia Khouri-Dagher, revient sur son histoire personnelle et familiale pour saisir les différences, des plus prosaïques aux plus sacralisées, qui distinguent Français et Libanais. Les traditions et les façons d'être peuvent différer, il n'en demeure pas moins qu'elles servent toutes les mêmes desseins : vivre, partager, échanger, aimer... Qu'est qu'être Français alors ?
À lire Nadia Khouri-Dagher, on retient un art de vivre, une gastronomie, une légèreté et un goût pour l'impertinence, pour la conversation et l'échange (on pense ici à Jack-Alain Léger). La « francitude » se niche aussi loin des grandes villes, dans les cultures régionales, dans la culture populaire aussi, véhiculée entre autres par son médium n°1 la télévision et par la radio.
Pour l'auteur, issue d'une société autrement cloisonnée socialement, la France c'est aussi la découverte de l'égalité entre hommes et femmes, la découverte des brassages sociaux... de sorte que « les enfants d'émigrants pourront devenir Français quand ils seront plongés dans la société de France (...) ». « L'Andalousie moi je la vis à Paris », « dans l'Occident métissé » écrit l'auteur. Dans la France mondialisée, de plus en plus métissée, l'idée d'un modèle culturel ou civilisationnel unique, qui fut dans un passé récent souvent hautain et méprisant pour les peuples colonisés ou dominés, s'estompe.
« Passer d'une culture à une autre est (...) une leçon de relativisme culturel » explique Nadia Khouri-Dagher. Ainsi si le vin - en l'occurrence le beaujolais - est célébré en France, en Orient ce serait plutôt le haschich qui tourne les têtes. Et de rappeler justement qu'avant que le rigorisme religieux n'étouffe les sociétés arabes, le vin était aussi chanté par les poètes arabes.(1) Le vin et l'amour. Ainsi plaisirs, raffinements, légèreté... ignorent les frontières et savent se jouer des barrières linguistiques ou autres.
« Mes vingt années d'anthropologie, d'études et de voyages m'ont appris que rien ne ressemble plus à une réunion de famille qu'une autre réunion de famille, l'affection d'une grand-mère à celle d'une autre grand-mère, un rire d'enfant heureux à un autre rire d'enfant heureux (...), la fierté d'une identité culturelle à celle d'une autre identité. »
Hammam & Beaujolais est un hymne à l'échange, au partage et à la compréhension de l'autre... Mais le souci, louable, de confondre les fausses différences et de démontrer l'inanité d'un soi disant « choc des civilisations » ne doit tout de même pas faire l'économie des spécificités et de ce que François Julien nomment les « écarts » lorsqu'ils existent. On a parfois l'impression que l'auteur, emportée par son élan et sa volonté démonstrative, en vient à minimiser ces particularités (on pense bien sûr à la question religieuse ou au statut de la femme).
Pour autant, dans son article sur la joie - érigée en Orient « comme dans bien d'autres pays » en une forme de savoir vivre, Nadia Khouri note : « la joie (...) n'appartient à aucune culture en exclusivité. Mais que la civilisation moderne, soucieuse d'efficacité et de productivité, et qui laisse moins de temps à la convivialité, gomme chaque jour partout un peu plus. » Et si le vrai problème n'était pas les différences culturelles, bien relatives donc, mais plutôt l'émergence d'une nouvelle culture, cette « modernité » froide, techniciste, productiviste (la nouvelle barbarie dont parle Edgar Morin) qui partout valorise rendements, résultats et machines sur les hommes et sur les femmes ?
1. Voir notamment Muhammad al-Nawâji, auteur égyptien du XIVe siècle : La Joie du vin. L'Arène du cheval bai, traduit de l'arabe par Philippe Vigreux, éd. Phébus, 2006.
Edition Zellige, 2008, 220 pages, 19 €
Essais - Page 5
-
Hammam & Beaujolais
-
La Planète des migrants
Jacques Barou
La Planète des migrants. Circulations migratoires et constitutions de diasporas à l'aube du XXIe siècle
 La Planète des migrants est un livre précis et didactique qui fait le point sur l'actualité des migrations dans le monde : zones de départ, zones d'arrivée, impacts respectifs des migrations, éclairages historiques, nouvelles tendances, déconstruction de quelques idées reçues ou théories, questions identitaires...
La Planète des migrants est un livre précis et didactique qui fait le point sur l'actualité des migrations dans le monde : zones de départ, zones d'arrivée, impacts respectifs des migrations, éclairages historiques, nouvelles tendances, déconstruction de quelques idées reçues ou théories, questions identitaires...
L'histoire de l'humanité est aussi l'histoire de ses migrations. Depuis la nuit des temps, les raisons de quitter la terre où l'on est né sont connues : économiques, écologiques, politiques. Mais, à ces motifs rationnels, l'auteur, judicieusement, en ajoute d'autres, culturelles ou psychologiques, tout aussi consubstantielles à l'espèce humaine, curieuse de découvertes et d'inconnu. « Même si tous les individus et tous les peuples n'ont pas forcément vocation à migrer, l'être humain en général semble être un homo migrator autant qu'il est un homo economicus ou un zoon politikon ». Ainsi la question des migrations contemporaines est appréhendée dans le temps long de l'histoire et comme une donnée ontologique la débarrassant de sa gaine de suspicion et de mépris voir d'amnésie.
De ce point de vue, Jacques Barou tord le cou à certaines idées reçues : les zones d'émigration ne sont pas les zones les plus pauvres et les candidats au départ les plus miséreux. Pour partir il faut réunir un minimum de conditions, matérielles et culturelles : les moyens de partir et l'envie de partir. Ainsi et sans esprit de provocation : la mobilité est un luxe de riche. Sur le plan démographique, l'auteur montre, exemples à l'appui, que les écarts de fécondité ne suffisent pas à eux seuls à expliquer les processus migratoires. Globalement et bousculant un autre lieu commun ou non-dit, Jacques Barou explique que les migrations internationales ont été un facteur d'enrichissement matériel, social et culturel du monde. Ainsi, l'affaire est complexe et ne peut se résumer à des explications (ou des solutions) univoques, réductrices, simplistes. Les chercheurs et autres spécialistes s'échinent, quelles que soient leurs grilles de lecture, à le dire. Les responsables politiques peinent eux à relayer auprès de leurs concitoyens quelques vérités plus difficiles à entendre (et peut-être à comprendre) que des promesses électorales.
À partir d'un tableau des zones de départ et des zones d'accueil, Jacques Barou fournit les éléments permettant d'apprécier l'incidence des migrations sur ces différents espaces ou pays. Si globalement les pays de départ bénéficient, via les transferts d'argent, de sources de revenus importantes, ces transferts - à l'exception pour l'heure des expériences espagnole, portugaise et italienne - ne semblent pas contribuer pour autant au développement des économies locales. Pour ce faire, il faudrait réunir un certain nombre de conditions : politiques (plus de démocratie, moins de corruption et de gaspillage), techniques (orientation des capitaux vers les secteurs qui en ont besoin) et même « relationnels » entendre les liens que les États entretiennent avec leurs ressortissants expatriés. Longtemps fustigé comme « trahison », l'exil tend à être utilisé comme un atout par certains pays de départ. Globalement cela n'est pas le cas de l'Afrique subsaharienne, de sorte que « les personnels qualifiés, de plus en plus nombreux à partir, n'ont que peu de chance de pouvoir trouver un poste qui leur convienne en rentrant dans leur pays d'origine. » En revanche d'autres pays (Maroc, Vietnam, Inde, Chine (mais jusqu'à quand ? interroge l'auteur) ont appris à utiliser « leurs » émigrés comme autant d'atouts. « Dans le cadre d'une économie mondialisée, écrit Jacques Barou, le lien entre une grande puissance et sa diaspora représente un atout important, non seulement pour la conquête des marchés mais aussi pour influencer les relations internationales dans un sens qui soit favorable aux intérêts de cette grande puissance. »
Les mouvements migratoires semblent surtout bénéficier aux économies les plus riches, celles qui ont fait appel, qui font appel et qui, demain, et malgré les slogans de campagne, feront encore appel à une main d'œuvre immigrée, à des compétences et des savoir-faire étrangers, à des hommes et des femmes aptes (peut-être) à renouveler les générations... Sans que les relations historiques entre certains pays fournisseurs et certains pays récepteurs n'aient disparu, une tendance nouvelle voit la multiplication des zones visées par les migrations. Les plus attractives d'entre elles accueillent une immigration de plus en plus diversifiée du point de vue des origines et des profils socioprofessionnels. Ainsi les « champs migratoires » s'élargissent et, plutôt que de « vagues », il serait déjà plus juste de parler de « circulations » migratoires tant irait croissante la mobilité des personnes. Mobilité favorisée par l'augmentation de la période d'étude et de formation au cours de la vie, la précarisation des emplois et l'internationalisation accrue du marché du travail. Cette mobilité suppose enfin l'existence de liens, de réseaux (voir les migrations Latino-Américaines, chinoises ou indiennes) installant un nouveau type de présence : les diasporas et avec elles, la conscience d'appartenir à un vaste ensemble de communautés dispersées. Ces nouvelles « circulations » migratoires contribuent aussi à l'émergence de nouvelles identités : transnationales et pluriculturelles. Des identités de plus en plus négociées.
Presses universitaires de Grenoble, 2007, 180 pages, 14 € -
Dictionnaire des mots français d’origine arabe
Salah Guemriche
Dictionnaire des mots français d’origine arabe
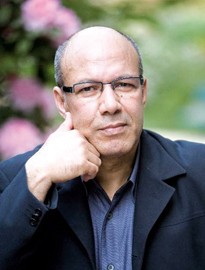 Selon Henriette Walter citée dans la préface de ce livre, sur 35 000 mots usuels de la langue française, 4 192 sont d’origine étrangère : 25 % viendraient de l’anglais, 16 % de l’italien, 13 % du germanique et, juste après, de l’arabe (entre 250 et 270 mots soit 6,5 %). Si, comme le fait l’auteur, on y ajoute les quelque 150 mots d’origine turque ou persane, passés au français via la langue d’Al Mutanabi, alors avec les 391 mots ici recensés par l’auteur, le pourcentage s’élève à 10 % abstraction faite des mots d’origine également arabe qui désignent les étoiles. Ainsi nos ancêtres ont beau être les Gaulois, sur le seul plan linguistique, les Sarrasins, Maures, Barbaresques et autres Mahométans ont peut-être davantage irrigué la langue nationale que les cousins, petits cousins et autres descendants de Vercingétorix…
Selon Henriette Walter citée dans la préface de ce livre, sur 35 000 mots usuels de la langue française, 4 192 sont d’origine étrangère : 25 % viendraient de l’anglais, 16 % de l’italien, 13 % du germanique et, juste après, de l’arabe (entre 250 et 270 mots soit 6,5 %). Si, comme le fait l’auteur, on y ajoute les quelque 150 mots d’origine turque ou persane, passés au français via la langue d’Al Mutanabi, alors avec les 391 mots ici recensés par l’auteur, le pourcentage s’élève à 10 % abstraction faite des mots d’origine également arabe qui désignent les étoiles. Ainsi nos ancêtres ont beau être les Gaulois, sur le seul plan linguistique, les Sarrasins, Maures, Barbaresques et autres Mahométans ont peut-être davantage irrigué la langue nationale que les cousins, petits cousins et autres descendants de Vercingétorix…
Pour chacune des 391 entrées de ce dictionnaire original (d’abricot à zouave), Salah Guemriche fournit une fiche étymologique et lexicographique savante, des données morphologiques et historiques précises où l’humour n’est pas forcément absent, le tout enrichit par une illustration littéraire.
Comment prendre ce dictionnaire des mots français d’origine arabe ? Cet ouvrage qui a sûrement demandé à son auteur quelques années de purgatoire peut-il se résumer pour le lecteur à une simple expérience gourmande, une traversée à travers les siècles (depuis le Xe en passant par cette période florissante qui court du XIIe au XVe siècle), les disciplines et les genres (mathématique, chimie, astronomie, architecture, médical, arts décoratifs ou de la table… ) et le patrimoine littéraire national (depuis Clément Marot ou Ronsard à Houellebecq, Yourcenar ou Derrida en passant par Rabelais, Voltaire ou Molière) ?
Ce livre est d’une prodigieuse érudition, mais cela n’étonnera que celles et ceux qui ont oublié ou n’ont pas eu le bonheur de lire Un Amour de djihad du même Salah Guemriche. Il est aussi placé sous le sceau de l’humanisme, celui sans doute qui guida l’auteur dans son Été sans juillet(1). Peut-il n’être qu’une simple curiosité pour quelques fats désireux de briller dans les dîners en ville, une simple et belle corbeille de mots dans laquelle on picorerait nonchalamment ? Non ! il y a un sens à tout cela, le sens qu’une société, tiraillée entre la tentation du repli sur soi et le désir d’ouverture à de nouveaux imaginaires, veut donner à son avenir. En ces temps où l’Africain et l’identité nationale sont « essentialisés » à la vitesse d’un jogger, ce dictionnaire rappelle que le moindre sens historique enseigne que le mouvement, les échanges, les compositions et les recompositions sont au cœur de toutes créations humaines. Ainsi les langues pures n’existent pas (pas davantage la langue française que la langue arabe, pourtant et par ailleurs sacralisée…). Comme les cultures ou les identités. Toutes se valent dès lors qu’elles reconnaissent ce qu’elles doivent aux autres, à quel titre elles s’inscrivent dans l’histoire de l’humanité et qu’elles ne sont pas, une fois pour toutes figées dans le marbre froid d’une Histoire fantasmée.
À ces perspectives historiques ou scientifiques, on peut, plus simplement mais avec autant de force, ajouter le bon sens de l’écrivaine chinoise installée au Canada, Ying Chen : « Si on bloquait les courants - les frontières sont faites pour cela -, le monde serait trempé et pourri dans des eaux mortes. » Les langues voyagent, s’échangent, s’interpénètrent. Une langue qui n’emprunterait pas serait vouée à mourir. Certains mots sont passés par l’Espagne, d’autres par l’Italie, d’autres sont directement venus chez nous. L’arabe lui-même emprunta aux langues grecque, turque (colback ou cravache), persane (pilaf, taffetas ou tulipe), indienne (orange), berbère (couscous). Ainsi, nous parlerions tous arabe sans le savoir… et comme ce qui vient de cette vaste et diverse aire linguistique arabe n’est pas forcément triste, dévot, sombre ou mortifère, on lui doit notamment les mots suivants : cumin, curcuma, gingembre, hammam, alcool, alcôve, almée, zellige, caramel, moka, mousseline, kohol, nouba, odalisque et autres kémia qui est aux pieds-noirs (mais pas seulement) ce que les tapas sont aux Espagnols. Les très modernes kif, niquer et zob itou. Autres incorrections avec les mots crouilles, bicot ou encore fissa qui, plus par ignorance que par faute de goût à n’en pas douter, font baragouiner arabe quelques xénophobes pure sucre, férus de chasse à l’impureté…
Dans sa préface Assia Djebar, dit combien ce dictionnaire est important pour cette jeunesse de France née avec et par les migrations de leurs aînés. Ainsi ces jeunes, conscients d’être les « héritiers d’un passé inventif », pourraient vivre décomplexés par rapport à leur société d’accueil… En sommes nous encore là ? Probablement. Pourtant on peut se prévaloir du plus glorieux passé et des plus honorables aïeux, ce qui importe ce sont les « bâtardises » pour reprendre Amin Maalouf, dont cette jeunesse de France est porteuse. Pour elle et pour la société tout entière. Il en est des hommes comme des langues…
1- Balland 1995 pour le premier et Le Cherche-midi 2004 pour le second.
Préface d’Assia Djebar. Edition du Seuil, 2007, 878 pages, 35 €
-
Le bon grain et l’ivraie. La sélection des migrants en occident, 1880-1939
Philippe Rygiel (sous la direction de)
Le bon grain et l’ivraie. La sélection des migrants en occident, 1880-1939
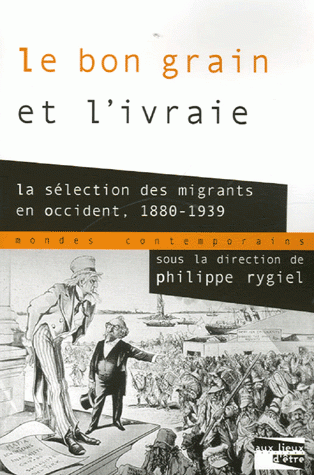 L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.
L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.
Retenons ici le lien qui se noue entre l’idée nationale et la mise en place d’une politique à tout le moins d’un cadre réglementaire visant à sélectionner les étrangers en fonction de critères particuliers. De ce point de vue, la France, à la différence du Brésil et de l’Allemagne, mais aussi de l’Angleterre (Aliens Act en 1905 mais surtout loi de 1920), des USA (Chinese exclusion Act de 1882) sans parler de l’Australie ne semble pas pratiquer une sélection ethnique. Faut-il y voir une conséquence heureuse des idéaux de 89 et d’un universalisme à la française, étrangers par exemple à la définition d’une nation ethnique allemande née de l’imaginaire d’une « nature » ou d’une « race » allemande faisant des Juifs et des Polonais des « indésirables » ? Peut-être. Comme le montre P.Rygiel les espaces politiques nationaux, produits d’histoires différentes, façonnés par des traditions culturelles et idéologiques distinctes, élaborent des systèmes législatifs différents. Pour autant, la France de la Déclaration universelle des droits de l’homme opère des distinctions parmi « ses » étrangers. Ainsi, si les ressorts ethniques et raciaux ne semblent pas être, a priori, au fondement des dispositifs de sélection, pour l’administration centrale, les populations migrantes et étrangères ne sont pas homogènes, certaines communautés jouissant d’avantages ou de privilèges dont d’autres sont privées. C’est le cas des Américains présents en France dans l’entre-deux guerres. Si selon Kant « personne n’a originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu’à un autre », en matière de migrations, certains se voient gratifier d’un surplus d’âme et donc de droits…
L’utilité économique, l’état sanitaire et l’ordre public sont au cœur des dispositifs hexagonaux, mais, la question raciale et ethnique n’est pas évacuée pour autant. Sans parler de la question noire et remonter aux mesures de contrôles des étrangers du Consulat et de l’Empire, Geneviève Massard-Guilbaud, dans une contribution centrale, souligne les responsabilités de l’Etat dans le fait que l’immigration algérienne, « aujourd’hui encore », reste une « immigration à part ». Selon l’auteur, l’immigration algérienne « a été victime, de la part de l’Etat, de discriminations comme n’en ont connu les immigrés d’aucune autre nationalité, et ceci dès les lendemains de la première guerre mondiale ». Elle innove, en relativisant la doxa qui fait de la guerre d’Algérie l’origine de cette spécificité. Elle incrimine plutôt ici la politique nationale métropolitaine qui, pour faire court, se serait calquée sur la politique coloniale : craintes et fantasmes quant à la sexualité des Algériens (se profile l’horreur d’un possible métissage ou brassage…), efficacité du lobby des colons et des milieux patronaux d’Alger, peurs enfin que ne fleurissent les fleurs de l’émancipation dans l’esprit des colonisés provoquant « une brèche dans l’apartheid de fait qui sévissait en Algérie ». G.Massard-Guilbaud précise comment l’Etat français a mis en place une politique non seulement discriminatoire mais aussi illégale et inefficace. Une politique qui aura, sur le long terme, des conséquences catastrophiques en fermant aux Algériens « l’accès à toutes les voies connues pour faciliter l’intégration ».
L’ensemble des contributions montre que la sélection, le contrôle et l’affectation des immigrés en France exigent de prendre en compte bien des critères : l’organisation du marché du travail, les besoins économiques sur le plan national mais aussi par secteurs ou régions, les dispositifs institutionnels et leurs conditions d’application, les relations diplomatiques avec les pays d’émigration, les capacités organisationnelles ou d’adaptation des migrants eux-mêmes etc. Enfin, « parce qu’une partie au moins des immigrés est appelée à se fondre dans la communauté nationale, la « question immigrée » rejoint par ailleurs le problème de la définition de la nation et de la délimitation de ses contours, question politique centrale de la période ». Question redevenue centrale aujourd’hui et qu’il est bon d’éclairer par ce retour en arrière.
Edition Aux Lieux d’être, 272 pages, 28,50 €
-
La prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc (1830-1962)
Christelle Taraud
La prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc (1830-1962)
 On ne rappellera jamais assez à quel point l'irruption coloniale a été destructrice pour les sociétés d'Afrique du Nord. Les travaux des historiens, l'action militante ou les témoignages des ex-colonisés le montrent et le démontrent, parfois même jusqu'à l'excès en présentant des récits univoques et en dédouanant à bon compte les élites modernes de leurs responsabilités. Mais enfin, l'impact colonial fut non seulement violent, mais son onde de choc continue de traverser ces sociétés.
On ne rappellera jamais assez à quel point l'irruption coloniale a été destructrice pour les sociétés d'Afrique du Nord. Les travaux des historiens, l'action militante ou les témoignages des ex-colonisés le montrent et le démontrent, parfois même jusqu'à l'excès en présentant des récits univoques et en dédouanant à bon compte les élites modernes de leurs responsabilités. Mais enfin, l'impact colonial fut non seulement violent, mais son onde de choc continue de traverser ces sociétés.
Christelle Tarraud en offre une nouvelle illustration à travers l'investigation érudite d'un champ d'études jusqu'alors peu ou pas objet de recherche (à l'exception de quelques travaux d'historiens tunisiens notamment) : le monde de la prostitution en Afrique du Nord depuis 1830 jusqu'en 1962.
S'appuyant sur des archives administratives, fiscales, policières et médicales d'une part, et une riche documentation iconographique, cinématographique voir littéraire d'autre part, l'auteur donne à lire de l'intérieur le monde de la prostitution et celui des imaginaires et autres fantasmes coloniaux.
Craignant que la contagion de maladies sévissant au Maghreb, à commencer par la syphilis, gagne leurs rangs, dès les premiers jours de la conquête d'Alger, les militaires mettent en place une réglementation sur la prostitution. Cette réglementation s'appliquera non seulement aux prostituées professionnelles venues dans les bagages de la troupe conquérante ou aux femmes migrantes poussées par la misère à faire commerce de leurs attributs mais aussi à la prostitution dite locale, orientale, "maure" ou "mauresque" et plus tard "indigène". Le sec réglementarisme colonial allait avoir raison de la diversité et des charmes de la société traditionnelle en matière de prostitution. Car le conquérant, en blouse blanche ou en vareuse kaki, ne distingue pas chez ces femmes les statuts différents : l'odalisque de harem, l'almée citadine lettrée, les danseuses professionnelles, les chanteuses des campagnes lointaines, les groupes de femmes constituée, autonomes et itinérantes comme les Ouled Naïl, les azriates ou les chikhates, ou enfin les prostituées stricto sensu. Peu chaut aux nouveaux responsables les pratiques différentes et les statuts autres réservés à la prostitution, tout ici est balayé, les femmes comme les structures de la société traditionnelle. Il faut alors encarter les prostituées isolées ; numéroter celles qui travaillent dans les maisons closes, européennes d'abord, indigènes ensuite ; ouvrir des rues réservées et même des quartiers réservés à la prostitution indigène comme l'incroyable quartier Bousbir de Casablanca sans oublier les fameux et tristes BMC, bordels militaires de campagne.
Christelle Taraud montre l'échec de ce réglementarisme, la prostitution clandestine ayant toujours débordé, et largement, ce système. Elle en montre aussi les conséquences terribles sur les filles prostituées, car plus le commerce était artisanal et peu localisé plus il échappait à la mainmise des hommes (et des administrations, municipales ou médicales); plus il a été centralisé et répressif, plus les hommes ( et pas seulement les souteneurs) ont pu exercer leur main mise sur les femmes et tirer profit de la prostitution.
Reste que la colonisation, portée par ces premiers hommes, militaires et colons, qui devaient bien trouver à exulter, a brisé un tabou, le plus fort peut-être de la société traditionnelle, celui de la ségrégation sexuelle et notamment de la ségrégation sexuelle des femmes selon leur appartenance confessionnelle. La colonisation va ouvrir le marché des femmes locales à l'envahisseur, à l'étranger, au chrétien. D'où la thèse défendue par Christelle Tarraud selon laquelle la mixité sexuelle a permis à ces femmes d'être des passerelles de la rencontre. Des passerelles sous domination certes, masculine et coloniale, mais des passerelles tout de même.
Edition Payot, 2003, 495 pages, 25 €
-
La Plume dans la plaie. Les écrivains journalistes et la guerre d’Algérie
Philippe Baudorre (Édition préparée par)
La Plume dans la plaie. Les écrivains journalistes et la guerre d’Algérie


1954, sans le savoir et pour huit an
 s la France bascule dans la guerre. Une nouvelle et dramatique page des relations franco-algériennes s’ouvre. Ses conséquences politiques sont encore insoupçonnées : naissance de la Ve République et crise de la gauche en France notamment, phagocytose de la société algérienne par son armée sous couvert d’un parti unique et totalitaire. Mais cette guerre signe aussi la fin d’une page de la vie intellectuelle en France. Il y aurait un avant 1962 et un après, marqué par « l’engagement autonome de l’intellectuel », sa volonté de s’extraire des « mandibules des partis » pour reprendre l’expression de Mauriac. Avec la fin du conflit sonne la fin d’une « logique de résistance » et de guerre franco-française, guerre des mots non dénués d’ambiguïté comme le montre le texte consacré à « France-Observateur ». Sans doute, François Mauriac le pressent-il, le 8 juillet 1962 qui écrit : « ces confrères dont le métier est d’écrire et qui ne prennent parti sur rien, qui ne trace pas un mot dont on ne puisse augurer un acquiescement ou une réprobation, à quelle distance vivent-ils notre drame ? Il se peut que cette indifférence apparente recouvre chez certains un détachement de tout ce qui ne les concerne que par la bande, si j’ose dire : cette politique sur laquelle ils n’ont pas pouvoir ».
s la France bascule dans la guerre. Une nouvelle et dramatique page des relations franco-algériennes s’ouvre. Ses conséquences politiques sont encore insoupçonnées : naissance de la Ve République et crise de la gauche en France notamment, phagocytose de la société algérienne par son armée sous couvert d’un parti unique et totalitaire. Mais cette guerre signe aussi la fin d’une page de la vie intellectuelle en France. Il y aurait un avant 1962 et un après, marqué par « l’engagement autonome de l’intellectuel », sa volonté de s’extraire des « mandibules des partis » pour reprendre l’expression de Mauriac. Avec la fin du conflit sonne la fin d’une « logique de résistance » et de guerre franco-française, guerre des mots non dénués d’ambiguïté comme le montre le texte consacré à « France-Observateur ». Sans doute, François Mauriac le pressent-il, le 8 juillet 1962 qui écrit : « ces confrères dont le métier est d’écrire et qui ne prennent parti sur rien, qui ne trace pas un mot dont on ne puisse augurer un acquiescement ou une réprobation, à quelle distance vivent-ils notre drame ? Il se peut que cette indifférence apparente recouvre chez certains un détachement de tout ce qui ne les concerne que par la bande, si j’ose dire : cette politique sur laquelle ils n’ont pas pouvoir ».
Dix-sept contributions données dans le cadre d’un colloque organisé à Malagar, sur les terres de Mauriac donc, en septembre 2001 sont ici publiées. Elles sont l’occasion de lire (ou de relire) ces écritures de la guerre mais aussi cette guerre de l’écriture à travers les plumes de Mauriac, Camus, Sartre Nimier, Blondin, Laurent, Courrière, mais aussi Feraoun, Assia Djebar et d’autres. Ces écrivains-journalistes tiennent des chroniques ou signent des papiers dans les revues (Esprit et Les Temps modernes notamment), les magazines (France-Observateur, L’Express, Témoignage Chrétien…) et autres quotidiens. Ils écrivent aussi des journaux, des romans, des pièces de théâtre voir des ouvrages inclassables parce que composites et « polyphoniques ».
Bien évidemment dominent ici la figure de Mauriac, « le plus clairvoyants des écrivains-journalistes» et l’opposition érigée depuis en symbole entre Sartre et Camus. La « radicalité » et la violence sartrienne, dont les soubassements philosophiques sont rappelés, face à « l’honnêteté » camusienne. Comme l’écrit en avant-propos Philippe Baudorre, Camus est « exemplaire », peut-être même « le plus exemplaire ». Ses tragiques illusions, quant à une possible concertation, comme les doutes et le désarroi de l’enfant de Belcourt, jamais ne pervertiront son « souci pédagogique ». Oui Camus a été « exemplaire » comme Mouloud Feraoun, son ami. L’instituteur kabyle, dans sa vie comme dans ses écrits, frôlerait, si elle était de ce monde, l’intégrité absolue. Son Journal, écrit entre 1955 et 1962 demeure encore aujourd’hui le plus sûr document sur cette guerre. « Ce texte, écrit Martine Mathieu-Job, montre l’impossibilité d’un discours de vérité, l’impossibilité surtout d’une représentation claire et univoque de la guerre, et cela quel que soit le genre dans lequel on le classe » à savoir « journal personnel, « chronique » ou « récit sur la guerre ».
Chez Camus, après 1956, l’honnêteté prendra le visage du silence ou plutôt d’un retour en littérature avec la rédaction du Premier homme qui ne naîtra au monde que trente-cinq ans après la mort de son auteur. Chez Mouloud Feraoun, elle prendra la forme « d’une poétique de l’écriture de la guerre » marquée par le « fractionnement » et « l’éclatement » du texte. « C’est dans le désordre du texte, dans l’impossibilité pour l’écrivain de s’en tenir à un projet d’écriture bien codifié ou de développer une analyse bien univoque, c’est dans l’entrelacs des temporalités et le télescopage des perceptions et des voix que peut s’entrevoir la vérité informe de la guerre ».
C’est bien par le Journal de Feraoun qu’il faudrait toujours commencer l’étude de cette guerre d’Algérie. Mieux encore, la publication des actes de ce colloque ne fait que renforcer ce credo : la lecture de ce texte unique offre à son lecteur la distance nécessaire pour aborder tous les autres textes écrits sur et autour de ce drame, et tant d’autres d’ailleurs… plus récents.
Editions Presses universitaires de Bordeaux, 2003, 302 pages, 26 €
-
Le Malentendu
Franco La Cecla
Le Malentendu
 L’auteur, anthropologue italien partagé entre Palerme et Paris, ancien élève d'Ivan Illich et de Michel Foucault, présente dans Le Malentendu, son premier livre traduit en français, une réflexion stimulante sur l’altérité. Partant des travaux de Vladimir Jankélévitch (celui du Le je ne sais quoi et le Presque rien), le malentendu ne se réduit pas à un défaut de la fade et triomphante communication, mais est plutôt une chance, celle de la rencontre. Cet événement, ce « lubrifiant des rapports interpersonnels », selon le mot du philosophe français, seul le temps le sauvera, en permettant aux uns et aux autres de renouer avec la « conscience de l’« expérience de l’autre ». Au temps comme solution au malentendu (V. Jankélévitch), l’auteur, en ancien urbaniste qu’il fut, ajoute une dimension spatiale. Selon lui, « on peut « habiter » le malentendu et en faire une zone de respect, un « coussinet amortisseur » de la relation à autrui ».
L’auteur, anthropologue italien partagé entre Palerme et Paris, ancien élève d'Ivan Illich et de Michel Foucault, présente dans Le Malentendu, son premier livre traduit en français, une réflexion stimulante sur l’altérité. Partant des travaux de Vladimir Jankélévitch (celui du Le je ne sais quoi et le Presque rien), le malentendu ne se réduit pas à un défaut de la fade et triomphante communication, mais est plutôt une chance, celle de la rencontre. Cet événement, ce « lubrifiant des rapports interpersonnels », selon le mot du philosophe français, seul le temps le sauvera, en permettant aux uns et aux autres de renouer avec la « conscience de l’« expérience de l’autre ». Au temps comme solution au malentendu (V. Jankélévitch), l’auteur, en ancien urbaniste qu’il fut, ajoute une dimension spatiale. Selon lui, « on peut « habiter » le malentendu et en faire une zone de respect, un « coussinet amortisseur » de la relation à autrui ».
Revenant sur les ghettos juifs et illustrant son propos par l’expérience des Littles Italies ou des Chinatown, le ghetto « est une façon de limiter le malentendu interculturel, et de le gérer en se servant de l’espace urbain ». Ainsi, serait-il « le malentendu par excellence » parce qu’il cacherait « sous un terme négatif quelque chose de très utile ».
Ce mode de gestion du rapport à l’autre, cette forme de résistance à une assimilation rapide ou ces simulations d’identité... créent « un espace pour la rencontre, pour le pacte qui doit s’en suivre ». Ce n’est pas de la fermeture et du repli sur soi mais bien de la rencontre dont l’auteur fait ici l’éloge, à travers le malentendu et ses transpositions spatiales et urbaines. Une rencontre qui ne va pas de soi et qui exige ces « acrobaties » de la part d’un groupe (minorité culturelle, linguistique, ethnique, immigrés...) pour « rendre sa présence élastique et apte à la contradiction sociale ». La « fragmentation », repérable dans les grandes villes américaines par exemple, n’est plus pour l’auteur assimilable au malentendu ; il en marque la fin, la disparition, sa mutation en « peur », alors, « l’espace physique n’est plus perçu comme seuil mais comme barrière ». Fustigeant le discours sur l’intégration, Franco La Cecla marque bien la différence entre ce qu’il nomme « ma découverte « positive » du ghetto » et « ces lieux de haine, de marginalisation et de violence » que seraient « les banlieues parisiennes ». « Une banlieue n’est pas un ghetto, c’est bien pire. C’est un lieu auquel on a soustrait le temps, c’est une périphérie où la temporalité relationnelle avec la ville est totalement impossible, c’est le lieu off limits de la réclusion, l’espace du refoulement physique des différences ». Et, sur cette question essentielle aujourd’hui, celle de la place de l’islam dans les sociétés européennes, l’auteur diagnostique que « l’islam tourne au fondamentalisme précisément là où l’Occident a perdu son caractère multiculturel et multiconfessionnel ».
Après l’éloge du ghetto, l’auteur loue la frontière. Non pas la ligne de démarcation (caractéristique du « mythe de l’intégration », ligne tracée par on ne sait quelle instance supérieure et soupçonneuse, et qui très vite se transforme en tranchée) mais la frontière comme « filtre et séparation, lieux où se présentent deux identités », « sorte de terrain vague », flou et incertain. Elle s’apparente plutôt aux marchés traditionnels comme lieux de la mise en scène et de la rencontre des différences, ou, aujourd’hui, aux villes-mondes. La frontière est alors lieu de malentendu, c’est-à-dire « un parcours de la connaissance dans le temps. Mieux, elle devient « identité » et Franco de Cecla rejoint E. Glissant, P. Chamoiseau et d’autres dans la tentative de dégager une « troisième voie entre universalisme et fanatisme localiste », celle de la « créolité » et du métissage et de la « démonstration qu’il n’y a pas d’identité fixe, que l’identité n’est pas une limite mais une ressource de vie ».
Préface de Marc Augé, édition Balland, 2002, 163 pages, 14,50 € -
La notion de culture dans les sciences sociales
Denys Cuche
La notion de culture dans les sciences sociales
 A l'heure où de nombreuses questions taraudent nos contemporains et notamment comment marquer sa différence dans un universel tout aussi revendiqué, à l'heure de la crise de l'Etat-nation sous l'assaut conjugué de dynamiques internes mais aussi de cette fameuse mondialisation qui ne serait qu'une américanisation qui ne dit pas son nom, à l'heure enfin, où des apprentis sorciers jouent, en utilisant le tison du multiculturalisme, avec le feu du communautarisme quand d’autres s’amusent à ouvrir la boîte de Pandore de l’identité, Denys Cuche permet à la fois de prendre quelques distances avec l'actualité et d'esquisser des réponses à des débats souvent passionnels et chargés sur le plan affectif.
A l'heure où de nombreuses questions taraudent nos contemporains et notamment comment marquer sa différence dans un universel tout aussi revendiqué, à l'heure de la crise de l'Etat-nation sous l'assaut conjugué de dynamiques internes mais aussi de cette fameuse mondialisation qui ne serait qu'une américanisation qui ne dit pas son nom, à l'heure enfin, où des apprentis sorciers jouent, en utilisant le tison du multiculturalisme, avec le feu du communautarisme quand d’autres s’amusent à ouvrir la boîte de Pandore de l’identité, Denys Cuche permet à la fois de prendre quelques distances avec l'actualité et d'esquisser des réponses à des débats souvent passionnels et chargés sur le plan affectif.
Dans son livre, devenu un classique plusieurs fois réédité, il brosse à grands traits mais de manière éclairante l'histoire de l'idée moderne de culture née au XVIIIème siècle, les approches théoriques, aux USA et en Europe, des questions culturelles et identitaires, des situations de rencontres culturelles et des processus d'acculturation c'est à dire des mouvements de rapprochement culturel.
Il montre en quoi chaque culture particulière se rattache à un universel commun, et en quoi, parce que l'humanité est une, les différences culturelles ne représentent que l'application de principes culturel universels.
Constituant des systèmes cohérents en soi, les différentes cultures sont sujettes à des transformations, soit par le fait de logiques internes soit sous l'influence d'éléments extérieurs. Elles sont dynamiques, mouvantes, changeantes, tout le contraire donc de certaines représentations muséographiques - sans doute pour mieux les nier - ou figées dans un âge d'or lointain et irréel.
Denys Cuche montre la distinction à établir entre les notions de culture et d'identité. Alors que la culture relève en grande partie de processus inconscients, l'identité elle, renvoie à un processus réfléchi d'affirmation de "sa" différence. Une affirmation qui repose à la fois sur des normes d'appartenance (nous) et d'opposition (les autres). Autrement dit, comme l'écrit l'auteur, "il n'y a pas d'identité en soi, ni même uniquement pour soi. L'identité est toujours un rapport à l'autre".
L'étude de ce rapport s'inscrit dans le champs complexe des rapports sociaux, des relations entre groupes culturels minoritaires et l'Etat-nation mais aussi sur le plan individuel, le parcours affectif, psychologique, socio-culturel... de chacun.
Dans cette lutte au quotidien pour simplement marquer une présence, une existence, une vie, l'affirmation d'une identité revient toujours à tracer une frontière.
Mais attention "une même culture peut être instrumentalisée de façon différente, voire opposée, dans diverses stratégies d'identification". Ainsi, n'assiste t-on pas aujourd'hui au lamentable spectacle de l'appauvrissement d'une culture et d'une histoire pourtant si riche et foisonnante par ceux qui, en instrumentalisant et trahissant la foi d'un milliard d'hommes et de femmes, revendiquent une identité mortifère et liberticide ?
Avec force, il faut dire et redire, armé de ce travail important, que "ce qui sépare deux groupes ethno-culturels ce n'est pas au départ la différence culturelle (...). [Non] ce qui crée la séparation, la "frontière" c'est la volonté de se différencier et l'utilisation de certains traits culturels comme marqueurs de son identité spécifiques".
Si, par le fait même qu'il est extrêmement dense, le livre est parfois d'un abord difficile il est en revanche - après un tour d'horizon sur plus de deux siècles de débats et d'usage de la notion de culture en sociologie, en anthropologie et en ethnologie, indispensable pour réaffirmer qu' "il n'y a pas de différence essentielle entre les hommes et les cultures - autrement dit que l'autre n'est jamais absolument autre, qu'il y a du même chez l'autre, parce que l'humanité est une, ce qui fait que la Culture est au cœur des cultures ou, selon l'expression consacrée, que "l'universel est au cœur du particulier (...)".
Edition La Découverte, collection Repères, 2004, 124 pages, 7,95€Illustration: Yue Minjun
-
Immigration, le défi mondial
Philippe Bernard
Immigration, le défi mondial
 Journaliste au Monde et spécialiste des questions d’immigration, Philippe Bernard donnait ici un livre dense mais jamais confus, au ton informatif et toujours argumenté. Si depuis sa parution nous sommes entrés dans l’ère de « l’immigration choisie » abandonnant le fantasme de « l’immigration zéro » et si quelques chiffres sont à actualiser, ce petit livre demeure bien utile, par sa quasi-exhaustivité sur la question et le rappel de données statistiques, historiques, juridiques et autres mesures gouvernementales prises depuis 1974, le tout sans jamais perdre de vue l’essentiel : pointer les enjeux des migrations mondiales mais aussi ceux de l’immigration en France.
Journaliste au Monde et spécialiste des questions d’immigration, Philippe Bernard donnait ici un livre dense mais jamais confus, au ton informatif et toujours argumenté. Si depuis sa parution nous sommes entrés dans l’ère de « l’immigration choisie » abandonnant le fantasme de « l’immigration zéro » et si quelques chiffres sont à actualiser, ce petit livre demeure bien utile, par sa quasi-exhaustivité sur la question et le rappel de données statistiques, historiques, juridiques et autres mesures gouvernementales prises depuis 1974, le tout sans jamais perdre de vue l’essentiel : pointer les enjeux des migrations mondiales mais aussi ceux de l’immigration en France.
Car, si Philippe Bernard a choisi de titrer son ouvrage sur le « défi mondial », il aurait tout aussi bien pu mettre en avant d’autres défis, ceux qui se limitent aux frontières de l’Hexagone et qui baignent, encore et toujours, dans une mare de confusions, d’approximations et d’erreurs d’où il est difficile de s’extraire. Didactique, l’auteur en fournit quelques illustrations et permet de dépasser ces lieux communs où pataugent trop souvent les débats qui empêchent d’aborder les vraies questions. Ainsi du prétendu coût social des immigrés, du « faux-semblant » de la délinquance étrangère, de cette « fausse évidence », économiquement « aberrante » qui établit chez le vulgum pecus perméable aux arguments spécieux une correspondance entre chômage et immigration ou encore de cet autre mirage du bon sens, un temps en vogue chez nos hommes politiques, qui consisterait à fermer les frontières et à prôner une immigration zéro. L’enjeu est de taille car il ne s’agit pas moins du devenir du vivre ensemble dans une France par ailleurs engagée dans la construction européenne et ballottée par une mondialisation qui prône allègrement la libre circulation des biens et des capitaux et semble rétive à celle des hommes. Tout pourtant n’est pas sombre sous le ciel de l’intégration à la française. Reprenant les résultats de l’enquête de l’Ined publiée par M.Tribalat en 1995, l’auteur rappelle « la relative bonne santé des mécanismes d’intégration » mesurée par l’utilisation de la langue française, le nombre de mariages mixtes, les pratiques religieuses, la scolarité (l’insertion professionnelle est autrement problématique pour les jeunes d’origine maghrébine notamment) ou les acquisitions de la nationalité française.
Mais fort justement P.Bernard montre aussi les pièges des discours sur l’intégration. Tout d’abord parce qu’ils ne cessent de renvoyer des jeunes nés en France depuis deux voir trois générations « à une appartenance culturelle irréductible » et, ajoutons largement fantasmagorique. Ensuite, ces discours devenus insupportables pour beaucoup « masquent la violence sociale que produisent les discriminations dans l’accès à l’emploi, au logement, aux services publics, face à la police ou à l’entrée des boîtes de nuit ».
Autres obstacles pour les années à venir : les conséquences d’un type d’urbanisation qui peut mener à la ghettoïsation, l’émergence d’un racisme qui ne puise plus ses principes dans une idéologie inégalitaire mais, s’appuyant sur un dévoiement du droit à la différence, prône l’affirmation de soi en soulignant l’inassimilabilité des cultures et les dangers du métissage ou encore la montée de tendances communautaristes (les pratiques matrimoniales turques sont pointées du doigt).
L’auteur relève « cinq » (en fait ils sont six) défis pour les années à venir : l’école qui ne doit pas s’ouvrir aux cultures d’origine ; la politique familiale qui doit viser à consolider les familles, y favoriser l’autonomie de la femme mais aussi la transmission entre les générations ; l’urbanisme populaire qui depuis un demi siècle s’apparente à une politique de relégation. Il ne suffira pas de démolir mais de prendre en compte aussi la répartition des populations immigrées, l’accès aux services publics et la lutte contre les pratiques discriminatoires. P.Bernard ajoute deux enjeux : l’islam avec d’un côté son aptitude à « s’acclimater » à la laïcité républicaine et de l’autre « la souplesse de la société française pour accepter cette religion » et un « enjeu mémoriel », la capacité de la société à intégrer la mémoire des anciens colonisés. La lutte contre les discriminations et le respect de l’égalité républicaine est le sixième et dernier défi.
Si, sur les six chapitres du livre, cinq concernent la France, il n’en demeure pas moins que l’immigration est aujourd’hui de dimension planétaire comme invite à en prendre conscience le chapitre d’ouverture du livre. 125 millions de personnes dans le monde vivent en dehors du pays dont ils ont la nationalité. Si l’on y ajoute les quelque 30 millions de « déplacés » dans leur propre pays, le monde compte 150 millions d’hommes et de femmes en migration soit 2,5% de sa population totale.À cette échelle et paradoxalement les craintes d’un déferlement d’immigrés en Europe ne tiennent pas. Tout d’abord parce que sur ces données l’éclatement de l’ex-URSS et avec lui la multiplication des Etats a eu un effet artificiel « en produisant à lui seul 45 millions d’étrangers ». Mais surtout P.Bernard montre que la majorité de ces mouvements de populations se situe au sein de l’hémisphère sud et que malgré le différentiel important des taux de rémunération du travail entre le Nord et le Sud, il n’y a nulle « invasion » mais des risques énormes pris par certains ressortissants des pays pauvres (2000 morts ont été recensés aux frontières de l’Europe entre 1993 et 2000).
L’immigration n’est pas seulement le fait d’une pression du Sud, elle correspond aussi à l’appel des pays développés : besoins du marché du travail, besoins démographiques, offre de travail illégal de plusieurs secteurs économiques... Ajoutez à cela les gains tirés par les maffias albanaises, chinoises et turques du trafic de clandestins (de cinq à sept milliards de dollars de chiffre d’affaires par an !), plus ceux tirés de la traite des femmes et l’on comprend que le tableau ne peut se réduire à cette inconvenance qui consiste, parfois en toute bonne foi, à demander si les pays européens peuvent ou non accueillir « toute la misère du monde ».
Pourtant, les migrations mondiales, de plus en plus complexes et aux causes plurielles (travail, regroupement familial, quête d’un asile) se heurtent à la volonté des Etats de contrôler les entrées. De ce point de vue, en Europe, dans le cadre d’un processus de communautarisation du dossier de l’immigration, les enjeux des prochaines années sont clairement énoncés : harmonisation des statistiques européennes, mise au point d’une politique européenne de l’asile, rapprochement des législations sur l’entrée et le séjour des étrangers...
Défi national, défi mondial, l’immigration est au cœur des questions identitaires. De même que la population de la France, cette « terre d’immigration » n’est plus seulement « multiprovinciale » mais aussi « multiraciale », qu’elle est de moins en moins hexagonale « et de plus en plus européenne voire planétaire », de même, la population de la planète se mondialise progressivement. Ce mouvement tend à relativiser les prétentions universalistes des uns et bute sur les fermetures communautaristes des autres, la toute puissance des marchés et la persistance des inégalités économiques, sociales et internationales. L’enjeu culturel et identitaire n’est pas et de loin le moindre des défis ici répertoriés. La France sera t-elle voir dans le miroir le reflet de son nouveau visage ?
Edition Gallimard, Folio actuel, 2002, 346 pages
Illustration : Picasso - Fille devant un miroir -
Les républicains espagnols dans le Camp de concentration nazi de Mauthausen.
Pierre et Marie Salou Olivares
Les républicains espagnols dans le Camp de concentration nazi de Mauthausen. Le devoir collectif de survivre
 Quelques jours seulement après la parution de ce livre, le quotidien espagnol El Mundo du 30 octobre 2005 rapportait que le criminel de guerre nazi, Aribert Heim, recherché par les polices allemande et autrichienne, se cacherait en Espagne depuis 1985. La piste sera vite abandonnée au profit d’une piste chilienne puis égyptienne. Cet ancien médecin est surnommé « le petit Mengele » pour avoir torturé et pratiqué des injections de poisons sur des centaines de victimes entre le 8 octobre et le 29 novembre 1941 à Mauthausen. Terrible ironie de l’histoire, c’est dans ce camp que 7297 Espagnols ont été déportés. 4761 n’en sont pas revenus. Combien parmi ces victimes sont passées entre les mains du bourreau Heim ?
Quelques jours seulement après la parution de ce livre, le quotidien espagnol El Mundo du 30 octobre 2005 rapportait que le criminel de guerre nazi, Aribert Heim, recherché par les polices allemande et autrichienne, se cacherait en Espagne depuis 1985. La piste sera vite abandonnée au profit d’une piste chilienne puis égyptienne. Cet ancien médecin est surnommé « le petit Mengele » pour avoir torturé et pratiqué des injections de poisons sur des centaines de victimes entre le 8 octobre et le 29 novembre 1941 à Mauthausen. Terrible ironie de l’histoire, c’est dans ce camp que 7297 Espagnols ont été déportés. 4761 n’en sont pas revenus. Combien parmi ces victimes sont passées entre les mains du bourreau Heim ?
Pierre et Marie Salou Olivares ont consacré des années de travail à ces « Espagnols anti-fascistes » de Mauthausen en colligeant les témoignages des survivants publiés entre le début des années 60 et la première moitié des années 90 dans Hispania le journal de la FEDIP, la Fédération Espagnole des Déportés et Internés Politiques.
« Je suis fille d’un militant actif au sein de la FEDIP, écrit Marie Salou Olivares, et toute mon enfance, j’ai entendu parler du « livre » de la FEDIP sur le Camp de Mauthausen. Mais toujours les urgences de la vie l’ont remisé à plus tard (…) ». C’est donc elle, aidée de son fils, qui, bien plus tard, réalise ce livre « pour que cette terrible expérience ne soit pas engloutie avec le dernier témoin » et pour « transmettre aux générations futures, conformément aux souhaits de tous ces humains meurtris, les pénibles épreuves qu’ils ont affrontées. Leur espoir étant que cela ne se reproduise jamais ! ». Cette volonté de « témoigner » sourd des mille pages de ce livre et des quelque quatre-vingts textes écrits en espagnol et suivis de leur traduction en français. Témoigner comme un hommage collectif rendu à ceux qui n’en sont pas revenus. Témoigner pour que l’histoire ne soit pas falsifiée ni oubliée. Témoigner, pour rester vigilant, pour ne pas voir « diminuer la détermination du monde à combattre » la toujours menaçante « bête immonde » dont parle Brecht. Témoigner enfin comme un acte de résistance, pour dire cette âme de résistance chevillée au corps des Républicains espagnols, éternels combattants de la liberté. Combattants oubliés d’une liberté remisée au clou de l’Histoire.
Aux origines de la déportation
L’histoire des Républicains espagnols fait aussi partie de notre histoire. Pas seulement parce qu’après la « retirada », au cours de cet « exode tragique », ils furent accueillis en « exilés maudits » dans les camps de regroupements (à Argelès sur Mer, Saint Cyprien, Vernet d’Ariège, Bram, Sepfonds, Gurs,…), mais aussi parce que leur arrivée en France a été pour des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, l’antichambre de la déportation dans les camps nazis de concentration ou d’extermination, l’antichambre de la mort. Pour ces exilés, la seconde guerre mondiale n’a pas commencé en 1939, mais le 18 juillet 1936 avec la guerre d’Espagne. Les républicains espagnols n’ont cessé de le répéter : ils ont été aux avants postes de la lutte contre le « fascisme international ». Face à Franco, à Mussolini et Hitler, les « soi-disant démocraties » ont démissionné dans ce qui sur le sol ibérique n’aura été qu’une « répétition ». Pire, pourquoi déporter les Espagnols en Allemagne demande Lazaro Nates ? L’ex-détenu, matricule 3832, parle d’une « complicité » pour se débarrasser des « indésirables », des « rouges espagnols », « complicité entre les xénophobes français de cette époque, les autorités espagnoles franquistes et ceux qui devaient exécuter cette triple complicité : les Allemands ».
Les « triangles bleus » des « apatrides »
Mauthausen a été un camp où 118 000 déportés sur les 198 000 qui y ont été internés entre le 8 août 1938 et le 5 mai 1945 (1), ont été exterminés. « 80 mois consacrés à la mort » comme l’écrit un ancien häftlingen (détenu) dans ce que les rescapés appellent « la machine de destruction », « l’abattoir », « l’enfer » ou « le bagne dantesque ». 1475 morts par mois, 53 morts par jour et ce pendant près de sept ans ! Cette macabre et incertaine comptabilité est peut-être nécessaire pour donner une vague idée de l’horreur.
À leur arrivée, les déportés savaient vite ce qui les attendait : « Vous êtes entrés par cette grande porte et vous ne sortirez que par cette cheminée », assenait, en montrant la fumée qui s’échappait des fours crématoires, le commandant Franz Ziereis ou l’interprète allemand du camp surnommé « Enriquito » ou « Manolita » par les détenus espagnols.
 Mauthausen était un camp d’extermination par le travail. « La célèbre carrière nommée : Wienergraben », carrière de granit, se trouvait en contrebas du camp. Un escalier de 186 marches, « le tragique escalier sur lequel périrent tant d’hommes » y donnait accès.
Mauthausen était un camp d’extermination par le travail. « La célèbre carrière nommée : Wienergraben », carrière de granit, se trouvait en contrebas du camp. Un escalier de 186 marches, « le tragique escalier sur lequel périrent tant d’hommes » y donnait accès.
Déportés en convoi depuis le 6 août 1940 jusqu’à la fin de l’année 1943, les Espagnols ont été les premiers en France à être expédiés dans les camps de la mort, à y être broyés par le monde concentrationnaire nazi. À Mauthausen, un triangle bleu avec la lettre « S » (pour « Spanier », Espagnol) les distinguait des autres détenus.
Pour tuer, les bourreaux n’ont jamais manqué d’imagination : froid, manultrition, épuisement, vermines, tortures, sauvageries, humiliations, sadismes, bastonnades, morsures de chiens, pendaison, expériences médicales, chambres à gaz, crémation... La mort était partout et frappait à chaque instant, le sadisme était sans limites. « Personne, à part ceux qui l’ont vécu, ne peut imaginer jusqu’à quel point le fanatisme amène à des actes extrêmes. Personne ne peut imaginer que la férocité puisse atteindre de telles proportions ». Pourtant, il faut lire les témoignages, tous les témoignages pour, peut-être et seulement, se rappeler de quoi justement les hommes sont capables. « Pour eux, [les SS] il ne s’agissait pas de tuer des êtres humains mais d’exterminer des animaux nuisibles ». « Prolonger l’agonie de ces martyrs était leur amusement, leur jouissance. Nous nous demandions comment ces hommes, appartenant à un des pays les plus civilisés, comme c’est le cas de l’Allemagne, pouvaient-ils commettre quotidiennement tant de crimes et parvenir à la fin de leur journée à rentrer dans leur foyer pour se comporter en amants, époux ou pères affectueux avec leurs enfants ».
Fidélité
Il faut témoigner aussi et surtout pour celles et ceux qui n’en sont pas revenus : « nous leur devons de défendre la mémoire de leur sacrifice, afin qu’ils ne meurent pas assassiner une autre fois » écrit en 1980 un rescapé (matricule 5080). Défendre la mémoire des victimes est un devoir qui va bien au-delà du cercle des rescapés : « si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer et ils seraient anéantis définitivement. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité", disait le philosophe Vladimir Jankélévitch.
Ces hommages et ces témoignages de « fidélité » aux victimes sont écrits avec une étonnante sobriété et une remarquable pudeur. Les horreurs subies sont relatées avec dignité, de cette dignité qui fait les combattants : toujours rester debout et faire face. La lutte ne cesse jamais disent ces rescapés. Elle n’a jamais cessé : en Espagne d’abord. En s’engageant contre l’Allemagne nazie ensuite. Puis dans les camps et, au lendemain de la guerre, en exil, contre le régime franquiste et contre les tentatives révisionnistes et le réveil de la barbarie. Résistance et liberté sont les deux mots qui reviennent le plus souvent sous la plume de ces hommes devenus passeurs de mémoire mais surtout testateurs d’un bien inestimable.
Résister
La résistance à l’intérieur du camp prend des formes multiples. Individuelle ou collective, elle frôle toujours la mort. José Marfil Escaboue, matricule 3394, est à l’origine du premier acte de résistance des Espagnols de Mauthausen. À sa mort, les Espagnols osent demander et obtiennent la permission d’observer une minute de silence en hommage à leur camarade, première victime d’une longue série.
Où trouver « le salut » demande Antonio Velasco ? « En nous préoccupant d’éliminer le négatif pour favoriser le positif. Cette attitude nous permit d’être un petit pourcentage à sortir vivants de Mauthausen. La principale cause fut la chance pour les uns d’être dispensés de dures punitions et pour les autres de recevoir plus de nourriture que la ration prévue. Il n’y a pas de mystère. Mais la mort nous entourait avec insistance (…), il suffisait d’un caprice plus ou moins imbécile des SS ou de la haine d’un quelconque kapo (…) ». Et pour Juan de Portado, cette certitude : « dans une tragédie, il reste toujours quelqu’un pour raconter ce qui s’est passé, nous ne pouvions échapper à cette règle, cette pensée nous réchauffait un peu ».
Pour survivre, il faut se battre quotidiennement, tenter d’améliorer la misérable pitance servie par les SS, éviter les travaux pénibles, en cherchant, comme Pedro Freixa, à travailler à l’infirmerie ou à conquérir certains postes clés de l’administration du camp en luttant contre les « triangles verts », les prisonniers de droits communs, pour « tant que faire se pouvait, humaniser la vie de cet enfer ». « Humaniser » cet enfer à en faire monter les larmes aux yeux de ces hommes qui ont tout vu, tout subi, en organisant, clandestinement une célébration du noël de l’année 1943...
C’est au cours d’une autre nuit, celle du 23 juillet 1941, qu’Antonio Velasco, avec trois autres compagnons, décident de s’évader. Un périple dangereux de quarante-deux jours à travers une Autriche hostile pour tenter de gagner la Suisse. Antonio Velasco sera rattrapé et réexpédié au camp. Il échappera à la mort. Plus que d’autres, si cela est seulement possible, Antonio Velasco est un « miraculé ». C’est en se suicidant que Narcisse Gali choisit, lui, la liberté : « sa mort fut comparable à sa vie écrit P.Pey Sarda. Elle fut un ultime geste de propagande antifascite ». Résister encore et toujours. Résister jusqu’aux derniers jours. Dès le mois d’octobre 1944, les Espagnols participent aux préparatifs d’une défense pour prévenir une extermination massive des détenus par des gardiens prêts à déserter devant l’avancée des troupes alliées.
Le goût de la liberté
On oublie trop souvent cette bannière déployée sur le fronton du portail pour saluer l’arrivée des troupes américaines ce « 5 del 5 del 45 » comme l’écrit Solticio en une heureuse arithmétique et une joyeuse mélopée de chiffres. Sur la toile tendue, ce 5 mai 1945 les détenus espagnols avaient écrit : « Los Españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras ». Mais, à l’instar de « cette banderole de la solidarité » oubliée, les Républicains espagnols ont aussi « la désagréable sensation d’être fréquemment les oubliés de l’histoire ». Pourtant, comme hier, quand il a fallu taire ses déceptions et ses divisions et s’engager dans l’armée française ou dans la résistance, face à « l’ennemi commun », qu’importe aujourd’hui les conflits de mémoires, qu’importe même la désillusion de voir se bâtir « un monde plus humain et plus juste », « notre mission n’est pas terminée ! » écrivait en 1981, un représentant de FEDIP, face aux menaces révisionnistes et au réveil de « l’euro fascisme ». Et les menaces ne manquent pas. Depuis le Rwanda jusqu’à la Tchétchénie en passant par l’ex-Yougoslavie, depuis un certain 21 avril 2001 jusqu’aux drames de Ceuta et Melila en passant par les dangereux amalgames fomentés par des apprentis caudillos de banlieues. Comme l’écrit Michel Reynaud dans sa préface, « en ces temps incertains et quelquefois insultants il est bon de clamer que des « étrangers » nous permirent de retrouver notre liberté. (…). L’histoire, notre histoire, leur est redevable et plus encore ». Oui, l’histoire des Républicains espagnols est bien notre histoire, encore faudrait-il ne pas l’oublier. Le dire et le répéter ne suffit pas, ne sert à rien, si cela ne se traduit pas en acte. Voilà ce que les derniers rescapés encore en vie nous lèguent. Leur dernier acte de résistance et le goût de la liberté.
Edition Tirisias, Collect. Les oubliés de l’histoire, 2005, 910 pages, 36 euros
(1) Selon les chiffres de l’Amicale des déportés de Mauthausen (site : http://www.campmauthausen.org/). Dans le livre de Pierre et Véronique Salou Olivares il est question de 25 000 survivants pour 225 000 détenus (page 126)