Jesus Diaz
Parle-moi un peu de Cuba
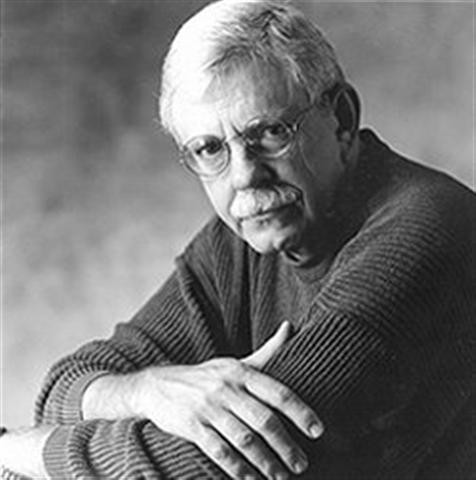 Il y aurait deux façons pour un Cubain de débarquer aux USA. Il y a la voie royale, celle où les Gringos vous déroulent le tapis rouge avec permis de séjour et autorisation de travail à la clef, et l’autre, où l’accueil se fait plus suspicieux, du bout des lèvres, comme à regret. Le même pays fera alors attendre le même exilé cubain une bonne année pour daigner le gratifier d’un permis et d’autorisations diverses. Il faut faire ses preuves. Dans le premier cas, le Cubain, perché ou vautré sur une méchante embarcation ou un radeau de fortune a réussi à s’esbigner de son île, éviter les humeurs des requins et échapper aux caprices des vents et des courants du détroit de Floride, pour s’en aller poser un pied salvateur du côté de Key West. Dans l’autre cas, le bougre est passé par le Mexique, comme le vulgum pecus des migrants de sorte qu’il sera soumis au commun législatif.
Il y aurait deux façons pour un Cubain de débarquer aux USA. Il y a la voie royale, celle où les Gringos vous déroulent le tapis rouge avec permis de séjour et autorisation de travail à la clef, et l’autre, où l’accueil se fait plus suspicieux, du bout des lèvres, comme à regret. Le même pays fera alors attendre le même exilé cubain une bonne année pour daigner le gratifier d’un permis et d’autorisations diverses. Il faut faire ses preuves. Dans le premier cas, le Cubain, perché ou vautré sur une méchante embarcation ou un radeau de fortune a réussi à s’esbigner de son île, éviter les humeurs des requins et échapper aux caprices des vents et des courants du détroit de Floride, pour s’en aller poser un pied salvateur du côté de Key West. Dans l’autre cas, le bougre est passé par le Mexique, comme le vulgum pecus des migrants de sorte qu’il sera soumis au commun législatif.
Le dénommé Staline Martinez, le personnage central du roman de Jesus Diaz, peut se vanter, lui, d’avoir tâter des deux méthodes. Mais dans le mauvais ordre. Il raconte son histoire enfermé sur une terrasse de Miami, exposant sa peau aux brûlures du soleil et son corps aux rigueurs du jeun et de la déshydratation, histoire de faire croire aux autorités américaines qu’il est bien un balsero, un cubain sauvé des eaux, un Staline anadyomène qui entend bénéficier illico du statut de réfugié. Pourtant, quelques semaines plus tôt, avant son come back via la frontière mexicaine, il était bien arrivé aux Etats-Unis par la mer. Et les Yankies lui ouvraient alors grand les bras, il lui suffisait de le demander, de faire le show au micro du reporter dépêché par un des nombreux réseaux d’informations, de vanter à la caméra la liberté retrouvée et de médire du socialisme à la sauce castriste. Il n’en fit rien. Mieux - ou pire - il demanda à reprendre le premier vol pour la Havane. Incompréhensible pour un esprit cartésien, qui a biberonné à l’économie néolibérale et à l’anti communisme.
Staline Martinez, modeste dentiste de son état, anti héros par excellence, travaillé par la culpabilité, la crainte et l’indécision, déconsidéré par son entourage, demande pourtant à rentrer sur son île, pour y retrouver son quotidien terne, pauvre, fait de pénuries, retrouver Fredesvinda, sa bicyclette antédiluvienne, Pepe son ventilateur moribond et surtout Idalys, son épouse callipyge. L’enamouré croit qu’elle l’attend comme Pénélope son Ulysse - mais sur un mode mas caliente - quand Idalys a déjà délaissé Staline pour Jésus...
A son retour, les autorités font du bien nommé Staline Martinez un héros national qui se doit cette fois de vanter les mérites du « Lider Maximo » et de médire de « L’Oncle Sam »…« Les gens comme lui étaient condamnés à courir d’un côté à l’autre en se cognant la tête pour voir si par hasard ils arrivaient à sortir du labyrinthe ». Quant aux vertus des systèmes politiques, Stalina (la sœur) a sa petite théorie : « le socialisme (…) était un parc zoologique où les gens vivaient dans des cages, en attendant que les gardiens leur lancent leur pitance ; tandis que le capitalisme était une forêt vierge où il fallait chasser tous les jours ».
Staline, à demi nu, se retrouve donc perché, durant cinq jours, sur la terrasse du pavillon de son frère Lénine, alias Léo pour les Américains. Pendant que le corps de l’infortuné se détériore, empeste, se couvre de squames, son esprit se dégrade à mesure que les souvenirs se font plus pressants, plus douloureux. Staline revit son histoire : comment et pourquoi par deux fois il a réussi à rejoindre les Etats-Unis, son quotidien à Cuba partagé entre l’hôpital, sa sœur et sa mère, quelques connaissances et Idalys. Comment, pour pallier l’absence de droits, les Cubains s’adonnent à la débrouille et aux magouilles pour trouver le nécessaire ou quelques dollars quand les jinetera, prostituée occasionnelles, tapinent avec les touristes… Staline ranime sa jalousie, ses frustrations, ce mépris de soi qui tire son origine davantage d’un système et d’une organisation sociale que d’une défaillance individuelle. Etre né cubain serait alors comme une malédiction : « Ah, s’il pouvait transmettre un jour à quelqu’un l’exaspérante humiliation que signifiait être cubain à Cuba (…) » dit-il. Les Maghrébins - et les Algériens en particulier - ont un mot pour cela : la hogra ! D’ailleurs, une scène de Parle-moi un peu de Cuba en rappelle une autre tirée du Passé Simple du marocain Driss Chraïbi. Les deux auteurs font, en un acte sacrilège, « pisser » leurs personnages qui sur le royaume marocain qui sur l’île révolutionnaire.
La solitude et les souvenirs de Staline sont entrecoupés des visites de Miriam, la nièce de Christina, sa belle-sœur. « Parle-moi un peu de Cuba » lui demande Miriam, arrivée aux Etats-Unis âgée de deux ou trois ans et qui ne peut converser qu’en anglais avec Staline. Christina exprimera le même souhait, le même appel. Derrière ces demandes identiques, percent deux attentes différentes. Une quête de repères pour l’une, plongée dans une société où elle ressent l’hostilité des autres communautés à l’endroit des Cubains et demande à Staline « who am I ? ». Quant à la boulimique Christina, il y entre une part de tristesse et de mal du pays. Christina est malheureuse et sans doute vit-elle son exil comme un déracinement. Parle-moi un peu de Cuba évoque la nostalgie et le sentiment de faute qui accompagne l’exilé, y compris chez Léo, le frère de Staline et l’époux de Christina qui fait tout pour que son fils Jeff « guérisse de Cuba ».
La dernière nuit approche. Lénine, alias Léo va déposer son frère aux large des côtes américaines sur un radeau. Quelques heures suffiront à Staline pour rejoindre la terre ferme. « Mardi 28 » sera un nouveau jour. Un page encore blanche, une page à noircir. Pour une fois « l’orgueil », fut-il « stupide » de Staline, pourrait bien y tenir la première place.
Il faut se méfier de ce roman et du style magistral de Jesus Diaz. Cette histoire est racontée avec force, densité, sur un mode plaisant, l’humour s’y baguenaude et même, au détour d’une page, une scène comique surgit. La distance avec les faits est trompeuse, comme un contre-pied. Cette narration, tenue de bout en bout, a sans doute à voir avec le « comique naturel (…) de tant de Cubains » : « capables de rire du malheur dans lequel ils [vivent] ».
Jesus Diaz est né en 1941 à Cuba, en exil à Madrid depuis 1992, il y meurt en 2002. Il est l’auteur de plusieurs romans dont quatre ont été traduits en français chez Métailié et deux autres chez Gallimard.
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Jean-Marie Saint-Lu, Métailié 2011, 237 page, 12 €
 Septième roman traduit en français pour cet auteur guatémaltèque proche, en son temps de Paul Bowles et qui se réclame de Borgès. Ce court texte à l'écriture limpide laisse perplexe. Une chouette en est le personnage principal : achetée, on tentera de la voler dans la médina de Tanger, blessée, elle sera soignée pour devenir objet d'un troc sexuel peu ragoûtant. Quelle histoire ! Elle sera le lien entre Hamza, jeune berger marocain et Angel touriste colombien. «Tout le monde sait que les chouettes ne dorment pas la nuit, et qu'elles voient dans l'obscurité. Donc, si l'on a décidé de veiller toute une nuit, il est bon de capturer une chouette et de lui arracher les yeux. » Hamza est justement chargé par son oncle d'une nocturne mission de surveillance sur la plage. Angel, lui, a perdu son passeport. Document officiel si l'en est... Objet de toutes les convoitises sur cette rive africaine mais dont la mystérieuse disparition sera pour notre Sud-Américain le prétexte à un nouveau départ.
Septième roman traduit en français pour cet auteur guatémaltèque proche, en son temps de Paul Bowles et qui se réclame de Borgès. Ce court texte à l'écriture limpide laisse perplexe. Une chouette en est le personnage principal : achetée, on tentera de la voler dans la médina de Tanger, blessée, elle sera soignée pour devenir objet d'un troc sexuel peu ragoûtant. Quelle histoire ! Elle sera le lien entre Hamza, jeune berger marocain et Angel touriste colombien. «Tout le monde sait que les chouettes ne dorment pas la nuit, et qu'elles voient dans l'obscurité. Donc, si l'on a décidé de veiller toute une nuit, il est bon de capturer une chouette et de lui arracher les yeux. » Hamza est justement chargé par son oncle d'une nocturne mission de surveillance sur la plage. Angel, lui, a perdu son passeport. Document officiel si l'en est... Objet de toutes les convoitises sur cette rive africaine mais dont la mystérieuse disparition sera pour notre Sud-Américain le prétexte à un nouveau départ. Ni "guide", ni vraiment tristes, sont les quatorze nouvelles de ce recueil où l'auteur d'Un monde pour Julius (chez le même éditeur) brosse, entre réalité et imaginaire, les souvenirs et les portraits d'exilés latino américains dans le Paris des années soixante. Plus que de tristesse, c'est peut-être de nostalgie dont il est fait état ici. Ce sentiment qui étreint les plus âgés à l'évocation d'un temps qui n'est plus et d'un espace devenu méconnaissable, où les plus jeunes poussent leurs aînés vers l'inconnu. Comme il est bien loin le temps des études au Quartier Latin ou à l'institut Goethe ! Car le monde de ce "guide triste" n'est pas celui de l'immigration ouvrière mais celui d'une jeunesse estudiantine, passablement insouciante, agrémentée, ici ou là, de quelques figures atypiques et souvent fort estimables comme ce Luis Antonio Vera, "exemplaire de Péruvien optimiste du début à la fin et de A à Z" ou Rosita San Roman, vieille dame respectable, officiant à l'ambassade du Pérou, amatrice de whisky et amoureuse de la ville Lumière, mais qui se laissera prendre par l'un des nombreux pièges tendus par cette "canaille" de Paris.
Ni "guide", ni vraiment tristes, sont les quatorze nouvelles de ce recueil où l'auteur d'Un monde pour Julius (chez le même éditeur) brosse, entre réalité et imaginaire, les souvenirs et les portraits d'exilés latino américains dans le Paris des années soixante. Plus que de tristesse, c'est peut-être de nostalgie dont il est fait état ici. Ce sentiment qui étreint les plus âgés à l'évocation d'un temps qui n'est plus et d'un espace devenu méconnaissable, où les plus jeunes poussent leurs aînés vers l'inconnu. Comme il est bien loin le temps des études au Quartier Latin ou à l'institut Goethe ! Car le monde de ce "guide triste" n'est pas celui de l'immigration ouvrière mais celui d'une jeunesse estudiantine, passablement insouciante, agrémentée, ici ou là, de quelques figures atypiques et souvent fort estimables comme ce Luis Antonio Vera, "exemplaire de Péruvien optimiste du début à la fin et de A à Z" ou Rosita San Roman, vieille dame respectable, officiant à l'ambassade du Pérou, amatrice de whisky et amoureuse de la ville Lumière, mais qui se laissera prendre par l'un des nombreux pièges tendus par cette "canaille" de Paris. Edgardo Cozarinsky est né en Argentine en 1939, petit-fils d’immigrés juifs fuyant les pogroms russes de la fin du XIXè siècle, il a grandi à Buenos Aires avant de venir s’installer à Paris en 1974. Cinéaste, il est aussi, comme écrivain, l’auteur de deux essais sur Borges et Henry James. Après Vaudou urbain (Bourgois, 1989) et Le Violon de Rothschild (Actes-Sud, 1996) ce recueil de nouvelles est sa troisième œuvre de fiction. E. Cozarinsky appartient encore à une génération où la littérature constituait encore la première ouverture sur le monde. Voilà pourquoi peut-être ses personnages ne peuvent s’appréhender qu’à travers la fiction romanesque. Aucune autre clef ne pourrait ouvrir sur ces existences marquées par l’exil, l’appartenance à des diasporas nombreuses, russe, juive ou argentine, le mélange poussé parfois jusqu’à la contradiction, les identités mêlées, les mémoires obscures et les tragédies totalitaires du dernier siècle.
Edgardo Cozarinsky est né en Argentine en 1939, petit-fils d’immigrés juifs fuyant les pogroms russes de la fin du XIXè siècle, il a grandi à Buenos Aires avant de venir s’installer à Paris en 1974. Cinéaste, il est aussi, comme écrivain, l’auteur de deux essais sur Borges et Henry James. Après Vaudou urbain (Bourgois, 1989) et Le Violon de Rothschild (Actes-Sud, 1996) ce recueil de nouvelles est sa troisième œuvre de fiction. E. Cozarinsky appartient encore à une génération où la littérature constituait encore la première ouverture sur le monde. Voilà pourquoi peut-être ses personnages ne peuvent s’appréhender qu’à travers la fiction romanesque. Aucune autre clef ne pourrait ouvrir sur ces existences marquées par l’exil, l’appartenance à des diasporas nombreuses, russe, juive ou argentine, le mélange poussé parfois jusqu’à la contradiction, les identités mêlées, les mémoires obscures et les tragédies totalitaires du dernier siècle.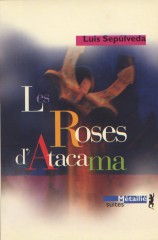 "J'étais ici et personne ne racontera mon histoire". Cette phrase a été gravée sur une pierre, à deux pas des fours crématoires du camp de concentration de Bergen Belsen en Allemagne. En visitant le camp, Luis Sepulveda est resté longtemps devant la terrible inscription. Il a alors vu des dizaines et des dizaines de mains passer et caresser le texte pour éviter que "la poussière de l'oubli" ne la recouvre définitivement. Ces mains appartenaient aux victimes de la barbarie nazie, mais aussi à celles des barbaries militaro-fascistes, nationalistes ou religieuses. "Raconter c'est résister", voilà pourquoi le romancier chilien en écrivant l'histoire de quelques-unes de ces victimes ne restitue pas seulement des mémoires que l'Histoire officielle et souvent oublieuse assassine une seconde fois, il anime et réanime la flamme de la résistance et cette "capacité d'aimer" qui semble être la marque de ces hommes et de ces femmes que la vie a dressé en une barricade inviolable face à la monstruosité de leurs soi-disant semblables.
"J'étais ici et personne ne racontera mon histoire". Cette phrase a été gravée sur une pierre, à deux pas des fours crématoires du camp de concentration de Bergen Belsen en Allemagne. En visitant le camp, Luis Sepulveda est resté longtemps devant la terrible inscription. Il a alors vu des dizaines et des dizaines de mains passer et caresser le texte pour éviter que "la poussière de l'oubli" ne la recouvre définitivement. Ces mains appartenaient aux victimes de la barbarie nazie, mais aussi à celles des barbaries militaro-fascistes, nationalistes ou religieuses. "Raconter c'est résister", voilà pourquoi le romancier chilien en écrivant l'histoire de quelques-unes de ces victimes ne restitue pas seulement des mémoires que l'Histoire officielle et souvent oublieuse assassine une seconde fois, il anime et réanime la flamme de la résistance et cette "capacité d'aimer" qui semble être la marque de ces hommes et de ces femmes que la vie a dressé en une barricade inviolable face à la monstruosité de leurs soi-disant semblables.