Luis Sepulveda
Les Roses d'Atacama
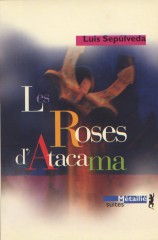 "J'étais ici et personne ne racontera mon histoire". Cette phrase a été gravée sur une pierre, à deux pas des fours crématoires du camp de concentration de Bergen Belsen en Allemagne. En visitant le camp, Luis Sepulveda est resté longtemps devant la terrible inscription. Il a alors vu des dizaines et des dizaines de mains passer et caresser le texte pour éviter que "la poussière de l'oubli" ne la recouvre définitivement. Ces mains appartenaient aux victimes de la barbarie nazie, mais aussi à celles des barbaries militaro-fascistes, nationalistes ou religieuses. "Raconter c'est résister", voilà pourquoi le romancier chilien en écrivant l'histoire de quelques-unes de ces victimes ne restitue pas seulement des mémoires que l'Histoire officielle et souvent oublieuse assassine une seconde fois, il anime et réanime la flamme de la résistance et cette "capacité d'aimer" qui semble être la marque de ces hommes et de ces femmes que la vie a dressé en une barricade inviolable face à la monstruosité de leurs soi-disant semblables.
"J'étais ici et personne ne racontera mon histoire". Cette phrase a été gravée sur une pierre, à deux pas des fours crématoires du camp de concentration de Bergen Belsen en Allemagne. En visitant le camp, Luis Sepulveda est resté longtemps devant la terrible inscription. Il a alors vu des dizaines et des dizaines de mains passer et caresser le texte pour éviter que "la poussière de l'oubli" ne la recouvre définitivement. Ces mains appartenaient aux victimes de la barbarie nazie, mais aussi à celles des barbaries militaro-fascistes, nationalistes ou religieuses. "Raconter c'est résister", voilà pourquoi le romancier chilien en écrivant l'histoire de quelques-unes de ces victimes ne restitue pas seulement des mémoires que l'Histoire officielle et souvent oublieuse assassine une seconde fois, il anime et réanime la flamme de la résistance et cette "capacité d'aimer" qui semble être la marque de ces hommes et de ces femmes que la vie a dressé en une barricade inviolable face à la monstruosité de leurs soi-disant semblables.
En trente-cinq textes très cours, à l'écriture concise, toujours percutante et vive, Luis Sepulveda écrit la vie de ces anonymes, une vie "mutilée" par les dictatures sud américaines. Il raconte les résistances des syndicalistes équatoriens ou chiliens, des indiens du Panama, toujours soucieux d'honnêteté ou le combat des habitants du lac d'Epuyen contre les tronçonneuses, celui aussi des Lapons pour la survie de leur culture, de leur langue et de leurs traditions. Il évoque aussi le sort d'une femme qui aujourd'hui déambule dans les rues de Moscou en racontant son passé de combattante à Stalingrad, le courage "indispensable" des journalistes sous les dictatures à mille lieux de nos "démocraties d'opinion" et maintenant "d'émotion". Dans "la grande famille humaine" le survivant de l'holocauste et résistant juif (Avram Sützkever) côtoie Don Giuseppe, l'épicier d'origine italienne de Santiago ou Fredy Taberna insatiable spectateur des merveilles du monde, comme ces roses d'Atacama, et qui fera face à ses exécuteurs "en chantant, à pleins poumons, la Marseillaise socialiste".
Les personnages historiques (Klaus Störtebecker, "le pirate de l'Elbe" du XIVe siècle ou Vasco Nunez de Balboa, "le seul espagnol qui est laissé un bon souvenir" au Panama), les événements (à Pietrasanta, la mort de deux cavatori, les travailleurs anonymes des carrières de marbre ou la fermeture d'une vieille trattoria sur le marché d'Asti) et ces figures de résistant (elles sont nombreuses ici) donnent lieu à des récits riches d'enseignements, source de réflexions, matières à s'enthousiasmer, à aimer ou à détester, à rire ou à pleurer. Et surtout à se révolter. À se révolter aussi contre le cynisme mercantile de nos sociétés. Un cynisme et une cupidité (cette "aiguille de glace dans la pupille") qui conduisent, en Amazonie, en Patagonie ou en Laponie, à la destruction de la terre, de la flore, de la faune quand ce n'est pas des hommes.
Nulle tristesse ici malgré le poids des horreurs et des injustices. Car comme le disait Hemingway à qui l'auteur consacre un texte, "la tristesse se résout dans un bar, jamais dans la littérature". Et ce recueil, placé entre le reportage journalistique et un plaidoyer en faveur "des hommes les plus marginaux de la terre" - plaidoyer qui parfois prend les accents d'une mise en garde - n'abandonne jamais les rivages de la littérature.
Traduit de l'espagnol (Chili) par François Gaudry, édition Métailié, 2003, 160 pages, 7 euros