Slimane Zeghidour, Sors, la route t’attend. Mon village en Kabylie, 1954-1962
 Question : quel pays a connu au cours de la seconde moitié du XXème siècle des déplacements de populations à hauteur de deux millions trois cent cinquante mille hommes, femmes et enfants ? Deux millions trois cent cinquante mille anonymes représentant plus d’un quart d’une de ses soi-disant composantes nationales ? Une migration interne, voulue, organisée, forcée aux conséquences individuelles et collectives désastreuses. Deux millions trois cent cinquante mille hommes, femmes et enfants, expulsés manu militari au petit jour, de leur gourbi (un indice) pour se retrouver enfermés dans un millier de camps (dits de regroupement) ceints souvent de barbelés, parfois électrifiés ! Ce pays a vu encore plus grand que la grande Amérique qui, dès 1942, avait expédié, sans autre forme de procès, 110 000 Nippo-Américains derrière d’identiques barbelés (voir Julie Otsuka, Quand l’empereur était un dieu, Phébus, 2004). Il faut dire que question camp, depuis au moins 1938, on s’y connaît… en France. Car c’est bien en France, dans une Algérie encore française, que ces déplacements furent imposés. Deux millions trois cent cinquante mille et plus si on ajoute celles et ceux qui se sont agglutinés aux abords des grandes villes du pays ou qui se sont esbignés qui au Maroc qui en Tunisie. « Un peuple en exil » écrit l’auteur, un « tsunami démographique [qui] aura ainsi touché un Algérien sur deux ».
Question : quel pays a connu au cours de la seconde moitié du XXème siècle des déplacements de populations à hauteur de deux millions trois cent cinquante mille hommes, femmes et enfants ? Deux millions trois cent cinquante mille anonymes représentant plus d’un quart d’une de ses soi-disant composantes nationales ? Une migration interne, voulue, organisée, forcée aux conséquences individuelles et collectives désastreuses. Deux millions trois cent cinquante mille hommes, femmes et enfants, expulsés manu militari au petit jour, de leur gourbi (un indice) pour se retrouver enfermés dans un millier de camps (dits de regroupement) ceints souvent de barbelés, parfois électrifiés ! Ce pays a vu encore plus grand que la grande Amérique qui, dès 1942, avait expédié, sans autre forme de procès, 110 000 Nippo-Américains derrière d’identiques barbelés (voir Julie Otsuka, Quand l’empereur était un dieu, Phébus, 2004). Il faut dire que question camp, depuis au moins 1938, on s’y connaît… en France. Car c’est bien en France, dans une Algérie encore française, que ces déplacements furent imposés. Deux millions trois cent cinquante mille et plus si on ajoute celles et ceux qui se sont agglutinés aux abords des grandes villes du pays ou qui se sont esbignés qui au Maroc qui en Tunisie. « Un peuple en exil » écrit l’auteur, un « tsunami démographique [qui] aura ainsi touché un Algérien sur deux ».
« Rien n’est, rien ne sera plus comme avant » rapporte celui qui n’avait alors que quatre ans : « La guerre (…) aura tôt retourné notre univers comme un gant. Nos mets, nos mots, nos habits, nos habitudes, tout a changé du tout au tout. En a peine douze mois de conflit armé, la France nous aura plus francisés, et sous toutes les coutures, qu’en cent vingt ans de prétendue « paix française ». « Cet exode qui a « dessouché » tout un peuple, désertifié le djebel, ce repaire millénaire, et, au final, annihilé l’univers paysan, reste un tabou absolu, ici et là-bas, car autant l’Etat français n’aura lésiné sur aucun moyen pour le parachever, autant l’Etat algérien une fois proclamé ne fera rien pour y remédier, et toujours pas un seul geste pour réparer le drame en aidant chacun à retourner en ses foyers. » Pire, un demi siècle après, Zeghidour revient au djebel où il ne peut que constater le « gâchis». « Rien n’aura été épargné par l’incurie, le népotisme, l’inculture historique » écrit-il, « rien qui puisse indiquer tant soit peu l’existence d’un Etat », juste les stigmates d’un « pouvoir, qui n’est rien d’autre, au fond, qu’une intériorisation du dédain colonial, un legs historique catalysé par d’ancestrales haines claniques ». C’est dit ! Retour en arrière.
« D’une main la torture, de l’autre l’écriture »
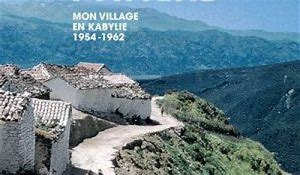 La plume alerte et affûtée, la pensée subtile et mordante, le regard sombre, l’esprit indépendant, l’essayiste et journaliste remonte le temps pour retrouver l’enfant né à l’orée de l’année 1954, dans une famille modeste, au cœur d’un village kabyle haut perché et encore épargné - pour le meilleur et pour le pire - par la modernité, et où langue et traditions, tout autant païennes que musulmanes, nimbaient de sacralité - pour le meilleur et pour le pire - chaque instant de l’existence. 1954, la guerre d’Algérie éclate, ou se poursuit, après « le divorce sans appel » du 8 mai 1945. « Mes premiers pas ont coïncidé avec ses bruits de bottes » écrit Zeghidour qui souligne que « c’est la guerre d’indépendance qui nous a fait rencontrer les Français. » Mise en présence paradoxale : « d’une main la torture, de l’autre l’écriture (…) ; l’avers et le revers d’une même médaille, soit, en même temps et tout d’une pièce, le pire et le meilleur de la France ». Thème déjà présent chez un Jean Amrouche et que l’on retrouve dans bien des textes écrits par quelques métèques devenus écrivains français qui ont d’abord découvert une Marianne méconnaissable leur claquer la porte au nez. Il aura donc fallu 1954 pour que des Algériens pur sucre tombent sur des Français (plutôt l’inverse ici). Pourtant au XIXe siècle, l’armada tricolore ne s’est pas gênée pour « retourne[r] le bled comme un gant ». Quant aux colons, qui « affluent en masse (…) ; ces prolétaires soudain devenus propriétaires » ils ont été « insatiables » et… sourds aux mises en garde visionnaires du pourtant colonialiste Jules Ferry. Lorsque Zeghidour évoque son père, Belkacem, sa mère Mériem, lorsqu’il revient sur la mort de son frère et de sa sœur Houria ou sur la disparition d’Amar, son frère d’adoption, il le fait avec pudeur, sans taire l’amour pour les siens ni cacher des larmes qu’il ne peut, aujourd’hui encore, contenir. Trois enfants morts ! Voilà, plus que de longs discours, le résultat d’une colonisation injuste et indifférente qui a laissé des hommes et des femmes vivre sans le soin, loin de la civilisation promise, sans autres recours que des croyances et des traditions vaines, inefficaces et parfois mortelles. L’Algérie de papa ? « Deux peuples qui vivent au sein du même territoire, mais pas dans le même pays ». Et parmi les ressorts souterrains des ruptures et violences, il y a peut-être le poids de la sexualité : « les intimités entravées » car « qu’est-ce qu’un voisinage qui met à l’index l’amour, une coexistence, une mixité qui interdit le mariage mixte, un mélange qui refuse le brassage ? Voilà tout le drame de l’Algérie française, l’alpha et l’oméga de son impasse. » Où quand Slimane Zeghidour rejoint Alexis Jenni.
La plume alerte et affûtée, la pensée subtile et mordante, le regard sombre, l’esprit indépendant, l’essayiste et journaliste remonte le temps pour retrouver l’enfant né à l’orée de l’année 1954, dans une famille modeste, au cœur d’un village kabyle haut perché et encore épargné - pour le meilleur et pour le pire - par la modernité, et où langue et traditions, tout autant païennes que musulmanes, nimbaient de sacralité - pour le meilleur et pour le pire - chaque instant de l’existence. 1954, la guerre d’Algérie éclate, ou se poursuit, après « le divorce sans appel » du 8 mai 1945. « Mes premiers pas ont coïncidé avec ses bruits de bottes » écrit Zeghidour qui souligne que « c’est la guerre d’indépendance qui nous a fait rencontrer les Français. » Mise en présence paradoxale : « d’une main la torture, de l’autre l’écriture (…) ; l’avers et le revers d’une même médaille, soit, en même temps et tout d’une pièce, le pire et le meilleur de la France ». Thème déjà présent chez un Jean Amrouche et que l’on retrouve dans bien des textes écrits par quelques métèques devenus écrivains français qui ont d’abord découvert une Marianne méconnaissable leur claquer la porte au nez. Il aura donc fallu 1954 pour que des Algériens pur sucre tombent sur des Français (plutôt l’inverse ici). Pourtant au XIXe siècle, l’armada tricolore ne s’est pas gênée pour « retourne[r] le bled comme un gant ». Quant aux colons, qui « affluent en masse (…) ; ces prolétaires soudain devenus propriétaires » ils ont été « insatiables » et… sourds aux mises en garde visionnaires du pourtant colonialiste Jules Ferry. Lorsque Zeghidour évoque son père, Belkacem, sa mère Mériem, lorsqu’il revient sur la mort de son frère et de sa sœur Houria ou sur la disparition d’Amar, son frère d’adoption, il le fait avec pudeur, sans taire l’amour pour les siens ni cacher des larmes qu’il ne peut, aujourd’hui encore, contenir. Trois enfants morts ! Voilà, plus que de longs discours, le résultat d’une colonisation injuste et indifférente qui a laissé des hommes et des femmes vivre sans le soin, loin de la civilisation promise, sans autres recours que des croyances et des traditions vaines, inefficaces et parfois mortelles. L’Algérie de papa ? « Deux peuples qui vivent au sein du même territoire, mais pas dans le même pays ». Et parmi les ressorts souterrains des ruptures et violences, il y a peut-être le poids de la sexualité : « les intimités entravées » car « qu’est-ce qu’un voisinage qui met à l’index l’amour, une coexistence, une mixité qui interdit le mariage mixte, un mélange qui refuse le brassage ? Voilà tout le drame de l’Algérie française, l’alpha et l’oméga de son impasse. » Où quand Slimane Zeghidour rejoint Alexis Jenni.
«Passer entre les gouttes »
La guerre donc. Et quelle guerre ! Un terrible conflit où « pour sauver sa tête et ne pas risquer de la perdre par la folie, le coup de pistolet ou la lame du couteau, il faudra avoir deux visages, un double langage, l’un pour l’Ordre [ou nidham entendre l’Armée de Libération Nationale], l’autre pour la Rougeaude [« notre Marianne du bled »] ; chacun est alors contraint de mener, yeux et oreilles grands ouverts, une vie double en une seule. » « Je m’aperçois, écrit l’auteur, là aussi, avec le recul, à quel niveau de duplicité il a fallu s’abaisser pour passer entre les gouttes ; jouer le jeu, double jeu, donner le change, louvoyer, mentir avec la hantise d’être confondu. Quel calvaire atroce, aliénant, ont dû subir mes parents. (…) J’ai vécu et revécu ce supplice, j’en ai hérité un fond d’anxiété, un sentiment quasi permanent de vulnérabilité, à savoir que le pire peut arriver à tout instant, partout. »
Une fois de plus, Slimane Zeghidour rappelle que sous couvert de lutte pour l’indépendance, d’engagements sincère et courageux, ce sont d’antiques guerres claniques, de vieilles rancœurs, d’inavouables jalousies qui furent exhumées, à l’instar de cette rivalité meurtrière du cru qui oppose les Beni-Médjaled aux Beni-Ouarzeddine et que l’oncle Larbi, à la fin du conflit, paiera de sa vie. « Qui l’a tué ? demande Zeghidour. Des Beni-Médjaled, bien sûr ! » Il n’y eut pas de plaintes, encore moins d’enquête. Rien ! « Le départ à l’anglaise des Français et la non-relève par des responsables du FLN ont ravivé les haines claniques, les rancunes intimes ; l’heure idéale pour apurer les vieux contentieux, laver dans le sang des outrages réels ou imaginaires. »
« Je revisite sans un iota d’aigreur ce passé commun qui attend d’être enfin partagé »
Zeghidour ne réécrit pas le passé, il revisite l’histoire pour mieux faire reculer l’horizon, esquisser de nouvelles perspectives. Il s’inspire de l’historien Michel Heller pour qui « rien ne change aussi vite que le passé ». Zeghidour aborde ces questions difficiles, et encore douloureuses, avec le souci de la vérité, désagréable ou pas. Pas de sentimentalisme, mais la phrase, tout en tenue et retenue, regorge d’émotions et de tendresse pour les siens et pour cette enfance kabyle à jamais disparue. Sans sentimentalisme et sans compromission, Zeghidour s’efforce de renforcer le lien indispensable qui doit rassembler les hommes et les femmes : « je revisite sans un iota d’aigreur ce passé commun qui attend d’être enfin partagé » et ce jusqu’à manifester de « l’indulgence » pour… un Saint-Arnaud ! affublé en son temps, par Victor Hugo soi-même, du triste titre de « chacal ». Ce ton est à la fois une méthode de rigueur et une pédagogie de la relation.
Zeghidour donne à réfléchir, à saisir en quoi certaines difficultés, enjeux du moment - pervertis par la « discourite » des egos médiatiques et l’embrouillamini télévisuel - peuvent trouver dans cette histoire franco-algérienne si ce n’est des réponses à tout le moins d’utiles éclairages. Exemple avec la sacro sainte intégration. Cette « doctrine de l’intégration » lancée comme en catastrophe par Soustelle, revisitée par Papon, « porte déjà en elle les sous-entendus et les non-dits qui « informent » toujours le discours officiels actuel sur l’islam et les musulmans ». Ainsi explique Zeghidour, l’intégration fut lancée comme un « moindre mal », un choix par défaut, un calcul d’intérêt plutôt qu’une adhésion aux valeurs républicaines, car « mieux vaut les avoir sous la main que sur le dos » - ces Algériens nés d’« une grossesse indésirable » ! Les limites, les non-dits et les mensonges que recouvre ces questions - exposés, avec force mais sans ressentiment - s’étendent au « caractère ambigu, quasiment inné, du régime républicain ». Cette République, ou plutôt ces républicains qui, sur le papier, ne reconnaissent que des hommes libres et égaux en droit, ont fait leur (petite) affaire du double statut : réservant le titre de citoyen à quelques happy few de la colonisation et le statut d’« éternel sujet » aux Indiens du cru, ces Algériens, Français entièrement à part, ci-devant « indigènes » ou « français de confession musulmane ». A propos de religion, même la loi de 1905, dont on se fait aujourd’hui les gorges chaudes et qui sert à certains d’argument d’autorité pour pointer du doigt, accuser, suspecter, l’Etat lui-même a refusé d’en étendre l’application au culte musulman malgré les appels des premiers intéressés à séparer le religieux du politique (on pourra sur ce point se rafraichir la mémoire en écoutant l’émission que Ghaled Bencheikh à consacré à Ali Mérad sur France culture, le 22 octobre 2017).
Tout n’est donc pas rose et tout n’est pas clair sous le ciel de la République tricolore. Zeghidour n’injurie personne en le disant et en le démontrant. Il s’agit, simplement et utilement, de faire œuvre de connaissance, de sensibiliser, de rester en alerte, en veille. Car, par bien des aspects, le conflit algérien se poursuit ici, en France, aujourd’hui. S’il ne faut pas généraliser cette rémanence, et encore moins en faire un fonds de commerce, il n’en reste pas moins qu’elle infeste encore certains esprits. Ainsi de cette « culture du soupçon policier à l’endroit de tout Algérien, un travers qui, un demi-siècle plus tard, persiste encore et toujours. » De même qu’« hier « sujet français », le citoyen « musulman » est devenu aujourd’hui, à son corps défendant, sujet… à caution ; tenu de s’expliquer, et de rassurer, quant au type de rapport qu’il entretient avec l’islam ». Sans en faire un absolu, une grille de lecture unique et univoque, il faut - avec les exigences que posent Zeghidour ! - interroger « les stigmates mentaux inconscients » laissés par le régime colonial chez « les héritiers – désormais tous citoyens – des uns et des autres, d’ici et de là-bas. »
Ce retour vers l’enfance pour « ce rejeton de ces fellahs en guenilles » devenu français, parisien, maniant la langue française avec un brio que pourraient lui envier nombre de littérateurs, primés ou non ; ce retour, pour cet homme qui a décidé de poser son barda loin de sa Kabylie natale mais dont les rêves et parfois les cauchemars restent visités par quelques lointaines figures et douleurs, ne serait-ce pas aussi une façon de retrouver une part de lui-même ? De raviver les couleurs et les nuances du manteau d’Arlequin d’une vie où « à aucun moment, tiens-je à souligner, je n’ai ressenti un quelconque décalage entre l’un et l’autre savoir, la leçon de l’instituteur et le fabliau de ma mère, ni accordé plus de crédit à celui-ci qu’à celui-là, ou vice-versa ». Nulle origine ou racine ici, juste le récit d’un citoyen du cru et du moment, d’un « Français, non pas tout court mais tout long, tout au long d’un bon siècle et demi d’Histoire et d’histoires ».
Les Arènes, 2017, 290 p., 20€
 Attention : âmes sensibles s’abstenir ! Les plus émotifs et imaginatifs parmi les jeunes lecteurs risquent de se faire des frayeurs en lisant le livre concocté par Janne Teller, danoise d’origine austro-allemande par sa famille. Chez les aînés – car ce livre peut, et doit être lu, par tous – il aidera les uns à réfléchir et les autres à vivre une expérience par procuration. Quand aux blasés, qu’ils continuent à ruminer dans leur coin !
Attention : âmes sensibles s’abstenir ! Les plus émotifs et imaginatifs parmi les jeunes lecteurs risquent de se faire des frayeurs en lisant le livre concocté par Janne Teller, danoise d’origine austro-allemande par sa famille. Chez les aînés – car ce livre peut, et doit être lu, par tous – il aidera les uns à réfléchir et les autres à vivre une expérience par procuration. Quand aux blasés, qu’ils continuent à ruminer dans leur coin !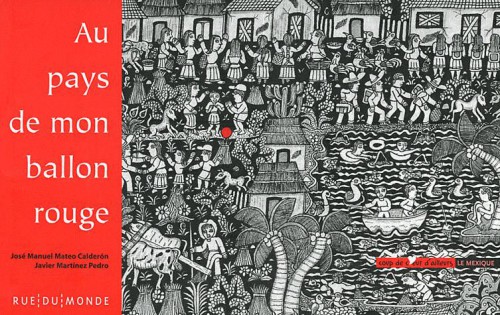 Au pays de mon ballon rouge raconte l’histoire d’un petit mexicain qui doit abandonner son ballon, rouge, et son chien, pour émigrer, avec mère et sœur, de l’autre côté de la frontière, aux Etats-Unis. Rien de nouveau sous le soleil migratoire mais il est vrai aussi qu’il n’est pas vain de répéter ad libitum que : les migrants ne quittent pas leur terre pour le plaisir, que le voyage est loin d’être une sinécure, que le danger se cache derrière mille et un visages, qu’un mur de 1 100 kilomètres sépare les deux pays, et que, pour ceux qui ont pu échapper aux trafiquants ou aux chiens de la police, il faudra grimper bien haut sur de grands immeubles pour nettoyer les vitres et les enseignes lumineuses symboles d’une autre société et d’une modernité à vous filer le tournis et le bourdon.
Au pays de mon ballon rouge raconte l’histoire d’un petit mexicain qui doit abandonner son ballon, rouge, et son chien, pour émigrer, avec mère et sœur, de l’autre côté de la frontière, aux Etats-Unis. Rien de nouveau sous le soleil migratoire mais il est vrai aussi qu’il n’est pas vain de répéter ad libitum que : les migrants ne quittent pas leur terre pour le plaisir, que le voyage est loin d’être une sinécure, que le danger se cache derrière mille et un visages, qu’un mur de 1 100 kilomètres sépare les deux pays, et que, pour ceux qui ont pu échapper aux trafiquants ou aux chiens de la police, il faudra grimper bien haut sur de grands immeubles pour nettoyer les vitres et les enseignes lumineuses symboles d’une autre société et d’une modernité à vous filer le tournis et le bourdon. Depuis Mouloud Feraoun et Le Fils du pauvre jusqu’à son compatriote Djilali Bencheikh en passant par le marocain Driss Chraïbi ou des auteurs français comme Azouz Begag, Tassadit Imache, Saïd Mohamed et autre Mehdi Charef, l’école a su dresser ses façades, plus ou moins hautes, mais toutes parées de l’imposant triptyque républicain, dans les romans et les témoignages des auteurs maghrébins ou français issus de l’immigration. Les classes et les dortoirs de l’honorable institution, les soldats noirs de la République, la découverte de mondes insoupçonnés, l’altérité en bleu blanc rouge confrontent l’enfant, mal dégrossi de sa montagne berbère, de son bidonville parisien ou lyonnais aux premières expériences de la dissonance culturelle et existentielle. Le gamin, indigène ou « immigré », dans un trouble mano à mano, y fait l’apprentissage de l’autre et bifurque, sans le savoir parfois, sur les sentes escarpées de la relativité, de l’émancipation et de la réinvention identitaire.
Depuis Mouloud Feraoun et Le Fils du pauvre jusqu’à son compatriote Djilali Bencheikh en passant par le marocain Driss Chraïbi ou des auteurs français comme Azouz Begag, Tassadit Imache, Saïd Mohamed et autre Mehdi Charef, l’école a su dresser ses façades, plus ou moins hautes, mais toutes parées de l’imposant triptyque républicain, dans les romans et les témoignages des auteurs maghrébins ou français issus de l’immigration. Les classes et les dortoirs de l’honorable institution, les soldats noirs de la République, la découverte de mondes insoupçonnés, l’altérité en bleu blanc rouge confrontent l’enfant, mal dégrossi de sa montagne berbère, de son bidonville parisien ou lyonnais aux premières expériences de la dissonance culturelle et existentielle. Le gamin, indigène ou « immigré », dans un trouble mano à mano, y fait l’apprentissage de l’autre et bifurque, sans le savoir parfois, sur les sentes escarpées de la relativité, de l’émancipation et de la réinvention identitaire. Sympathique et efficace petite histoire de boutons rouges et bleus pour petits et… grands. « Tout allait bien » pour ces boutons rouges, heureux d’un entre soi qui ne souffrait d’aucune contrariété. « Tout allait bien »… « quand quelque chose de bizarre arriva ! » : un bouton de couleur bleue… Et c’est parti sur une quinzaine de doubles pages avec une courte phrase à gauche et l’illustration à droite. Comment les boutons rouges vont-ils réagir ? Que va faire le bouton bleu ? Pourquoi est-il rejoint par d’autres de la même couleur ? Qu’adviendra-t-il de tous ces boutons réunis sur une même page, sur un espace commun ?
Sympathique et efficace petite histoire de boutons rouges et bleus pour petits et… grands. « Tout allait bien » pour ces boutons rouges, heureux d’un entre soi qui ne souffrait d’aucune contrariété. « Tout allait bien »… « quand quelque chose de bizarre arriva ! » : un bouton de couleur bleue… Et c’est parti sur une quinzaine de doubles pages avec une courte phrase à gauche et l’illustration à droite. Comment les boutons rouges vont-ils réagir ? Que va faire le bouton bleu ? Pourquoi est-il rejoint par d’autres de la même couleur ? Qu’adviendra-t-il de tous ces boutons réunis sur une même page, sur un espace commun ?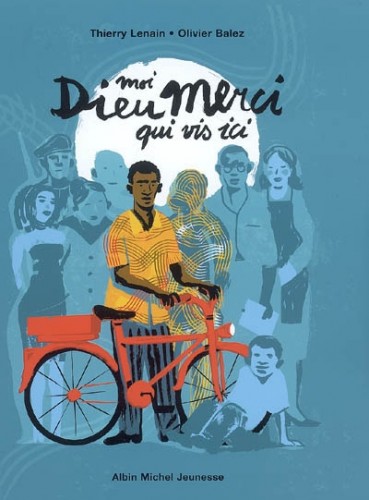 Après Wahid paru en 2003 chez le même éditeur, Thierry Lenain et Olivier Balez publiaient Moi, Dieu merci qui vis ici, un texte et des illustrations trempés dans le même bain, celui de l'humanisme et du refus de l'indifférence. Tous deux vont à l'essentiel, droit au cœur et à l'intelligence.
Après Wahid paru en 2003 chez le même éditeur, Thierry Lenain et Olivier Balez publiaient Moi, Dieu merci qui vis ici, un texte et des illustrations trempés dans le même bain, celui de l'humanisme et du refus de l'indifférence. Tous deux vont à l'essentiel, droit au cœur et à l'intelligence.