Francisco Casavella
Le jour du Watusi II, Du vent et des bijoux
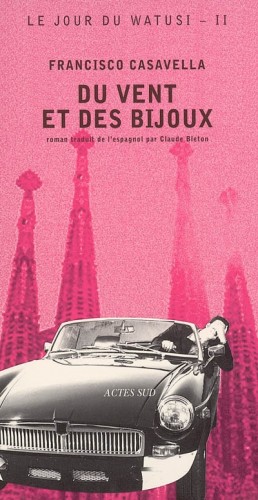 Il s’agit du deuxième volet d’un triptyque commencé avec Les Jeux féroces et qui se refermera avec Le Langage impossible. Dans Du vent et des bijoux, on retrouve le même narrateur, Fernando, qui, tout en relatant l’histoire de sa vie, écrit un étrange rapport pour un mystérieux Lecteur. Il faudra sans aucun doute attendre les dernières pages du troisième et dernier tome pour que tout prenne un sens.
Il s’agit du deuxième volet d’un triptyque commencé avec Les Jeux féroces et qui se refermera avec Le Langage impossible. Dans Du vent et des bijoux, on retrouve le même narrateur, Fernando, qui, tout en relatant l’histoire de sa vie, écrit un étrange rapport pour un mystérieux Lecteur. Il faudra sans aucun doute attendre les dernières pages du troisième et dernier tome pour que tout prenne un sens.
Pour l’heure, Fernando se raconte et à travers lui raconte l’histoire de l’Espagne et de la Barcelone des quarante dernières années. Le 15 septembre 1971, le Jour du Watusi, Fernando, enfant, courait en compagnie de Pepito, à travers la ville pour tenter de retrouver ce Watusi, un mythique et improbable voyou, accusé du meurtre de la fille d’un caïd du quartier de la montagne de Montjuïc. Le gamin et sa mère échapperont à la vindicte du parrain des cabanes mais devront quitter fissa le taudis. C’est ici que commence Du vent et des bijoux qui reste traversé de bout en bout par la mémoire et la quête du Watusi, une « mémoire transformée en une vie inventée » par Fernando mais qui sera aussi détournée, pervertie, salie.
Fernando et sa mère s’installent dans une méchante et triste loge de concierge à Barcelone même. Pour arrondir les fins de mois, Flora s’improvise vendeuse en cosmétique des produits Proust, organisant dans son antre bien peu hospitalier des après-midi vente sans succès. En 1975 elle rencontre Carmelo qui la sortira de sa loge, lui fera deux autres enfants et mettra le pied à l’étriller de l’ascension sociale au jeune Fernando. En ces années 1976-1977, le gamin des rues a grandi. Il a dix-neuf ans et tout à apprendre de la vie d’autant plus qu’il va évoluer dans un milieu, celui de la banque et de la politique, opaque et manipulateur, tripatouillant aussi bien le passé récent que l’avenir d’une Espagne, libérée du Caudillo et ouverte au vent de la démocratie. Il lui faudra pour mériter l’adoubement du sérail faire montre de docilité, de servilité même et de pas mal de cynisme.
Fernando aurait pu être oublié au sous-sol de la Banque citoyenne n’était Ballesto, l’homme à tout faire de l’établissement, qui le sortira d’un quotidien à l’horizon gris et bouché. Ballesto, le ci-devant et énigmatique Boris, sera, un temps, l’idéal et le modèle de Fernando. L’homme a du charisme, de la culture, de l’entregent et de la poigne. Avec les pontes de la banque, Don Carlos Del Escudo et son successeur à la direction générale Don Tomas Del Yelmo, ils décident de créer un parti politique, le « Parti libéral citoyen », moins pour participer à la démocratie naissante qu’histoire de recycler de vieilles casseroles et de tirer les marrons du feu. « Aujourd’hui, tout le monde se lance dans la politique. Peut-être pour ne pas être largué… Piétiner les autres pour ne pas être piétiné… ». Sur cette Espagne de la transition, Casavella porte un regard désenchanté qui laisse un goût amer en bouche : tout ici n’est que faux-semblant, manipulations, mensonges et solitudes. Le whisky coule à flot, les pilules sont ingurgitées ad libitum, les nuits blanches se terminent dans les boîtes et autres bordels de luxe de la capitale catalane ou de sa sœur castillane, les filles sont achetées à coups de Jaguar et de bijoux, « la sous-espèce des journalistes » est graissée avec force et lourdes enveloppes… Le personnel, valets et autres cadets de l’ancien régime, se recycle à gogo, changeant et détournant les règles du jeu : « de la loi à la loi, en passant par la loi, comme au jeu de l’oie, j’ai le droit de rejouer ». À sa façon, Ballesto administre des cours de philosophie politique au jeune Fernando : « tous les enfants de putain qui n’ont pas bougé un petit doigt de vérité de toute leur vie sont en train de bâtir l’Histoire ».
Cette période d’ouverture à la démocratie n’aurait-elle été qu’un vaste courant d’air, du vent dont on se gargarise histoire de taire le passé des uns et des autres et de mystifier le chaland ? Du vent à l’instar de la société de consommation qui elle aussi profile son ombre envahissante : publicitaires et « escrocs intellectuels » commencent à distiller leurs « parfums de pacotille ». On achète les esprits avec du vent et les corps à coups de bijoux. « Nous sommes ici pour enterrer des cadavres (…). Nous avons monté cette machination pour que tout soit bien enterré » dit Ballesto. Ce qu’il ignore encore, lui qui est loin d’être tombé de la dernière pluie, c’est qu’en politique il en est comme dans les gares : une machination peut en cacher une autre…Passionnant ! Francisco Casavella, le jeune prodige de la littérature espagnole, distille le doute et l’inquiétude chez son Lecteur.
Traduit de l’espagnol par Claude Bleton, Edition Actes-Sud, 496 pages, 23 €