Manuel Rivas
L’Éclat dans l’abîme. Mémoire d’un autodafé
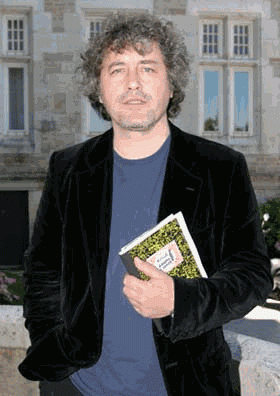 Les livres brûlent mal. Tel est le titre espagnol de ce troisième roman de Manuel Rivas, traduit en français chez le même éditeur. L’autodafé qui a eu lieu à la Corogne le 19 août 1936 est au cœur de ce récit justement flamboyant. Les pages et les mots voltigent au-dessus des flammes. De ce brasier, où « l’odeur des livres à la fin ressemblait à celle de la chair », quelques ouvrages seront sauvés par des mains intéressées ou compatissantes. Ces mots, ces pages et ces livres échappés du bûcher finiront par raconter les vies d’hommes et de femmes de ce côté-ci de l’Espagne, la Galice. A travers eux défilent plus d’une trentaine d’années d’histoire espagnole. Personnages et événements historiques, références politiques et bibliographiques, mots et idées virevoltent de page en page, de chapitre en chapitre. L’Éclat dans l’abîme est un livre éblouissant, mais qui exigera des efforts de la part du lecteur pour y pénétrer et se l’approprier. Des efforts vite récompensés. Manuel Rivas dans une construction hélicoïdale, tout en courbe, en enchevêtrement, en colimaçon croise les trajectoires de plus de soixante-dix personnages. Le génie de l’auteur transporte le lecteur de sujet en sujet : bibliophilie, philosophie du droit, histoire littéraire, franquisme… L’écriture de Manuel Rivas est époustouflante et dense de bout en bout. Son art du récit et du conte jamais ne faiblit.
Les livres brûlent mal. Tel est le titre espagnol de ce troisième roman de Manuel Rivas, traduit en français chez le même éditeur. L’autodafé qui a eu lieu à la Corogne le 19 août 1936 est au cœur de ce récit justement flamboyant. Les pages et les mots voltigent au-dessus des flammes. De ce brasier, où « l’odeur des livres à la fin ressemblait à celle de la chair », quelques ouvrages seront sauvés par des mains intéressées ou compatissantes. Ces mots, ces pages et ces livres échappés du bûcher finiront par raconter les vies d’hommes et de femmes de ce côté-ci de l’Espagne, la Galice. A travers eux défilent plus d’une trentaine d’années d’histoire espagnole. Personnages et événements historiques, références politiques et bibliographiques, mots et idées virevoltent de page en page, de chapitre en chapitre. L’Éclat dans l’abîme est un livre éblouissant, mais qui exigera des efforts de la part du lecteur pour y pénétrer et se l’approprier. Des efforts vite récompensés. Manuel Rivas dans une construction hélicoïdale, tout en courbe, en enchevêtrement, en colimaçon croise les trajectoires de plus de soixante-dix personnages. Le génie de l’auteur transporte le lecteur de sujet en sujet : bibliophilie, philosophie du droit, histoire littéraire, franquisme… L’écriture de Manuel Rivas est époustouflante et dense de bout en bout. Son art du récit et du conte jamais ne faiblit.
Au cœur de cette histoire il y a deux hommes que tout oppose, Samos Ricardo, juge bibliophile, ci-devant chef de l’autodafé, pro-nazi admirateur de Carl Schmitt, de l’autre, Hector Rios, procureur de la défunte République, devenu auteur clandestin de livres de Far West et rédacteur d’une Dramatique histoire de la culture. Les trajectoires de ces deux amis d’enfance ont divergé. L’un est devenu un dignitaire du régime franquiste, l’autre un reclus, fou de littérature prodiguant quelque enseignement…
Autour du premier gravitent sa mystérieuse épouse, Chelo Vidal, son fils Gabriel mais aussi Dez le chef de la Censure ou Ren, le phalangiste, inspecteur à la Brigade d’investigation policière. Autour du second, il y a Catia, sa nièce, et les élèves de La Rose Sténographique : Tito Balboa, le journaliste stagiaire, Paul Santos, le jeune inspecteur et Gabriel Samos, le propre fils du juge. Dans les rues de la Corogne, on croise Vicente Curtis l’ancien boxeur ; Terranova, le chanteur ; Silvia la couturière, qui, pour sortir de l’enfer franquiste, accepte de faire, pour les autorités de la ville, un travail particulier, ou encore Polca, un des fossoyeurs des livres morts, toute sa vie meurtri de ne pas avoir rendu un ouvrage emprunté à la bibliothèque : L’Homme invisible d’Élisée Reclus…
La Corogne c’est aussi des lieux : l’athénée L’Éclat dans l’abîme, l’académie de danse, le port et surtout le 12 de la rue Panadeiras, la demeure de Santiago Casarès, le père de Maria Cazarès, que le lecteur retrouve des années plus tard à Paris. Tous les livres de son père sont « décédés ». Quelques-uns qui ont « survécu », lui reviennent.
Livre admirable sur l’histoire espagnole, la mémoire des victimes, cette mémoire qui n’en finit pas de se rappeler au mauvais souvenir des vivants. Ici les livres, les mots, le langage deviennent des êtres incarnés, des coupables, qu’on arrête, qu’on assigne à résidence… Des êtres de mémoires, imprévisibles et dangereux. « Ce n’est pas si facile de fixer les limites à des mots. Les mots sont comme les cafards et les souris qui se déplacent sous terre, le long des égouts et entre les tombes. Comme les insectes. Les bactéries. C’est facile de fixer ses limites à un homme, mais ce n’est pas si facile de fixer leurs limites à des mots. Le silences, les pauses font partie du langage. Un homme silencieux, si c’est quelqu’un d’honnête, est un homme dangereux ».
Traduit de l’espagnol par Serge Mestre, édition Gallimard 2008, 681 pages, 25 €
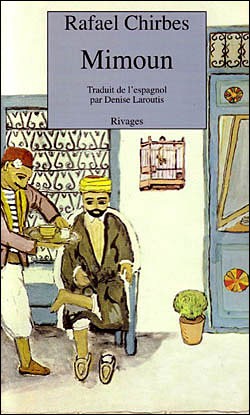 Manuel, jeune professeur d'espagnol alcoolique et un brin dépressif, décide de partir enseigner au Maroc - histoire de se refaire une santé et de s'atteler sérieusement à la rédaction de son livre. À force de penser que l'herbe de son voisin est toujours plus tendre et plus verte que la sienne, on finit par oublier que l'on transporte avec soi ses démons. Dans ce premier roman paru en Espagne en 1988, Rafael Chirbes raconte la descente aux enfers de Manuel au cours d'une année passée à Mimoun, un village de l'Atlas situé dans la région de Fès. L'écriture, froide et distanciée, aux adjectifs et adverbes rares, participe pleinement de l'ambiance de ce livre étrange où, à vrai dire, il ne se passe rien : entre ses cours donnés à l'université de Fès, Manuel passe son temps à se soûler avec du mauvais alcool, à entretenir des relations de fortune avec encore plus paumées que lui, ou avec des prostituées réduites à l'état d'épaves. L'atmosphère y est glauque. La nuit : un néant hanté d'insomnies et de cauchemars où rodent la mort et des fuites sans fin.
Manuel, jeune professeur d'espagnol alcoolique et un brin dépressif, décide de partir enseigner au Maroc - histoire de se refaire une santé et de s'atteler sérieusement à la rédaction de son livre. À force de penser que l'herbe de son voisin est toujours plus tendre et plus verte que la sienne, on finit par oublier que l'on transporte avec soi ses démons. Dans ce premier roman paru en Espagne en 1988, Rafael Chirbes raconte la descente aux enfers de Manuel au cours d'une année passée à Mimoun, un village de l'Atlas situé dans la région de Fès. L'écriture, froide et distanciée, aux adjectifs et adverbes rares, participe pleinement de l'ambiance de ce livre étrange où, à vrai dire, il ne se passe rien : entre ses cours donnés à l'université de Fès, Manuel passe son temps à se soûler avec du mauvais alcool, à entretenir des relations de fortune avec encore plus paumées que lui, ou avec des prostituées réduites à l'état d'épaves. L'atmosphère y est glauque. La nuit : un néant hanté d'insomnies et de cauchemars où rodent la mort et des fuites sans fin. Pere Calders est né à Barcelone en 1912. En 1939, après la victoire des franquistes, il s’exile au Mexique. Il ne retournera en Catalogne qu’en 1962. Les six nouvelles de ce recueil rassemblées pour la première fois en 1980 (pour la version catalane) sont toutes consacrées à ce pays qui l’a accueilli durant plus de vingt ans, aux Indiens et aux métis, qu’il a côtoyés et observés tout au long de son exil forcé.
Pere Calders est né à Barcelone en 1912. En 1939, après la victoire des franquistes, il s’exile au Mexique. Il ne retournera en Catalogne qu’en 1962. Les six nouvelles de ce recueil rassemblées pour la première fois en 1980 (pour la version catalane) sont toutes consacrées à ce pays qui l’a accueilli durant plus de vingt ans, aux Indiens et aux métis, qu’il a côtoyés et observés tout au long de son exil forcé.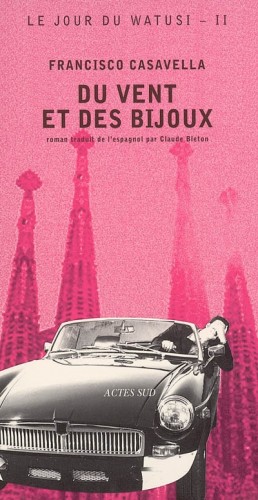 Il s’agit du deuxième volet d’un triptyque commencé avec Les Jeux féroces et qui se refermera avec Le Langage impossible. Dans Du vent et des bijoux, on retrouve le même narrateur, Fernando, qui, tout en relatant l’histoire de sa vie, écrit un étrange rapport pour un mystérieux Lecteur. Il faudra sans aucun doute attendre les dernières pages du troisième et dernier tome pour que tout prenne un sens.
Il s’agit du deuxième volet d’un triptyque commencé avec Les Jeux féroces et qui se refermera avec Le Langage impossible. Dans Du vent et des bijoux, on retrouve le même narrateur, Fernando, qui, tout en relatant l’histoire de sa vie, écrit un étrange rapport pour un mystérieux Lecteur. Il faudra sans aucun doute attendre les dernières pages du troisième et dernier tome pour que tout prenne un sens. Barcelonais de quarante-deux ans et auteur de quatre romans à la sortie de ce premier tome du Jour du Watusi, Francisco Casavella appartient à la jeune génération des romanciers espagnols et la critique hispanique voyaient en lui un des piliers de la nouvelle littérature nationale. Les Jeux féroces est le premier volet d’un triptyque sur « une Espagne de la transition qui titube entre franquisme moribond et démocratie balbutiante » (dixit l’éditeur). Les deux autres tomes, Du vent et des bijoux et Le Langage impossible sont parus la même année. Francisco Casavella écrit dans une langue touffue et chargée, une densité nourrit de précisions et de descriptions, d’allusions, de renvois et de rappels. Il dissèque la ville, les groupes sociaux et l’histoire récente de son pays.
Barcelonais de quarante-deux ans et auteur de quatre romans à la sortie de ce premier tome du Jour du Watusi, Francisco Casavella appartient à la jeune génération des romanciers espagnols et la critique hispanique voyaient en lui un des piliers de la nouvelle littérature nationale. Les Jeux féroces est le premier volet d’un triptyque sur « une Espagne de la transition qui titube entre franquisme moribond et démocratie balbutiante » (dixit l’éditeur). Les deux autres tomes, Du vent et des bijoux et Le Langage impossible sont parus la même année. Francisco Casavella écrit dans une langue touffue et chargée, une densité nourrit de précisions et de descriptions, d’allusions, de renvois et de rappels. Il dissèque la ville, les groupes sociaux et l’histoire récente de son pays.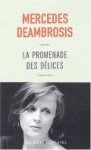 Dans ce recueil de huit nouvelles, Mercedes Deambrosis auteur de trois premiers romans (le premier paru en 1999 chez Dire éditions, les deux derniers chez le même éditeur) revient sur la guerre d'Espagne pour en montrer les retombées sur une population finalement et bien souvent vaincue, bourreaux et victimes confondus. La plume n'est jamais accusatrice. Le contraste est d'ailleurs saisissant entre la délicatesse de l'écriture et la dureté des faits, entre le rythme paisible et fluide de la phrase et les convulsions des événements rapportés. Mercedes Deambrosis ne transporte pas le lecteur au milieu des champs de bataille ou au cœur d'une embuscade. Elle ne le place pas en spectateur privilégié dans le feu de l'action et le bruit des armes. Elle préfère le silence des consciences, l'intimité des âmes, les destinés individuelles, les doutes des uns, la grandeur ou la faiblesse des autres. Ce n'est pas l'Histoire qui défile sur les grandes avenues mais le peuple d'Espagne surpris, dans sa diversité et son quotidien, dans les ruelles et les à-côtés. Ces à-côtés qui font la vie. La vraie, la seule qui vaille le coup comme peut le laisser entendre la phrase d'Andrès Trapiello choisie par l'auteur en exergue
Dans ce recueil de huit nouvelles, Mercedes Deambrosis auteur de trois premiers romans (le premier paru en 1999 chez Dire éditions, les deux derniers chez le même éditeur) revient sur la guerre d'Espagne pour en montrer les retombées sur une population finalement et bien souvent vaincue, bourreaux et victimes confondus. La plume n'est jamais accusatrice. Le contraste est d'ailleurs saisissant entre la délicatesse de l'écriture et la dureté des faits, entre le rythme paisible et fluide de la phrase et les convulsions des événements rapportés. Mercedes Deambrosis ne transporte pas le lecteur au milieu des champs de bataille ou au cœur d'une embuscade. Elle ne le place pas en spectateur privilégié dans le feu de l'action et le bruit des armes. Elle préfère le silence des consciences, l'intimité des âmes, les destinés individuelles, les doutes des uns, la grandeur ou la faiblesse des autres. Ce n'est pas l'Histoire qui défile sur les grandes avenues mais le peuple d'Espagne surpris, dans sa diversité et son quotidien, dans les ruelles et les à-côtés. Ces à-côtés qui font la vie. La vraie, la seule qui vaille le coup comme peut le laisser entendre la phrase d'Andrès Trapiello choisie par l'auteur en exergue