Alain Lorne
Le Petit gaulliste
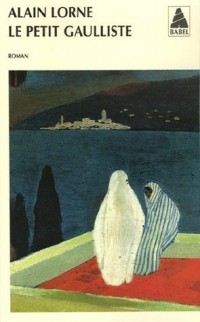 Le Petit gaulliste se prénomme Paul. Il a treize ans. Antoine, son frère, en a deux de plus et soigne sa ressemblance avec Johnny Halliday, celui de « Pour moi la vie va commencer ». Nous sommes en 1963. Les parents ont divorcé. En ces temps pas si lointains, seule la femme supporte l’opprobre et la condamnation morale des bien pensants. Aussi, pour Cécile, la mère, l’atmosphère devient vite irrespirable. Il est urgent de quitter le 52 ! (entendre la Haute-Marne).
Le Petit gaulliste se prénomme Paul. Il a treize ans. Antoine, son frère, en a deux de plus et soigne sa ressemblance avec Johnny Halliday, celui de « Pour moi la vie va commencer ». Nous sommes en 1963. Les parents ont divorcé. En ces temps pas si lointains, seule la femme supporte l’opprobre et la condamnation morale des bien pensants. Aussi, pour Cécile, la mère, l’atmosphère devient vite irrespirable. Il est urgent de quitter le 52 ! (entendre la Haute-Marne).
Professeur d’anglais dans un collège, elle décide de s’expatrier en Algérie pour y enseigner la langue de Shakespeare à des têtes brunes et bouclées dont les parents ne sont pas encore remis de la gueule de bois des lendemains d’indépendance. La coopération technique (C.T.) a du bon et est plutôt lucrative... Ce n’est pas pour rien que « C.T. » a été transformée par les Algériens en « course au trésor ». Mais laissons-là ces raisons bassement matérielles. Elles n’expliquent pas à elles seules le choix de Cécile. Non ! il y a aussi un certain Jean Lesaucier dont elle s’est énamourée. Le bonhomme reste plutôt évasif sur ses liens passés avec l’Algérie - pied-noir ? militaire ? barbouze ? ancien de l’OAS ?... Deux choses ne souffrent d’aucune ambiguïté : le pays et ses habitants ne lui sont ni étrangers ni indifférents ( « la trahison gaulienne » ne passe pas) et, côté futur, il compte bien prospérer dans le commerce, se rendre « indispensable au pays ». Pour l’heure, il s’affaire dans l’import-export de... fromages. Mais attention pas n’importe lequel, non du maroille ! du qui ne supporte pas d’être intempestivement retenu au port. La précieuse cargaison est fragile, gare à l’affinage abusif ! gare au prolifique asticot !
Pour Paul, à l’école, les choses auraient pu mal tourner. Dans la cour de récréation, ces nouveaux condisciples, animés d’un solide instinct grégaire, ne se privent pas de bousculer et de railler le nouveau venu fraîchement débarqué de la ci-devant métropole... Mais Paul, un brin affabulateur, n’est pas sans ressources. En France, il habite Colombey-les-Deux-Eglises et la maison de « Mé » (la grand-mère) jouxte celle du Général de Gaulle, celui qui a « niqué les pieds-noirs ». Voilà qui réchauffe le climat des relations franco-algériennes et calme les ardeurs revanchardes. Le Petit gaulliste ne va pas se gratter pour la jouer à l’esbrouffe.
Alain Lorne décrit les premières heures de l’Algérie indépendante, depuis 1963 jusqu’à la veille du coup d’Etat de 1965. Le récit est rythmé par les magouilles, les trafics et autres coups tordus de Lesaucier. Le « socialisme spécifique » a de beaux jours devant lui. La corruption, déjà généralisée, itou. Le ver n’infeste pas les seuls maroilles. Il prolifère et prolifèrera avec constance depuis Ben Bella jusqu’à... mais cela est un autre sujet. Pour l’heure, sous le regard tantôt averti tantôt innocent du Petit gaulliste, la corruption prospère, le marché-noir s’organise, les passe-droits se multiplient, la police politique veille, la suspicion s’intalle, l’aumône - en fait le pillage des bijoux des Algériennes - est érigée en méthode de gouvernement, le mécontentement populaire gronde tandis que l’autogestion finit de démanteler le secteur agricole.
La forme, un brin irrévérencieuce et distante, ne masque nullement la dimension humaine des événements ici davantage suggérées que relatées. Alain Lorne semble interroger l’Histoire et vouloir souligner le peu de choix qu’elle laisse aux Hommes dans la conduite de leur existence. Les Algériens y sont présentés comme les jouets des rivalités entre le FLN et le MNA et des exactions de la police française. Quant au drame vécu par les Pieds-noirs il n’est qu’à pousser la porte de ces maisons abandonnées dans la précipitation, lire de vieilles lettres oubliées et retrouvées par Paul et Antoine ou écouter parler la vieille Madame Ayach pour mesurer ce sentiment d’impuissance.
À l’exception des combines de Lesaucier et du regard porté par Le Petit gaulliste sur le méli-mélo des adultes, le livre ne renferme aucune intrigue romanesque, psychologique ou historique. L’intérêt se niche entre les lignes, il s’entend dans le ton distancé et plein d’humour de l’écriture. Les dialogues, les expressions, le rappel des actualités... restituent les années soixante en France et les lendemains de l’indépendance algérienne. L’espoir illuminait alors l’horizon. Pour l’Algérie, comme pour Paul, la vie commençait...
Edition Actes Sud, 271 pages, 16,9 0 €
- Page 2
-
-
Crise d’asthme
Etgar Keret
Crise d’asthme
 Âgé de seulement trente-cinq ans, à la sortie de ce livre en France, Etgar Keret était déjà un auteur à succès en Israël aussi bien comme écrivain que comme auteur de bandes dessinées, scénariste ou cinéaste. Non content de vendre ses livres à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, Etgar Keret voit Crise d’asthme inscrit au programme des universités. Le jeune homme, amateur de promenades sur la plage de Tel-Aviv, est devenu, bien malgré lui, le symbole d’une génération d’écrivains qui a chamboulé la langue en la dépouillant de sa sacralité et bousculé les fameux mythes fondateurs de l’Etat d’Israël au grand dam de ses aînés en écriture (A.B. Yahoshua ou Amos Oz). Crise d’asthme rassemble près de cinquante nouvelles, extrêmement courtes et percutantes. Mêlant fantastique, dérision, réalisme ou poésie, elles décrivent, parfois avec cruauté, nos dérives égoïstes, la déshumanisation des rapports et la quête, souvent vaine et illusoire mais toujours indispensable, de ces valeurs et sentiments qui donneraient un sens à des existences sans perspective, abîmées par la solitude, la dépression, le culte des apparences, l’instrumentalisation des mémoires et des identités ou la violence.
Âgé de seulement trente-cinq ans, à la sortie de ce livre en France, Etgar Keret était déjà un auteur à succès en Israël aussi bien comme écrivain que comme auteur de bandes dessinées, scénariste ou cinéaste. Non content de vendre ses livres à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, Etgar Keret voit Crise d’asthme inscrit au programme des universités. Le jeune homme, amateur de promenades sur la plage de Tel-Aviv, est devenu, bien malgré lui, le symbole d’une génération d’écrivains qui a chamboulé la langue en la dépouillant de sa sacralité et bousculé les fameux mythes fondateurs de l’Etat d’Israël au grand dam de ses aînés en écriture (A.B. Yahoshua ou Amos Oz). Crise d’asthme rassemble près de cinquante nouvelles, extrêmement courtes et percutantes. Mêlant fantastique, dérision, réalisme ou poésie, elles décrivent, parfois avec cruauté, nos dérives égoïstes, la déshumanisation des rapports et la quête, souvent vaine et illusoire mais toujours indispensable, de ces valeurs et sentiments qui donneraient un sens à des existences sans perspective, abîmées par la solitude, la dépression, le culte des apparences, l’instrumentalisation des mémoires et des identités ou la violence.
C’est dans ce recueil que se trouve la fameuse nouvelle intitulée Des chaussures où E.Keret raille l’enseignement – et peut être l’instrumentalisation – de la mémoire à travers le cadeau d’une paire d’Adidas à un jeune israélien qui vient d’apprendre, à l’occasion d’une visite scolaire à un mémorial de la Shoah, que les produits allemands sont « fabriqués avec les os, la peau et la chair des juifs morts ». Du coup le gamin dont le grand-père est mort dans les camps nazis croit marcher et devoir jouer au football sur les restes de son aïeul !
Qu’il s’agisse de Cran d’arrêt, de La Copine de Corby, d’Exclusivité ou de Buffalo la présence arabe ou palestinienne dans les textes de ce recueil marque toujours et exclusivement l’irruption, à un degré ou à un autre, de la violence. Sans doute est-ce là l’illustration des propos révélateurs de l’auteur rapportés dans Télérama du 20 novembre 2002 : « les seuls Palestiniens que l’on connaît sont ceux qui viennent se faire exploser, les seuls Israéliens qu’ils connaissent sont des soldats armés jusqu’aux dents ».
Pourtant, malgré les violences diverses et la mort qui reviennent de nombreuses fois, ces récits ne sont nullement sombres. Même si elles demandent à disparaître parce qu’elles n’auraient plus leur place dans la société des hommes - dont les compliments et les cris admiratifs ne parviennent plus à masquer l’hypocrisie - la bonté, comme la conscience de l’autre, l’amitié, ou l’amour... forment le cœur de ces nouvelles. Leur évocation répétée aiderait-elle à les dégager des gaines dans lesquelles nos sociétés les enserrent toujours plus douloureusement, jusqu’à l’asphyxie ? Quoi qu’il en soit et telles des bouffées de bronchodilatateur, E. Keret distille les mots avec parcimonie. Il s’agit de ne pas les gâcher, d’éviter de les galvauder pour leur restituer toute leur importance, celle de l’air pour l’asthmatique en pleine crise : la vie même.
Traduction (de l’hébreu) Rosie Pinhas-Delpuech, Actes Sud, 2002, 210 pages, 18 €
-
Alger Nooormal
Mohamed Ali Allalou, Aziz Smati, photographies, Jean Pierre Vallorani, coordination des textes Mustapha Benfodil
Alger Nooormal
 « Alger Nooormal », premier disque-audio du genre, fait découvrir Alger comme sans doute peu de livres ne l’ont fait ou ne le feront. Les auteurs se sont mis à quatre pour offrir aux connaisseurs comme aux néophytes un cadeau rare : l’âme d’une ville et de ses habitants. Les textes sont signés Ali Allalou, Aziz Smati et Mustapha Benfodil, les photos Jean Pierre Vallorani qui avait en son temps accompagné l’écrivain marseillais Salim Hatubou dans ses pérégrinations mémorielles du côté des Comores.
« Alger Nooormal », premier disque-audio du genre, fait découvrir Alger comme sans doute peu de livres ne l’ont fait ou ne le feront. Les auteurs se sont mis à quatre pour offrir aux connaisseurs comme aux néophytes un cadeau rare : l’âme d’une ville et de ses habitants. Les textes sont signés Ali Allalou, Aziz Smati et Mustapha Benfodil, les photos Jean Pierre Vallorani qui avait en son temps accompagné l’écrivain marseillais Salim Hatubou dans ses pérégrinations mémorielles du côté des Comores.
Avant d’être lieu de visite pour touristes en goguette dans ses quartiers de légendes, ses rues bouillonnantes et autres monuments défraîchis, pour nos quatre passeurs en émotions, « Alger est une parole ». Voyage porté par la musique et les mots de la ville, un CD accompagne le livre dans lequel pas moins d’une quarantaine d’extraits de chansons et d’entretiens restitue l’histoire musicale d’Alger, ses sons et ses bruits, les paroles diverses des Algérois qui, bien mieux que de longs discours, rendent le sel de cette ville, son histoire jusqu’à ses parfums et odeurs sans pour autant étouffer quelques remugles et autres émanations pestilentielles.
Si Buenos Aires a son tango, Lisbonne son fado, la Nouvelle-Orléans ou Memphis le blues, Séville son flamenco, Oran le raï…, Alger a le chaabi. Musique également métisse, elle est à l’image de la ville. D’origine religieuse et réservée à des cercles étroits d’abord, le chaabi a été concocté par un kabyle Hadj M’Hamed el Anka (Halo Mohand Ouyidir) aidé d’un juif Lili Boniche (Lili Abassi) et de Bellilo, le luthier italien de Bab el Oued qui confectionna la première mandole du maître El Anka. La mandole sera au chaabi ce que l’accordéon est au musette parisien. Depuis, les musiciens du genre ne se sont pas gênés pour se nourrir d’influences venues d’ailleurs et, par la magie de la création, les acclimater à l’âme algéroise : ainsi en sera-t-il du banjo qui débarque à Alger avec les soldats américains en 1942, du piano introduit par Skandrani ou du qanoun, la cithare qui vient de l’orient arabe…
Et oui, le chaabi (comme le couscous pour l’Afrique du Nord) est un merveilleux résumé de l’histoire d’une ville, « ville bazar », riche d’une identité syncrétique où, sur un substrat berbère, sont venues se greffer les influences arabe, turque, française, juive… À la fois populaire et mystique, dur et tendre, rocailleux et voluptueux, triste et joyeux, envoûtant et mélodieux, le chaabi est une musique sismographe, le sismographe des passions, des humeurs et du quotidien des Algérois. Pour s’en rendre compte, il suffit d’écouter la compil confectionnée par Aziz Smati riche des voix de Dahmane El Harrachi, d’El Hachemi Guerrouabi, de Boudjemaa el Ankis et surtout celle d’Abdelmajid Meskoud interprétant la magnifique « El Assima » devenue « l’hymne d’Alger ».
La terre algérienne, depuis les temps les plus anciens, a mêlé des ingrédients divers à l’origine d’une identité devenue irréductible à une composante exclusive. Mélange étonnant, liaisons contre-nature et violentes, le « butin de guerre » ne se limite pas à une langue : entre violence et tendresse, exubérance et retenue, humour et gravité, provocation et générosité… la personnalité algérienne en porte la marque. Rien que de très « nooormal », selon ce qualificatif qui rend probable l’improbable, supportable l’insupportable et normal l’anormal. Une sorte de pragmatisme teinté de taoïsme, à se demander si Laozi ne s’est pas taper quelques bières avec le volubile Abderrahmane du côté de la Madrague et devisé sur l’universalité des valeurs humaines avec le pétillant Belkacem Aït Ouyahia qui, entre deux cours de médecine à l’université et deux patients, traduit les fables de La Fontaine en kabyle. Il faut les écouter et savourer les dialogues enregistrés par Allalou. Car, l’ancien trublion de la radio algérienne, a retrouvé les trottoirs de sa ville et avec eux, les calembours d’Abderrahmane Lounès, les mises en garde de l’architecte urbaniste Jean-Jacques Deluz quant à l’avenir de la ville ou encore l’humour de Farid le rockeur de Belcourt qui résume l’amour à Alger par cette formule inoubliable : « frites omelette… sans sel ! ». Il y a surtout Fatma Zohra de la Casbah. L’ancienne prostituée a aujourd’hui 72 ans et confie à un Allalou complice qu’en 1962 elle n’a pas pris « un appartement de Français » : « parce qu’il y a eu des larmes dans ces appartements (…) parce que je ne voulais pas, non, y a rien à faire, ça porte malheur ». Sans chercher à paraphraser Shakespeare, ce que montre ce livre sonore c’est qu’il y a souvent plus de vérité dans une seule phrase d’une ancienne prostituée d’Alger que dans cinquante ans de vulgate nationaliste. Et oui, la France n’est pas la seule à qui un petit retour sur la période coloniale serait profitable… « On a fait du peuple une chose secondaire, presque un outil » disait-il y a bien longtemps le Marocain Mohamed Kheïr-Eddine, avec Alger Nooormal, on mesure ce qui a été négligé et gâché.
Entraîné dans cette virée algéroise où le son du thé à la menthe versé dans les verres se mêle aux voix éraillées des noctambules amateurs de bière et de poésie, le lecteur partage l’allégresse, la « jouissance » même de ses compagnons heureux de retrouver une ville qu’ils ont dû fuir après les menaces de mort, après l’attentat dont a été victime Aziz Smati. La nostalgie a sa place dans ce voyage où la question est posée : « Alger a t-elle un présent ? Alger a t-elle un avenir ? ». Mais nos auteurs dédaignent ces cucuteries pour anciens combattants : Alger vit, Alger revit à travers un renouveau musical porté par une jeunesse et notamment des jeunes filles, créatives et frondeuses. Les groupes se nomment Hamma Boys, MBS, Intik, Gnawa Diffusion, Bnet Lebled… chantent et assènent leur part de vérité sur des rythmes rap, rock, folk, teckno ou empruntant à leurs aînés une rythmique gnawa ou chaabi. Peut-être que cette génération inventive ne s’en laissera plus compter…
Les textes, les photos comme les enregistrements ne cachent pas les travers de la ville et de ses habitants. Mais Alger est encore trop meurtrie par les années qui viennent de se terminer pour en rajouter. Il vaut sans doute mieux en célébrer le soleil qui l’inonde d’une lumière prometteuse, ce soleil qui « tue les questions » comme l’écrit Camus. Si, après sa prémonitoire chanson composée il y a plus de trente ans, « Sobhane Allah yaltif » Mustapha Toumi ne se sent pas de rejouer les cassandres, il ne veut pas non plus revenir sur le passé récent. Sans doute que les retours en arrière se feront plus tard. Sûrement même, pour éviter les effets boomerang d’une funeste amnésie orchestrée par un régime toujours aveugle aux siens. Pour le moment, comme le montre « Alger nooormal », les premières leçons du passé peuvent être tirées avec une distance critique, poétique, l’humour toujours corrosif et chantant d’Alger. C’est d’ailleurs la seule façon de faire pour ne pas condamner l’avenir. Le passé ne peut être remisé, mais ce n’est pas à lui de dicter ses conditions. Alors ne boudons pas le plaisir du lecteur-auditeur : ce livre est d’abord une fête, des retrouvailles joyeuses, une déclaration d’amour. La vie quoi ! Pour le reste, barakat ! (Ça suffit !)
Françoise Truffaut éditions, 2005, 158 pages, 26 euros
-
Trans
Pavel Hak
Trans
 Écrivain tchèque de quarante-sept ans installé en France depuis 1986, Pavel Hak livrait ici son troisième roman après les remarqués Safari (2001) et Sniper (2002) tous deux publiés aux éditions Tristram. Après les violences de la guerre, il se penche sur d’autres violences, celle des migrations.
Écrivain tchèque de quarante-sept ans installé en France depuis 1986, Pavel Hak livrait ici son troisième roman après les remarqués Safari (2001) et Sniper (2002) tous deux publiés aux éditions Tristram. Après les violences de la guerre, il se penche sur d’autres violences, celle des migrations.
Dans Trans, Wu Tse tente de se frayer un chemin dans les dédales d’un monde gagné par le vertige sécuritaire et l’illusion de l’immigration choisie, un monde où tout doit être sous contrôle : les droits politiques, les corps, la circulation des hommes, les frontières… Dans ce monde prospèrent les dictatures, les virus, les injustices et les fermetures nationales, communautaires et autres.
Cauchemardesque est l’odyssée de Wu Tse qui le conduit à fuir la dictature qui sévit dans son pays mais qui, avant de réussir à rejoindre ce qui a tout l’air d’une contrée européenne, échoue dans une jungle, sans doute africaine, infestée de virus meurtriers, ensanglantée par des guerres civiles assassines et des cannibales estampillés autochtones pure sucre, d’autant plus friands de touristes et autres égarées qu’ils sont allogènes et donc marqués du sceau de l’impureté.
Cet improbable périple, dicté d’abord par la nécessité et non par le désir « de bénéficier des aides sociales » comme il se dit en ces temps de braderie présidentielle ici ou là, est marqué par la violence et la déshumanisation : violence de la misère et de la faim qui pousse les ventres vides, candidats à l’exil, à dévorer les cadavres d’autres miséreux, violence des réseaux de passeurs et de travail clandestin, violence des centres de rétention, violence faites aux corps depuis les expérimentations hallucinées d’un Mengele de la jungle africaine jusqu’aux entraves à la libre circulation des hommes, violence enfin et surtout infligées aux femmes dans des scènes de viol à répétition et de sexualité bestiales.
Mais si Trans se montre, sur un des aspects des migrations contemporaines, d’un réalisme nauséeux, il est aussi conte fantastique où l’humour flotte à la surface de l’insoutenable. À l’image du titre polysémique, l’écriture, gourmande en parenthèses, fonctionne à coups de flashs, les scènes et les situations défilent donnant un récit haletant de bout en bout. Entre réalité et fable, Pavel Hak montre que l’instinct de survie, l’énergie vitale et la quête d’amour de Wu Tse sont autant de passagers clandestins qui transpercent, traversent interdits, murailles, frontières, folies sécuritaires et autres ghettos de nantis. Entre sapiens et démens, ces deux pôles qui rythment l’histoire de l’humanité (Edgar Morin), il n’est pas certain que la sagesse et le juste soient du côté des respectables et proprets tenants d’une urbanité de façade et d’une idéologie qui fait du gain l’objectif et de l’homme un moyen.
Pavel Hak, qui a lui-même connu l’expérience de la clandestinité en Italie, semble dire à ceux qui, « obsédés par religions idéologies origines propriété », érigent des murs et des interdits : « Les hommes fuyant la misère sont un fléau qu’aucune mesure de sécurité ne peut arrêter. Ils sont des milliers, ne possèdent rien. N’ayant rien, ils ne craignent rien (puisqu’ils n’ont rien à perdre). Et rien ne peut les faire renoncer au rêve de prospérité que la misère a injecté dans leurs têtes. »
Trans n’invite pas à un choix naïf et illusoire entre deux mondes, mais montre la part de rêve et de vie que portent en contrebande des hommes et des femmes, fuyards par nécessité et réduits à la clandestinité parce qu’ils transportent avec eux un viatique devenu subversif : l’humanité, une humanité qui, même si elle n’est pas pour tous une et indivisible, aurait intérêt à être un peu plus solidaire.
Edition du Seuil, 2006, 188 pages, 15,90 € -
L’écho du silence
Jean Pierre Robert
L’écho du silence
 Bien des livres de cette rentrée littéraire 2009 reviennent sur la Guerre d’Algérie. On pense notamment à Annelise Roux, La Solitude de la fleur blanche (Sabine Wespieser), Laurent Mauvignier, Les Hommes (Minuit), Francine de Martinoir, L’Aimé de juillet (J. Chambon), Marc Bressant, La Citerne (de Fallois) et même à l’excellent Jean-Michel Guenassia, Le Club des incorrigibles optimistes (Albin-Michel). Depuis une dizaine d’années, peut-être un peu plus, la littérature française revient, sous la forme de témoignages, romancés ou non, de fictions, sur la fin de la présence française de l’autre côté de la Méditerranée. Le mur du silence lui aussi tombe. Retour sur un livre paru en 2002.
Bien des livres de cette rentrée littéraire 2009 reviennent sur la Guerre d’Algérie. On pense notamment à Annelise Roux, La Solitude de la fleur blanche (Sabine Wespieser), Laurent Mauvignier, Les Hommes (Minuit), Francine de Martinoir, L’Aimé de juillet (J. Chambon), Marc Bressant, La Citerne (de Fallois) et même à l’excellent Jean-Michel Guenassia, Le Club des incorrigibles optimistes (Albin-Michel). Depuis une dizaine d’années, peut-être un peu plus, la littérature française revient, sous la forme de témoignages, romancés ou non, de fictions, sur la fin de la présence française de l’autre côté de la Méditerranée. Le mur du silence lui aussi tombe. Retour sur un livre paru en 2002.
« Non toute cette souffrance n’avait pas pu sortir et il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu’il pensait déjà qu’il faudrait repartir et qu’il ne fallait pas faire de peine en disant sa peine à lui, peut-être aussi parce qu’il sentait que de toute façon le père n’était pas prêt à l’entendre ».
« Pas prêt à l’entendre » ! le père... pas plus la fiancée d’ailleurs : « (...) à elle non plus, il n’avait pas pu parler. Elle lui semblait trop loin de lui, inaccessible dans ses rêves d’enfant ». Entendre quoi d’ailleurs ? Les récits d’une guerre sans nom dont la majorité des Français de métropole n’avait fichtre rien à faire ?! Les crimes et abominations commis par l’armée au nom du maintien de l’ordre ou de la pacification ? Mieux valait rester loin de tout cela ! S’interroger sur la présence française en Algérie et triturer « nos » mentalités travaillées par cent trente-deux ans de colonialisme ? Allons allons, il y avait mieux à faire que perdre son temps pour ces « indigènes » : ils veulent leur indépendance, qu’on l’a leur donne et basta !
Alors, « le Dégonfleur », en permission dans sa famille, s’était tu. Lui, comme des milliers d’autres de son âge. Avoir vingt ans dans les Aurès ! Une nouvelle fois, l’écho de ce long et lointain silence s’échappe de blessures jamais refermées. Une mémoire toujours tourmentée laisse remonter à la surface des souvenirs jamais disparus.
Dans ce premier roman, Jean Pierre Robert revient donc sur cette douloureuse page de l’histoire nationale. Nous sommes en 1961. Au cœur du massif des Aurès. Tournant le dos aux simplifications et au manichéisme, la structure romanesque met en vis-à-vis tout au long du récit deux personnages. L’un est Français, « le Dégonfleur », l’autre est Algérien, « l’homme de Nara » - du nom de son village rasé par l’armée française - celui qu’on appelle aussi « l’Absent ». Il ne dit plus rien et ne voit plus rien parce que « les Français lui avaient brûlé les yeux, [et] les djounouds lui avaient arraché la langue ». « Le Dégonfleur » et « l’Absent » seront entraînés dans cette guerre, malgré eux. Ils en seront aussi les victimes. Pas celles tombées au champ d’honneur. Non. Seulement celles, plus nombreuses, qui, en France mais aussi en Algérie, tairont leurs souffrances. Souvent, dans ce dernier pays, les souffrances se doublent de l’injustice. Car les exactions, les tortures, la justice expéditive ne sont pas le seul fait de l’armée française - ici des bérets verts de la légion ou des harkis représentés entre autres par « l’Enfant ». Elles sont aussi de l’autre côté et une juste cause ne peut absoudre les mauvaises actions.
Jean Pierre Robert décrit la vie à la caserne, l’ambiance fait d’ennui, d’attente, de petites et de grandes compromissions, de solitude, de nuits « sans rêve », de peur et de mort. Avec « le Dégonfleur » il y a le caporal, cet ancien étudiant gauchiste de la Sorbonne qui cherche « à sauvegarder un peu de sa dignité perdue » ; il y a aussi le caporal-chef qui n’est pas loin de la quille. Ensemble, ils seront témoins de tortures infligées à des prisonniers. « On savait bien que près du PC, dans l’officine du sergent harki, les interrogatoires n’étaient pas tendres. (...) Comme on n’y pouvait rien, on n’en parlait pas et d’ailleurs on préférait ne pas trop savoir (...) ».
À Alger, tandis que les généraux font leur putsch, Jean Pierre Robert tire une salve contre ceux qu’il appelle « les brailleurs » ou « les excités d’Alger » : « (...) dans la belle ville blanche, au bord de la Méditerranée si bleue, les vrais Français gueulaient leur enthousiasme guerrier, et ils avaient bien raison, ces héroïques civils qui ne risquaient rien ». À la caserne, les officiers se déballonnent, les postes radio grésillent, la troupe discute, les subalternes prennent les choses en main, et la légalité républicaine triomphe, « et au commando, on se disait que çà valait mieux comme ça ».
La guerre se poursuivant encore un temps, l’auteur montre les horreurs, dit les tortures, ne cache rien semble-t-il des exactions. Il faut en passer par là pour faire comprendre au lecteur « le mal » et « la honte » ressentis. « C’est pour des choses comme cela que les soldats, dans les guerres, ils n’écrivent rien d’intéressant à leur famille et qu’après, ils ne parlent pas ».
Pour ceux qui ont souffert, la paix est « une nouvelle souffrance, un nouveau coup qui coupe le souffle et fait perdre la tête. Parce que tout ce qui a été subi et qui a fait si mal devient tout à coup inutile et ridicule. (...). Il y a de quoi devenir fou. Beaucoup se protègent en faisant semblant, semblant d’oublier, semblant d’être heureux et ils essaient de vivre. Mais pas tous. Il y a ceux qui ne peuvent pas et dont la tête éclate ».
Gallimard, 2002, 223 pages, 15 €
Illustration :
ALGER-1839
Chiaoux et karamoussa , deux officiers de police volontaires, repoussent la foule algéroise (les enfants tout particulièrement) au passage des troupes françaises de retour d'expédition (collection annales algériennes) -
Ma Boîte noire
Driss Ksikes
Ma Boîte noire
 Un écrivain qui accable son lecteur de ses angoisses existentielles et pleure sur sa plume sèche devant une page désespérément blanche ou mal noircie est souvent ennuyeux. Dans Ma Boîte noire, le narrateur, Mokhtar, revisite son passé et raconte justement la genèse tourmentée d’un roman qu’il est en train d’écrire. Balancement entre mémoire et fiction pour, in fine, voir l’écriture se nourrir du vécu. Exercice périlleux donc, d’autant plus que Driss Ksikes n’évite pas quelques fautes de goût ou lieux communs du genre : « Au fait, j’ai décidé d’écrire un livre. Ce n’est pas la première fois que j’y pense. Je me suis toujours pris pour un écrivain. Depuis le jour où je surpris mon moniteur de colonie de vacances qui se mastiquait le mastodonte (périphrase grotesque indiquant qu’il se masturbait), j’ai compris qu’il y avait des choses à dire et d’autres indicibles. Reste à les écrire ». Et, à propos de l’écriture : « entre les fastes de la diarrhée et les timidités de la constipation, j’allais trouver ma voix. ». Pourtant, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain : Ma Boîte noire renferme une trame romanesque, en l’occurrence mémorielle et existentielle (celle de Mokhtar), captivante par ses rebondissements et révélations, et son sujet demeure, à n’en pas douter, l’un des plus brûlants au Maroc et ailleurs en Afrique du Nord : le droit au plaisir et la liberté individuelle.
Un écrivain qui accable son lecteur de ses angoisses existentielles et pleure sur sa plume sèche devant une page désespérément blanche ou mal noircie est souvent ennuyeux. Dans Ma Boîte noire, le narrateur, Mokhtar, revisite son passé et raconte justement la genèse tourmentée d’un roman qu’il est en train d’écrire. Balancement entre mémoire et fiction pour, in fine, voir l’écriture se nourrir du vécu. Exercice périlleux donc, d’autant plus que Driss Ksikes n’évite pas quelques fautes de goût ou lieux communs du genre : « Au fait, j’ai décidé d’écrire un livre. Ce n’est pas la première fois que j’y pense. Je me suis toujours pris pour un écrivain. Depuis le jour où je surpris mon moniteur de colonie de vacances qui se mastiquait le mastodonte (périphrase grotesque indiquant qu’il se masturbait), j’ai compris qu’il y avait des choses à dire et d’autres indicibles. Reste à les écrire ». Et, à propos de l’écriture : « entre les fastes de la diarrhée et les timidités de la constipation, j’allais trouver ma voix. ». Pourtant, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain : Ma Boîte noire renferme une trame romanesque, en l’occurrence mémorielle et existentielle (celle de Mokhtar), captivante par ses rebondissements et révélations, et son sujet demeure, à n’en pas douter, l’un des plus brûlants au Maroc et ailleurs en Afrique du Nord : le droit au plaisir et la liberté individuelle.
Après la mort de Tante Maria, Mokhtar s’installe dans l’appartement de la défunte. À la faveur de ce déménagement, l’homme revisite son passé et s’attèle à satisfaire sa vocation d’écrivain. Son sujet d’écriture est tout trouvé, ce sera Tante Maria. Cette femme, en apparence probe et respectueuse des convenances sociales et religieuses, cacherait en fait, dans l’intimité de son appartement, quelques inavouables secrets. Duplicité et ambiguïté donc. Tout est bon pour alimenter les fantasmes du neveu, lui-même surpris que sa « tête soit peuplée de tant de promiscuité ».
Chez Mi Saliha, la voisine, entre trois joints et quelques verres, tombent deux révélations sur la véritable personnalité de sa tante. L’une alimentera son roman, l’autre sonne comme un coup de théâtre, un coup de théâtre qui lui fera porter un tout autre regard sur sa tante si mal aimée depuis ce temps lointain où, castratrice, elle mit fin aux dangereux attouchements auxquels il se livrait, dans un placard, avec la jeune Zina. Les révélations de Mi Saliha feront coïncider écriture et vécu le tout servi par une trame mémorielle tissée par le désir et la sexualité. Avant Zina, il y a eu Zahra, l’initiatrice, et, après, Warda, la cousine au slip rouge. C’est d’ailleurs au nom de la liberté sexuelle qu’adolescent, Mokhtar se brouillait avec son père et quittait, quinze ans plus tôt, le domicile familial.
Car Mokhtar, « attaché à la compagnie des femmes », est une espèce rare et suspecte aux yeux des « conservateurs vicieux » à l’instar du proviseur du lycée où il enseigne ou de ses collègues du genre de M.Sallam, prof d’éducation islamique, digne représentant de la « junte masculine » pour qui la « promiscuité » commence avec la « mixité ». Jeune, Mokhtar chercha bien dans la voix de Dieu à calmer ses ardeurs. En vain : « je reniflais désespérément le musc qui emplissait la mosquée. Il ne me menait nulle part. Dieu s’éloignait. L’image de Zahra, origine de mon plaisir inextinguible devenait envahissante, irrésistible. » Une image si forte, si présente que Mokhtar ne pourra s’empêcher de jouir… en pleine mosquée ! L’alcool et l’herbe aidant, Mokhtar entrevoit qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le trépas pour entrer au paradis, que le paradis est ici, sur terre.
Mais voilà l’ordre des hommes est celui des interdits et des frustrations. Un ordre qui fait les hommes et les femmes malheureux et où la duplicité et l’ambiguïté sont partout. Warda, se cache en Arabie pour tapiner ; son père, taciturne à la maison, autrement prolixe à l’extérieur, cache des activités secrètes inavouables ; Tante Maria… jusqu’à une génération tout entière « qui a tout vu, ou presque, et qui n’a rien dit, ou presque » des exactions commises par feu le monarque et ses sbires ! Cette critique de la société marocaine devient acerbe quand Amine un « vieux copain » émigré à Boston l’enjoint de quitter le royaume, « cette terre d’asservis », « les coups bas et l’attitude mielleuse » de ses compatriotes.
Ce travail d’écriture et d’anamnèse se déroule au lendemain du 11 septembre et débouche sur une pirouette littéraire désuète pour expliquer le terrorisme islamiste : « Sans les femmes, finalement, j’aurais peut-être été un vulgaire kamikaze, au corps déchiqueté ». En bref, il suffirait de s’envoyer en l’air entre deux draps pour ne pas avoir à le faire, à quelques centaines de mètres du sol, entre deux tours…Programme certes alléchant mais sans doute un peu court.
Dommage car Driss Ksikes n’avait pas besoin de cela pour appuyer son utile et pertinente description des effets, sur les corps et les esprits, d’un puritanisme hypocrite et d’une idéologie masculine liberticide, offrant pour seules soupapes l’ambivalence (schizophrénique ?) et le secret. Rendons grâce à la femme donc ( « un monde sans femmes, sans la brise fraîche de leur parfum ? J’étoufferais à la longue »), louons le plaisir mais, en attendant des jours meilleurs, et pour paraphraser le cardinal de Retz, il vaut mieux, pour éviter des ennuis, ne pas sortir de l’ambiguïté.
Le Grand Souffle Editions et Tarik éditions, 2006, 125 pages, 11.80 €
-
De sabres et de feu
Marc Trillard
De sabres et de feu
 Le voyage et l’autre sont au cœur de l’œuvre et sans doute de la vie de Marc Trillard. Écrivain (prix Louis-Guilloux 1997 pour Coup de lame, et Interallié en 1994 pour Eldorado 51), voyageur auteur de livres-reportages (Madagascar en 2001, Cuba en 1999 ou le Cap-Vert en 1993) il est enfin directeur du semestriel Le Journal des lointains. Dans ce nouveau roman, le toulousain invite son lecteur à le suivre pas très loin de chez lui mais à pénétrer l’intimité mystérieuse d’un camp de manouches ou tsiganes, gitans, Roms, Yéniches et autres Gens du voyage.
Le voyage et l’autre sont au cœur de l’œuvre et sans doute de la vie de Marc Trillard. Écrivain (prix Louis-Guilloux 1997 pour Coup de lame, et Interallié en 1994 pour Eldorado 51), voyageur auteur de livres-reportages (Madagascar en 2001, Cuba en 1999 ou le Cap-Vert en 1993) il est enfin directeur du semestriel Le Journal des lointains. Dans ce nouveau roman, le toulousain invite son lecteur à le suivre pas très loin de chez lui mais à pénétrer l’intimité mystérieuse d’un camp de manouches ou tsiganes, gitans, Roms, Yéniches et autres Gens du voyage.
La trame romanesque est assez réduite et est surtout prétexte à pointer du doigt nos fantasmes et nos peurs et à déplorer la disparition progressive d’un mode de vie et d’une culture au profit d’une modernité vorace et omnivore qui aime rien moins qu’engloutir les hommes et les cultures.
Le vieil Enrique Torres Esquivel, le doyen des tziganes, vient de casser sa pipe. De tous les coins de France et d’Europe confluent les tsiganes pour lui rendre un dernier et traditionnel hommage. La mort d’Enrique correspond à une autre mort : celle du camp, des caravanes et autres roulottes qui seront reléguées dans les garages de la future et proche cité Saint-James en construction, dans laquelle les autorités locales entendent parquer, fissa et manu militari, ces indésirables et inquiétants nomades. « Une réserve » où le gitan devra faire « en tout exactement comme fait le non-tzigane, le gadjo qui s’est laissé passer le collier et dont [il méprise] la trace autour du cou ».
Le camp de Ginestous se trouve dans la périphérie nord de la ville rose. Ce nouveau Ginestous est une aire d’accueil sur un parking. L’autre, le vieux Ginestous, « Ginestous l’historique », se dissimulait, « libre », sur les bords de la Garonne. Un soir, alors que la rivière sortait de son lit pour tout emporter, les autorités municipales oublièrent tout simplement ces hommes, ces femmes et ces enfants. Seules, livrées à elles-mêmes dans la nuit, les familles grelottantes et trempées se serraient devant le fleuve qui emportait tout, c’est-à-dire le peu qu’elles possédaient.
Au camp il y a Pèpo, porte-parole de la communauté qui s’occupe des deux chevaux d’Enrique, confinés dans une écurie clandestine. Rafaël dit « L’Ergot » élève des coqs. Agustin Torres Arcoz, l’indomptable neveu du mourant, est un mélange détonnant d’un gitan et d’une maghrébine. À travers ces personnages et d’autres, l’auteur brosse l’histoire, les parcours et les pratiques de cette « population de voyageurs », « derniers parias du vieux monde ».
Bartolomé Gavard est l’agent communal en charge du campement. Passionné par ces populations et leurs modes de vie, le gadjo pas tout à fait gadjo se sent à l’étroit dans ce qui est devenu une prison : femme, gosse, boulot, rapport hebdomadaire, bulletin de salaire, crédit-maison… « Le sympathique gardien du camp, si proche de ses habitants et curieux de leurs façons », un brin déboussolé, s’éprend d’un impossible et illusoire amour pour Antucha, la fille d’Agustin, l’éternelle adolescente.
Bartolomé et Moscowicz, le vieux et toujours aussi militant toubib du camp, sont bien les seuls à s’intéresser à ces gitans. Dans « la cartésienne France sarkozienne, sarkosyste, sarkophile, ou plus rien ne dépasse du rang », on préfère les « ignorer », « regarder ailleurs », les tenir à l’écart ou les faire entrer dans le rang. Disparition programmée !
Edition Le Cherche midi, 2006, 280 pages, 15 € -
Liberté, égalité, carte d'identité
Evelyne Ribert
Liberté, égalité, carte d'identité. Les jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale
 Qu’est ce qui motive chez les jeunes dits de la « seconde génération », selon une appellation ambiguë née dans les années 90, le choix de la nationalité et quel est leur degré d’adhésion au « modèle d’appartenance nationale » ? C’est à ces deux questions que répond le livre d’Evelyne Ribert, jeune docteur en sociologie et chercheur au CNRS, qui publie ici les conclusions d’une enquête sur le choix d’une nationalité et l’appartenance nationale menée entre 1995 et 1996 auprès de cinquante jeune, âgés de 16 à 20 ans, nés en France, de parents marocains, tunisiens, espagnols, portugais et turcs.
Qu’est ce qui motive chez les jeunes dits de la « seconde génération », selon une appellation ambiguë née dans les années 90, le choix de la nationalité et quel est leur degré d’adhésion au « modèle d’appartenance nationale » ? C’est à ces deux questions que répond le livre d’Evelyne Ribert, jeune docteur en sociologie et chercheur au CNRS, qui publie ici les conclusions d’une enquête sur le choix d’une nationalité et l’appartenance nationale menée entre 1995 et 1996 auprès de cinquante jeune, âgés de 16 à 20 ans, nés en France, de parents marocains, tunisiens, espagnols, portugais et turcs.
 En ce mitan des années quatre-vingt-dix, la nouvelle loi sur la nationalité, dite loi Méhaignerie s’applique. Depuis un an et jusqu’en 1998 elle oblige les jeunes nés de parents étrangers (à l’exception de ceux d’origine algérienne) à une déclaration d’intention. L’enquête d’Évelyne Ribert vient confirmer que le choix de la nationalité française est majoritaire, écrasant même, chez ces jeunes et ce au détriment de celle du pays d’origine des parents. Mieux, ce choix ne souffre aucune discussion tant la nationalité française est considérée comme « naturelle », « allant de soi », un simple « choix de papiers », une question, enfin, qui ne se pose même pas. Pourtant Évelyne Ribert montre que l’attachement national n’est nullement corrélé au choix de la nationalité française autrement dit que l’identité de ces jeunes est déconnectée de la nationalité. Pour expliquer cette dissociation elle avance trois explications. Tout d’abord, jusqu’à leur majorité, la plupart de ces jeunes ignorent leur nationalité, ensuite, la catégorie « seconde génération » dans laquelle la loi et plus largement la société les enferme, les renvoie constamment à une « origine » réelle ou fantasmée, enfin et surtout, l’appartenance nationale n’est qu’une facette de l’identité de ces jeunes qui revendiquent ou reconnaissent, confusément souvent, plusieurs appartenances, réinventant ainsi des modèles nationaux, bousculant les frontières et les territoires, bricolant des identités plurielles et composites.
En ce mitan des années quatre-vingt-dix, la nouvelle loi sur la nationalité, dite loi Méhaignerie s’applique. Depuis un an et jusqu’en 1998 elle oblige les jeunes nés de parents étrangers (à l’exception de ceux d’origine algérienne) à une déclaration d’intention. L’enquête d’Évelyne Ribert vient confirmer que le choix de la nationalité française est majoritaire, écrasant même, chez ces jeunes et ce au détriment de celle du pays d’origine des parents. Mieux, ce choix ne souffre aucune discussion tant la nationalité française est considérée comme « naturelle », « allant de soi », un simple « choix de papiers », une question, enfin, qui ne se pose même pas. Pourtant Évelyne Ribert montre que l’attachement national n’est nullement corrélé au choix de la nationalité française autrement dit que l’identité de ces jeunes est déconnectée de la nationalité. Pour expliquer cette dissociation elle avance trois explications. Tout d’abord, jusqu’à leur majorité, la plupart de ces jeunes ignorent leur nationalité, ensuite, la catégorie « seconde génération » dans laquelle la loi et plus largement la société les enferme, les renvoie constamment à une « origine » réelle ou fantasmée, enfin et surtout, l’appartenance nationale n’est qu’une facette de l’identité de ces jeunes qui revendiquent ou reconnaissent, confusément souvent, plusieurs appartenances, réinventant ainsi des modèles nationaux, bousculant les frontières et les territoires, bricolant des identités plurielles et composites.
Si, affinant l’analyse, des différences sont à noter (liées à l’origine culturelle, à l’âge, à la possession ou non des papiers d’identité, à l’insertion professionnelle…), globalement, cette attitude des jeunes français issus des différentes migrations ne diffère pas de celle des jeunes Français nés de parents français, chez qui l’on observe également une tendance à remettre en cause le « modèle d’appartenance nationale » au profit de références européennes voir mondiales quand ce n’est pas d’une critique des frontières au nom de l’unité de l’espèce humaine.
Fort justement, l’auteur insiste : la faible identification des jeunes d’origine immigrée au modèle national n’est nullement le fait d’une prétendue allégeance étrangère mais correspond à un mouvement générale perceptible au sein de la jeunesse française de sorte qu’elle témoignerait selon l’auteur d’une parfaite intégration (sur ce point du moins).
Evelyne Ribert, ajoute à ses analyses les conclusions de l’enquête menée par Olivier Galland et Jean Vincent Pfirsch (1), qu’elle cite : « la faiblesse du sentiment national des jeunes d’origine immigrée ne semble pas être liée à une dépréciation plus marquée à leurs yeux de l’image de la nation et du pays dont ils s’accordent à reconnaître, autant que les jeunes Français de souche, les qualités et les avantages (et également les défauts) mais plutôt à la faiblesse du sentiment de continuité entre leur propre histoire et celle du pays où ils vivent ». Elle ajoute : « Les adolescents rêvent, en outre, d’être reconnus pour ce qu’ils sont, avec leur origine étrangère et d’être perçus ainsi comme partie intégrante de la nation. C’est à cette double condition qu’ils pourront pleinement s’identifier à la communauté nationale ».
Voilà qui ouvre sur la question des bagages identitaires de ces jeunes et notamment sur la question de la culture d’origine qu’il ne faudrait pas essentialiser, globaliser et surtout, comme l’esquisse étonnement Evelyne Ribert, aborder par ce fichu voile imposer par les seuls islamistes et qui réduit singulièrement des siècles d’histoire et de civilisation portés par des peuples et des groupes autrement divers et créatifs.
(1) Les Jeunes, l’armée et la nation, Centre d’études en sciences sociales de la défense.
Edition La Découverte, 2006, 276 p., 23 € -
Identité 4
Identité 4
Pour terminer ce florilège sur le thème de l'identité, pour respirer un bon bol d'air frais et saluer un vieil ethnologue!
« les courants de transformations qui traversent notre planète sont plus forts que les résistances identitaires »
Daryush Shayegan
« Si on bloquait les courants - les frontières sont faites pour cela -, le monde serait trempé et pourri dans des eaux mortes »Ying Chen
« Je ne crois pas aux vertus du nomadisme systématique, de l’accumulation illimitée des emprunts culturels. Pour être à l’aise dans une culture, de nombreuses années d’apprentissage sont nécessaires ; la durée limitée de la vie humaine nous empêche d’aller au-delà de deux ou trois expériences semblables. » Tzvetan Todorov
« Mes premiers écrits, je les ai consacrés à mon incapacité à savoir qui j’étais (…). Je ne trouvais pas ma place sur le nuancier des identités américaines : je ne me sentais ni blanc, ni black, ni hispanique, ni asiatique. Sur le papier, j’étais « africain-américain », mais toutes mes tentatives d’agir comme les membres de cette communauté ont échoué. Alors, vers quinze ans, j’ai laissé tomber : « Américain solitaire », ça me convenait. » Dinaw Mengestu
« On mélange tous la mémoire et l’imagination. Pas seulement notre mémoire, d’ailleurs, mais celle de la génération qui nous a précédés. Même si leur histoire n’est pas la nôtre, on a fini par l’absorber. L’important, c’est de ne pas se sentir « obligé » par elle (…) » Dinaw Mengestu
« L’homme dépaysé, arraché à son cadre, à son milieu, à son pays, souffre dans un premier temps : il est plus agréable de vivre parmi les siens. Il peut cependant tirer profit de son expérience. Il apprend à ne plus confondre le réel avec l’idéal, ni la culture avec la nature : ce n’est pas parce que ces individus-ci se conduisent différemment de nous qu’ils cessent d’être humains. Parfois, ils s’enferment dans un ressentiment, né du mépris ou de l’hostilité de ses hôtes. Mais, s’il parvient à le surmonter, il découvre la curiosité et apprend la tolérance. Sa présence parmi les « autochtones » exerce à son tour un effet dépaysant : en troublant leurs habitudes, en déconcertant par son comportement et ses jugements, il peut aider certains d’entre eux à s’engager dans cette même voie de détachement par rapport à ce qui va de soi, voie d’interrogation et d’étonnement. » Tzvetan Todorov
Aimé Césaire « n’a pas recours à des rebellions bornées, des crocs identitaires aveugles, des légitimités assassines, close dans un infernal jeu de miroir meurtrier entre le dominant et le dominé, mais (…) il déploie au contraire l’hymne guerrier du « plus ouvert contre le plus étroit » (…) » Patrick Chamoiseau
« Mettre ces représentations en perspective dans le temps et dans l’espace conduit à comprendre combien la plupart de nos évidences en matière d’identité sont étranges et improbables pour qui se décide à les considérer d’ailleurs, et souvent de plus loin. » Marcel Detienne
« Le métissage ce n’est pas une fusion, l’addition d’un et d’un, la rencontre de deux identités dans l’illusion de leurs puretés originelles, encore moins un croisement d’espèces et de genres où la biologie aura sa part. Non, le métissage, c’est une politique. Et, plus précisément, une politique de résistance » Edwy Plenel
« Ceux qui se sont élevés contre la mise en avant d’une « identité nationale » sont souvent les défenseurs d’identités plus englobantes encore, apportant la preuve qu’il reste encore à ébaucher une pensée de l’identité, de l’appartenance et de la mémoire, qui se dessinerait dans la forme poétique de l’archipel et non dans la forme politique de l’assignation à résidence » Natacha Polony (Marianne du 12 au 17 juillet)
"J'ai connu une époque où l'identité nationale était le seul principe concevable des relations entre les Etats. On sait quels désastres en résultèrent. […] L'Eurorégion crée entre les pays de nouvelles relations qui débordent les frontières et contrebalancent les anciennes rivalités par les liens concrets qui prévalent à l'échelle locale sur les plans économique et culturel". Claude Levi-Strauss
Quand les hommes de la fin du Moyen-âge et de la Renaissance ont redécouvert l'antiquité gréco-romaine et quand les jésuites ont fait du grec et du latin la base de leur enseignement, ne pratiquaient-ils pas une première forme d'ethnologie ? On reconnaissait qu'aucune civilisation ne peut se penser elle-même si elle ne dispose pas de quelques autres pour servir de terme de comparaison. La Renaissance trouva dans la littérature ancienne le moyen de mettre sa propre culture en perspective, en confrontant les conceptions contemporaines à celles d'autres temps et d'autres lieux. Claude Levi-Strauss"(...) on sait déjà qu'aucune fraction de l'humanité ne peut aspirer à se comprendre, sinon par référence à toutes les autres."
Claude Levi-Strauss
"Sans doute cette uniformisation [des méthodes, des techniques et des valeurs de l'Occident] ne sera jamais totale. D'autres différences se feront progressivement jour, offrant une nouvelle matière à la recherche ethnologique. Mais, dans une humanité devenue solidaire, ces différences seront d'une autre nature : non plus externes à la civilisation occidentale, mais internes aux formes métissées de celle-ci étendues à toute la terre." Claude Levi-Strauss
Mais si l'homme possède d'abord des droits au titre d'être vivant, il en résulte que ces droits, reconnus à l'humanité en tant qu'espèce, rencontrent leurs limites naturelles dans les droits des autres espèces. Les droits de l'humanité cessent au moment où leur exercice met en péril
l'existence d'autres espèces.
Claude Levi-Strauss
-
Identité 3
Identité 3
Voici d'autres citations qui devraient aider à ne pas enfermer les identités dans des catégories coercitives et illusoires... La police de l'identité veille et se réveille, les poètes éveillent et élèvent.
La droite « veut des guerres des cultures, et non des luttes de classes : tant que les affrontements concernent l’identité plutôt que la richesse, peut lui importe qui les gagne. » (...) « Pendant ce temps, l’idée, elle vraiment radicale, d’une redistribution des richesses devient quasi impensable. » Walter Benn Michaels
 « Pour impressionner son public, Fofana Bakary en profitait pour rappeler, avec une pointe de fierté dans la voix, que le chef de la France libre avait, en 1944 à Brazzaville, décoré son père, un tirailleur valeureux, émérite et franchement polygame. Avant de mourir grignoté par ses nombreuses et turbulentes femmes, il avait terminé la guerre avec des médailles et le prestigieux grade de sergent-chef. Il se flattait aussi de connaître par cœur La Marseillaise. Cela ne l’empêchait pas, se plaignait son fils, d’avoir une pension inférieure à celle des Français de métropole. » Abdelkader Djemai
« Pour impressionner son public, Fofana Bakary en profitait pour rappeler, avec une pointe de fierté dans la voix, que le chef de la France libre avait, en 1944 à Brazzaville, décoré son père, un tirailleur valeureux, émérite et franchement polygame. Avant de mourir grignoté par ses nombreuses et turbulentes femmes, il avait terminé la guerre avec des médailles et le prestigieux grade de sergent-chef. Il se flattait aussi de connaître par cœur La Marseillaise. Cela ne l’empêchait pas, se plaignait son fils, d’avoir une pension inférieure à celle des Français de métropole. » Abdelkader DjemaiIl serait bon de « réviser cette identité républicaine hypocrite qui a du mal à s’ouvrir à la diversité. Et quand on constate que monsieur Brice Hortefeux, ministre de cet affreux ministère de « l’Intégration, de l’identité nationale et de l’immigration », aux relents franchement vichyssois, se permet de réunir, à Vichy précisément, les ministres européens chargés des questions d’immigration, on peut légitimement penser qu’il y a là une continuité conservatrice inquiétante » Jacky Dahomay
 « Une autre dimension problématique de l’identité culturelle française est constituée par le rapport au passé colonial. Depuis une vingtaine d’années, on se penche en France avec insistance sur l’épisode vichyssois, sur la compromission avec la politique nazie. Or l’épisode colonial est beaucoup plus long (la seule « aventure » algérienne va de 1830 à 1962), il a donc laissé des traces dans la conscience de plusieurs générations de Français, et les rapports entre colonisateurs et colonisés n’ont guère été moins violents, loin de là, que ceux entre Français (non juifs) et Allemands pendant la dernière guerre. La colonisation est aujourd’hui annulée et ce sont les ressortissants des anciennes colonies qui se retrouvent nombreux en métropole. Cette question, dont on perçoit aisément toute la complexité psychologique, est absente du discours public contemporain. Le colonialisme, la décolonisation et leurs séquelles font l’objet de travaux spécialisés, mais ils sont refoulés par la conscience collective. Ce refoulement, à son tour, nuit à l’établissement d’une identité culturelle nouvelle. » Tzvetan Todorov
« Une autre dimension problématique de l’identité culturelle française est constituée par le rapport au passé colonial. Depuis une vingtaine d’années, on se penche en France avec insistance sur l’épisode vichyssois, sur la compromission avec la politique nazie. Or l’épisode colonial est beaucoup plus long (la seule « aventure » algérienne va de 1830 à 1962), il a donc laissé des traces dans la conscience de plusieurs générations de Français, et les rapports entre colonisateurs et colonisés n’ont guère été moins violents, loin de là, que ceux entre Français (non juifs) et Allemands pendant la dernière guerre. La colonisation est aujourd’hui annulée et ce sont les ressortissants des anciennes colonies qui se retrouvent nombreux en métropole. Cette question, dont on perçoit aisément toute la complexité psychologique, est absente du discours public contemporain. Le colonialisme, la décolonisation et leurs séquelles font l’objet de travaux spécialisés, mais ils sont refoulés par la conscience collective. Ce refoulement, à son tour, nuit à l’établissement d’une identité culturelle nouvelle. » Tzvetan Todorov
« Loyalisme. Antiloyalisme. Allégeance. Obéissance. Des mots, ce ne sont que des mots ».
Julie Otsuka

« Noirs et Blancs ? Oui, parlons-en ! mais en prenant ces dénominations pour ce qu’elles sont, non pas le compte-rendu de variations pigmentaires, mais l’héritage dans les mots d’une histoire de domination naturalisée par les siècles, non pas notre destinée génétique, mais la postérité d’un conflit planétaire pesant sa marque dans notre regard et nos comportements ». Jean-Louis Sagot-Duvauroux
« Nul n’est plus fils ou fille de son pays que l’exilé, l’orphelin, le déraciné... Combien je déteste cette suffisance par laquelle on délimite son « clan », où on ne se reconnait de fraternité qu’à l’aune des frontières d’un pays... Les nationalistes sont des daltoniens, ils ne savent pas apprécier toutes les nuances et le colorie de cette fraternité élargie qu’on a coutume d’appeler la « diaspora » ; et, de même que la logique ou l’illogisme de l’intolérance tend à s’étendre au sein même des différentes régions d’une même nation, de même le mot « diaspora » revêt pour moi un sens plus généreux que celui de la simple connotation ethnique ». Ook Chung
« Je suis devenue «Musulman ». Cela je ne peux plus l’effacer. De la fange du monde capitaliste, le pétrole boueux, sont parvenus les pourvoyeurs de morts, les Instrumentateurs de la planète. Des hommes-à-face-de-pitt-bull, que leur force mécanique pervertit et enrage, croisent les hommes-en-noir-cracheurs-de-morts tout aussi animés de violence et de bêtise. (…) Ces deux espèces veulent ma mort. (…) Ils me nomment « Musulman »Zahia Rahmani
« Mon cher enfant, à quoi bon chercher ta famille « biologique » ? (...) La recherche des racines comme panacée est une illusion. Chéris ton déracinement. Attache toi à une foi, à un dieu, plutôt qu’à un pays, et je te donne ce conseil de père même si tu es athée (il n’est pas besoin d’être dévot pour croire).
(...) Il y a bien longtemps, j’ai fait le choix de placer toute ma foi dans les mots, au-delà de la « famille », de la patrie, de ma propre vie. » Ook Chung
« Vivre c’est fabriquer de l’oubli et du mensonge »Tassadit Imache
"De même qu'il n'existe pas de bon conte, il est illusoire de penser qu'il puisse exister un bon endroit, un bon moment, une bonne personne. Peut-être que l'existence elle-même est une erreur totale. Il se peut que nous menions tous des existences prisonnières de hasards absurdes et que nous perdions notre temps à chercher un ordre sous-jacent". Murathan Mungan,