Rawi Hage
De Niro’s Game Le contenu d’une valise ou d’un sac de clandestin que vomit nuitamment un cargo dans une ville encore endormie livre quelques détails sur celui qui débarque. Dans son sac, Bassam, a emporté un revolver, de l’argent et un chandail de laine. De cette arme, il est facile de déduire que l’homme vient de quitter ou de fuir un quotidien de violence. L’argent pourrait être le fruit de quelques économies ou le résultat d’un larcin. Le chandail tricoté à la main rappelle sans doute le don d’un être cher. Une mère ? Une sœur ? Une épouse ?
Le contenu d’une valise ou d’un sac de clandestin que vomit nuitamment un cargo dans une ville encore endormie livre quelques détails sur celui qui débarque. Dans son sac, Bassam, a emporté un revolver, de l’argent et un chandail de laine. De cette arme, il est facile de déduire que l’homme vient de quitter ou de fuir un quotidien de violence. L’argent pourrait être le fruit de quelques économies ou le résultat d’un larcin. Le chandail tricoté à la main rappelle sans doute le don d’un être cher. Une mère ? Une sœur ? Une épouse ?
Dans De Niro’s Game, Rawi Hage, raconte avec une force étonnante pour un premier roman, l’histoire de Bassam et de Georges, son ami d’enfance. Ils sont Libanais. Chrétiens de Beyrouth. Le Beyrouth de la guerre civile et des bombes. Cette chronique est celle des bombardements, des immeubles éventrés, de la mort et de la solitude, des luttes entre factions armées, celle aussi des seigneurs de guerre qui engraissent et engrangent sur le dos de martyrs shootés à l’idéologie et à la cocaïne ou de pauvres bougres bien obligés de remplir la gamelle familiale. Rawi Hage laisse deviner la sauvagerie des milices qui déciment le camp palestinien de Sabra et Chatila ; le terrorisme en complet veston et robe de soirée des responsables israéliens ; l’exploitation des immigrés égyptiens par les milices…
Mais cela n’est que la toile de fond de ce récit. Rawi Hage raconte l’histoire de deux hommes. Bassam et Georges. Deux amis d’enfance que la guerre - ou la vie - va séparer. Deux amis qui filent sur la moto de Georges dans une ville noyée sous une pluie de bombes. Nos deux compères échafaudent des plans pour se faire du fric. Ils détournent de l’argent de la salle de jeux où travaille Georges. Bassam livre du mauvais whisky au secteur musulman de la ville. Ensemble, ils lèvent beaucoup moins de filles qu’ils ne vident de bouteilles. Georges est un bâtard, élevé par sa seule mère ce qui est loin d’aller de soi dans une société patriarcale... Bassam, l’Arménien, vit avec sa mère et fricote ave Rana. Mais même dans une ville en ruine, derrière les murs délabrés, les yeux continuent de surveiller les hymens des jeunes femmes, les « longues langues » s’insinuent sous toutes les portes, sous toutes les jupes.
Bassam veut quitter Beyrouth, « laisser cette terre à ses démons », ce pays où « dix mille cercueils dormaient sous la terre et au-dessus, les vivants dansaient toujours, les bras chargés d’armes à feu. » Georges, lui, s’enfonce, un peu plus dans la guerre, la violence et l’autodestruction. Bassam, surnommé Majnoun (le fou), n’est ni un tendre, ni un faible… Heureusement. Pourtant, le soutien et la protection de Nabila, la tante de Georges, lui seront utiles. A Paris, dans un univers de manipulations, d’espionnage et d’agents de renseignement, il retrouve la sœur de Georges, c’est elle qui lui apprend l’histoire du père absent.
L’écriture de Rawi Hage est métallique et sensuelle, âpre, rugueuse et pourtant fluide car emportée par un torrent violent gros de la bêtise des hommes, ces « chiens humains, [ces] chiens portant masques d’hommes, [ces] chiens armés de fusils (…) », un torrent qui emporte tout sur son passage : le beau comme le laid, l’amour comme la haine, la fraternité des camps opposés comme la cruauté des assassins. Ce récit de guerre au réalisme cru nimbé de bouffées de rêve et de bouffées fantastiques prend des airs de polar et de secrets de famille.
De Niro’s game balance entre Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino et Albert Camus. Bassam est un homme absurde celui qui, pour paraphraser l’auteur du Mythe de Sisyphe, par le seul jeu de sa conscience, transforme en règle de vie ce qui était invitation à la mort - et refuse le suicide.
Traduit de l’anglais (Canada) par Sophie Voillot, édition Denoël 2008, 267 pages, 20€
Littérature libanaise
-
De Niro’s Game
-
Fais voir tes jambes, Leïla !
Rachid el-Daïf
Fais voir tes jambes, Leïla !
 Un spectre hante le monde arabe : le spectre du désir et de la sexualité. Contre lui, tous les censeurs de tous les pays arabes se sont ligués, au diapason d’islamistes hystériques à force de vouloir « cacher ce sein » et le corps tout entier des femmes objets de toutes les (diaboliques) tentations, de tous les fantasmes et… frustrations.
Un spectre hante le monde arabe : le spectre du désir et de la sexualité. Contre lui, tous les censeurs de tous les pays arabes se sont ligués, au diapason d’islamistes hystériques à force de vouloir « cacher ce sein » et le corps tout entier des femmes objets de toutes les (diaboliques) tentations, de tous les fantasmes et… frustrations.
Pour en rester à quelques exemples, ces thèmes occupent des pages entières de salubres romans diffusés parfois sous le manteau. Il y a ainsi Dérèglements (2002) du Syrien Amar Abdulhamid, L’Immeuble Yacoubian (2006) de l’Égyptien Alaa Al-Aswany, L’Amande (2004) de Nedjma, anonyme marocaine ou Ma Boîte noire de Driss Ksikes (2006) également marocain ou encore Un été sans juillet (2004) de l’Algérien Salah Guemriche… Dans son précédent et savoureux Qu’elle aille au diable Meryl Streep !, le Libanais, Rachid el Daïf, posait déjà la question des rapports entre hommes et femmes.
Le lecteur retrouvera avec délices ici le ton de la farce et de la bouffonnerie cher à l’auteur. Professeur de littérature arabe, versé dans les lettres classiques, il est un lecteur attentif du Livre des chansons, écrit au Xe siècle par Abu Faraj al Isfahani. Certaines scènes de ce livre vieux de onze siècles inspirent, aujourd’hui encore, le regard malicieux que porte l’auteur libanais sur la société et ses contemporains. L’ironie ici n’est jamais méchante. Empreinte de tendresse, elle rend les personnages - tous les personnages - sympathiques et émouvants, empêtrés qu’ils sont dans leurs contradictions entre leurs aspirations et le respect des règles sociales, morales et/ou religieuses.
Au volant de sa maudite Subaru que lui a refourguée son pote Rafic, le narrateur de Fais voir des jambes Leïla !, vient d’être victime d’un accident. À son réveil, l’homme se rappelle les déconvenues qui ont précédé l’accident. Cette voiture d’abord : symbole d’une société de consommation effrénée, d’appât du gain et de combines en tout genre. Après son acquisition, le narrateur se rend compte qu’il se retrouve dans une galère sans nom : les pièces de rechange sont introuvables au Liban, prohibitives à l’importation et pour la revendre il faudrait dénicher, après lui, un autre pigeon. Le Beyrouth d’El-Daïf est un Beyrouth matérialiste, on y fait l’amour pour de l’argent, on y vend des livres photocopiés, des logiciels piratés, etc.
Mais là n’est pas son principal souci : son père âgé de soixante-cinq ans entretient une relation avec une jeune femme de trente ans qu’il a décidé d’épouser. Pour ce faire, il a déjà hypothéqué le domicile familial. Pour le fiston « il y a un piège là-dessous, c’est certain ! ». Aussi, va-t-il tout mettre en œuvre pour s’opposer au paternel projet. À commencer par un infantile chantage. Des jours durant, sur le balcon de l’appartement, il s’expose au soleil estival. Pendant que lui brûle et se déshydrate son père, comme indifférent, mange et boit à sa guise. Alors germe une autre idée : offrir à son géniteur - partager plutôt avec lui ! - sa petite amie, la belle Leïla, avec qui il entretient un sporadique commerce amoureux. Ainsi comprendra-t-il que pour assouvir ses désirs charnels, il n’est pas obligé de se marier où alors qu’il le fasse avec une femme de son âge ! de sorte qu’il évitera d’enfanter et le fiston, lui, s’évitera de devoir assumer quelques responsabilités et autres dépenses à l’avenir. Point de morale dans l’affaire, le souci matériel est exclusif.
Mais voilà, peu chaut au père les manœuvres et inquiétudes de son fils. Encore fringant, il semble jouir de la vie quand l’autre se ronge les sens, il fait l’amour, avec empressement et savoir faire avec la jeunette de vingt ans que son fiston lui fourgue entre les mains après l’avoir, lui-même, excitée ! Pragmatique et sensé, il fait en toute chose à la mesure de son humaine condition : « mon Dieu à moi est tout petit, il est juste à la taille de mon cœur, tandis que le tien est trop grand pour toi ! » dit-il à son rejeton gagné par un conformisme religieux de façade.
Alors ultime et diabolique manigance du narrateur : coucher avec Z., la (future) épouse de son père, et ainsi empêcher l’union avec cette femme dont la laideur a déjà repoussé tous les autres hommes de la ville ! « Et dire que les hommes croient comprendre les femmes ! » Lui peut-être moins que les autres encore. « Tu n’es qu’un homme aussi mauvais que les autres » lui assène l’infortunée Z. Empêtré dans son innocente et machiste suffisance, le narrateur s’emberlificote entre ses désirs et ses valeurs : « Leïla est vraiment une fille super (…) si elle avait été un peu moins libérée, j’aurais pu penser à elle plus sérieusement ».
De machination en machination, de suspicion en suspicion - depuis l’homosexualité supposée du père jusqu’à croire être devenu lui-même objet de manipulation par le trio formé de son père, de Leïla et de Z - le narrateur finit par admettre : « rien ne se passait comme je l’avais cru ». Humilié, il croit même être victime d’une injustice : « pourquoi tout ce que je fais finit-il par se retourner contre moi ? ».
Traduit de l’arabe (Liban) pas Yves Gonzalez-Quijano, Actes Sud, 2006, 175 pages, 18 €
-
Hanan El-Cheikh
Hanan El-Cheikh
Londres, mon amour
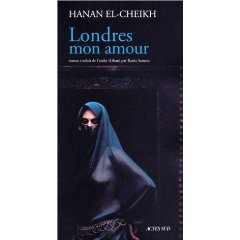 Avec sa nouvelle « Je balaie les terrasses du soleil » parue en 2000 dans le recueil intitulé « Le Cimetière des rêves », la romancière libanaise installée à Londres, abordait pour la première fois l’univers de l’immigration. Elle y revient avec ce roman drôle et tendre, parfois un peu long, qui met en scène quatre personnages exilés dans la capitale anglaise évoluant dans le microcosme de la diaspora arabe, davantage levantine que maghrébine, plus magnats du pétrole et de la finance ou familles princières adeptes des palaces que pauvres bougres et autres drilles réduits aux bouis-bouis communautaires.
Avec sa nouvelle « Je balaie les terrasses du soleil » parue en 2000 dans le recueil intitulé « Le Cimetière des rêves », la romancière libanaise installée à Londres, abordait pour la première fois l’univers de l’immigration. Elle y revient avec ce roman drôle et tendre, parfois un peu long, qui met en scène quatre personnages exilés dans la capitale anglaise évoluant dans le microcosme de la diaspora arabe, davantage levantine que maghrébine, plus magnats du pétrole et de la finance ou familles princières adeptes des palaces que pauvres bougres et autres drilles réduits aux bouis-bouis communautaires.Amira, la Marocaine, est la plus volubile. Prostituée de luxe au grand cœur, en stratège et comédienne elle s’applique à berner « son » monde aristocratique - bien plus lucratif - en se faisant passer pour une princesse. Son amie Nahed vient d’Egypte. Elle a laissé tomber la danse pour, elle aussi, faire commerce de ses charmes. Mais, ravagée par l’alcool, la dépression et la maladie, son crédit s’amenuise chaque jour un peu plus. Samir, tout juste débarqué du Liban, s’adonne, en toute liberté, à assouvir une insatiable et dévorante passion homosexuelle au point que notre joli et fantasque mignon en oublie, qu’à Beyrouth, il est marié et plusieurs fois père. Lamis est Irakienne et, ne supportant plus sa condition d’épouse arabe, a bravé interdits et pressions familiales pour divorcer. Femme seule dans Londres, Lamis, dont les relations avec les Anglais pur sucre se limitaient à quelques médecins, rencontre Nicholas, un spécialiste en arts islamiques. Ce petit monde évolue avec ses soucis et ses petits bonheurs. L’exil n’est pas rose et la jovialité d’Amira ou l’insouciance de Samir ne peuvent faire oublier la solitude et les incertitudes du lendemain. Sans complaisance, Hanan El-Cheikh brosse un tableau mi-figue, mi-raisin de cette immigration particulière. Après s’être affranchie des contraintes imposée par sa société d’origine, Lamis s’efforce à s’intégrer totalement à l’Angleterre et à sa capitale quitte à renier une partie d’elle-même. Londres devient alors l’autre personnage du récit. L’acculturation s’accompagne bien évidemment d’interrogations et de doutes identitaires, de même que la relation amoureuse entre Lamis et Nicholas doit payer le prix de l’incompréhension culturelle et surmonter quelques interdits et non-dits.
Reste que, comme le dit Amira : « je suis un être humain avant d’être une femme arabe »... Que les esprits chagrins se rassurent, l’optimisme du roman n’évacue pas pour autant les obstacles que les hommes savent dresser entre eux.
Traduit de l’arabe (Liban) par Rania Samara, éd. Actes Sud, 2002, 325 pages, 21,90 euros
-
La Porte du soleil
Elias Khoury
La Porte du soleil
 Il faut lire La Porte du soleil du Libanais Elias Khoury. Ce texte sombre et incandescent, présenté comme le récit de l’odyssée tragique des Palestiniens, restitue à ce peuple son nom : « Mon Dieu, il nous faut du temps pour porter notre nom, pour que notre nom devienne vraiment notre nom. Zeineb est devenue Zeineb parce qu’elle a raconté son histoire ». Or que sait-on du drame palestinien ? L’indifférence internationale (depuis 1948 !) suppose des consciences bien peu tourmentées ou incapables de se défaire d’une seule version de l’histoire. « Tant que le lion n’aura pas d’historiens, l’histoire favorisera celle du chasseur » dit un dicton africain.
Il faut lire La Porte du soleil du Libanais Elias Khoury. Ce texte sombre et incandescent, présenté comme le récit de l’odyssée tragique des Palestiniens, restitue à ce peuple son nom : « Mon Dieu, il nous faut du temps pour porter notre nom, pour que notre nom devienne vraiment notre nom. Zeineb est devenue Zeineb parce qu’elle a raconté son histoire ». Or que sait-on du drame palestinien ? L’indifférence internationale (depuis 1948 !) suppose des consciences bien peu tourmentées ou incapables de se défaire d’une seule version de l’histoire. « Tant que le lion n’aura pas d’historiens, l’histoire favorisera celle du chasseur » dit un dicton africain.E.Khoury s’est attelé à une tâche folle : raconter l’épopée du peuple palestinien, village par village, famille par famille depuis le désastre de 1948 (la Naqba) jusqu’à nos jours. Pour qui avait lu les trois précédents romans traduits en français du même auteur, il ne sera pas surprenant de retrouver les qualités du romancier qui pousse son art vers des sommets. Mieux, il semble rompre avec tous les genres connus : la parole, rapportée ici sans guillemets, se fait écriture ; ce roman, construit autour de témoignages n’est pas un roman historique, mais il ouvre pourtant sur l’histoire ; ce récit, d’un drame collectif voit, à chaque page s’extraire de la boue de l’Histoire des hommes et des femmes jusque-là sans nom et sans voix, enfin, le souffle de la geste palestinienne est là, presque palpable mais nulle trace d’un quelconque héroïsme ou de grandiloquence.
La structure circulaire adoptée par Elias Khoury ne perturbe jamais le lecteur. Le tour de force est d’autant plus appréciable que La Porte du soleil court sur plusieurs décennies, brasse près de trois cent personnages et moult faits historiques. Cette histoire collective du peuple palestinien n’est pas écrite au détriment de l’individu. La dimension humaine de ce drame est ici magnifiquement rendue. Sans jamais céder aux sirènes de la compassion ou de l’idéologie, la litanie des expulsions, des persécutions, des exécutions sommaires, des tortures, des emprisonnement abusifs, du malheur et de la misère endurée... rompt avec le terrible anonymat des chiffres : « la terreur c’est le chiffre, et c’est pourquoi les gens portent sur eux les photos de leurs morts (...), ils en ont fait les substituts des noms ». Oui! ce livre est admirable, c’est-à-dire étonnant, par sa puissance et sa profondeur, mais aussi beau car sa matière a été malaxée dans une glaise faite d’amour et d’humanité.
Sa trame, dense, est tissée autour de deux histoires d’amour. Celle qui a uni une vie durant malgré les séparations imposées par l’exil, Younès à Nahîla et l’autre, shakespearienne, rassemble Khalil et Shams (Soleil en arabe). L’amour est donc au centre de ce récit. L’amour et la femme palestinienne.
Younès, le vieux fedayin et ex-responsable du Fatah gît sur un lit d’hôpital - le fantomatique et irréel hôpital Galilée du camps martyr de Chatila. Plongé dans un coma profond, il est condamné. Seul, Khalil croit en sa résurrection. Pour le ramener à la vie, il va des mois durant, le veiller. Comme la Shéhérazade des Mille et une nuits, il parle et raconte des histoires à ce corps végétatif. Comme elle, Khalil parle « pour acheter la vie », celle de Youcef qui est aussi la sienne et celle de tout un peuple, et ainsi sauver l’humanité tout entière car « le corps d’un seul être humain constitue l’incarnation de toute l’histoire de l’humanité ».
Le livre est un long monologue où une histoire en appelle une autre et ce jusqu’à l’infini. Où chaque récit est irréductible à une seule version. « L’histoire possède en fait des dizaines de versions différentes et, lorsqu’elle se fige en une seule version, cela ne mène qu’à la mort ».
Il faut sans doute ne pas connaître le poids de la culpabilité européenne héritée de la Shoah et ne pas subir la pression médiatico-morale quand à cette terrible page de l’histoire contemporaine pour oser, comme le fait ici Elias Khoury, comparer la tragédie palestinienne à celle dont ont été victimes les Juifs d’Europe, oser dénier aux Israéliens le statut de victime : les colons-soldats « ne ressemblent pas à ceux qui sont morts » écrit-il « tandis que ceux qui sont morts alors ressemblaient à Nahîla et Oum Hassan ».
Comme il ne faut pas que les Palestiniens deviennent eux-mêmes « une seule histoire », E. Khoury raconte aussi les dérives du mouvement de libération et le sort que les « frères » arabes ont réservé à ces réfugiés bien encombrants, la vie dans les camps, le massacre de Chatila, ce que l’on a appelé « la guerre des camps », le racisme de la société libanaise à l’égard des Palestiniens privés de tous droits et parqués dans des ghettos où, comme les Juifs de Venise entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ils sont enfermés, tenus à l’écart !
Les pages les plus poignantes portent sur l’illusion dont se bercent les Palestiniens eux-mêmes : ces histoires toujours ressassées et qui regorgent de faits héroïques, ces hommes et ces femmes qui collectionnent les clefs de leurs maisons alors que les portes ont été détruites, les cassettes vidéo, ces « rêves éveillées » d’une Galilée illusoire. Les « murs de l’histoire », « l’illusion de la mémoire » sont devenus la prison des Palestiniens. La Porte du soleil est peut-être le premier livre qui traduit avec autant de force et d’acuité la difficulté et peut être la nécessité pour ce peuple de prendre conscience de son exil.
Actes-Sud/Sindbad, Le Monde Diplomatique, 2002, 630 pages, 24,90 euros
-
Qu'elle aille au diable, Meryl Streep !
Rachid El-Daïf
Qu'elle aille au diable, Meryl Streep !
 Pourquoi Rachid, le narrateur, voue-t-il la pauvre et innocente Meryl Streep au démon ? Pourtant l'homme ne cache ni son admiration ni son amour pour la belle actrice américaine. Il croit même être le seul homme digne de l'aimer, le seul capable de rendre heureuse cette femme qui, dans le film Kramer contre Kramer, quitte son Dustin Hoffmann de mari que Rachid accable de toutes les fautes et éreinte de son mépris. Car Rachid s'autoproclame, lui, "intelligent" et "perspicace". Il se croit un amant idéal doublé d'un mari affectueux et prévenant. Le moment venu, il n'en doute pas un instant, il sera un père attentif. Mieux, il prétend être un homme ouvert, compréhensif, un homme aux idées larges et modernes, disposé à permettre à la femme arabe de s'émanciper des gaines de la tradition et de la religion : "j'aime bien aider la femme à sortir de la coquille dans laquelle les coutumes l'ont enfermée. Mais, en même temps, j'aime que la femme conserve un minimum de retenue". ..
Pourquoi Rachid, le narrateur, voue-t-il la pauvre et innocente Meryl Streep au démon ? Pourtant l'homme ne cache ni son admiration ni son amour pour la belle actrice américaine. Il croit même être le seul homme digne de l'aimer, le seul capable de rendre heureuse cette femme qui, dans le film Kramer contre Kramer, quitte son Dustin Hoffmann de mari que Rachid accable de toutes les fautes et éreinte de son mépris. Car Rachid s'autoproclame, lui, "intelligent" et "perspicace". Il se croit un amant idéal doublé d'un mari affectueux et prévenant. Le moment venu, il n'en doute pas un instant, il sera un père attentif. Mieux, il prétend être un homme ouvert, compréhensif, un homme aux idées larges et modernes, disposé à permettre à la femme arabe de s'émanciper des gaines de la tradition et de la religion : "j'aime bien aider la femme à sortir de la coquille dans laquelle les coutumes l'ont enfermée. Mais, en même temps, j'aime que la femme conserve un minimum de retenue". ..Pourtant voilà, sa propre épouse vient de le quitter et s'apprête même à entamer une procédure de divorce. Abasourdi, seul dans son appartement en compagnie de l'autre personnage du roman, la télévision auréolée de sa parabole, qu'il vient d'installer pour sa femme aujourd'hui envolée, Rachid tente de comprendre ce qui lui arrive et le lecteur avec. Bien sûr, les avis de l'un et de l'autre diffèreront.
Rachid El-Daïf parvient, à travers une construction légère et subtile, à brosser par touches successives, les portraits et les personnalités des deux protagonistes, donne à mesurer les résonances sociales et culturelles des rivalités qui divisent le jeune couple, pose, in fine, un des principaux enjeux du devenir des sociétés arabes : celui de la libération de la femme, traitée ici via le mariage et symptomatiquement la sexualité.
Par son écriture, l'auteur réussit à créer une atmosphère de suspicion autour de l'épouse, de doute sur son passé et ses agissements présents. Que cache donc cette femme et jusqu'où ira la crédulité de l'époux ? Au fil du récit, le lecteur découvre sous le vernis social et libéral de Rachid une autre figure, plus complexe, contradictoire, un brin schizophrénique même. Malgré ses beaux discours, l'homme est enfermé dans des représentations mentales et des comportements surannés. Il se révèle, sur le plan affectif et sexuel, immature et soumis. Visiblement, l'épouse n'aime pas son mari. Elle le domine avec une bonne dose de mépris. Ses velléités d'indépendance et d'émancipation semblent se limiter à des relations adultérines et à une toujours ingénieuse résistance aux assauts de son conjoint. Cette femme, mystérieuse et rebelle, peut-elle représenter une image positive de l'épanouissement et de la libération féminine ? Non mais qu'importe ! Là n'est pas l'objet du roman. Rachid El-Daïf, sans pathos mais avec efficacité, montre comment cette société transforme la femme en victime (l'affaire du cousin) et en objet (la sexualité bien sûr mais aussi la visite chez la gynéco ou l'épisode de la couturière). Mais surtout, avec pertinence et acuité, en connaisseur de "la logique des hommes", l'auteur vise où il est certain de faire mouche, là où les hommes, dans toute leur splendeur, bonimenteurs à qui mieux mieux sur leur libéralisme et leur bienveillante disponibilité à l'égard des modestes velléités d'autonomie de la gent féminine, auront le plus mal et devront illico lever le masque : le sexe !
Rachid tombe par hasard sur Kramer contre Kramer. Il regarde le film sur son écran, mais, diffusé en anglais, il n'y comprend rien. Les images défilent devant lui sans révéler leur sens véritable. Il s'adonne alors à mille et une supputations et autant d'interrogations sur les formes prises par la séparation. Lui qui encense la beauté de Meryl Streep et son sentiment maternel lui refuse le droit d'abandonner son mari et peut-être son enfant. Il s'agirait d'une "faute" aux yeux de Rachid. "Non, Meryl Streep ! Garde-toi bien d'être un soutien pour ma femme !" clame-t-il vouant aux gémonies non seulement l'actrice américaine mais aussi les femmes occidentales en général qui "n'ont rien à voir avec nous", les modèles importés des États-Unis et celles qui au Liban transgressent les codes et de citer la chanteuse Sabah, la comédienne Nidal al-Achkar ou la romancière Hanan El-Cheikh. Finalement, semble dire Rachid El-Daïf, si au lieu de toujours mettre au centre des débats "la question du statut de la femme" on interrogeait plutôt le statut de l'homme et les représentations sociales de la masculinité. Ce qui pose problème n'est pas tant le souci d'émancipation des femmes que le carcan d'une virilité masculine sacralisée. De même, Qu'elle aille au diable, Meryl Streep ! n'invite pas à opposer sociétés occidentales et arabes mais plutôt à analyser la façon dont les sociétés arabes reçoivent et perçoivent les milliers d'images qui quotidiennement sont déversées sur les écrans des télévisions.
Traduit de l'arabe (Liban) par Edgar Weber, éd. Actes-Sud, 2004, 173 pages, 18 euros.