Jean El Mouhoub Amrouche
Un Algérien s’adresse aux Français ou l’histoire d’Algérie par les textes (1943-1961)
 En 1991 Tassadit Yacine rassemblait vingt ans de discours et d’articles politiques de Jean El Mouhoub Amrouche. Sans doute y a t-il beaucoup de redites, de thèmes et de thèses récurrentes dans les quelques soixante textes ici proposés. Mais quel brio ! Quelle force ! Quelle profondeur ! Et quel style ! Ces écrit sentent (toujours) le souffre. Jean Amrouche ne demande pas le respect. Il l’impose. Pour lui et pour les siens : « ces jeunes, pour qui l’espérance humaine a cessé pour longtemps peut-être d’être une espérance française ».
En 1991 Tassadit Yacine rassemblait vingt ans de discours et d’articles politiques de Jean El Mouhoub Amrouche. Sans doute y a t-il beaucoup de redites, de thèmes et de thèses récurrentes dans les quelques soixante textes ici proposés. Mais quel brio ! Quelle force ! Quelle profondeur ! Et quel style ! Ces écrit sentent (toujours) le souffre. Jean Amrouche ne demande pas le respect. Il l’impose. Pour lui et pour les siens : « ces jeunes, pour qui l’espérance humaine a cessé pour longtemps peut-être d’être une espérance française ».
Dès 1943, il dresse le procès de la colonisation française au nom même des valeurs et de l’esprit de cette France universelle, « mythologique », tant chérie et qui n’a pas su être fidèle à elle-même aux yeux de ces Algériens partis en rébellion pour recouvrer leur dignité.
Et c’est bien au nom de cette dignité que cet « intellectuel d’une espèce particulière » - la France étant l’esprit de son âme et l’Algérie l’âme de son esprit – ne tergiverse pas et se place clairement et très tôt du côté de l’indépendance. Il va à l’essentiel et l’essentiel est l’indépendance. Une exigence qui balaie toutes les ratiocinations humanistes d’une certaine gauche française qu’il brocarde résolument. L’Histoire paraît lui avoir donné raison jusqu’à y compris cette terrible et prémonitoire sentence adressée à Germaine Tillion : « la Révolution algérienne ne promet au peuple que le seul bonheur d’être libre, non la prospérité et le bien être pour demain. »
_______________________________________
Publié en 1945 dans les pages du Figaro, « La France d’Europe et la France d’Afrique » fut écrit au lendemain des massacres de Sétif et de Guelma. Sa puissance est telle que bien des lignes éclairent des controverses et des interrogations de ce début de siècle. Qu’il s’agisse des réactions à propos d’Hors-la-loi, le dernier film de Rachid Bouchareb que personne n’a encore vu et dont la sortie est prévue pour la rentrée, du triste et pauvre débat sur l’identité nationale, de la relégation indigne de certaines populations et d’une partie de la jeunesse française par cette « France d’Europe » pourtant louée ici par Jean Amrouche ou encore de la portée et des limites des études postcoloniales (voir les récents Yves Lacoste, La Question postcoloniale. Une analyse géopolitique chez Fayard et Jean-François Bayart, Les Etudes postcoloniales. Un carnaval académique chez Karthala), ce texte vieux de soixante cinq ans comme tant d’autres au sein de ce recueil mérite d’être lu et relu.
Extraits:
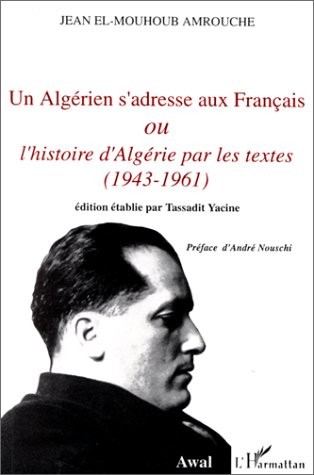 "Ce n’est pas le moment d’ouvrir le procès de la colonisation française. Le prestige, apparent, apparent, de la France a subi de trop graves atteintes. Les propagandes intéressées sont habiles à exploiter tout prétexte, tout aveu propre à les servir. Toute vérité est donc dangereuse qui astucieusement mutilée, se compose avec une vérité contraire, quand ce n’est pas avec le mensonge. S’en suit-il que nous dussions nous taire ? Comme si l’ombre guérissait les plaies et non le grand soleil !
"Ce n’est pas le moment d’ouvrir le procès de la colonisation française. Le prestige, apparent, apparent, de la France a subi de trop graves atteintes. Les propagandes intéressées sont habiles à exploiter tout prétexte, tout aveu propre à les servir. Toute vérité est donc dangereuse qui astucieusement mutilée, se compose avec une vérité contraire, quand ce n’est pas avec le mensonge. S’en suit-il que nous dussions nous taire ? Comme si l’ombre guérissait les plaies et non le grand soleil !
C’est à l’issue d’un cruel débat de conscience que je me décide à prendre la plume. Et si je me présente en accusateur aux lecteurs du Figaro, je tiens d’abord à les assurer que mon propos n’est point d’attiser la haine, mais de servir la France. Je dois à la France, ma patrie, plus que la vie : la conscience de la vie, la révélation de ce qui fait son prix et de l’humble gloire de l’homme ; - mais je dois mon sang à la Kabylie et à un héritage spirituel admirable. Si la France est l’esprit de mon âme, la Kabylie est l’âme de cet esprit. Et voici qu’il faudrait croire – ô honte plus cruelle encore que la douleur ! – qu’en Algérie et précisément en cette Numidie où je suis né, dans un village dont je ne sais pas s’il existe encore, que l’une et l’autre se sont déshonorées. Si les crimes des tueurs indigènes soulèvent en moi une indignation et un dégoût plus forts que la souffrance, la répression qui aussitôt fut abattue sur mon pays a ouvert une blessure plus profonde, car le crime des enfants aveugles ne justifie pas le crime de leur mère.
Mais l’heure presse. Le temps des larmes est passé. Songeons à sauver les vivants. Il faut oser découvrir l’étendue du mal et en sonder la profondeur. Il ne s’agit pas de compatir, mais de comprendre pour agir. Ce n’est pas à partir de l’émeute qu’il faut poser le problème, mais à partir de la répression. (…)Mais soyons sûrs qu’en Algérie le prestige de la France n’est plus seul en cause, mais son existence même en tant que grande nation. (…) Qu’on le veuille ou non, ni les avions ni les blindés ni les canons de la flotte ne prévaudraient contre la haine, fille du désespoir. (…) Qu’attendaient de la France les Algériens, qu’en espèrent-ils encore aujourd’hui, si l’irréparable n’est pas consommé ?
Non pas les biens de la terre, que tout autre nation aurait pu leur procurer, mais un bien sans prix, dont la France seule dans sa folle générosité est capable de se dépouiller : un esprit, une âme. C’est à ce signe qu’on reconnaît la France, c’est du haut d’une tour immatérielle que sa puissance rayonne sur le monde.
(…) S’il est vrai que la France ignore les frontières des races, des couleurs, et des religions, il n’en va pas de même pour les Français d’Algérie, chez qui le racisme constitue, bien plus qu’une doctrine : un instinct, une conviction enracinée. De sorte que toute l’Algérie souffre d’un malaise profond dans la cause réside dans une contradiction entre l’enseignement et les mœurs. Ceux parmi les Algériens qu’on appelle anti-français ne sont pas dressés contre la France, mais contre la France d’Algérie. Il est aisé de rendre hommage à l’œuvre française en Afrique du Nord. Mais il y a lieu de mesurer son succès d’après ce qui semble la mettre en péril. Car c’est au nom de la justice et de la liberté, que les élites indigènes réclament la réforme des méthodes et des institutions.
(…) Il faut savoir ce que signifie la France pour l’indigène, car le même mot couvre trois réalités différentes.
La première est une figure mythologique composée d’un ensemble d’images d’Epinal, de symboles, de principes, de pensées et d’actions. Elle représente la vocation qui porte le peuple français à conquérir toujours plus sur la nature et sur l’homme, pour le bénéfice de l’homme. Cette mythologie française, dont le prestige est universel, se résume tout entière dans la devise constamment affirmée et si souvent trahie : Liberté, Egalité, Fraternité. L’enfant africain comme son frère de France, l’apprend à l’école dès qu’il commence à déchiffrer son syllabaire. Il y était d’ailleurs préparé par l’humanisme de l’Islam. Dorénavant, ce code sera la règle suivant laquelle il jugera les actes de ses maîtres.
(…) La France est aussi pour le Nord-Africain une patrie géographique. L’étudiant, le soldat, la travailleur nord-africains n’oublieront jamais que la France d’Europe remplit assez bien les promesses de la France mythologique. Elle est la terre bénie du destin. Elle est la terre de l’accueil et du sourire, celle de la liberté, où le tabou racial est inconnu, où l’homme d’où qu’il vienne peut courir toutes ses chances, où le plus déshérité peut espérer être heureux. Elle est la terre de l’égalité où disparaît toute frontière entre les compagnons d’une même peine. Elle est enfin l’asile de la vérité, car elle est le lieu du moindre écart entre les paroles et les actes, entre les lois et les mœurs.
Mais dans son pays d’origine, retrouve la troisième France, les tabous et les cloisons étanches, les rebuffades et le mépris, l’omnipotence policière et administrative. Pour les plus sensibles, l’atmosphère devient irrespirable. Et j’en connais beaucoup qui ont préféré l’exil dans l’espace à cet exil singulier où ils se voient jetés dans leur pays natal.
Un étrange sentiment de malédiction assombrit leur humeur, car tout espoir de connaître un jour l’harmonie intérieure leur est retiré. (…) Je crains que beaucoup ne succombent à la tentation mortelle de désespérer de la France. Car la France mythologique et la France d’Europe, l’esprit et le corps, ont trop souvent en Afrique des délégués qui consciemment ou non les trahissent.
Je sais qu’il est difficile d’être un homme, et plus difficile encore de rester Français en Afrique du Nord. Il y faut un concours de vertus assez rares. (…) Aux colonies, tout Français est astreint au service public. Il ne soutient pas seulement les intérêts d’une nation ou d’une classe mais les intérêts de l’esprit humain, et l’indigène ou l’étranger excusera chez l’un des siens les erreurs ou les fautes qu’ils ne pardonneront pas à un Français, parce qu’il se fait de la France une idée non point trop haute, mais tout juste assez haute pour que les meilleurs des Français tremblent devant leurs responsabilités morales.
On voit la contrainte que doit imposer la conscience d’une destinée si particulière. L’esprit est prompt, la chair est faible. L’on comprend que la chair et l’esprit faiblissent devant des exigences qui remplissent exactement la mesure de l’homme dont la France est responsable devant les nations. On ne demande pas au Français d’être grand, mais d’être juste ; on ne lui demande pas d’avoir du génie, on lui demande seulement de ne pas démentir ses discours par ses actes ; on ne lui demande plus d’être charitable, mais d’accomplir honnêtement les promesses de la France.
S’il ne respecte pas ce contrat sur lequel est fondé l’autorité de la France, sa défaillance ne porte pas préjudice à lui seul, mais elle atteint à travers lui la France universelle.
Certains me diront que les Français ne sont pas responsables de l’idée trop noble que se font les peuples qui vivent dans sa lumière. Je répondrai que nul Français n’est libre de travestir ou de corrompre ce par quoi il participe de la grandeur française. Car aujourd’hui plus que jamais : noblesse oblige.
Je ne peux pleurer qu’en kabyle
Je suis Algérien, c’est un fait de nature. Je me suis toujours senti Algérien. Cela ne veut pas seulement dire que je suis né en Algérie, sur le versant de la vallée de la Soummam, en Kabylie, et qu’un certain paysage est plus émouvant, plus parlant, pour moi, que tout autre, fût-il le plus beau du monde. Qu’en ce lieu j’ai reçu les empreintes primordiales et entendu pour la première fois une mélodie du langage humain qui constitue dans les profondeurs de la mémoire l’archétype de toute musique, de ce que l’Espagne nomme admirablement le chant profond. C’est cela et bien plus : l’appartenance « ontologique » à un peuple, une communion, une solidarité étroite de destin, et par conséquent une participation totale à ses épreuves, à sa misère, à son humiliation, à sa gloire secrète d’abord, manifeste ensuite, à ses espoirs, à sa volonté de survivre comme peuple et de renaître comme nation.
J’étais, je suis de ce peuple, comme il est mien. A l’intérieur de ce sentiment, il y avait un pressentiment, une intuition si profondément vécue dans le for intérieur que je désespère de le traduire en clair : que tout ce que je pourrais dire durant ma vie, paroles de bouche ou paroles écrites, ne serait jamais que l’expression d’un discours antérieur à moi, préformé dans un passé lointain, mais vivant en moi, nourri par une tradition, une sagesse, une conception de la vie et de l’homme qui sont le trésor inaliénable et sacré de mon peuple. Il s’est trouvé que par grâce j’ai reçu ma part de ce trésor et que, en dépit de la distance, du temps, du déracinement, la communication entre moi et la source originelle ne fut pas rompue.
Au contraire, à travers mes lectures, mes voyages qui furent chacun autant de lectures, mes amours et mes rencontres – dont certaines sont illustres et m’ont profondément marqué – mon chemin m’a toujours ramené vers cette source cachée qui est pour moi quelque chose qui ressemble aux mères dont parle Goethe.
Mais, revenant vers ma source, je l’entends chanter dans une harmonie plus complexe et plus vaste, faisant dialoguer en moi la voix des ancêtres avec d’autres voix de l’homme, plus belles peut-être, plus riches, mieux travaillées, mais qui en provoquant en moi les mêmes somptueuses fêtes de l’esprit n’atteignaient pas cette fine pointe, cette jointure où le domaine d’Animus cède la place en nous au domaine d’Anima, pour rappeler la célèbre parole de Claudel. Un ami, qui est dans cette salle, m’avait dit récemment une parole bouleversante, que je tiens pour un don sans prix, car elle éclaire ce que je ne sais pas bien dire : « je ne peux pleurer qu’en kabyle ». Cela veut dire qu’il y a pour chacun de nous un langage des langages, qui seul fait pleurer notre âme, qui est seul, pour nous, ce langage de l’âme pour l’âme dont parlait Rimbaud (…) ».
Edition établie par Tassadit Yacine. Préface d’André Nouschi. 1991, Edition Awal-L’Harmattan
 En 1985 Jules Roy faisait paraître la correspondance qu’il a entretenue de 1937 à 1962 avec Jean Amrouche. Vingt-cinq années d’échange – de communion – épistolaire qui révèle l’histoire passionnée et émouvante, parfois tumultueuse et conflictuelle, d’une profonde amitié entamée en 1937 sous l’égide d’Armand Guibert. Parmi les lettres présentées, celles écrites par Jean Amrouche sont plus abondantes. Elles confirment ce que l’on savait déjà du grand poète kabyle : grandeur, haute valeur morale, une exigence qui confine à la dureté, quête de l’absolu, orgueil… mais elles livrent aussi, au détour d’une phrase, d’une réflexion, d’un jugement, au détour tout simplement des tracasseries du quotidien, l’homme avec ses faiblesses, son égoïsme, ses colères et parfois son injustice. Ce n’est pas le moindre des mérites de cette correspondance que de restituer un Jean Amrouche humanisé, multipliant ainsi au centuple la portée de son message.
En 1985 Jules Roy faisait paraître la correspondance qu’il a entretenue de 1937 à 1962 avec Jean Amrouche. Vingt-cinq années d’échange – de communion – épistolaire qui révèle l’histoire passionnée et émouvante, parfois tumultueuse et conflictuelle, d’une profonde amitié entamée en 1937 sous l’égide d’Armand Guibert. Parmi les lettres présentées, celles écrites par Jean Amrouche sont plus abondantes. Elles confirment ce que l’on savait déjà du grand poète kabyle : grandeur, haute valeur morale, une exigence qui confine à la dureté, quête de l’absolu, orgueil… mais elles livrent aussi, au détour d’une phrase, d’une réflexion, d’un jugement, au détour tout simplement des tracasseries du quotidien, l’homme avec ses faiblesses, son égoïsme, ses colères et parfois son injustice. Ce n’est pas le moindre des mérites de cette correspondance que de restituer un Jean Amrouche humanisé, multipliant ainsi au centuple la portée de son message. Les Jardins de lumières d'Amin Maalouf raconte l'histoire de Mani né le 14 avril 216 sur les bords du Tigre, non loin de l'actuelle Bagdad. Son enseignement sera non seulement trahi mais défiguré et oublié au point que du manichéisme, les siècles ne retiendront qu'une version erronée de l'opposition entre le Bien et le Mal.
Les Jardins de lumières d'Amin Maalouf raconte l'histoire de Mani né le 14 avril 216 sur les bords du Tigre, non loin de l'actuelle Bagdad. Son enseignement sera non seulement trahi mais défiguré et oublié au point que du manichéisme, les siècles ne retiendront qu'une version erronée de l'opposition entre le Bien et le Mal. La femme (l'homme) ne serait-elle pas le sujet essentiel de nos réflexions les plus intimes, de nos pensées inavouées, de nos rêves les plus fous comme de nos désirs les plus ardents, de nos plus intenses bonheurs et de nos plus cruelles désillusions ?
La femme (l'homme) ne serait-elle pas le sujet essentiel de nos réflexions les plus intimes, de nos pensées inavouées, de nos rêves les plus fous comme de nos désirs les plus ardents, de nos plus intenses bonheurs et de nos plus cruelles désillusions ?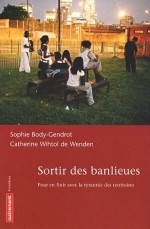 De quelle « tyrannie » parlent S. Body-Gendrot, professeur et directrice d'études urbaines à l'université Sorbonne-Paris IV et C.Wihtol de Wenden directrice de recherche au CNRS, par ailleurs membre du comité de rédaction d'Hommes et Migrations ? Et comment « sortir » de ces banlieues qui occupent les unes de la presse nationale, alimentent parfois les promesses sécuritaires d'estrades électorales et mobilisent les pouvoirs publics depuis près d'une trentaine d'années ? La « tyrannies des territoires » tient dans la contradiction observée par ces deux spécialistes entre les aspirations à la mobilité géographique des individus d'une part et des politiques publiques qui visent à maintenir ces mêmes populations dans ces banlieues d'autre part. Alors que de nombreux pays mettent en place des politiques en direction d'abord des populations, la France privilégierait ses « territoires » : cette politique de « bonnes intentions », « élaborée au sommet de l'Etat à partir d'utopie de mixité sociale est inadaptée à la réalité (beaucoup de familles déménagent dès qu'elles le peuvent). C'est ce que nous appelons la « tyrannie des territoires ».
De quelle « tyrannie » parlent S. Body-Gendrot, professeur et directrice d'études urbaines à l'université Sorbonne-Paris IV et C.Wihtol de Wenden directrice de recherche au CNRS, par ailleurs membre du comité de rédaction d'Hommes et Migrations ? Et comment « sortir » de ces banlieues qui occupent les unes de la presse nationale, alimentent parfois les promesses sécuritaires d'estrades électorales et mobilisent les pouvoirs publics depuis près d'une trentaine d'années ? La « tyrannies des territoires » tient dans la contradiction observée par ces deux spécialistes entre les aspirations à la mobilité géographique des individus d'une part et des politiques publiques qui visent à maintenir ces mêmes populations dans ces banlieues d'autre part. Alors que de nombreux pays mettent en place des politiques en direction d'abord des populations, la France privilégierait ses « territoires » : cette politique de « bonnes intentions », « élaborée au sommet de l'Etat à partir d'utopie de mixité sociale est inadaptée à la réalité (beaucoup de familles déménagent dès qu'elles le peuvent). C'est ce que nous appelons la « tyrannie des territoires ».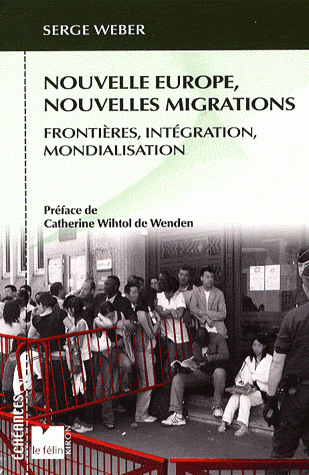 Dans ce petit livre, Serge Weber, maître de conférences en géographie à l'université de Paris-Est présente les nouvelles tendances des migrations internationales et les politiques d'immigration menées par les États européens. Il souligne surtout les contradictions de ces politiques au regard des besoins et tord le coup à quelques idées reçues qui obscurcissent l'entendement et empuantissent certains programmes électoraux.
Dans ce petit livre, Serge Weber, maître de conférences en géographie à l'université de Paris-Est présente les nouvelles tendances des migrations internationales et les politiques d'immigration menées par les États européens. Il souligne surtout les contradictions de ces politiques au regard des besoins et tord le coup à quelques idées reçues qui obscurcissent l'entendement et empuantissent certains programmes électoraux. C'est un premier roman autobiographique que donne ici Knud Romer. Danois d'origine allemande par la branche maternelle, il raconte, en bousculant la chronologie et en entremêlant l'histoire des deux branches de la famille, près de soixante ans de saga familiale (des années dix aux années soixante-dix), soixante ans d'histoire danoise et allemande, d'histoire européenne. L'irlandais Hugo Hamilton, lui aussi d'origine allemande avait en son temps raconté les déboires familiaux et l'hostilité de ces concitoyens celtes à l'égard de sa mère également teutonne. De ce point de vue, Cochons d'allemand est le versant danois de
C'est un premier roman autobiographique que donne ici Knud Romer. Danois d'origine allemande par la branche maternelle, il raconte, en bousculant la chronologie et en entremêlant l'histoire des deux branches de la famille, près de soixante ans de saga familiale (des années dix aux années soixante-dix), soixante ans d'histoire danoise et allemande, d'histoire européenne. L'irlandais Hugo Hamilton, lui aussi d'origine allemande avait en son temps raconté les déboires familiaux et l'hostilité de ces concitoyens celtes à l'égard de sa mère également teutonne. De ce point de vue, Cochons d'allemand est le versant danois de  Ce "voyage" à Dreux par l'auteur de Faire France est une enquête de terrain réalisée en 1997, un important appareil statistique doublé de plus de 200 entretiens. À ces données locales s'ajoutent de nombreuses références à d'autres travaux. Mais l'enquête, qui prend parfois une tournure journalistique, n'est pas une froide recension. Les convictions, le sens de l'engagement et les perspectives avancées par l'auteur enrichissent ce travail. Ainsi, ses critiques de la gestion municipale, de l'image et de l'action de la police, des discriminations sociales et professionnelles ou ses mises en garde, fermes et claires, contre certaines attitudes des jeunes des cités ou organisations musulmanes lui donnent plus de poids. Selon Michèle Tribalat, Dreux, déjà symbolique pour avoir la première ouvert ses portes au FN, "va plus mal que la France en général, son contexte démographique est plus exigeant, la situation sociale plus explosive et la dégradation plus marquée". Avec 36 800 habitants et un taux de chômage estimé à 24,8 % en 1997, Dreux est une ville ouvrière et jeune, marquée par une inquiétante tendance à la paupérisation. Son tissu industriel est non seulement fragile mais aussi dépendant, pour plus de deux tiers de ses emplois, de décisions extérieures. Avec 48,6 %, Dreux enregistre "la plus forte concentration de populations d'origine étrangère". Un tiers de cette population est originaire du Maghreb (19,9 % du Maroc, 8,9 % d'Algérie et 2,2 % de Tunisie), le reste se répartissant entre populations d'origine turque (5,4 %) portugaise (5 %), noire africaine (3,4 %) ou pakistanaise (1,3 %). Dixième circonscription par ordre d'importance du taux de délinquance, estimé à 116 ‰ (contre 60 ‰ en moyenne nationale), à Dreux, "tant en termes d'évolution que de niveau réel, la délinquance s'avère légitimement préoccupante". Rappelant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre immigration et délinquance, Michèle Tribalat souligne que "seule la condition objective de 'nécessité', de 'besoin' reflétée par le taux de chômage se révèle liée au niveau global de délinquance et plus particulièrement à ses composantes prédatrices". La concentration de cette "population d'origine étrangère" est variable. De 15,7 %, dont près de 9 % de population d'origine portugaise dans le centre-ville, elle est, par exemple de 79,1 % dans le quartier des Charmards, dont plus de 45 % de population d'origine marocaine. À cette "segmentation ethnique du territoire", avec au centre les "populations d'origine française" et à la périphérie celles "d'origine étrangère", s'ajoutent les oppositions entre nantis et déshérités, entre vieux et jeunes. "Dreux n'est plus le lieu d'une structure sociale collective cohérente", note Michèle Tribalat, qui montre que cette "segmentation" est devenue constitutive de "l'identité locale, individuelle et collective", au point que l'autorité publique elle-même est perçue comme partie prenante de cette opposition. Plus grave, elle alimente une dangereuse "logique de coupables-victimes" qui, ignorance aidant, conduit à la radicalisation des uns et des autres, à l'exacerbation réciproque d'un racisme anti-arabe et d'un racisme anti-français doublé d'un repli identitaire centré sur la religion musulmane. Dans un chapitre quelque peu caricatural et par trop généraliste, Michèle Tribalat analyse l'influence et la dégradation du modèle parental maghrébin - où le père fait figure de satrape domestique ! - sur le rapport des plus jeunes à l'école et à l'autorité notamment et, de façon plus pertinente, sur l'influence des valeurs transmises au sein des familles sur la vie en société. Distinguant nettement la pratique de la religion, de la "propagande active" d'une doctrine hostile à la séparation du politique et du religieux, l'enquête montre que "l'islamisme est en gestation à Dreux". À l'opposé des conclusions optimistes d'autres travaux (Isabel Taboada-Léonetti ou F. Khosrokhavar), Michèle Tribalat est extrêmement critique quant à l'influence d'associations qui, comme les Jeunes Musulmans de France, distillent "une idéologie islamiste sous le masque de la laïcité". Pour l'auteur, "ces associations n'ont abandonné ni la dimension communautaire, ni le caractère totalisant de la doctrine islamique". L'action de ces structures - comme la sous-traitance des problèmes sociaux confiée par les pouvoirs publics à des médiateurs religieux ou associatifs mal identifiés - aggrave les oppositions et la déréliction du lien social, dont les manifestations sont ici détaillées : tendance au repli sur soi, affaiblissement des contrôles sociaux, non-intériorisation des normes collectives, multiplication des incivilités, désaffiliation institutionnelle... Le tableau présenté ici est sombre, peut-être un peu trop. L'ethnicisation des rapports sociaux, si ce n'est sur Dreux, du moins en France, peut être discutée, voire contestée. Par ailleurs, de ces quartiers émergent aussi des initiatives qui justement recréent des liens sociaux, ce que montre, avec insistance aussi, Michèle Tribalat pour Dreux. Les trop noires perspectives ici esquissées ne sont pas inéluctables, semble dire l'auteur, pour peu que l'on se donne réellement les moyens de comprendre la réalité et surtout d'élaborer des politiques globales. "Penser l'avenir de Dreux, c'est faire des projets pour les jeunes Drouais, aujourd'hui majoritairement d'origine étrangère. À Dreux, on bute encore sur ce fait, qu'on n'arrive pas à dépasser. Mais il nous semble que c'est toute la société française qui bute sur cette réalité. Les enfants des immigrés maghrébins sont partie intégrante du peuple français, et ont une légitimité égale à celle des autres Français." On ne saurait être plus clair et dégager, par l'énoncé de cette évidence, qui n'est pas encore présente dans toutes les têtes, autant de perspectives nouvelles.
Ce "voyage" à Dreux par l'auteur de Faire France est une enquête de terrain réalisée en 1997, un important appareil statistique doublé de plus de 200 entretiens. À ces données locales s'ajoutent de nombreuses références à d'autres travaux. Mais l'enquête, qui prend parfois une tournure journalistique, n'est pas une froide recension. Les convictions, le sens de l'engagement et les perspectives avancées par l'auteur enrichissent ce travail. Ainsi, ses critiques de la gestion municipale, de l'image et de l'action de la police, des discriminations sociales et professionnelles ou ses mises en garde, fermes et claires, contre certaines attitudes des jeunes des cités ou organisations musulmanes lui donnent plus de poids. Selon Michèle Tribalat, Dreux, déjà symbolique pour avoir la première ouvert ses portes au FN, "va plus mal que la France en général, son contexte démographique est plus exigeant, la situation sociale plus explosive et la dégradation plus marquée". Avec 36 800 habitants et un taux de chômage estimé à 24,8 % en 1997, Dreux est une ville ouvrière et jeune, marquée par une inquiétante tendance à la paupérisation. Son tissu industriel est non seulement fragile mais aussi dépendant, pour plus de deux tiers de ses emplois, de décisions extérieures. Avec 48,6 %, Dreux enregistre "la plus forte concentration de populations d'origine étrangère". Un tiers de cette population est originaire du Maghreb (19,9 % du Maroc, 8,9 % d'Algérie et 2,2 % de Tunisie), le reste se répartissant entre populations d'origine turque (5,4 %) portugaise (5 %), noire africaine (3,4 %) ou pakistanaise (1,3 %). Dixième circonscription par ordre d'importance du taux de délinquance, estimé à 116 ‰ (contre 60 ‰ en moyenne nationale), à Dreux, "tant en termes d'évolution que de niveau réel, la délinquance s'avère légitimement préoccupante". Rappelant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre immigration et délinquance, Michèle Tribalat souligne que "seule la condition objective de 'nécessité', de 'besoin' reflétée par le taux de chômage se révèle liée au niveau global de délinquance et plus particulièrement à ses composantes prédatrices". La concentration de cette "population d'origine étrangère" est variable. De 15,7 %, dont près de 9 % de population d'origine portugaise dans le centre-ville, elle est, par exemple de 79,1 % dans le quartier des Charmards, dont plus de 45 % de population d'origine marocaine. À cette "segmentation ethnique du territoire", avec au centre les "populations d'origine française" et à la périphérie celles "d'origine étrangère", s'ajoutent les oppositions entre nantis et déshérités, entre vieux et jeunes. "Dreux n'est plus le lieu d'une structure sociale collective cohérente", note Michèle Tribalat, qui montre que cette "segmentation" est devenue constitutive de "l'identité locale, individuelle et collective", au point que l'autorité publique elle-même est perçue comme partie prenante de cette opposition. Plus grave, elle alimente une dangereuse "logique de coupables-victimes" qui, ignorance aidant, conduit à la radicalisation des uns et des autres, à l'exacerbation réciproque d'un racisme anti-arabe et d'un racisme anti-français doublé d'un repli identitaire centré sur la religion musulmane. Dans un chapitre quelque peu caricatural et par trop généraliste, Michèle Tribalat analyse l'influence et la dégradation du modèle parental maghrébin - où le père fait figure de satrape domestique ! - sur le rapport des plus jeunes à l'école et à l'autorité notamment et, de façon plus pertinente, sur l'influence des valeurs transmises au sein des familles sur la vie en société. Distinguant nettement la pratique de la religion, de la "propagande active" d'une doctrine hostile à la séparation du politique et du religieux, l'enquête montre que "l'islamisme est en gestation à Dreux". À l'opposé des conclusions optimistes d'autres travaux (Isabel Taboada-Léonetti ou F. Khosrokhavar), Michèle Tribalat est extrêmement critique quant à l'influence d'associations qui, comme les Jeunes Musulmans de France, distillent "une idéologie islamiste sous le masque de la laïcité". Pour l'auteur, "ces associations n'ont abandonné ni la dimension communautaire, ni le caractère totalisant de la doctrine islamique". L'action de ces structures - comme la sous-traitance des problèmes sociaux confiée par les pouvoirs publics à des médiateurs religieux ou associatifs mal identifiés - aggrave les oppositions et la déréliction du lien social, dont les manifestations sont ici détaillées : tendance au repli sur soi, affaiblissement des contrôles sociaux, non-intériorisation des normes collectives, multiplication des incivilités, désaffiliation institutionnelle... Le tableau présenté ici est sombre, peut-être un peu trop. L'ethnicisation des rapports sociaux, si ce n'est sur Dreux, du moins en France, peut être discutée, voire contestée. Par ailleurs, de ces quartiers émergent aussi des initiatives qui justement recréent des liens sociaux, ce que montre, avec insistance aussi, Michèle Tribalat pour Dreux. Les trop noires perspectives ici esquissées ne sont pas inéluctables, semble dire l'auteur, pour peu que l'on se donne réellement les moyens de comprendre la réalité et surtout d'élaborer des politiques globales. "Penser l'avenir de Dreux, c'est faire des projets pour les jeunes Drouais, aujourd'hui majoritairement d'origine étrangère. À Dreux, on bute encore sur ce fait, qu'on n'arrive pas à dépasser. Mais il nous semble que c'est toute la société française qui bute sur cette réalité. Les enfants des immigrés maghrébins sont partie intégrante du peuple français, et ont une légitimité égale à celle des autres Français." On ne saurait être plus clair et dégager, par l'énoncé de cette évidence, qui n'est pas encore présente dans toutes les têtes, autant de perspectives nouvelles.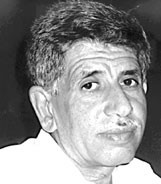 L'univers décrit par cet écrivain irakien né à Bassorah en 1942 est sombre. Il est marqué par la guerre contre l'Iran, la mort, la fragilité des existences et l'âcreté du quotidien. Pour rendre cette atmosphère, Mohammed Khudayyir a du talent. Son écriture suffit à plonger le lecteur dans l'inquiétude. Souvent, la première phrase de la nouvelle installe le trouble et un malaise suscité par la prémonition d'une menace, d'un danger imminent. Ainsi, pour Le royaume noir, le récit qui ouvre le recueil : "La lourde porte chargée de clous énormes, avec son heurtoir de bronze ouvragé et ses solides planches de bois noir aux bords sculptés, n'est pas fermée à clé." Ou encore : "Deux jeunes filles travaillant comme couturières dans un atelier d'État sont debout l'une à côté de l'autre en haut d'un escalier, au matin de leur jour de congé hebdomadaire." (Le rêve du singe) Le ton est toujours paisible mais des murmures, des chuchotements, des silences, un "bleu sombre", des "escaliers obscurs", une terrasse "sans parapet", une cicatrice, la pénombre, un "rêve couleur de sang" troublent cette apparente quiétude. De même, dans L'intercesseur, les allers et venues dans les escaliers d'une auberge d'une femme sur le point d'accoucher et qui se presse dans les rues de Karbala pour rattraper la procession d'Achoura. Et cette inconnue, plus ombre que femme qui, dans la gare d'Ur, remet à un soldat en permission, en guise de lettre pour son mari, une enveloppe contenant une feuille blanche (Les trains de nuit). Pour échapper à un monde tragique, ces femmes seules, ces veuves, ces adolescents en quête du père, ces orphelins, ces soldats basculent dans l'étrange ou le merveilleux. Alors les graffitis sur les murs d'une vieille demeure deviennent des chevaux ; du marbre du mausolée d'Al-Husayn à Karbala sourd un ruisseau qui emporte Naziha et lui procure un "plaisir étrange" et un "éblouissement merveilleux". D'une valise rapportée du front par un soldat sortirait le père mort à la guerre... Quand la vie devient irréelle à force de charrier trop de souffrances, tenue éloignée par des horizons bornés et noirs, elle semble pourtant vouloir se faufiler dans les dédales souterrains de l'imaginaire, dans les méandres de cerveaux fatigués, pour jaillir dans un autre monde, celui de l'étrange et du merveilleux.
L'univers décrit par cet écrivain irakien né à Bassorah en 1942 est sombre. Il est marqué par la guerre contre l'Iran, la mort, la fragilité des existences et l'âcreté du quotidien. Pour rendre cette atmosphère, Mohammed Khudayyir a du talent. Son écriture suffit à plonger le lecteur dans l'inquiétude. Souvent, la première phrase de la nouvelle installe le trouble et un malaise suscité par la prémonition d'une menace, d'un danger imminent. Ainsi, pour Le royaume noir, le récit qui ouvre le recueil : "La lourde porte chargée de clous énormes, avec son heurtoir de bronze ouvragé et ses solides planches de bois noir aux bords sculptés, n'est pas fermée à clé." Ou encore : "Deux jeunes filles travaillant comme couturières dans un atelier d'État sont debout l'une à côté de l'autre en haut d'un escalier, au matin de leur jour de congé hebdomadaire." (Le rêve du singe) Le ton est toujours paisible mais des murmures, des chuchotements, des silences, un "bleu sombre", des "escaliers obscurs", une terrasse "sans parapet", une cicatrice, la pénombre, un "rêve couleur de sang" troublent cette apparente quiétude. De même, dans L'intercesseur, les allers et venues dans les escaliers d'une auberge d'une femme sur le point d'accoucher et qui se presse dans les rues de Karbala pour rattraper la procession d'Achoura. Et cette inconnue, plus ombre que femme qui, dans la gare d'Ur, remet à un soldat en permission, en guise de lettre pour son mari, une enveloppe contenant une feuille blanche (Les trains de nuit). Pour échapper à un monde tragique, ces femmes seules, ces veuves, ces adolescents en quête du père, ces orphelins, ces soldats basculent dans l'étrange ou le merveilleux. Alors les graffitis sur les murs d'une vieille demeure deviennent des chevaux ; du marbre du mausolée d'Al-Husayn à Karbala sourd un ruisseau qui emporte Naziha et lui procure un "plaisir étrange" et un "éblouissement merveilleux". D'une valise rapportée du front par un soldat sortirait le père mort à la guerre... Quand la vie devient irréelle à force de charrier trop de souffrances, tenue éloignée par des horizons bornés et noirs, elle semble pourtant vouloir se faufiler dans les dédales souterrains de l'imaginaire, dans les méandres de cerveaux fatigués, pour jaillir dans un autre monde, celui de l'étrange et du merveilleux. Vincent Cespedes est professeur de philosophie « dans un lycée en zone sensible » comme le précise l'éditeur. Si, dans son style décapant et parfois fatigant, il rejoint certaines analyses et conclusions du livre d'Yves Michaud paru la même année (incohérence des mesures, nécessité de la sanction...), il s'en démarque en faisant de la violence la résultante de « la globalisation néo-libérale » et ses conséquences : déshumanisation des rapports ; avènement de « démocraties-marchés » et de régimes ploutocratiques où « l'argent explique, dirige, affirme, impose » ; « marchandisation de l'Etre » ; primat de l'Avoir sur l'Etre... Il y a aussi ce que l'auteur nomme l'«hamstérisation » de la jeunesse où les ravages d'une culture de masse présentée comme un mélange détonant d'américanisation, de manipulation mentale par la pub et la TV, d'idéologie consumériste et d'abrutissement par le culte des nouvelles technologies (la « cybermeute »). Ici, les médias ne sont pas épargnés qui en médiatisant les violences impunies, « loin de les congédier, les entérine et leur donne droit de cité », l'école non plus où se pratiquerait la ségrégation en faveur des élèves nantis, des « Français d'origine française » et « blancs ». Ajoutons à cette liste non exhaustive « le complexe de Brazzaville » du Français moyen « qui peine à considérer Mourad ou Fatou instantanément comme d'authentiques concitoyens, comme des gens pouvant prétendre au pouvoir, comme des supérieurs hiérarchiques légitimes ».
Vincent Cespedes est professeur de philosophie « dans un lycée en zone sensible » comme le précise l'éditeur. Si, dans son style décapant et parfois fatigant, il rejoint certaines analyses et conclusions du livre d'Yves Michaud paru la même année (incohérence des mesures, nécessité de la sanction...), il s'en démarque en faisant de la violence la résultante de « la globalisation néo-libérale » et ses conséquences : déshumanisation des rapports ; avènement de « démocraties-marchés » et de régimes ploutocratiques où « l'argent explique, dirige, affirme, impose » ; « marchandisation de l'Etre » ; primat de l'Avoir sur l'Etre... Il y a aussi ce que l'auteur nomme l'«hamstérisation » de la jeunesse où les ravages d'une culture de masse présentée comme un mélange détonant d'américanisation, de manipulation mentale par la pub et la TV, d'idéologie consumériste et d'abrutissement par le culte des nouvelles technologies (la « cybermeute »). Ici, les médias ne sont pas épargnés qui en médiatisant les violences impunies, « loin de les congédier, les entérine et leur donne droit de cité », l'école non plus où se pratiquerait la ségrégation en faveur des élèves nantis, des « Français d'origine française » et « blancs ». Ajoutons à cette liste non exhaustive « le complexe de Brazzaville » du Français moyen « qui peine à considérer Mourad ou Fatou instantanément comme d'authentiques concitoyens, comme des gens pouvant prétendre au pouvoir, comme des supérieurs hiérarchiques légitimes ».