Amin Maalouf
Le Dérèglement du monde
Le précieux romancier franco-libanais, polyglotte à cheval sur l’ « Occident » et le « monde arabe », citoyen et intellectuel qui embrasse de son regard gourmand et de sa plume élégante le vaste monde devenu « village planétaire » revient à l’essai. Après ses percutantes Identités meurtrières, de nouveau, il aide ses contemporains à mettre un peu d’ordre dans un monde déréglé par la montée du « fanatisme », de la « violence », de « l’exclusion », du « désespoir » et des « surenchères identitaires ». Le Dérèglement du monde invite à créer les bases d’un « nouvel humanisme ».
Bonne année 2014 à toutes et à tous !
 Et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là. Et les immigrés irréguliers par-ci, et les immigrés légaux par-là. Et patati ! et patata ! Et allez qu’à chaque fois depuis des années, je te rajoute une couche dans l’exclusion, la suspicion, l’opprobre. A ce jeu, tout devient possible. Le pire surtout. Et les « plus jamais ça » mémoriels, des pièges à gogo. On se prépare des jours bien sombres. Il ne s’agit nullement-là d’une posture de gloriole ou de provoc, façon arrogance à la sauce beur ou black de banlieues en mal de reconnaissance. Non ! Non ! C’est Maalouf qui parle. Notre Goncourt 1993, gloire internationale des lettres françaises. Le Dérèglement du monde c’est aussi çà : des pays occidentaux qui méprisent leurs citoyens, du moins ceux venus d’ailleurs. L’arrogance ne sévit pas qu’en banlieue tout de même ! Et si l’on en doute, il faut relire Les Invités d’Assouline.
Et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là. Et les immigrés irréguliers par-ci, et les immigrés légaux par-là. Et patati ! et patata ! Et allez qu’à chaque fois depuis des années, je te rajoute une couche dans l’exclusion, la suspicion, l’opprobre. A ce jeu, tout devient possible. Le pire surtout. Et les « plus jamais ça » mémoriels, des pièges à gogo. On se prépare des jours bien sombres. Il ne s’agit nullement-là d’une posture de gloriole ou de provoc, façon arrogance à la sauce beur ou black de banlieues en mal de reconnaissance. Non ! Non ! C’est Maalouf qui parle. Notre Goncourt 1993, gloire internationale des lettres françaises. Le Dérèglement du monde c’est aussi çà : des pays occidentaux qui méprisent leurs citoyens, du moins ceux venus d’ailleurs. L’arrogance ne sévit pas qu’en banlieue tout de même ! Et si l’on en doute, il faut relire Les Invités d’Assouline.
Et pourtant ! « Je l’écris sans détour, et en pesant mes mots : c’est d’abord là, auprès des immigrés, que la grande bataille de notre époque devra être menée, c’est là qu’elle sera gagnée ou perdue. Ou bien l’Occident parviendra à les reconquérir, à retrouver leur confiance, à les rallier aux valeurs qu’il proclame, faisant d’eux des intermédiaires éloquents dans ses rapports avec le reste du monde ; ou bien ils deviendront son plus grave problème. » C’est dit. Le Dérèglement du monde dénonce dans le même temps « (…) un monde où les appartenances sont exacerbées, notamment celles qui relèvent de la religion ; où la coexistence entre les différentes communautés humaines est, de ce fait, chaque jour un peu plus difficile ; et où la démocratie est constamment à la merci des surenchères identitaires. »
Ce monde déréglé par les communautarismes et les replis sur soi, l’est tout autant par l’absence de « légitimité » dans le monde arabe(1) et par la perte de « légitimité » de l’Occident, obligé de jouer des biscoteaux un peu partout sur la planète. Si les dérèglements sont locaux, leurs effets, eux, sont planétaires. Il suffit d’une poussée de fièvre à l’autre bout du globe, pour qu’on se mette à greloter dans son lit. Si la légitimité manque (ou manquait) au monde arabe, elle déserte aussi les pays d’Occident qui, faute de suprématie économique et d’autorité morale, font de l’intervention militaire « une méthode de gouvernement » de la planète. Car, selon Amin Maalouf, la civilisation occidentale, « créatrice de valeurs universelles » reste partagée « entre son désir de civiliser le monde et sa volonté de le dominer ». Et pourtant, selon l’universalité occidentale, « l’humanité est une » et « aucun peuple sur terre n’est fait pour l’esclavage, pour la tyrannie, pour l’arbitraire, pour l’ignorance, pour l’obscurantisme, ni pour l’asservissement des femmes. Chaque fois qu’on néglige cette vérité de base, on trahit l’humanité, et on se trahit soi-même. »
Le monde étant global, « nous sommes en train de sombrer ensemble » et, dans ce monde partagé et unique, « les problèmes ne peuvent être résolus que si l’on réfléchit globalement, comme si l’on était une vaste nation plurielle, tandis que nos structures politiques, juridiques et mentales nous contraignent à réfléchir et à agir en fonction de nos intérêts spécifiques – ceux de nos Etats, de nos électeurs, de nos entreprises, de nos finances nationales. » Pour l’auteur des Identités meurtrières, il faut partir d’un fait, une évidence à l’heure où la radioactivité, les virus, les capitaux, les marchandises, les hommes et les identités se baguenaudent allègrement à la surface du globe, au nez soupçonneux et à la moustache frétillante de la maréchaussée douanière : le monde est un, global, partagé et unique, les cadres nationaux vacillent, il serait temps non seulement de penser « globalement » mais aussi d’agir « globalement » en imaginant « une sorte de gouvernement global ».
Mais attention, dans le respect de tous et de chacun. Il faut alors et aussi dépasser ses petites mesquineries et ses grandes peurs, admettre que les civilisations sont allez au bout de leur bout, et qu’au bout de ce bout, c’est le vide pour tous ! Alors que l’Occident en rabatte de sa morgue et de sa suffisance, renvoyant (enfermant) l’autre – et ici l’Arabe – à une improbable différence culturelle et surtout religieuse (il y a un trop plein de religion nous dit Maalouf).
Il conviendrait d’en finir avec « l’esprit d’apartheid ». Basta ! des présupposés ethniques sur « ces gens-là » qui « ne sont pas comme nous ». Ce pseudo « respect » de l’Autre est une forme de mépris, et le révélateur d’une détestation. »
Ainsi, si l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire, l’Arabe, lui, poireauterait encore dans l’antichambre. Son passé, son présent et son avenir seraient, à l’ombre des minarets, écrit ad aeternam. « Et c’est ainsi qu’Allah est grand » aurait peut-être écrit Alexandre Vialatte. L’Occident oublierait-il ses propres leçons ? Le devenir des sociétés est le résultat de l’Histoire et non le fruit d’un commandement divin rappelle l’auteur, de sorte qu’« expliquer sommairement par la « spécificité de l’islam » tout ce qui se passe dans les différentes sociétés musulmanes, c’est se complaire dans les lieux communs, et c’est se condamner à l’ignorance et à l’impuissance. » Cela n’exonère nullement le monde arabe de corriger « l’indigence de sa conscience morale » : qu’il « s’introspecte » et fasse un grand ménage (de printemps, s’entend…). Des décennies d’illégitimité satrapique ou révolutionnaire ont laissé des toiles d’araignées dans les constitutions nationales et dans les consciences de chacun.
Amin Maalouf invite à un peu moins de religion et à un peu plus d’attention aux peuples. Et fissa encore ! Car il y a danger. « Dans le « village global » d’aujourd’hui, une telle attitude n’est plus tolérable, parce qu’elle compromet les chances de coexistence au sein de chaque pays, de chaque ville, et prépare pour l’humanité entière d’irréparables déchirements et un avenir de violence. »
Pour sortir, « par le haut », de ce « dérèglement », il faut recourir à… la culture. Voilà qui mettra sans doute du baume au cœur des lycéens imprudemment engagés en filière littéraire et des étudiants qui perdent leur temps à faire des langues, de la littérature et autres matières insignifiantes du genre philo, histoire, psy quelque chose et autres langues dites « mortes », au lieu d’être utiles à leur pays et à leur économie : des finances jeune homme ! de l’éco ! et plutôt de la micro que de la macro ; des mathématiques jeunes dame ! De la tenue, de la rigueur… de l’utilitarisme carnassier à vocation citoyenne et bourgeoise. Il ne s’agit pas d’opposer quoi que ce soit à quoi que ce soit d’autre, mais voilà, notre Goncourt national, redore le blason de la culture, des langues et des littératures pour allez vers l’Autre et s’imprégner de son « intimité » : « Sortir par le haut » du « dérèglement » « exige d’adopter une échelle des valeurs basée sur la primauté de la culture ». La culture « peut nous aider à gérer la diversité humaine », aider à se connaître les uns les autres, « intimement » et « l’intimité d’un peuple c’est sa littérature ». Ici, « l’intimité » à la sauce Maalouf a peut-être à voir avec la « connivence » façon François Jullien…
Dans ce fatras planétaire aux retombées de proximité, la culture tiendrait donc le premier rôle pour éviter de sombrer ensemble. Et les immigrés du monde entier seraient, une fois de plus les OS, obscurs mais diligents, du salut général. C’est dire si l’attitude des pays européens à leur égard est une « question cruciale ». Que l’on cesse alors de les renvoyer à une religion ou une appartenance exclusive. « L’immigré a soif (…) de dignité culturelle [dont] (…) la composante la plus irremplaçable est la langue. « l’appartenance religieuse est exclusive, l’appartenance linguistique ne l’est pas ; tout être humain a vocation à rassembler en lui plusieurs traditions linguistiques et culturelles ». Comme Driss Chraïbi ou Ying Chen avant lui, Amin Maalouf demande que chacun s’enrichisse de l’individualité de l’autre, émancipé de tout communautarisme. Alors les immigrés du monde entier - et de France - pourront jouer ce rôle indispensable d’ « intermédiaire ». Et non celui de boucs émissaires.
1-La première édition date de 2009 (chez Grasset). Autrement dit bien avant les fragrances du jasmin tunisien…
Le Livre de poche, 2010, 320 pages
 Les Jardins de lumières d'Amin Maalouf raconte l'histoire de Mani né le 14 avril 216 sur les bords du Tigre, non loin de l'actuelle Bagdad. Son enseignement sera non seulement trahi mais défiguré et oublié au point que du manichéisme, les siècles ne retiendront qu'une version erronée de l'opposition entre le Bien et le Mal.
Les Jardins de lumières d'Amin Maalouf raconte l'histoire de Mani né le 14 avril 216 sur les bords du Tigre, non loin de l'actuelle Bagdad. Son enseignement sera non seulement trahi mais défiguré et oublié au point que du manichéisme, les siècles ne retiendront qu'une version erronée de l'opposition entre le Bien et le Mal.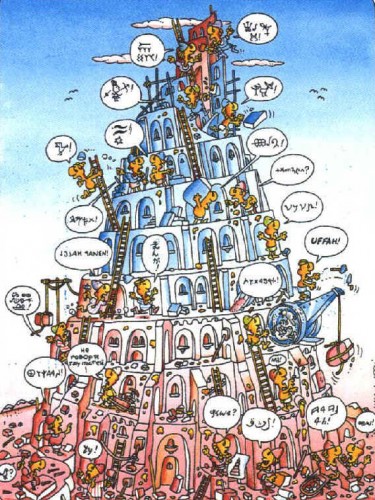 Pourquoi Amin Maalouf, ce célèbre romancier libanais qui a passé les 29 premières années de sa vie dans son pays natal et 22 autres en France (à la parution de ce livre) a t-il ressenti le besoin d’écrire un essai sur la notion d’identité? L’homme refuse de compartimenter son identité et revendique une identité et une seule mais “faite de tous les éléments qui l’ont façonnée (...)”. Cette évidence ne l’est pas pour tout le monde et surtout elle ne correspond pas à “l’air du temps”. Cela se vérifie quand ce franco-libanais, arabe, d’origine chrétienne, issu d’une minorité marginalisée dans son pays, aux riches ramifications familiales et personnelles doit répondre à l’anodine - en apparence - et récurrente question : “mais au fin fond de vous même qu’est ce que vous vous sentez?”. Ainsi, prix Goncourt ou pas, l’immigré Amin Maalouf doit justifier, défendre une autre conception de l’identité, que celle, “meurtrière” qui tend à réduire, “au fond”, à une seule appartenance l’identité des uns et des autres - entendre aussi bien celle des individus que des communautés ou des nations. “Car c’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c’est notre regard qui peut les libérer”. Il est facile d’imaginer les difficultés – voire les impasses – des jeunes issus de l’immigration pour se libérer du regard de la société française. Ce regard qui tend à les enfermer dans une identité unique ou même une identité de substitution – l’arabité ou l’islamisme par exemple – et ne les aide pas, à l’instar d’un Amin Maalouf, à se construire à partir d’une autre conception de l’identité et de leur place au sein de la société.
Pourquoi Amin Maalouf, ce célèbre romancier libanais qui a passé les 29 premières années de sa vie dans son pays natal et 22 autres en France (à la parution de ce livre) a t-il ressenti le besoin d’écrire un essai sur la notion d’identité? L’homme refuse de compartimenter son identité et revendique une identité et une seule mais “faite de tous les éléments qui l’ont façonnée (...)”. Cette évidence ne l’est pas pour tout le monde et surtout elle ne correspond pas à “l’air du temps”. Cela se vérifie quand ce franco-libanais, arabe, d’origine chrétienne, issu d’une minorité marginalisée dans son pays, aux riches ramifications familiales et personnelles doit répondre à l’anodine - en apparence - et récurrente question : “mais au fin fond de vous même qu’est ce que vous vous sentez?”. Ainsi, prix Goncourt ou pas, l’immigré Amin Maalouf doit justifier, défendre une autre conception de l’identité, que celle, “meurtrière” qui tend à réduire, “au fond”, à une seule appartenance l’identité des uns et des autres - entendre aussi bien celle des individus que des communautés ou des nations. “Car c’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c’est notre regard qui peut les libérer”. Il est facile d’imaginer les difficultés – voire les impasses – des jeunes issus de l’immigration pour se libérer du regard de la société française. Ce regard qui tend à les enfermer dans une identité unique ou même une identité de substitution – l’arabité ou l’islamisme par exemple – et ne les aide pas, à l’instar d’un Amin Maalouf, à se construire à partir d’une autre conception de l’identité et de leur place au sein de la société.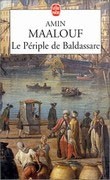 Après son roboratif essai invitant à repenser la notion d’identité (Les identités meurtrières), Amin Maalouf renouait ici avec le roman historique. La documentation est riche et abondante. Le texte, précis et élégant, offre une peinture minutieuse des cités, des communautés humaines du pourtour méditerranéen et du Nord de l’Europe dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Les dialogues brillent d’érudition et sont toujours exposés avec simplicité. L’auteur raconte les pérégrinations de Baldassare Embriacio, parti en 1665 sur les routes de l’Empire ottoman puis d’Europe. L’homme est un riche négociant en curiosités à Gibelet. Sa famille, d’origine génoise, est installée au Levant depuis les Croisades. Il est accompagné de ses deux neveux et d’un serviteur. Martha, abandonnée par son mari depuis des années, se joint au groupe pour vérifier auprès des hautes autorités de la Sublime Porte si son mari est mort. Baldassare recherche un livre exceptionnel : Le centième nom, d’Al Mazandarani. Dans le Coran, quatre-vingt-dix-neuf noms servent à désigner Dieu. Selon une tradition, il en existerait un centième, “un nom suprême qu’il suffirait de prononcer pour écarter n’importe quel danger, pour obtenir du Ciel n’importe quelle faveur”. Ce nom figurerait dans le livre d’Al Mazandarani. L’urgence de la quête est avivée par les prédictions qui, venues des quatre coins du monde, se bousculent jusque dans la boutique renommée du “brave et bedonnant” bibliophile : la fin du monde est imminente, 1666 sera l’année de l’Apocalypse. La rumeur enfle, la crainte monte et les signes se multiplient. D’abord incrédule, Baldassare ne cache pas que “dans ce combat qui oppose en [lui] la raison à la déraison, cette dernière a marqué des points”.
Après son roboratif essai invitant à repenser la notion d’identité (Les identités meurtrières), Amin Maalouf renouait ici avec le roman historique. La documentation est riche et abondante. Le texte, précis et élégant, offre une peinture minutieuse des cités, des communautés humaines du pourtour méditerranéen et du Nord de l’Europe dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Les dialogues brillent d’érudition et sont toujours exposés avec simplicité. L’auteur raconte les pérégrinations de Baldassare Embriacio, parti en 1665 sur les routes de l’Empire ottoman puis d’Europe. L’homme est un riche négociant en curiosités à Gibelet. Sa famille, d’origine génoise, est installée au Levant depuis les Croisades. Il est accompagné de ses deux neveux et d’un serviteur. Martha, abandonnée par son mari depuis des années, se joint au groupe pour vérifier auprès des hautes autorités de la Sublime Porte si son mari est mort. Baldassare recherche un livre exceptionnel : Le centième nom, d’Al Mazandarani. Dans le Coran, quatre-vingt-dix-neuf noms servent à désigner Dieu. Selon une tradition, il en existerait un centième, “un nom suprême qu’il suffirait de prononcer pour écarter n’importe quel danger, pour obtenir du Ciel n’importe quelle faveur”. Ce nom figurerait dans le livre d’Al Mazandarani. L’urgence de la quête est avivée par les prédictions qui, venues des quatre coins du monde, se bousculent jusque dans la boutique renommée du “brave et bedonnant” bibliophile : la fin du monde est imminente, 1666 sera l’année de l’Apocalypse. La rumeur enfle, la crainte monte et les signes se multiplient. D’abord incrédule, Baldassare ne cache pas que “dans ce combat qui oppose en [lui] la raison à la déraison, cette dernière a marqué des points”. Amin Maalouf
Amin Maalouf