20 personnalités commentent un rapport choc de l’Education nationale
L’École face à l’obscurantisme religieux
 Osons rapporter une conversation privée. Je discutais l’autre soir, après le service, avec A. le patron d’un restaurant du XXe arrondissement parisien. A. est kabyle et en France depuis une trentaine d’années. Père de deux jeunes filles de dix et quatorze ans, il m’expliquait, lui le farouche laïque, partisan convaincu du vivre ensemble républicain hexagonal et de l’école publique avoir inscrit ses deux filles dans une école privée. Décision prise la mort dans l’âme mais nécessaire pour préserver sa progéniture des harcèlements religieux émanant d’autres élèves, en l’occurrence turcs ou africains, mais aussi des assignations à résidence cultuelle provenant du personnel scolaire soi-même qui décrétait, ad hominem, que les Yasmina ou Mohamed devaient s’abstenir de manger du porc et observer le jeûne du mois de ramadan. Il n’y a là, en ce début de XXIe siècle, dans la France républicaine et laïque, rien que de banal et le rapport Obin, puisque c’est de lui dont il est question, regorge d’exemples, autrement douloureux, de cet obscurantisme religieux agissant, subi ou complice.
Osons rapporter une conversation privée. Je discutais l’autre soir, après le service, avec A. le patron d’un restaurant du XXe arrondissement parisien. A. est kabyle et en France depuis une trentaine d’années. Père de deux jeunes filles de dix et quatorze ans, il m’expliquait, lui le farouche laïque, partisan convaincu du vivre ensemble républicain hexagonal et de l’école publique avoir inscrit ses deux filles dans une école privée. Décision prise la mort dans l’âme mais nécessaire pour préserver sa progéniture des harcèlements religieux émanant d’autres élèves, en l’occurrence turcs ou africains, mais aussi des assignations à résidence cultuelle provenant du personnel scolaire soi-même qui décrétait, ad hominem, que les Yasmina ou Mohamed devaient s’abstenir de manger du porc et observer le jeûne du mois de ramadan. Il n’y a là, en ce début de XXIe siècle, dans la France républicaine et laïque, rien que de banal et le rapport Obin, puisque c’est de lui dont il est question, regorge d’exemples, autrement douloureux, de cet obscurantisme religieux agissant, subi ou complice.
Vingt personnalités sont donc réunies pour commenter ce rapport. Ils sont (ou ont été) enseignants (Alain Seksig, Barbara Lefebvre, Denis Kambouchner, Jean-Paul Brighelli, Annette Coulon, Chantal Delsol, Michèle Narvaez), romanciers, (Emilie Frèche, Thierry Jonquet, Gaston Kelman), militants laïques, (Patrick Kessel ancien grand maître du Grand Orient de France, Fadela Amara et Mohammed Abdi de l’association Ni Putes ni soumises), journaliste et/ou intellectuels (Ghaleb Bencheikh, Paul Thibaud, Jeanne-Hélène Kaltenbach), démographe (Michèle Tribalat), psychanalyste (Fethi Benslama) ou sociologues, (Jacqueline Costa-Lascoux, Esther Benbassa, Dominique Schnapper).
Tous connaissent parfaitement ces sujets et tous, à une exception, disent la pertinence du rapport et l’urgence de tirer la sonnette d’alarme face à des manifestations d’obscurantisme qui se multiplient. En nombre et en acuité. Les inquiétudes du rapport Obin sont donc partagées et corroborent les expériences des uns et les observations des autres. Certains sont alarmistes, d’autres, prenant la question très au sérieux, se montrent pugnaces. Tous enfin, constatent les désertions des établissements publics au profit d’écoles privées devenues refuges de sécurité pour les élèves juifs ; garanties de réussite pour les plus aisés ou les nantis et affres de paix pour les élèves étiquetés, malgré eux, « musulmans » et qui refusent le diktat d’une minorité et les incohérences de l’institution publique.
Beaucoup fustigent la veulerie des pouvoirs publics et autres responsables administratifs et l’aveuglement idéologique, incendiaire parfois, de certains pontes de la sociologie française. Pourquoi masquer ou taire l’ampleur du problème au point d’éviter, par exemple, de faire trop de publicité à ce rapport ? « Ne pas faire de vague » (B. Lefebvre), voilà ce qui aurait, depuis une vingtaine d’années, servi de politique à des autorités transies. Transies de culpabilité, d’ignorance, de condescendance culturelle ou par crainte du conflit. De sorte que l’école aujourd’hui doit faire avec les diktats d’une minorité sur la majorité, se dépatouiller avec ses doutes et hésitations ou, ici ou là, voir substituer de nouvelles règles à la loi commune et surtout s’interdire de comprendre que ce qui se « joue » là est une « sournoise » « partie de go » visant à « engluer l’ennemi en rognant peu à peu son domaine » (Thierry Jonquet)
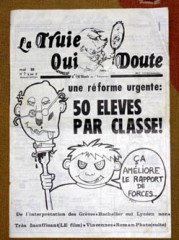 Que faire ? Tout d’abord et c’est le sens de cette publication, rendre le débat public. Ensuite, parabole martiale oblige : il ne sert à rien de s’agiter, de bomber le torse, de croire à l’efficacité d’une technique ou d’une mesure si l’ancrage au sol n’est pas sûr. L’ensemble des auteurs, à commencer par D.Schnapper, rappelle que cet « ancrage » existe et qu’il se nomme laïcité. Central sur ce point est le texte de J.Costa-Lascoux qui précise le sens de ce concept « polysémique » : « la laïcité n’est pas seulement une règle d’organisation structurelle : elle est intimement liée à la conception de la citoyenneté et aux droits fondamentaux de la personne. (…) Elle développe la logique des droits de l’homme. Elle suppose que soient intériorisées les règles de la démocratie et que les libertés soient entendues comme les droits d’un individu autonome et responsable ». Nullement figée, « la laïcité est un concept dont l’actualisation dans la vie quotidienne est sans cesse à retravailler (…) ».
Que faire ? Tout d’abord et c’est le sens de cette publication, rendre le débat public. Ensuite, parabole martiale oblige : il ne sert à rien de s’agiter, de bomber le torse, de croire à l’efficacité d’une technique ou d’une mesure si l’ancrage au sol n’est pas sûr. L’ensemble des auteurs, à commencer par D.Schnapper, rappelle que cet « ancrage » existe et qu’il se nomme laïcité. Central sur ce point est le texte de J.Costa-Lascoux qui précise le sens de ce concept « polysémique » : « la laïcité n’est pas seulement une règle d’organisation structurelle : elle est intimement liée à la conception de la citoyenneté et aux droits fondamentaux de la personne. (…) Elle développe la logique des droits de l’homme. Elle suppose que soient intériorisées les règles de la démocratie et que les libertés soient entendues comme les droits d’un individu autonome et responsable ». Nullement figée, « la laïcité est un concept dont l’actualisation dans la vie quotidienne est sans cesse à retravailler (…) ».
Alors, fort de cet ancrage qui ne se limite pas à « une vague idée de tolérance », le souple pourra être plus efficace que le dur pour traiter des trois urgences ici recensées : retrouver les missions de l’école ; poser clairement la question de l’identité ; comprendre les interactions entre l’institution scolaire et son environnement social et politique.
Nombre d’erreurs passées, d’« abandons » et d’« ignorances » (J.Costa-Lascoux) ont détourné l’institution scolaire de sa fonction première : l’enseignement de la langue française et l’acquisition du bagage culturel et historique minimum qui va avec. De ce point de vue, il faut cesser de prendre à la légère, par condescendance ou exotisme social, l’appauvrissement linguistique des plus jeunes : « les barbarismes langagiers préparent le terrain conduisant aux crimes les plus barbares » (B. Lefebvre ou JP. Brighelli). L’école est un service public dont la vocation première est de dispenser de la culture, trop facilement et socialement devenue objet de mépris au point que certains remettent sur le tapis les vertus de l’élitisme, du mérite et les travers de cet « égalitarisme littéralement pourri » (P. Thibaud).
Au lieu de mettre « l’enfant au centre du système », Denis Kambouchner en appelle à « de nouvelles Lumières » plutôt qu’à « l’abdication », M.Navarez à « des décisions politiques fortes », F. Amara et M. Abdi et d’autres à l’enseignement et à la promotion de la laïcité, G.Bencheikh à « dispenser de la culture ». « Quand le sage montre la lune l’imbécile regarde le doigt » dit le fameux proverbe chinois. Ainsi, quand l’école est devenue le lieu du « droit à la réussite » et non plus le lieu où l’on doit d’abord « faire de bonnes études » (P.Thibaud) alors sans doute, l’imbécillité s’est démocratisée.
Au lieu de cela l’école se serait fourvoyée dans l’interculturelle et le droit à la différence qui pour beaucoup serait le cheval de Troie du communautarisme si ce n’est de l’intégrisme (Seksig, Kelman…). Ces assignations à résidences culturelles et religieuses, dont les ELCO ont été le prototype, n’ont fait qu’introduire au sein de l’enceinte scolaire la question de l’identité. Il conviendrait de se défaire de « l’emprise identitaire » (A.Seksig) responsable de ce climat de mépris et de méfiance propice à l’émergence d’une autre obsession, « l’obsession de la pureté » (D.Schnapper) qui, comme l’a montré ailleurs F.Benslama, va toujours de pair avec le refus de la mixité (1).
Faut-il chasser la question identitaire des préoccupations de l’institution ? Peut-être pas. En tout cas, F.Benslama la réintroduit au cœur du débat en montrant en quoi l’école est aussi le lieu où s’élabore « la constitution du sujet humain ». Dès lors et pour ne plus tomber dans les pièges des « identités meurtrières », des approximations, des confusions identitaires et autres identités de substitution, nul ne pourra faire l’économie de la complexité c’est-à-dire rompre avec les logiques binaires, essentialistes et figées et admettre avec G.Kelman que « l’enfant est un devenir et non une histoire ». Comme le dit P.Thibaud, mais aussi G.Kelman, cette question devrait être posée « en partant d’ici », en privilégiant le « où sommes-nous ? » sur le sur ssur le « d’où sommes-nous ? » et ainsi offrir un « point de vue » pour légitimer des programmes d’enseignements qui ne seraient pas des patchworks mémoriels et autres services. Pour autant nul ne pourra faire l’économie d’interroger ses propres « mythologies » (F.Fanon) car la question identitaire ne se limite pas à aider les élèves, français, « de souche ou de branche », à se dépatouiller dans une modernité où les adultes eux-mêmes se perdent, mais aussi à remettre en question la « mythologie d’une France blanche et chrétienne » et saisir les changements et évolutions de l’identité nationale et républicaine (Kelman, Bencheikh…).
Enfin, nulle avancée ne peut être envisagée sans agir sur l’environnement même des écoles, en finir avec les « capitulations » (M.Tribalat) par une volonté politique forte et sans ambiguïté, en luttant contre les discriminations et « l’indécence » (Jonquet) de la « ségrégation urbaine » (F.Benslama) ou en interrogeant la place de l’islam dans la cité (G.Bencheikh). Pour certains, dans ce contexte, la sectorisation ne serait rien d’autre que « le terreau des absolutismes religieux » et ne ferait que renforcer ou favoriser la ghettoïsation. En publiant ces contributions et en annexe le rapport Obin, ce livre pose publiquement le débat offrant à chacun, dans et hors l’enceinte scolaire, d’assumer ses responsabilités de citoyen. Nous sommes avertis : contre l’instrumentalisation de l’enfance, contre l’antisémitisme, contre la relégation des femmes, « seule la résistance paie » sachant que « la reconnaissance de la dignité égale de tous les êtres humains » est un principe universel qui ne souffre aucun relativisme culturel (D.Schnapper).
(1) Fethi Benslama, Déclaration d’insoumission à l’usage des musulmans et de ceux qui ne le sont pas, éd. Flammarion, 2005
Max Milo, 2006, 377 pages, 20€
 Chez Mourad Djebel, « le temps (et même l’espace géographique), (...) ne se retrouve plus dans des repères linéaires (...), ne construit plus mais déconstruit et s’empêtre dans une inconsistance et une inconstance où les objets et les êtres affluent et refluent sans cheminement précis (...) ». Voilà le plus caractéristique de ce roman dont l’originalité est tout entière contenue dans l’écriture et dans la mise en scène d’un récit centré sur la disparition de Yasmina. Autour d’une scène cruciale, récurrente, se tissent les fils d’une histoire livrée par bouffées, en épisodes brusques et parfois inattendus. L’histoire de Maroued et de Yasmina mais aussi celle de trois adolescents, Larbi, Nabile et le même Maroued, liées par un pacte tacite scellé en octobre 1986 dans les odeurs des lacrymogènes et le sifflement des balles des militaires dépêchés pour réprimer des manifestations à Constantine. C’est sur un pont de cette ville, que les trois camarades marcheront « dans les deux sens en faisant des allers-retours ininterrompus pendant plusieurs heures, jouant aux sentinelles ou nous livrant en prisonniers au pont, aux deux abstractions du code de la route (le Sens interdit et le Stop)... ».
Chez Mourad Djebel, « le temps (et même l’espace géographique), (...) ne se retrouve plus dans des repères linéaires (...), ne construit plus mais déconstruit et s’empêtre dans une inconsistance et une inconstance où les objets et les êtres affluent et refluent sans cheminement précis (...) ». Voilà le plus caractéristique de ce roman dont l’originalité est tout entière contenue dans l’écriture et dans la mise en scène d’un récit centré sur la disparition de Yasmina. Autour d’une scène cruciale, récurrente, se tissent les fils d’une histoire livrée par bouffées, en épisodes brusques et parfois inattendus. L’histoire de Maroued et de Yasmina mais aussi celle de trois adolescents, Larbi, Nabile et le même Maroued, liées par un pacte tacite scellé en octobre 1986 dans les odeurs des lacrymogènes et le sifflement des balles des militaires dépêchés pour réprimer des manifestations à Constantine. C’est sur un pont de cette ville, que les trois camarades marcheront « dans les deux sens en faisant des allers-retours ininterrompus pendant plusieurs heures, jouant aux sentinelles ou nous livrant en prisonniers au pont, aux deux abstractions du code de la route (le Sens interdit et le Stop)... ».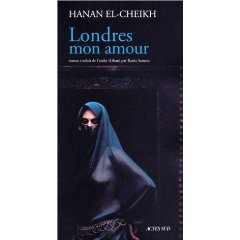 Avec sa nouvelle «
Avec sa nouvelle «  Tandis qu’on traque le réfugié afghan du côté de la « jungle » de Calais pour, selon l’officielle version, le protéger des passeurs, on continue à croire ici ou là que ces hommes, ces femmes et même ces enfants qui débarquent sur le sol de l’Europe sont en quête d’un Eldorado. Certains laissent même entendre qu’ils seraient prêts à tout pour rester, bien au chaud, et profiter de la douceur de cette bonne terre de France. Mohamed Hmoudane est poète et l’auteur de plusieurs recueils,
Tandis qu’on traque le réfugié afghan du côté de la « jungle » de Calais pour, selon l’officielle version, le protéger des passeurs, on continue à croire ici ou là que ces hommes, ces femmes et même ces enfants qui débarquent sur le sol de l’Europe sont en quête d’un Eldorado. Certains laissent même entendre qu’ils seraient prêts à tout pour rester, bien au chaud, et profiter de la douceur de cette bonne terre de France. Mohamed Hmoudane est poète et l’auteur de plusieurs recueils,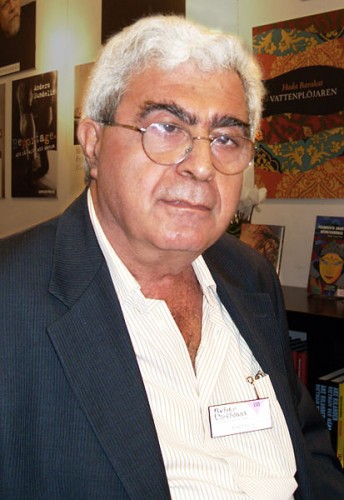 Il faut lire
Il faut lire Osons rapporter une conversation privée. Je discutais l’autre soir, après le service, avec A. le patron d’un restaurant du XXe arrondissement parisien. A. est kabyle et en France depuis une trentaine d’années. Père de deux jeunes filles de dix et quatorze ans, il m’expliquait, lui le farouche laïque, partisan convaincu du vivre ensemble républicain hexagonal et de l’école publique avoir inscrit ses deux filles dans une école privée. Décision prise la mort dans l’âme mais nécessaire pour préserver sa progéniture des harcèlements religieux émanant d’autres élèves, en l’occurrence turcs ou africains, mais aussi des assignations à résidence cultuelle provenant du personnel scolaire soi-même qui décrétait, ad hominem, que les Yasmina ou Mohamed devaient s’abstenir de manger du porc et observer le jeûne du mois de ramadan. Il n’y a là, en ce début de XXIe siècle, dans la France républicaine et laïque, rien que de banal et le rapport Obin, puisque c’est de lui dont il est question, regorge d’exemples, autrement douloureux, de cet obscurantisme religieux agissant, subi ou complice.
Osons rapporter une conversation privée. Je discutais l’autre soir, après le service, avec A. le patron d’un restaurant du XXe arrondissement parisien. A. est kabyle et en France depuis une trentaine d’années. Père de deux jeunes filles de dix et quatorze ans, il m’expliquait, lui le farouche laïque, partisan convaincu du vivre ensemble républicain hexagonal et de l’école publique avoir inscrit ses deux filles dans une école privée. Décision prise la mort dans l’âme mais nécessaire pour préserver sa progéniture des harcèlements religieux émanant d’autres élèves, en l’occurrence turcs ou africains, mais aussi des assignations à résidence cultuelle provenant du personnel scolaire soi-même qui décrétait, ad hominem, que les Yasmina ou Mohamed devaient s’abstenir de manger du porc et observer le jeûne du mois de ramadan. Il n’y a là, en ce début de XXIe siècle, dans la France républicaine et laïque, rien que de banal et le rapport Obin, puisque c’est de lui dont il est question, regorge d’exemples, autrement douloureux, de cet obscurantisme religieux agissant, subi ou complice.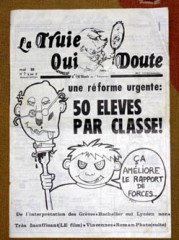 Que faire ? Tout d’abord et c’est le sens de cette publication, rendre le débat public. Ensuite, parabole martiale oblige : il ne sert à rien de s’agiter, de bomber le torse, de croire à l’efficacité d’une technique ou d’une mesure si l’ancrage au sol n’est pas sûr. L’ensemble des auteurs, à commencer par D.Schnapper, rappelle que cet « ancrage » existe et qu’il se nomme laïcité. Central sur ce point est le texte de J.Costa-Lascoux qui précise le sens de ce concept «
Que faire ? Tout d’abord et c’est le sens de cette publication, rendre le débat public. Ensuite, parabole martiale oblige : il ne sert à rien de s’agiter, de bomber le torse, de croire à l’efficacité d’une technique ou d’une mesure si l’ancrage au sol n’est pas sûr. L’ensemble des auteurs, à commencer par D.Schnapper, rappelle que cet « ancrage » existe et qu’il se nomme laïcité. Central sur ce point est le texte de J.Costa-Lascoux qui précise le sens de ce concept « 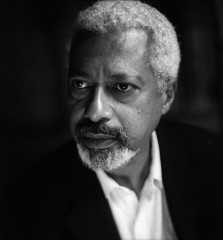 «
« 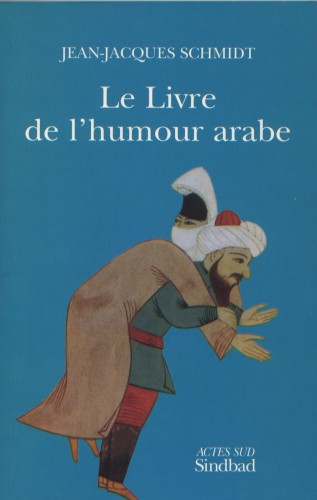 «
«  « Ça sent différemment dans chaque maison : avec certaines odeurs, on se sent tout seul ; avec d’autres on se sent chez soi. (…) Je ne sais pas ce qui rend l’odeur de chaque maison si différente mais chez nous, ça sent comme être heureux et comme avoir peur ».
« Ça sent différemment dans chaque maison : avec certaines odeurs, on se sent tout seul ; avec d’autres on se sent chez soi. (…) Je ne sais pas ce qui rend l’odeur de chaque maison si différente mais chez nous, ça sent comme être heureux et comme avoir peur ».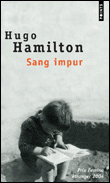 Sang impur, prix Femina 2004, est écrit dans une langue légère, fluide, à l’oralité enfantine, parfaitement maîtrisée par son auteur qui jamais ne donne dans la fausse naïveté ou la mièvrerie. Ce livre est une réussite qui dit des choses graves et essentielles. De belles choses aussi, de très belles choses.
Sang impur, prix Femina 2004, est écrit dans une langue légère, fluide, à l’oralité enfantine, parfaitement maîtrisée par son auteur qui jamais ne donne dans la fausse naïveté ou la mièvrerie. Ce livre est une réussite qui dit des choses graves et essentielles. De belles choses aussi, de très belles choses.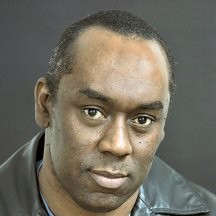 Londres. Cités du sud de la capitale. Au cœur de la communauté immigrée jamaïcaine. Dans ce magma urbain où le désœuvrement et l'absence de future colle à la peau, émerge la figure de Biscuit. Le jeune ado traîne sa misère entre deal, braquages
Londres. Cités du sud de la capitale. Au cœur de la communauté immigrée jamaïcaine. Dans ce magma urbain où le désœuvrement et l'absence de future colle à la peau, émerge la figure de Biscuit. Le jeune ado traîne sa misère entre deal, braquages Marrakech est à la mode. Mais enfin, ce n’est pas parce que cette ville s’est refaite depuis quelques années des couleurs, qu’il faut éviter d’en parler. Certes il y a pas mal de raison pour se détourner du flot des touristes en quête d’exotisme à bon compte, d’émois plus ou moins avouables et de soleil livré en demi-pension autour d’un bassin bien propret. Car Marrakech ne se résume pas à quelques perversions touristiques et autres spéculations immobilières : sous l’ombre de la Koutoubia, les remparts de la ville rouge abritent neuf siècles d’histoire et une société humaine autrement désintéressée et chaleureuse une fois tombé le masque pour touristes.
Marrakech est à la mode. Mais enfin, ce n’est pas parce que cette ville s’est refaite depuis quelques années des couleurs, qu’il faut éviter d’en parler. Certes il y a pas mal de raison pour se détourner du flot des touristes en quête d’exotisme à bon compte, d’émois plus ou moins avouables et de soleil livré en demi-pension autour d’un bassin bien propret. Car Marrakech ne se résume pas à quelques perversions touristiques et autres spéculations immobilières : sous l’ombre de la Koutoubia, les remparts de la ville rouge abritent neuf siècles d’histoire et une société humaine autrement désintéressée et chaleureuse une fois tombé le masque pour touristes.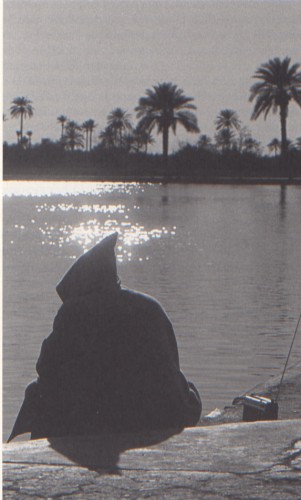 Le lecteur, aidé de Mahi Binebine, déambule dans la vieille cité, croise, ici ou là, le grand-père et le père de l’auteur ou la figure du poète Ben Brahim, marque une pause aux Jardins de l’Agdal pour évoquer la noyade d’un négrillon, s’arrête sous les remparts pour en observer d’étranges traces blanchâtres, ou vérifie si Dar Bellarj, la maison aux cigognes est, comme le dit la rumeur, hantée ou non… Le Palais de Bahia a beau être un des joyaux de la ville, la narrateur du cru aiguise le sens critique du visiteur en contant l’histoire du vizir à l’origine de la demeure : « l’arbitraire de son pouvoir féodal et corrompu dont on traîne encore les boulets, nous a jeté pour une durée indéterminée dans les affres du Moyen-Âge. Oui, j’avais dit (ce que je n’avais pas su dire à mon père) tout le mal que je pensais de ces suzerains qui incarnaient à mes yeux l’arantèle dans laquelle nous nous débattons encore, et qui continuent de faire des émules dans nos villes et nos campagnes ».
Le lecteur, aidé de Mahi Binebine, déambule dans la vieille cité, croise, ici ou là, le grand-père et le père de l’auteur ou la figure du poète Ben Brahim, marque une pause aux Jardins de l’Agdal pour évoquer la noyade d’un négrillon, s’arrête sous les remparts pour en observer d’étranges traces blanchâtres, ou vérifie si Dar Bellarj, la maison aux cigognes est, comme le dit la rumeur, hantée ou non… Le Palais de Bahia a beau être un des joyaux de la ville, la narrateur du cru aiguise le sens critique du visiteur en contant l’histoire du vizir à l’origine de la demeure : « l’arbitraire de son pouvoir féodal et corrompu dont on traîne encore les boulets, nous a jeté pour une durée indéterminée dans les affres du Moyen-Âge. Oui, j’avais dit (ce que je n’avais pas su dire à mon père) tout le mal que je pensais de ces suzerains qui incarnaient à mes yeux l’arantèle dans laquelle nous nous débattons encore, et qui continuent de faire des émules dans nos villes et nos campagnes ».