Jean Mattern
Les Bains de Kiraly
 Mémoire et quête des origines sont censées constituer le fil conducteur de ce premier roman, court mais dense, écrit avec élégance et sensibilité par Jean Mattern, par ailleurs directeur de collection chez Gallimard. Mémoire et quête des origines mais aussi et peut-être surtout, les ravages que le silence, les non-dits, les trous de mémoire infligent à une vie. A l’identité qui, pour être un devenir, a aussi besoin de s’accrocher à quelques certitudes.
Mémoire et quête des origines sont censées constituer le fil conducteur de ce premier roman, court mais dense, écrit avec élégance et sensibilité par Jean Mattern, par ailleurs directeur de collection chez Gallimard. Mémoire et quête des origines mais aussi et peut-être surtout, les ravages que le silence, les non-dits, les trous de mémoire infligent à une vie. A l’identité qui, pour être un devenir, a aussi besoin de s’accrocher à quelques certitudes.
De certitudes, Gabriel, le narrateur n’en a aucune. Il ne sait rien des origines judéo-hongroises de sa famille. Et la mort accidentelle de sa sœur a laissé chez l’enfant un vide nourri d’absence et de culpabilité. Le silence de ses parents, ces « blancs », toujours là, enfermeront Gabriel lui-même dans un silence maladif, lesté pour tout héritage paternel de la parole de Job : « Dieu a donné, Dieu a repris ». Un peu court pour faire le deuil de sa sœur, un peu court pour vivre, un peu court pour « être un père pour notre enfant ». Car Gabriel, après s’être réfugié derrière les mots et les langues des autres - comme traducteur -, a cru que la sémillante Laura le convertirait au bonheur. « Et jusqu’à l’annonce de sa grossesse, elle avait presque réussi sa mission. » L’arrivée de cet enfant provoque chez Gabriel un sentiment où la panique se mêle à l’absurdité et au réveil des peurs enfouies. Il s’enfuit, abandonnant épouse, enfant, et l’ami Léo.
Difficile de saisir les ressorts qui poussent Gabriel vers de lointaines et incertaines origines. De deux choses l’une, où ici le livre ne convainc pas ou alors, cette faiblesse indique justement que le véritable propos de l’auteur est ailleurs. « On ne devient pas juif par trois certificats de baptême » dit Gabriel lui-même. Il semble plus instructif alors de déplacer la question : peut-on se remettre d’un défaut de mémoire, d’un traumatisme laissé à vif faute d’attentions, et passer à autre chose, c’est-à-dire rester disponible à la vie ? A soi ? Jean Mattern répond ici par la négative. Faute de savoir que faire de ces « ombres » surgies du passé familial, faute de « comprendre », Gabriel est condamné à l’errance.
Edition Sabine Wespieser 2008, 133 pages, 17€
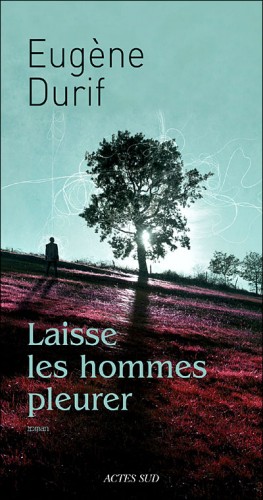 Il s’agit là d’une migration bien particulière. Il est question de rapt d’enfants, de gamins volés à des parents trompés, abusés et, au bout du compte, de vie brisées, d’hommes et de femmes parfois anéantis. Cela se passe en France. Entre 1963 et 1982 où plus de 1 600 enfants réunionnais ont été allègrement arrachés à leur île et à leur proche. Ils seront placés dans des familles d’accueil ou des institutions qui en Creuse, qui en Lozère ou dans le Gers. Puisque l’île connaît une croissance démographique importante et que dans le même temps les campagnes de la métropole souffrent d’un manque de bras et/ou de jeunes… L’idée lumineuse ne peut venir que d’un grand esprit et d’un grand cœur. En l’occurrence, Michel Debré soi-même, ci-devant fidèle Premier ministre du Général de Gaulle et alors préfet de l’île de la Réunion. La DDASS se charge du travail ; la peur gagne : « cache-toi bien sous les draps, la voiture de la DDASS, la voilà qui passe, ceux qu’elle emmène on ne les revoit jamais plus, cache-toi elle va nous prendre, pour la reconnaître certains jours elle est rouge, d’autres bleue pour mieux tromper. »
Il s’agit là d’une migration bien particulière. Il est question de rapt d’enfants, de gamins volés à des parents trompés, abusés et, au bout du compte, de vie brisées, d’hommes et de femmes parfois anéantis. Cela se passe en France. Entre 1963 et 1982 où plus de 1 600 enfants réunionnais ont été allègrement arrachés à leur île et à leur proche. Ils seront placés dans des familles d’accueil ou des institutions qui en Creuse, qui en Lozère ou dans le Gers. Puisque l’île connaît une croissance démographique importante et que dans le même temps les campagnes de la métropole souffrent d’un manque de bras et/ou de jeunes… L’idée lumineuse ne peut venir que d’un grand esprit et d’un grand cœur. En l’occurrence, Michel Debré soi-même, ci-devant fidèle Premier ministre du Général de Gaulle et alors préfet de l’île de la Réunion. La DDASS se charge du travail ; la peur gagne : « cache-toi bien sous les draps, la voiture de la DDASS, la voilà qui passe, ceux qu’elle emmène on ne les revoit jamais plus, cache-toi elle va nous prendre, pour la reconnaître certains jours elle est rouge, d’autres bleue pour mieux tromper. » Un squat, rue de la Chaussée d’Antin. Au 5, là où s’élevait dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et jusqu’en 1860 la maison de Louise d’Épinay, la protectrice de J.J.Rousseau. Dans son salon, elle recevait toutes les sommités intellectuelles de son temps, nationales et européennes. Mozart y fit un bref séjour. Plus tard et plus longuement, Chopin y résida avec quelques autres émigrés polonais. L’Hôtel d’Epinay n’existe plus. C’est un autre immeuble qui a vu le jour au niveau du 5 de la Chaussé d’Antin. L’esprit du lieu peut-être demeure encore…(1)
Un squat, rue de la Chaussée d’Antin. Au 5, là où s’élevait dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et jusqu’en 1860 la maison de Louise d’Épinay, la protectrice de J.J.Rousseau. Dans son salon, elle recevait toutes les sommités intellectuelles de son temps, nationales et européennes. Mozart y fit un bref séjour. Plus tard et plus longuement, Chopin y résida avec quelques autres émigrés polonais. L’Hôtel d’Epinay n’existe plus. C’est un autre immeuble qui a vu le jour au niveau du 5 de la Chaussé d’Antin. L’esprit du lieu peut-être demeure encore…(1) « Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges de la vie, et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années ». Cette réflexion de La Rochefoucauld pourrait servir d’illustration au nouveau roman de Mabrouck Rachedi qui avait publié
« Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges de la vie, et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années ». Cette réflexion de La Rochefoucauld pourrait servir d’illustration au nouveau roman de Mabrouck Rachedi qui avait publié 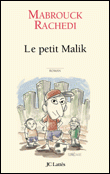
 Après son roman historique sur la bataille de Poitiers, Un Amour de djihad, paru en 1995, Salah Guemriche revient à la littérature dans un genre bien différent : le roman policier. Le style, parfois ampoulé, ne manque toutefois pas d'un certain charme pour le lecteur qui accepte de se cramponner aux wagons d'érudition et de curiosité de l'auteur. Il faut dire que comparé au précédent ouvrage - mais autre temps, autre langue -, il s'est ici allégé, sans pour autant perdre de son intérêt. Il y a gagné en rapidité et sa plume sait se faire assassine. Ce qui ne manque pas de stimuler, et même de ravir.
Après son roman historique sur la bataille de Poitiers, Un Amour de djihad, paru en 1995, Salah Guemriche revient à la littérature dans un genre bien différent : le roman policier. Le style, parfois ampoulé, ne manque toutefois pas d'un certain charme pour le lecteur qui accepte de se cramponner aux wagons d'érudition et de curiosité de l'auteur. Il faut dire que comparé au précédent ouvrage - mais autre temps, autre langue -, il s'est ici allégé, sans pour autant perdre de son intérêt. Il y a gagné en rapidité et sa plume sait se faire assassine. Ce qui ne manque pas de stimuler, et même de ravir. Résumons : père algérien, mère française. Nina Bouraoui, auteur en 1991 d'un premier roman justement remarqué, La Voyeuse interdite (Gallimard), a vécu en Algérie de quatre à quatorze ans, avant de retrouver sa France natale et sa famille maternelle, du côté de Rennes. Dans Garçon manqué, elle se laisse aller à une longue variation sur le thème du double, de l'identité fracturée, de l'exil à soi-même. Le livre, écrit à la première personne, impose un "je" omniprésent, envahissant. À n'en pas douter, Nina Bouraoui jouit d'une sensibilité et d'une finesse d'(auto)analyse et d'(auto)perception peu ordinaires. Mais ce livre contient aussi bien des passages assommants ! Non contente de verser finalement dans les lieux communs de la double culture difficile, voire impossible à vivre, l'auteur ramène le lecteur au cœur d'une problématique (celle de la fracture, de l'entre-deux) qu'il était en droit de croire dépassée à la lecture de certains écrivains ou, plus simplement, à l'expérience de la vie. Mais sur ce point, il est vrai que l'existence de chacun est bien singulière. Et, à en croire la presse, les dix années algériennes de Nina Bouraoui se sont soldées par une thérapie. Pour elle, l'Algérie serait bien ce pays dont on ne se remet jamais.
Résumons : père algérien, mère française. Nina Bouraoui, auteur en 1991 d'un premier roman justement remarqué, La Voyeuse interdite (Gallimard), a vécu en Algérie de quatre à quatorze ans, avant de retrouver sa France natale et sa famille maternelle, du côté de Rennes. Dans Garçon manqué, elle se laisse aller à une longue variation sur le thème du double, de l'identité fracturée, de l'exil à soi-même. Le livre, écrit à la première personne, impose un "je" omniprésent, envahissant. À n'en pas douter, Nina Bouraoui jouit d'une sensibilité et d'une finesse d'(auto)analyse et d'(auto)perception peu ordinaires. Mais ce livre contient aussi bien des passages assommants ! Non contente de verser finalement dans les lieux communs de la double culture difficile, voire impossible à vivre, l'auteur ramène le lecteur au cœur d'une problématique (celle de la fracture, de l'entre-deux) qu'il était en droit de croire dépassée à la lecture de certains écrivains ou, plus simplement, à l'expérience de la vie. Mais sur ce point, il est vrai que l'existence de chacun est bien singulière. Et, à en croire la presse, les dix années algériennes de Nina Bouraoui se sont soldées par une thérapie. Pour elle, l'Algérie serait bien ce pays dont on ne se remet jamais. Sauf erreur, les sans-papiers avaient inspiré bien peu de textes littéraires à la sortie de ce recueil de nouvelles. Le livre du marocain Mahi Binebine, Cannibales (1999), étant une première exception. C'est dire si l'initiative de publier trente-quatre nouvelles sur le sujet méritait l'attention. Et si, pour reprendre Hamlet, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que la philosophie d'Horatio en puisse rêver, osons dire qu'il y a plus de vérités et d'informations dans ces nouvelles que bien des controverses ou des publications savantes, utiles mais par trop abstraites, en puissent à leur tour rêver. La qualité première de ce recueil est de (ré)introduire la dimension humaine au cœur de cette aventure migratoire souvent tragique. Côté informations, le lecteur finit par tout savoir : le déracinement et les déchirements familiaux, l'espoir aussi de fuir, qui la misère, qui l'oppression, les filières de passeurs, l'attente, l'incertitude, la
Sauf erreur, les sans-papiers avaient inspiré bien peu de textes littéraires à la sortie de ce recueil de nouvelles. Le livre du marocain Mahi Binebine, Cannibales (1999), étant une première exception. C'est dire si l'initiative de publier trente-quatre nouvelles sur le sujet méritait l'attention. Et si, pour reprendre Hamlet, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que la philosophie d'Horatio en puisse rêver, osons dire qu'il y a plus de vérités et d'informations dans ces nouvelles que bien des controverses ou des publications savantes, utiles mais par trop abstraites, en puissent à leur tour rêver. La qualité première de ce recueil est de (ré)introduire la dimension humaine au cœur de cette aventure migratoire souvent tragique. Côté informations, le lecteur finit par tout savoir : le déracinement et les déchirements familiaux, l'espoir aussi de fuir, qui la misère, qui l'oppression, les filières de passeurs, l'attente, l'incertitude, la  dépossession de soi, l'argent qu'il faut fournir sans garantie aucune, la faim, le froid, le manque de sommeil, les douleurs physiques qui s'ajoutent aux souffrances morales. Il faut, de plus, compter avec les passeurs véreux qui, après avoir empoché l'argent, vous abandonnent dans la nature, ou avec ces filières qui se chargent de placer leurs "clients" auprès d'entrepreneurs qui les réduisent à la condition d'esclave. Reste enfin le risque de se faire prendre par la police. Ceux qui réussissent à passer la frontière ne sont pas au bout de leurs peines. De ce côté-ci, la dépossession de soi se poursuit, s'accentue même au point que le corps se décompose, partie par partie, jusqu'à la mutilation ; la peur d'être victime d'un contrôle de "non-identité" ou du racisme oblige à être en permanence sur le qui-vive ; fragilisés, ces hommes et ces femmes sont à la merci des rentiers du système, propriétaires d'appartements et autres entrepreneurs-exploiteurs, quand ce n'est pas la terrible descente aux enfers de la prostitution des filles-mères abandonnées. Le tableau ne serait pas complet sans l'évocation du rapport avec l'administration ou la police, et jusqu'aux conséquences de la législation en matière de régularisation. Tout y est, rien ne manque, pas même la question culturelle du rapport à l'Autre.
dépossession de soi, l'argent qu'il faut fournir sans garantie aucune, la faim, le froid, le manque de sommeil, les douleurs physiques qui s'ajoutent aux souffrances morales. Il faut, de plus, compter avec les passeurs véreux qui, après avoir empoché l'argent, vous abandonnent dans la nature, ou avec ces filières qui se chargent de placer leurs "clients" auprès d'entrepreneurs qui les réduisent à la condition d'esclave. Reste enfin le risque de se faire prendre par la police. Ceux qui réussissent à passer la frontière ne sont pas au bout de leurs peines. De ce côté-ci, la dépossession de soi se poursuit, s'accentue même au point que le corps se décompose, partie par partie, jusqu'à la mutilation ; la peur d'être victime d'un contrôle de "non-identité" ou du racisme oblige à être en permanence sur le qui-vive ; fragilisés, ces hommes et ces femmes sont à la merci des rentiers du système, propriétaires d'appartements et autres entrepreneurs-exploiteurs, quand ce n'est pas la terrible descente aux enfers de la prostitution des filles-mères abandonnées. Le tableau ne serait pas complet sans l'évocation du rapport avec l'administration ou la police, et jusqu'aux conséquences de la législation en matière de régularisation. Tout y est, rien ne manque, pas même la question culturelle du rapport à l'Autre. Il ne faut pas pour autant en déduire que le tableau est noir et trop militant. Côté littérature, la majorité des nouvelles ici présentées brillent autant par leur contenu informatif que par leurs qualités stylistiques et romanesques. De ce point de vue, nombre de trouvailles réjouissent le lecteur. Ainsi, ces sans-papiers qui entreprennent de démolir les trottoirs parce que la terre pourrit sous le béton (J.-P. Bernède), ou la rencontre de deux enfants sans-papiers avec Zidane et Ronaldo sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde de football (D. Daeninckx). Et cette petite perle d'humour qui montre comment Achille, un frêle Zaïrois s'exprimant dans un français du XVIIe siècle, et Mikhaïl, un malabar russe, ancien instructeur des forces spéciales de la marine soviétique, s'extraient des griffes des "archers du royaume des lys" (F. H. Fajardie). De dépossession de soi, il en est question chez P. Hérault, dans le calepin d'un sans-papiers retrouvé sur un banc d'un square, ou chez A. Kalouaz, dont le personnage aura usurpé pendant quinze ans l'identité d'un autre. Humour aussi, avec G. Mazuir et son héros embarqué malgré lui dans la lutte des sans-papiers, et dont les capacités à courir et à semer la police française le conduisent à représenter la France au sein de la Fédération française d'athlétisme. A. de Montjoie brosse un autre scénario, selon lequel l'expulsion des sans-papiers et autres immigrés laisse le pays en proie à un lent et inexorable dessèchement. L'appauvrissement sera non seulement économique, mais aussi social et humain. V. Staraselski fait se rencontrer le temps d'un contrôle, sous le faible éclairage d'un réverbère et à la lumière de la philosophie, un flic et une prostituée sans-papiers... Un livre riche et dense qui, malgré le tableau souvent sombre d'une triste réalité, parvient à ne pas désespérer le lecteur des hommes et de nos concitoyens.
Il ne faut pas pour autant en déduire que le tableau est noir et trop militant. Côté littérature, la majorité des nouvelles ici présentées brillent autant par leur contenu informatif que par leurs qualités stylistiques et romanesques. De ce point de vue, nombre de trouvailles réjouissent le lecteur. Ainsi, ces sans-papiers qui entreprennent de démolir les trottoirs parce que la terre pourrit sous le béton (J.-P. Bernède), ou la rencontre de deux enfants sans-papiers avec Zidane et Ronaldo sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde de football (D. Daeninckx). Et cette petite perle d'humour qui montre comment Achille, un frêle Zaïrois s'exprimant dans un français du XVIIe siècle, et Mikhaïl, un malabar russe, ancien instructeur des forces spéciales de la marine soviétique, s'extraient des griffes des "archers du royaume des lys" (F. H. Fajardie). De dépossession de soi, il en est question chez P. Hérault, dans le calepin d'un sans-papiers retrouvé sur un banc d'un square, ou chez A. Kalouaz, dont le personnage aura usurpé pendant quinze ans l'identité d'un autre. Humour aussi, avec G. Mazuir et son héros embarqué malgré lui dans la lutte des sans-papiers, et dont les capacités à courir et à semer la police française le conduisent à représenter la France au sein de la Fédération française d'athlétisme. A. de Montjoie brosse un autre scénario, selon lequel l'expulsion des sans-papiers et autres immigrés laisse le pays en proie à un lent et inexorable dessèchement. L'appauvrissement sera non seulement économique, mais aussi social et humain. V. Staraselski fait se rencontrer le temps d'un contrôle, sous le faible éclairage d'un réverbère et à la lumière de la philosophie, un flic et une prostituée sans-papiers... Un livre riche et dense qui, malgré le tableau souvent sombre d'une triste réalité, parvient à ne pas désespérer le lecteur des hommes et de nos concitoyens. Le monde de Tassadit Imache est un monde sans concession, âpre. Son parti pris est évident : décrire les laissés pour-compte. Marginalisés culturellement ou socialement, ses personnages subissent relégation et exclusion. Avant même de venir au monde, ils héritent des tares d'une famille, des dysfonctionnements d'une société, des ratés de l'Histoire. Dans Presque un frère, Tassadit Imache enfonce le clou, travaille la plaie avec une précision de chirurgien, appuie là où cela fait mal, quitte à choquer. Les "Terrains" vont-ils définitivement se détacher de la ville ? L'espace délimité, circonscrit, est le territoire des jeunes regroupés au sein du "Troupeau" et du "bétail affolé par le manque d'air, l'isolement". La description des lieux et des personnages est abrupte. Le sordide règne. Pas de pleurnicherie ni de volonté d'émouvoir pourtant. Le texte est brut, brutal et dur. Le récit n'est jamais factice. Il est construit sur un mode polyphonique, sa structure est éclatée. Ici, le gris domine, dilue les perspectives et étouffe les existences. Le brouillard est partout, jusque dans les têtes. Le banal quotidien d'une cité : les boîtes aux lettres cassées, les jeunes et leurs molosses aux crocs dissuasifs, les voitures volées ou endommagées, l'urine pestilentielle des chiens et la saleté qui obligent par endroits à se boucher le nez, le chômage, l'alcool et les trafics divers...
Le monde de Tassadit Imache est un monde sans concession, âpre. Son parti pris est évident : décrire les laissés pour-compte. Marginalisés culturellement ou socialement, ses personnages subissent relégation et exclusion. Avant même de venir au monde, ils héritent des tares d'une famille, des dysfonctionnements d'une société, des ratés de l'Histoire. Dans Presque un frère, Tassadit Imache enfonce le clou, travaille la plaie avec une précision de chirurgien, appuie là où cela fait mal, quitte à choquer. Les "Terrains" vont-ils définitivement se détacher de la ville ? L'espace délimité, circonscrit, est le territoire des jeunes regroupés au sein du "Troupeau" et du "bétail affolé par le manque d'air, l'isolement". La description des lieux et des personnages est abrupte. Le sordide règne. Pas de pleurnicherie ni de volonté d'émouvoir pourtant. Le texte est brut, brutal et dur. Le récit n'est jamais factice. Il est construit sur un mode polyphonique, sa structure est éclatée. Ici, le gris domine, dilue les perspectives et étouffe les existences. Le brouillard est partout, jusque dans les têtes. Le banal quotidien d'une cité : les boîtes aux lettres cassées, les jeunes et leurs molosses aux crocs dissuasifs, les voitures volées ou endommagées, l'urine pestilentielle des chiens et la saleté qui obligent par endroits à se boucher le nez, le chômage, l'alcool et les trafics divers...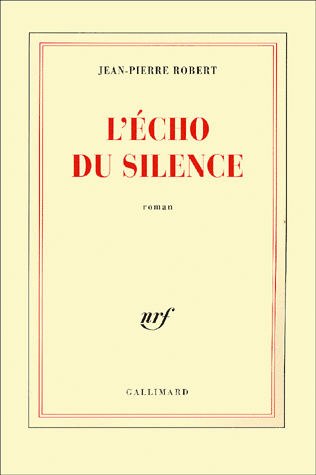 "Non, toute cette souffrance n'avait pas pu sortir et il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il pensait déjà qu'il faudrait repartir et qu'il ne fallait pas faire de peine en disant sa peine à lui, peut-être aussi parce qu'il sentait que de toute façon le père n'était pas prêt à l'entendre."
"Non, toute cette souffrance n'avait pas pu sortir et il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il pensait déjà qu'il faudrait repartir et qu'il ne fallait pas faire de peine en disant sa peine à lui, peut-être aussi parce qu'il sentait que de toute façon le père n'était pas prêt à l'entendre."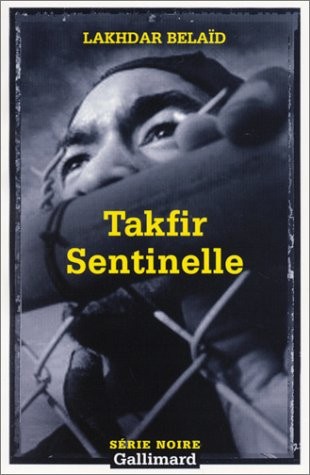 Après l'enthousiasmant
Après l'enthousiasmant