Hafid Aggoune,
Quelle nuit sommes-nous ?
 Pour son deuxième roman, le jeune et remarqué prodige 2004 de la littérature française confirme ce qui n’aurait pu être qu’une heureuse éclaircie. Quelle nuit sommes-nous ? est du même tonneau que Les Avenirs. À boire sans modération et à savourer par petites mais répétées gorgées tant le breuvage distillé par ce jeune homme de vingt-huit ans libère des illusions pour aller à l’essentiel. C’est du suc que sert Hafid Aggoune. Son écriture, élégante et précise, balance entre émerveillement et angoisse. Magnifiant l’instant présent, elle est sur le fil du rasoir. Comme la vie.
Pour son deuxième roman, le jeune et remarqué prodige 2004 de la littérature française confirme ce qui n’aurait pu être qu’une heureuse éclaircie. Quelle nuit sommes-nous ? est du même tonneau que Les Avenirs. À boire sans modération et à savourer par petites mais répétées gorgées tant le breuvage distillé par ce jeune homme de vingt-huit ans libère des illusions pour aller à l’essentiel. C’est du suc que sert Hafid Aggoune. Son écriture, élégante et précise, balance entre émerveillement et angoisse. Magnifiant l’instant présent, elle est sur le fil du rasoir. Comme la vie.
Plus encore peut-être que son premier et déjà court roman, l’intrigue de Quelle nuit sommes-nous ? est minimaliste, corsetée à l’excès, dépouillée de tout artifice. Qu’on en juge.
Le narrateur, Samuel Tristan, préfère la nuit au jour. Libre de toute attache, il vit la nuit. En quête de beauté, il trouve l’oubli dans des errances nocturnes. « Nuit sans aube », ses errances sont sans promesse a contrario des illusions dispensées par la lumière du jour. Il part pour Venise où un petit boulot l’attend. Il emporte avec lui son vieux sac bourré de livres et ses deux tapis. Là sur une île, dans ce qui fut hier un hôpital psychiatrique, il devra garder et entretenir les lieux. Il y retrouve Émeline, une Française. Elle sculpte tandis que lui débroussaille un sentier, luttant contre les ronces. À mesure de sa douloureuse et victorieuse progression contre les « ténèbres » Samuel revisite son propre cheminement, ses propres démons. Rien d’autre ou à peine plus.
Tout commence par un autre arrachement, une fugue à l’âge de quinze ans. Fugue sans retour mais aussi renaissance car « fuguer est le contraire d’un suicide : on part pour vivre et ce n’est pas une tentative de vivre, mais l’unique essai pour le faire ». Dénouant tout lien avec son passé, Samuel Tristan sera sa nouvelle identité : « l’ancien nom quittera ma mémoire » dit le narrateur. N’appartenant à aucun espace ( » les lieux je les quitte comme s’ils n’existaient pas, comme s’il n’y avait pas de frontière »), Samuel sera Sahel à Sidi Ifni, Salih dans le massif kabyle, Saleh à Djerba, Salim en Libye, Salman à Alexandrie, Saji à Beyrouth, Samih au Yémen…
Si les points communs avec son premier roman sont nombreux (éloge du livre, des langues, ces trois « piliers » que sont l’arabe, l’hébreu et le français, fragilité des âmes, hôpital psychiatrique, quête d’absolu, éloge de la Nature et dénonciation des travers de la modernité…) Quelle nuit sommes-nous ? est d’une tonalité plus sombre, plus désespérée. Tragique même : « Je me retrouve seul, emporté par le courant, livré à mon mal, entouré par les ténèbres invisibles, jeté corps et âme dans cette quête d’une poésie absente du monde, sans espoir ». À l’image du papillon qui vient se brûler les ailes sur la flamme dispensatrice de lumière, la connaissance a un prix. Hafid Aggoune rappelle qu’« il n’y a qu’une liberté, et son nom sera toujours écrit avec les lettres du sacrifice et du deuil ».
Et puisqu’il est question de prénoms dans ce livre rappelons que le prénom Hafid signifie : protecteur, celui qui, par sa connaissance du texte sacré, prend soin d’autrui, maintient les êtres dans l’existence. Sans aller jusque-là, Hafid Aggoune, comme Samuel dans le roman, ouvre un chemin, « une voie libre », pour, d’une autre façon, échapper à cette « longue nuit d’inhumanité » : « Fuis, chasse la honte de ton corps, arrache la culpabilité de ta tête, griffe les remords, échappe-toi, pense à toi, protège l’amour qui te contient, que tu contiens, garde-le pour tes pas sur terre, donne-le aux visages dont tu ignores tout, préserve tes caresses pour la peau qui te rend la félicité ».
Edition Farrago 2005, 122 pages, 15 €
Littérature française - Page 8
-
Quelle nuit sommes-nous
-
Les Avenirs
Hafid Aggoune
Les Avenirs
 “Elle est le rêve sur mes rêves. J’ai dix-sept ans. C’est mon premier amour. Je sais aussi qu’il est trop tard, que nos regards ne se croiseront plus. Je n’oublie pas la guerre. Je crois cela jusqu’à cette vision d’elle dans la foule, ce matin d’automne. Il faut attendre. Dans les salles de cours, nous sommes moins nombreux cette année. J’ai déjà peur pour elle.”
“Elle est le rêve sur mes rêves. J’ai dix-sept ans. C’est mon premier amour. Je sais aussi qu’il est trop tard, que nos regards ne se croiseront plus. Je n’oublie pas la guerre. Je crois cela jusqu’à cette vision d’elle dans la foule, ce matin d’automne. Il faut attendre. Dans les salles de cours, nous sommes moins nombreux cette année. J’ai déjà peur pour elle.”
Cette année, c’est l’année 1942. L’homme qui écrit ces lignes est un vieillard de soixante-dix-sept ans qui a passé près de soixante ans dans un asile. Ce premier amour se nomme Margot. Margot peint. Margot est juive. Juive sous l’Occupation. Le narrateur, Pierre Argan, mêle de lointaines racines amérindiennes par une arrière-grand-mère à une double origine, kabyle et française. À deux ans, son père l’envoie en Algérie. Il y restera en exil, loin de la langue française et loin de sa mère : “Durant ces deux années, nous étions morts l’un pour l’autre, ma mère sans moi, moi déporté d’elle. J’étais devenu un enfant imaginaire. Déporté, ça veut dire être loin de ce qui nous porte, loin de la vie.” 1942, Pierre et Margot s’aiment. Clandestinement. Ils projettent de fuir. Avant, ils cachent dans un cimetière vingt-cinq des toiles peintes par Margot. La dernière, Margot l’a appelée Les avenirs et a voulu la garder avec elle. Le 1er novembre, Margot Klein est emportée dans un train. Ce jour-là, pour Pierre, “la vie s’efface”. Il est emporté dans “un exil intérieur”, un exil de soixante années, “effaçant toute conscience de soi, tuant du même coup les deux douleurs qui grouillaient au fond de mon âme, cette cicatrice algérienne et ce premier amour avalé par le néant”.
Une autre mort ramènera Pierre à la vie. Celle d’un pensionnaire qui s’est pendu. Pendant toutes ces années, Pierre, assis sur un banc regardait l’homme peindre dans le vide. Sa main s’agitant dans l’air comme un pinceau sur une toile, “c’était un astre perdu dans ma longue nuit”. Seul Pierre distinguait les tableaux. Vingt-six toiles suspendues au-dessus des pierres, flottant dans l’air. Le 11 Septembre 2001, Pierre a fui l’asile de la Luz pour revenir à Paris où, par l’écriture, “il se redonne vie” et “éclate en mille morceaux de mémoire”.
Dans ce premier roman, écrit par un jeune Stéphanois de trente et un ans, plébiscité par les libraires et la critique, les éléments narratifs sont secondaires. Seule importe ici l’écriture, poétique et mystérieuse, parfois même impénétrable. Par ses mots, Hafid Aggoune a su recréer un monde, faire vivre et ressentir jusqu’au malaise la fragilité de l’humaine condition confrontée à la souffrance, au réel, à la mémoire et à cette humanité qui n’a toujours pas su trouver son cœur. La phrase est courte mais jamais sèche. Plutôt évanescente, fragile, comme en suspens. Passant d’un état à un autre, d’une sensation à une autre, d’un souvenir à un autre. D’une douleur à une autre. Il n’y a pas de fil conducteur pour indiquer le sens. Plutôt un écheveau de fils mémoriels et existentiels emberlificotés.
L’écriture seule pourrait le dénouer, le desserrer pour éviter l’asphyxie : “Toute mon existence aura été la recherche de ce lieu habitable, un monde vivable, ma langue, le livre” écrit Pierre qui, pour “refaire le monde”, pour “supporter cette impossibilité de rejoindre autrui” a fait de l’écriture sa nouvelle “chair”. Point d’illusion ici. Le temps n’existe pas et autour de chacun “il n’y a rien”, “rien sur quoi se tenir”. Pourtant Les Avenirs n’est nullement un tableau sombre, plutôt une généreuse invitation à saisir l’éphémère, à “apprendre à aimer cette vie et ce monde qui recommencent toujours, parce que nous sommes fragiles”.
Edition Farrago, 2004, 148 p., 15 €
-
Les mots étrangers
Vassilis Alexakis
Les mots étrangers
 Si selon le philosophe et sinologue François Jullien il y a urgence à « penser d’un dehors », car il serait impossible voire dangereux de vouloir se penser sans penser le monde, sans penser au dialogue entre les cultures, aux échanges entre les hommes, alors, Vassilis Alexakis, romancier grec installé en France depuis des années, raconte ici une expérience qui pourrait, en partie, servir d’illustration et de défense à cette disposition de l’esprit pressante face aux menaces qui pèsent sur la figure de l’étranger et aux dangers d’uniformisation, marchande ou guerrière, qui guettent la planète.
Si selon le philosophe et sinologue François Jullien il y a urgence à « penser d’un dehors », car il serait impossible voire dangereux de vouloir se penser sans penser le monde, sans penser au dialogue entre les cultures, aux échanges entre les hommes, alors, Vassilis Alexakis, romancier grec installé en France depuis des années, raconte ici une expérience qui pourrait, en partie, servir d’illustration et de défense à cette disposition de l’esprit pressante face aux menaces qui pèsent sur la figure de l’étranger et aux dangers d’uniformisation, marchande ou guerrière, qui guettent la planète.
Vassilis Alexakis qui écrit aussi bien dans sa langue maternelle qu’en français, décide, peu de temps après la mort de son père, d’apprendre une autre langue, des mots nouveaux, des « mots étrangers ». Il s’y plonge comme dans une « cure de jouvence ». Des mois durant, aidé d’un seul gros dictionnaire et de l’unique méthode existante, il se lance dans l’étude, quotidienne et solitaire, du sango. Idiome au nombre de locuteurs réduit, usitée dans le seule Centrafrique, langue de tradition strictement orale ne bénéficiant d’aucun enseignement et encore moins de méthodes pédagogiques. Méprisée par les Français et les nouveaux maîtres du pays, seul, un quarteron de chercheurs, ethnologues, universitaires et autant, c’est-à-dire bien peu, de locuteurs du cru, s’efforcent de tirer de l’oubli et de sauver cette langue et une culture tout de même et aussi patrimoine de l’humanité. Quand la globalisation se plait à rimer avec uniformisation et utilitarisme, cette initiative personnelle et littéraire s’avère bien salutaire et invite, sans grand discours ni effets de manche, à réfléchir sur la responsabilité de chacun dans la marche du monde. Car enfin, pourquoi diable aller se coltiner avec le sango quand tant d’autres langues, parlées par des millions de locuteurs et dotées d’une culture livresque plusieurs fois millénaire, sont là qui nous tendent les bras et nous offrent mille et une raisons gratifiantes pour justifier des heures et des heures de travail (d’investissement pour nos modernes esprits calculateurs) ? Avec d’autres (Patrick Chamoiseau, Amin Maalouf...), Vassilis Alexakis met son talent et son expérience au service de la diversité menacée : « il me serait très douloureux d’écrire en français si j’avais dû renoncer au grec. Je peux faire l’éloge de l’étude des langues, pas celui de leur oubli ». Mais enfin et pour en revenir au sango, « ne pas avoir de raison d’apprendre une langue n’est pas une raison ne de pas l’apprendre »...
Sans raison ? En apparence seulement. Car le Monde est Un et si depuis Térence - un autre Africain, mais berbère celui-là - nul n’est sensé ignorer que rien de ce qui est humain ne lui est étranger ; à l’aube de ce XXIè siècle, nul ne peut non plus prétendre mettre à distance ce monde qui constitue, de plus en plus, le quotidien de chacun. La « société-monde » (Edgar Morin), est là dans nos intérieurs, sur notre table, dans nos rues, dans nos langues, dans nos vies et dans nos mémoires.
Ainsi par l’histoire, celle de la communauté grecque installée en terre africaine, par sa famille et par son enfance, Vassilis Alexakis avait rendez-vous avec le Centrafrique et le sango. Le dehors de l’autre devient notre dedans.
Avec ce texte plaisant, un brin enchanteur, le lecteur partage la jubilation de l’écrivain pour ces mots étrangers, ces phrases aux constructions nouvelles qui laissent deviner une autre ouverture au monde, une autre poésie, un autre imaginaire. Avec lui, il partage cette « cure de jouvence », ce « nouveau départ » qui à nouveau rend disponible. Disponible d’abord à l’autre à commencer par les Africains de son quartier jusque là « invisibles », disponible aussi à une nouvelle approche de l’existence marquée notamment par la positivité de cette langue nouvelle comparée au grec et au français. « Les mots me font penser à des immigrés qui ressassent leurs souvenirs : ils me parlent de leur pays sans réussir à me communiquer leur nostalgie ou leur détresse ».
Vassilis Alexakis séjournera quinze jours en Centrafrique. Il y expérimente et parfait ses récentes acquisitions linguistiques et connaissances culturelles. Il évoque en visitant des commerces et des habitations souvent délabrées et abandonnées la présence grecque dans le pays et retrouve même le dernier représentant de cette communauté. Un vieil hellène dont le malheur est d’avoir un fils qui « n’est heureux qu’au milieu des Noirs », lui, qui, comme la plupart des membres de la communauté française, n’a que mépris pour eux et leur langue.
Mais laissons là les grincheux et laissons nous plutôt gagner, au sortir de ces bains de jouvence, par cette disponibilité oubliée, ce sentiment de fraternité avec toutes les choses créées que Jean Amrouche, chantre lui aussi d’une autre langue et culture menacées, appelait « l’esprit d’enfance ».
Edition Stock, 2002, 321 pages, 18,95 €
-
Un crime en Algérie
André Allemand
Un crime en Algérie
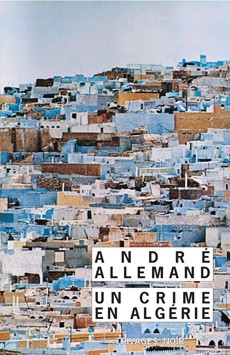 Alger, 15 août 1963. Danielle Orsini et son amant viennent d’être victime d’une agression sur la plage du Rocher bleu à l’est de la capitale. Elle aurait été violée. Son partenaire est mort. L’agresseur serait un homme armé d’un automatique. La jeune fille est prise en charge par des gendarmes français. Nous sommes au lendemain de l’indépendance algérienne.
Alger, 15 août 1963. Danielle Orsini et son amant viennent d’être victime d’une agression sur la plage du Rocher bleu à l’est de la capitale. Elle aurait été violée. Son partenaire est mort. L’agresseur serait un homme armé d’un automatique. La jeune fille est prise en charge par des gendarmes français. Nous sommes au lendemain de l’indépendance algérienne.
Danielle Orsini est la secrétaire de Jean Mercier le consul de France, ce qui complique singulièrement l’enquête. Mercier prend fait et cause pour son employée, une pied-noire raciste qui a fricotée avec l’OAS. Une relation troublante se noue entre la jeune femme et son aîné quinquagénaire. Par petites touches, l’auteur montre l’atmosphère de ces années de transition et de confusions. Le contexte politique est difficile : les vengeances individuelles et les exactions commises à l’encontre des biens de la maigre colonie française encore présente ont succédé aux milliers de disparus ; le crime, le vol, les prévarications et autres abus de pouvoir des nouveaux maîtres du pays prospèrent en toute impunité sur un désordre juridico-policier quasi absolu.
De plus, le gouvernement français négociant avec le président algérien un important accord pétrolier, l’ambassadeur s’emploie à calmer les ardeurs du consul pour « son ingénue » qui, en la circonstance, « ne représente guère plus qu’une fourmi emportée par l’eau d’un oued en crue ».
Ousmane, le Contrôleur général de la sûreté est chargé de l’enquête. Hirsute, court et adipeux, l’homme est craint. Ses manières, son accoutrement, ne le rendent guère sympathique. Il croit Danielle coupable du meurtre et s’emploie à le démontrer. A Mercier, il fait comprendre que le pouvoir aujourd’hui c’est lui. Les Français, fussent-ils consul, n’ont qu’à rentrer dans le rang et se plier aux nouvelles lois du pays !
Mercier, lui, est convaincu de l’innocence de sa protégée. Serait-ce alors Mrs Francis Jones, une Britannique, « la quarantaine pulpeuse » et un brin aguicheuse ? Elle a été l’amant de la victime et lui aurait prêté une importante somme d’argent. Soupçonnée d’être un agent des services secrets de sa Majesté, elle semble bénéficier de solides soutiens au sein du gouvernement et des forces armées du pays. Mais le meurtre pourrait aussi bien être un règlement de compte commandité par les anciens camarades de la victime, comme lui membres de l’OAS. André Allemand laisse ouvertes toutes les pistes.
La passion sensuelle contrariée d’un sentiment paternel de Mercier pour Danielle Orsini interfère sur l’enquête. Ces deux lignes de force du livre se croisent, se renforcent pour maintenir une tension constante et ascendante.
Un Crime en Algérie (re) plonge le lecteur dans une période de l’histoire algérienne peu abordée dans la littérature. On pourra reprocher à l’auteur de présenter les Algériens sous les traits de vulgaires et parfois dangereux obsédés sexuels : « vous autres Algériens êtes des obsédés du sexe. Votre gouvernement devrait prévoir des distributions obligatoires de bromure pour les mâles de plus de douze ans... ». Seul le procureur général Ahmad, qui a épousé une Française, échappe à ce triste tableau. On aurait pu y ajouter Ousmane, le Contrôleur général de la sûreté, n’était la révélation en fin d’ouvrage.
Edition Rivages/Noir, 2001, 170 pages
-
Métanoïa
Malek Abbou
Métanoïa
 En ouvrant Métanoïa, le lecteur se demande où il met les pieds. Intrigué d’abord par une prose délirante et bouffonne, des références aussi nombreuses que diverses (histoire, philosophie, économie, science physique, biogénétique, géostratégie paléontologie, œnologie...) le tout agrémenté de moult citations latines, il reste perplexe face à un texte touffu que l’éditeur présente pompeusement comme « une nouvelle expression romanesque » et qui n’est en fait que le premier roman d’un lyonnais de trente-cinq ans. Passé les premières surprises et le fait que l’auteur, comme l’un de ses personnages, ne soit pas toujours évident à « déchiffrer ligne à ligne », l’intrigue, petit à petit, prend forme.
En ouvrant Métanoïa, le lecteur se demande où il met les pieds. Intrigué d’abord par une prose délirante et bouffonne, des références aussi nombreuses que diverses (histoire, philosophie, économie, science physique, biogénétique, géostratégie paléontologie, œnologie...) le tout agrémenté de moult citations latines, il reste perplexe face à un texte touffu que l’éditeur présente pompeusement comme « une nouvelle expression romanesque » et qui n’est en fait que le premier roman d’un lyonnais de trente-cinq ans. Passé les premières surprises et le fait que l’auteur, comme l’un de ses personnages, ne soit pas toujours évident à « déchiffrer ligne à ligne », l’intrigue, petit à petit, prend forme.
Dans une Europe menacée par les délires fanatiques d’un complot théocratique fomenté par Buxton, un riche aristocrate britannique et un monde victime de l’abrutissement généralisé au nom de la marchandisation néolibérale de tous les rapports, les membres de Métanoïa, organisation secrète et fraternelle, veillent et s’appliquent à contrecarrer ces funestes ambitions et cette triste déshumanisation. L’agent Dorvillien a infiltré l’organisation de Buxton. Il a en charge de détruire « l’Elfe », une arme de destruction redoutable, « un transducteur (...) capable de réduire l’Annapurna en sucre glace » , Vallier. Pendant ce temps, son supérieur en désorganisation, s’applique à mettre la pagaille sur les marché financiers de la planète, une planète qui ignore encore que l’« hypospermie » menace l’espèce de disparition. Contre l’extinction, certains préparent l’avènement d’une « spermatocratie sino-américaine », quand d’autres concoctent l’effrayant projet d’une humanité choisie, d’une reprogrammation génétique de l’espèce humaine grâce à la « fabrication du premier spermatozoïde transgénique humain » où le vieux Houellebecq figurerait le modèle standard de l’écrivain. Métanoïa ne manque pas d’imagination... Et il en faut pour qu’une poignée de vieux fous, amoureux épris de danse et démolisseurs des mythes qui fondent notre rationalité, puisse, aidée d’une simple relique, un foulard encore imprégné de la sueur du King, Elvis Presley soi-même, sauver le monde.
Edition Hachette Littératures, 2002, 251 pages, 18,50 €
-
Métisse façon
Sarah Bouyain
Métisse façon
 Sarah Bouyain est une jeune cinéaste de mère française et de père burkinabé âgée de trente-quatre ans à la sortie de ce premier livre. Ici, les nouvelles et les destins se croisent et se mêlent au point d’offrir, in fine, un texte qui forme un tout cohérent et entièrement consacré aux métissages. Celui de l’auteur, résultat, comme tant d’autres, des modernes migrations internationales mais aussi et surtout celui, autrement violent et traumatisant, de ces orphelins d’Afrique, “nés de la force”, de “père inconnu”, parce que fruits des fantasmes libidineux ou de l’assouvissement des pulsions sexuelles d’une certaine gent coloniale et masculine en poste sur le continent noir.
Sarah Bouyain est une jeune cinéaste de mère française et de père burkinabé âgée de trente-quatre ans à la sortie de ce premier livre. Ici, les nouvelles et les destins se croisent et se mêlent au point d’offrir, in fine, un texte qui forme un tout cohérent et entièrement consacré aux métissages. Celui de l’auteur, résultat, comme tant d’autres, des modernes migrations internationales mais aussi et surtout celui, autrement violent et traumatisant, de ces orphelins d’Afrique, “nés de la force”, de “père inconnu”, parce que fruits des fantasmes libidineux ou de l’assouvissement des pulsions sexuelles d’une certaine gent coloniale et masculine en poste sur le continent noir.
L’Afrique de papa avait du bon ! Surtout quand, une fois sa petite affaire satisfaite, papa se volatilisait laissant derrière lui femme éplorée et enfants orphelins. Avec Les enfants qui rêvaient de traverser la mer (Seuil, 1999), l’écrivain Duyên Anh montrait comment les enfants amérasiens, “produits des amourettes” de la soldatesque américaine étaient, eux, relégués dans les décharges du Vietnam communiste. Indésirables pour les uns comme pour les autres, à l’image de Jeanne, d’Absatou ou d’Esther Boly, les personnages de Sarah Bouyain. Modernité et massification obligent : il existe aujourd’hui mille et une façons d’entrer dans l’univers du métissage. Mais, que ce soit volontairement (Rachel), de manière revendiquée (Sabine), contrainte (Bintoue Traoré) ou les conséquences de l’immigration (la petite Salimata), cette “métisse façon” bute sur des mentalités rigides, des identités frileuses ou “l’arrogance des moches”. Du moins chez Sarah Bouyain.
Edition La Chambre d’échos, 2003, 140 pages, 15 €
-
Des Poupées et des anges
Nora Hamdi
Des Poupées et des anges
 Nora Hamdi est peintre, réalisatrice (elle a elle même adapté en 2008 ce premier roman au cinéma avec l’excellente Leïla Bekhi dans le rôle de Lya) et co-auteur, dans la même maison, d'une BD. Elle signait ici un premier roman sans surprises. Pourtant, les textes qui offrent l'occasion d'approcher les histoires familiales et les parcours existentiels des "Français d'origine algérienne", sous l'angle de l'expérience féminine, ne sont pas si nombreux pour ne pas s'y intéresser. En effet, aux côtés des écritures masculines, souvent d'une autre génération (Begag, Charef, Tadjer, Lallaoui… mais les choses bougent là aussi), les "auteures" se comptent sur les doigts… des deux mains : T.Imache, N.Bouraoui, S.Nini, M.Sif, F.Belghoul, M.Gazsi, F.Kessas voire M.Wagner (pour autant la liste n’est pas exhaustive et mériterait d'être actualisée…).
Nora Hamdi est peintre, réalisatrice (elle a elle même adapté en 2008 ce premier roman au cinéma avec l’excellente Leïla Bekhi dans le rôle de Lya) et co-auteur, dans la même maison, d'une BD. Elle signait ici un premier roman sans surprises. Pourtant, les textes qui offrent l'occasion d'approcher les histoires familiales et les parcours existentiels des "Français d'origine algérienne", sous l'angle de l'expérience féminine, ne sont pas si nombreux pour ne pas s'y intéresser. En effet, aux côtés des écritures masculines, souvent d'une autre génération (Begag, Charef, Tadjer, Lallaoui… mais les choses bougent là aussi), les "auteures" se comptent sur les doigts… des deux mains : T.Imache, N.Bouraoui, S.Nini, M.Sif, F.Belghoul, M.Gazsi, F.Kessas voire M.Wagner (pour autant la liste n’est pas exhaustive et mériterait d'être actualisée…).
Dans Des Poupées et des anges, Lya, jeune fille au look sportif, adepte de taekwondo et de footing à répétition, rapporte l'histoire familiale, sa lutte pour préserver son indépendance et observe Chirine, sa sœur aînée, qui depuis son plus jeune âge cherche à quitter son milieu social et culturel pour devenir riche et admirée. Sur ce point, il n'y a rien de nouveau ici : un père qui a sa façon aime sa progéniture, mais exerce sur les siens un pouvoir tyrannique et même violent au point de susciter chez ses deux gamines de l'indifférence voir de la haine, une mère soumise et battue, des filles qui louvoient ou se battent pour défendre quelques espaces de liberté. Du moins pour Lya car Chirine jouit, elle, d'une totale et bien ambiguë indépendance, comme si à son endroit, le père avait abdiqué. Après une enfance dans un bidonville, la famille a été installée dans une cité du quartier parisien de Choisy.
Le plus séduisant dans ce roman, n'est pas cette interrogation sur le pourquoi les hommes s'échinent à fabriquer des "filles vides et mortes" à l'image de ces poupées offertes aux deux soeurs. Ce n'est pas non plus cette suggestion d'une ambivalence portée par la figure de l'ange qui peut aussi se révéler "terrifiant". Non, le plus séduisant réside dans cette perception, sensible et polyvalente, de la réalité schizophrénique des familles, des lieux et des êtres. Tout ce petit monde évolue, plus ou moins secrètement, dans plusieurs réalités, des réalités parfois inconciliables. Et les filles ne sont pas les seules. La gent masculine aussi. À commencer par le père, objet de tant de détestation et à qui pourtant, Nora Hamdi a su donner une douloureuse et émouvante réalité intérieure. Ou encore Medhi, le petit copain de Marie, l'amie de la narratrice, qui parce qu'il continue à voir (en cachette) son frère homosexuel doit subir les sarcasmes et l'hostilité de sa famille : "chez moi, ils ont jamais posé de questions. Quand ils ont appris, ils l'ont totalement ignoré, ont fait comme s'il n'existait plus du jour au lendemain et lui ont demandé de disparaître de leur vie". Et à la question de savoir si le sujet est abordé : "Non, c'est trop pudique, personne l'aborde, c'est tabou chez nous (…)".
Face à ce tabou de la sexualité, du côté féminin, les personnages de Nora Hamdi traduisent trois attitudes : la soumission ou l'abnégation (la mère), la rupture (Chirine) ou alors, avec Lya, ce souci de préserver son intégrité dans un combat quasi quotidien, quitte à enfreindre secrètement les règles du clan (la rencontre avec Mikaël) ou à accepter de céder (arrêter le taekwondo). Lorsque l'on refuse d'être une poupée, derrière le masque de l'ange se cache parfois non pas un démon, mais certainement une rebelle.
Editon Au Diable Vauvert, 2004, 212 pages, 17 € -
Les enfants de la Place
Yasmina Traboulsi
Les enfants de la Place
 La violence est au cœur de nos sociétés. Toutes les violences et toutes les sociétés. Pire la violence est consubstantielle à l’Homme. On aurait un peu tendance à l’oublier par les temps qui courent… C’est ce que montre ce roman que l’on pourrait présenter comme le pendant romanesque du livre du philosophe Yves Michaud paru en 2002 intitulé Changement dans la violence. Et les violences les moins médiatisées ne sont pas les moins dangereuses pour l’avenir. Ainsi, dans Les enfants de la Place, Yasmina Traboulsi montre comment les nantis des mégalopoles brésiliennes se réfugient derrière des enceintes de protection et des milices armées jusqu’aux dents pour ne pas avoir à se coltiner avec la misère ambiante et pour se protéger de la violence des « damnés de la terre ». Cette société à deux vitesses ne préfigure-t-elle pas un scénario d’avenir possible ? C’est aussi ce que montrait Yves Michaud.
La violence est au cœur de nos sociétés. Toutes les violences et toutes les sociétés. Pire la violence est consubstantielle à l’Homme. On aurait un peu tendance à l’oublier par les temps qui courent… C’est ce que montre ce roman que l’on pourrait présenter comme le pendant romanesque du livre du philosophe Yves Michaud paru en 2002 intitulé Changement dans la violence. Et les violences les moins médiatisées ne sont pas les moins dangereuses pour l’avenir. Ainsi, dans Les enfants de la Place, Yasmina Traboulsi montre comment les nantis des mégalopoles brésiliennes se réfugient derrière des enceintes de protection et des milices armées jusqu’aux dents pour ne pas avoir à se coltiner avec la misère ambiante et pour se protéger de la violence des « damnés de la terre ». Cette société à deux vitesses ne préfigure-t-elle pas un scénario d’avenir possible ? C’est aussi ce que montrait Yves Michaud.
De la Place à Salvador de Bahia à Sao-Paulo en passant par Rio de Janeiro, Yasmina Traboussi, née de mère brésilienne et de père libanais, écrit les destins tragiques de ces enfants de la Place. Ils ont rendez-vous avec la mort. Dans l’indifférence générale (à commencer par celle des touristes), avec la complicité des forces de l’ordre, ces mineurs (pour la société mais aussi devant la loi…) sont instrumentalisés par les caïds des favelas, enrégimentés dans des bandes rivales et violentes, rackettés par tous y compris par l’Eglise et/ou ses représentants, sans cesse sous la menace des bataillons de la morts ou des commandos de pseudo justiciers… Les enfants des rues brésiliennes ont bien peu de change d’échapper à une fin tragique et aucune d’éviter la peur, la haine et les violences diverses. Ces bas-fonds de la société brésilienne font froids dans le dos même si parfois le roman bascule dans l’irréel voir le conte de fée comme celui qui permet à la seule Ivone d’échapper à l’horreur des favelas (pour peut-être tomber dans un univers glauque et sordide, celui de la TV) ou la visite de la Gringa dans un pénitencier à la fin du récit.
Pour ce premier roman, Yasmina Traboulsi livre en séquences courtes et successives le portrait et les parcours des personnages qui finissent par former un tout composite où la tendresse, l’indifférence, l’amour, la haine, la peur dessinent les contours d’une humanité en péril. Par petites touches, la tension et la noirceur gagnent et envahissent un tableau que l’auteur a choisi pourtant de décrire avec une plume élégante, un brin enjoué et distancé
Edition Mercure de France, 2003, 164 pages, 15 €
-
Le Pied-rouge
François Muratet
Le Pied-rouge Ouvrez Le Pied rouge, vous le refermerez la dernière page lue. Pour son premier roman documenté et inspiré en partie de faits réels, justement récompensé du Prix Polar SNCF 2000, François Muratet signe là un coup de maître. Le livre baigne dans les remugles de la guerre d’Algérie et les souvenirs du gauchisme tendance mao des années soixante-dix. Il s’ouvre sur une scène doublement fondatrice. Frédéric, âgé de six ans, surprend une altercation entre son père et un inconnu. Alors qu’il cherche à s’interposer, dans la confusion et la mêlée, il reçoit un coup. À son réveil, il devine que la vie a quitté à jamais le corps qui gît à ses côtés. Scène doublement fondatrice car elle sera le terrible substrat émotionnel sur lequel Frédéric devra se construire et le point de départ d’une enquête qu’il mènera des années plus tard pour élucider la mort de son père.
Ouvrez Le Pied rouge, vous le refermerez la dernière page lue. Pour son premier roman documenté et inspiré en partie de faits réels, justement récompensé du Prix Polar SNCF 2000, François Muratet signe là un coup de maître. Le livre baigne dans les remugles de la guerre d’Algérie et les souvenirs du gauchisme tendance mao des années soixante-dix. Il s’ouvre sur une scène doublement fondatrice. Frédéric, âgé de six ans, surprend une altercation entre son père et un inconnu. Alors qu’il cherche à s’interposer, dans la confusion et la mêlée, il reçoit un coup. À son réveil, il devine que la vie a quitté à jamais le corps qui gît à ses côtés. Scène doublement fondatrice car elle sera le terrible substrat émotionnel sur lequel Frédéric devra se construire et le point de départ d’une enquête qu’il mènera des années plus tard pour élucider la mort de son père.
Entre temps, l’enfant refoule ce souvenir. Le traumatisme le laisse même un temps muet. Il grandit dans l’amnésie partielle, le non-dit et le mensonge entretenus par sa mère remariée. Mais, de profondes crises d’angoisse et des accès de violence inexpliquée rythmeront toute son existence.
Trente ans plus tard, en vacances à Paimpol avec Nadia, épouse délaissée par son chercheur de mari, Frédéric croise Max, l’ancien dirigeant de l’OCP, un groupuscule maoïste où il a milité. Max est alors un vieux militant qui a derrière lui la guerre d’Algérie, le militantisme des années soixante et soixante-dix, les causes internationales, le soutien aux Palestiniens et tant d’autres actions plus ou moins secrètes, troubles, clandestines.
Il est descendu dans le même hôtel que le couple d’amoureux. Comme il ne supporte pas le bruit, il a demandé à son ancien camarade de changer leurs chambres respectives. Dans la nuit, Max est sauvagement assassiné.
La police nationale, la presse mènent l’enquête, mais Frédéric veut aussi retrouver l’assassin de Max qui, au temps de l’OCP, a été son père spirituel.
Ses investigations exhument des souvenirs de la guerre d’Algérie où la victime a non seulement déserté mais choisit de devenir un « pied-rouge » c’est-à-dire de servir dans les rangs du FLN. Elles révèlent surtout que Max était toujours en activité. Frédéric croise les services peu amènes de la DST, ceux plus compréhensifs de l’Algérie. Il emprunte des chemins tortueux qui le conduisent au FIS et à un étrange complot où des islamistes s’acoquineraient avec une formation d’extrême droite. Les services de Franco et quelques barbouzes interfèrent.
François Muratet, professeur d’histoire en banlieue parisienne, est lui-même un ancien gauchiste. Son récit, où convergent quatre histoires, est parfaitement maîtrisé et jamais le lecteur ne cherche sa route ou ne s’ennuie. L’originalité est de coupler au genre politico-historique inspiré de faits réels une convaincante approche psychologique où la personnalité perturbée de l’enquêteur doit démêler un double imbroglio meurtrier. Le tout est mâtiné d’un soupçon d’exotisme et/ou de spiritualité où la pratique du kung-fu se prolonge par la mise en place d’une grille de lecture inspirée du jeu de go dont Frédéric est un amateur éclairé.
Edition Le Serpent à plumes, 1999, 261 pages. Réédité en poche chez Gallimard (Folio) -
Le Petit gaulliste
Alain Lorne
Le Petit gaulliste
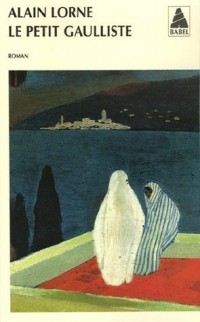 Le Petit gaulliste se prénomme Paul. Il a treize ans. Antoine, son frère, en a deux de plus et soigne sa ressemblance avec Johnny Halliday, celui de « Pour moi la vie va commencer ». Nous sommes en 1963. Les parents ont divorcé. En ces temps pas si lointains, seule la femme supporte l’opprobre et la condamnation morale des bien pensants. Aussi, pour Cécile, la mère, l’atmosphère devient vite irrespirable. Il est urgent de quitter le 52 ! (entendre la Haute-Marne).
Le Petit gaulliste se prénomme Paul. Il a treize ans. Antoine, son frère, en a deux de plus et soigne sa ressemblance avec Johnny Halliday, celui de « Pour moi la vie va commencer ». Nous sommes en 1963. Les parents ont divorcé. En ces temps pas si lointains, seule la femme supporte l’opprobre et la condamnation morale des bien pensants. Aussi, pour Cécile, la mère, l’atmosphère devient vite irrespirable. Il est urgent de quitter le 52 ! (entendre la Haute-Marne).
Professeur d’anglais dans un collège, elle décide de s’expatrier en Algérie pour y enseigner la langue de Shakespeare à des têtes brunes et bouclées dont les parents ne sont pas encore remis de la gueule de bois des lendemains d’indépendance. La coopération technique (C.T.) a du bon et est plutôt lucrative... Ce n’est pas pour rien que « C.T. » a été transformée par les Algériens en « course au trésor ». Mais laissons-là ces raisons bassement matérielles. Elles n’expliquent pas à elles seules le choix de Cécile. Non ! il y a aussi un certain Jean Lesaucier dont elle s’est énamourée. Le bonhomme reste plutôt évasif sur ses liens passés avec l’Algérie - pied-noir ? militaire ? barbouze ? ancien de l’OAS ?... Deux choses ne souffrent d’aucune ambiguïté : le pays et ses habitants ne lui sont ni étrangers ni indifférents ( « la trahison gaulienne » ne passe pas) et, côté futur, il compte bien prospérer dans le commerce, se rendre « indispensable au pays ». Pour l’heure, il s’affaire dans l’import-export de... fromages. Mais attention pas n’importe lequel, non du maroille ! du qui ne supporte pas d’être intempestivement retenu au port. La précieuse cargaison est fragile, gare à l’affinage abusif ! gare au prolifique asticot !
Pour Paul, à l’école, les choses auraient pu mal tourner. Dans la cour de récréation, ces nouveaux condisciples, animés d’un solide instinct grégaire, ne se privent pas de bousculer et de railler le nouveau venu fraîchement débarqué de la ci-devant métropole... Mais Paul, un brin affabulateur, n’est pas sans ressources. En France, il habite Colombey-les-Deux-Eglises et la maison de « Mé » (la grand-mère) jouxte celle du Général de Gaulle, celui qui a « niqué les pieds-noirs ». Voilà qui réchauffe le climat des relations franco-algériennes et calme les ardeurs revanchardes. Le Petit gaulliste ne va pas se gratter pour la jouer à l’esbrouffe.
Alain Lorne décrit les premières heures de l’Algérie indépendante, depuis 1963 jusqu’à la veille du coup d’Etat de 1965. Le récit est rythmé par les magouilles, les trafics et autres coups tordus de Lesaucier. Le « socialisme spécifique » a de beaux jours devant lui. La corruption, déjà généralisée, itou. Le ver n’infeste pas les seuls maroilles. Il prolifère et prolifèrera avec constance depuis Ben Bella jusqu’à... mais cela est un autre sujet. Pour l’heure, sous le regard tantôt averti tantôt innocent du Petit gaulliste, la corruption prospère, le marché-noir s’organise, les passe-droits se multiplient, la police politique veille, la suspicion s’intalle, l’aumône - en fait le pillage des bijoux des Algériennes - est érigée en méthode de gouvernement, le mécontentement populaire gronde tandis que l’autogestion finit de démanteler le secteur agricole.
La forme, un brin irrévérencieuce et distante, ne masque nullement la dimension humaine des événements ici davantage suggérées que relatées. Alain Lorne semble interroger l’Histoire et vouloir souligner le peu de choix qu’elle laisse aux Hommes dans la conduite de leur existence. Les Algériens y sont présentés comme les jouets des rivalités entre le FLN et le MNA et des exactions de la police française. Quant au drame vécu par les Pieds-noirs il n’est qu’à pousser la porte de ces maisons abandonnées dans la précipitation, lire de vieilles lettres oubliées et retrouvées par Paul et Antoine ou écouter parler la vieille Madame Ayach pour mesurer ce sentiment d’impuissance.
À l’exception des combines de Lesaucier et du regard porté par Le Petit gaulliste sur le méli-mélo des adultes, le livre ne renferme aucune intrigue romanesque, psychologique ou historique. L’intérêt se niche entre les lignes, il s’entend dans le ton distancé et plein d’humour de l’écriture. Les dialogues, les expressions, le rappel des actualités... restituent les années soixante en France et les lendemains de l’indépendance algérienne. L’espoir illuminait alors l’horizon. Pour l’Algérie, comme pour Paul, la vie commençait...
Edition Actes Sud, 271 pages, 16,9 0 €