Renaud de Rochebrune, Benjamin Stora
La Guerre d’Algérie vue par les Algériens. 1.Le Temps des armes (Des origines à la bataille d’Alger)
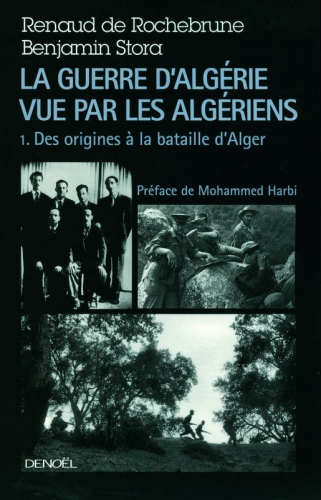 Il y aurait-il un art algérien de la guerre, pour paraphraser le remarquable L’Art français de la guerre (Gallimard 2011) signé Alexis Jenni ? Une façon bien à soi de régler les conflits et les problèmes et surtout - tout l’intérêt du livre de Jenni est là - de s’ingénier, de se fourvoyer, des années après que les armes se soient tues, à creuser le même, le tragique et fatal sillon de la force et de la violence. De cette terrible Guerre d’Algérie, déclenchée il y a tout juste soixante ans cette année, sont nées bien des mémoires, des controverses, des interrogations et autant de regrets. Si, selon la formule de Baltasar Gracián, « faire comprendre est bien meilleur que faire souvenir », le rôle et la fonction de l’historien sont essentiels. Pour peu qu’on lui fiche la paix et singulièrement que les politiques évitent de lui donner des leçons, de lui tenir la jambe et accessoirement le crayon, l’historien peut aider chacun à forger les outils indispensables pour non pas se souvenir, mais comprendre, pour non pas choisir entre le paradis ou l’enfer, mais mieux distinguer l’un de l’autre et en mesurer les enchevêtrements. « Les Algériens en général, cultivent un rapport singulier à leur histoire. C’est à la fois leur paradis et leur enfer » écrit en préface Mohamed Harbi.
Il y aurait-il un art algérien de la guerre, pour paraphraser le remarquable L’Art français de la guerre (Gallimard 2011) signé Alexis Jenni ? Une façon bien à soi de régler les conflits et les problèmes et surtout - tout l’intérêt du livre de Jenni est là - de s’ingénier, de se fourvoyer, des années après que les armes se soient tues, à creuser le même, le tragique et fatal sillon de la force et de la violence. De cette terrible Guerre d’Algérie, déclenchée il y a tout juste soixante ans cette année, sont nées bien des mémoires, des controverses, des interrogations et autant de regrets. Si, selon la formule de Baltasar Gracián, « faire comprendre est bien meilleur que faire souvenir », le rôle et la fonction de l’historien sont essentiels. Pour peu qu’on lui fiche la paix et singulièrement que les politiques évitent de lui donner des leçons, de lui tenir la jambe et accessoirement le crayon, l’historien peut aider chacun à forger les outils indispensables pour non pas se souvenir, mais comprendre, pour non pas choisir entre le paradis ou l’enfer, mais mieux distinguer l’un de l’autre et en mesurer les enchevêtrements. « Les Algériens en général, cultivent un rapport singulier à leur histoire. C’est à la fois leur paradis et leur enfer » écrit en préface Mohamed Harbi.
En France, la recherche historique progresse entre les écueils des conflits mémoriels, les vacarmes législatifs, les silences officiels et autres éructations révisionnistes et nostalgiques vociférées à contre courant de la marche du temps et des hommes. En Algérie, il faudrait que « le métier d’historien, encore balbutiant, cesse d’être soumis à surveillance comme le prône la Constitution ». L’un des enjeux de ce livre est là : en finir avec l’instrumentalisation - idéologique, nationaliste ou mémorielle - dénoncée ici par le préfacier, grognard de l’indépendance algérienne et de historiographie franco-algérienne.
Si le livre ne renouvelle par la recherche et les savoirs sur l’histoire de la guerre d’Algérie, il offre l’occasion de la remettre en perspective, non pas depuis 1954 mais depuis l’irruption de l’armada française sur la terre algérienne jusqu’en 1957, année où se termine ce premier tome. Nos deux auteurs montrent que l’opposition algérienne à la conquête, puis au colonialisme et enfin la revendication d’indépendance, n’a jamais cessé. C’est peut-être le premier enseignement de ce livre : la présence étrangère sur cette terre fut toujours perçue, de manière plus ou moins tranchante, comme illégitime.
Nos deux historiens sont partis en reportage au-delà des lignes, dans les chambres d’appartements modestes où une poignée d’hommes, souvent inexpérimentés, improvisent, « avec les moyens du bord », - plus qu’ils ne décident - l’avenir de l’Algérie et de la France. On les retrouve dans les maquis de Kabylie, des Aurès ou du Constantinois où les quelques centaines de maquisards, sans armes et déguenillés, deviendront quelques milliers qui donneront du fil à retordre à l’une des plus puissantes armées du monde. Ils sont aussi dans les caches de la Casbah avec le commandant Azzedine pour comprendre, expliquer, comment et pourquoi est prise la décision de s’attaquer aux civils.
Les dates qui rythment ce récit ne sont pas choisies au hasard. L’attaque en 1949 de la poste d’Oran, le 1er novembre 1954, le 20 août 1955 et l’insurrection dans le Constantinois, août 1956 et le Congrès de la Soummam et enfin la bataille d’Alger en 1957. Du point de vue algérien, ce sont des moment clefs, des dates charnières. Le hold-up de la poste d’Oran survient deux ans après la création de l’OS (Organisation spéciale) qui montre l’existence d’un groupe d’indépendantistes algériens partisans de la lutte armée. « La nuit de la Toussaint » de 1954 sonne l’heure du passage à l’acte : les hommes qui créent le FLN rompent avec les tergiversations d’hier et décident d’écrire une nouvelle page. Août 1955, Zighout Youcef, le commandant de la wilaya 2 (Constantinois) décide de frapper fort et d’engager la population. Plus que l’insurrection, les représailles de l’armée et des milices creuseront un fossé entre les communautés. Pour les auteurs, le déclenchement de la révolution date de ce 20 août 1955. Au Congrès de la Soummam, où sont repensés les liens entre les membres du FLN de l’extérieur et ceux de l’intérieur, la question du rapport entre politique et militaire, Abane Ramdane offre à l’Algérie les premières lignes programmatiques et organisationnelles de la révolution. Exit ici les références à la religion… Tout cela, sur fond de course au leadership, ne plaira pas à tous, à commencer à Ben Bella, affublé, en France, depuis le début, d’un chapeau bien trop large pour lui. Enfin, la fameuse bataille d’Alger se solde par la « victoire » des paras, mais politiquement, diplomatiquement, sur le plan de l’organisation, le FLN s’est renforcé, même s’il est à la veille de nouveaux conflits internes.
Lorsque l’on parle de cette guerre, on n’évoque pas la même histoire, en France et en Algérie. Et la liste est longue des ignorances réciproques et parfois partagées.
« L’art français de la guerre »
 Ainsi, connaît-on en France les horreurs commises en Algérie au nom de la mission civilisatrice par les troupes de Bugeaud ? Sait-on combien de morts sont à mettre au crédit de ce que les Algériens appelèrent la « syphilisation » ? Entre les années 1830 et 1870, il y eut entre un et trois millions de morts selon les sources, soit entre un tiers et les deux tiers de la population globale, suivant là encore des estimations.
Ainsi, connaît-on en France les horreurs commises en Algérie au nom de la mission civilisatrice par les troupes de Bugeaud ? Sait-on combien de morts sont à mettre au crédit de ce que les Algériens appelèrent la « syphilisation » ? Entre les années 1830 et 1870, il y eut entre un et trois millions de morts selon les sources, soit entre un tiers et les deux tiers de la population globale, suivant là encore des estimations.
Sait-on que ces « indigènes » s’opposèrent continuellement au régime colonial et militèrent, les armes à la main puis politiquement pour que les choses changent. En vain. Toujours en vain…
Sait-on que « la tradition des tripatouillages électoraux » dont on se gausse aujourd’hui quand il sont pratiqués de l’autre côté de la Méditerranées fut inaugurée, mise en place et développée par la France en Algérie ?
Sait-on en France que des Algériens avaient pris le maquis dès 1945 ? Que la torture était pratiquée bien avant la bataille d’Alger ? Que des Algériens ont été liquidés, à Paris, bien avant le 17 octobre 1961 ?
Sait-on aussi que la première revendication officielle d’indépendance remonte à 1927 ?
Sait-on la responsabilité des « civils européens » et de quelques officiels dans le déclenchement des émeutes du 8 mai 1945[i] ? On peut ignorer le nombre de victimes algériennes de la « répression » - de 15 000 à 35 000 morts selon les historiens, 45 000 pour le FLN – mais sait-on que cela se fit au prix de sauvageries, de bombardements aveugles, de villages passés à la mitrailleuse, de « charniers remplis à ras bord », de corps brûlés dans des fours à chaux, et tout cela, avec pour toile de fond, un peuple en liesse qui fêtait la victoire sur la barbarie nazie !? Les Algériens ont-ils tort d’évoquer ici la qualification de « crimes contre l’humanité » ?
Sait-on que la guerre d’Algérie aurait pu commencer dès 1949 ? Sait-on que les consignes données aux militants du 1er novembre 1954 interdisaient l’usage de la violence contre les civils européens (voir page 97 les circonstances rapportées sur la mort des époux Monnerot) ?
Qui connaît en France Ahmed Zahana ? La place que tiendra son exécution, guillotiné le 19 juin 1956, dans le déclenchement de la bataille d’Alger ? Quid d’Abane Ramdane ? De Ben M’hidi (assassiné sur ordre par le commandant Aussaresses[ii] )?
Sait-on que la première bombe à Alger qui vise aveuglément des civils innocents explosa rue de Thèbes en aout 1956 et est l’œuvre des ultras de l’Algérie française ? Que les auteurs étaient connus et qu’ils n’ont jamais été inquiétés ? Se doute-t-on, ici, que le « contre-terrorisme » a pu précéder les « terroristes » ? Qui connaît en France celui qui seul incarna l’honneur de son pays aux heures sombres où les soldats de la République torturaient : Paul Teitgen[iii] ?
Sait-on la part de l’intransigeance des ultras, les responsabilités des autorités dans l’inéluctabilité de la lutte armée ; et des monstruosités ? Se doute-t-on, en France, à quel point les responsables français, de la métropole et plus encore ceux d’Alger, ne comprirent rien à cette lutte algérienne, la renvoyant à un panarabisme piloté depuis le Caire ou à l’avant poste du communisme international ?
Sait on en France que dans l’Algérie de papa « à peine 15% des hommes et 6% des femmes parlent plus ou moins bien le français » ? Qu’il existait des « camps d’hébergement » que les Algériens appelaient « camps de concentration », que des villages entiers étaient « nettoyés », vidés de leurs populations[iv] ?
Se placer du côté algérien c’est déjà, en ces années 1945-1957, montrer la disproportion des méthodes utilisées, l’aveuglement et la surdité politiques, les horreurs infligées aux populations au nom de la « responsabilité collective » et la torture érigée en système d’un régime colonial devenu insurrectionnel, bafouant et défiant l’Etat de droit [v].
« Le paradis et l’enfer »
Mais cette « guerre d’Algérie vue pas les Algériens » révèlera ou rappellera au lecteur d’autres faits d’importance : sait-on, en Algérie cette fois, que le nationalisme algérien fut pluriel ? Qu’il fut traversé par moult conflits opposant réformistes et indépendantistes ; politiques et partisans de l’action armée, politiques et militaires ? Que ces oppositions se réglèrent souvent dans une « atmosphère de méfiance et de règlements de comptes » ? Il y eut certes le FLN, mais quid du MNA de Messali Hadj ? Quid des voix démocrates ? Quid des alternatives pluriculturelle et laïque portées aussi par des militants indépendantistes ? De ce point de vue, ce livre pointe aussi les absences et les amnésies de l’histoire officielle, algérienne cette fois.
C’est par la violence que les Algériens règleront leurs désaccords, et très tôt, avant même la création du FLN, (voir par exemple la crise dite « berbériste » de 1949). Qu’en est-il alors de la violence exercée contre le peuple, contre les mous, les pacifistes et ceux qui ne partageaient pas la ligne dictée par le FLN ? Quelle place le peuple algérien tenait-il pour les cadres du FLN ? N’était-il qu’un simple pion que l’on pouvait exposer au moindre risque, voir sacrifier (en août 55 dans le nord-constantinois, ou en octobre 61 à Paris ) ? Que sait-on en Algérie des massacres de Ioun-Dagen (Bejaïa) en 1956 et de Melouza en 1957 ? Comment, entre étonnement, réserve, indifférence, hostilité, peur, adhésion, évolua l’attitude des populations algériennes ? Quid de la responsabilité de Zighout Youcef dans l’usage de la violence contre les civils ? Des règlements de compte ordonnés par Abane Ramdane contre les militants algériens du MNA ? Se doute-t-on en Algérie du service que les Français ont rendu en organisant, le 22 octobre 1956, le premier détournement d’avion de l’histoire, évitant ainsi au mouvement nationaliste sa première guerre des chefs ?
Alexis Jenni repère dans la façon dont la société française se penche sur ses problèmes, un lourd héritage belliciste et, disons-le, suicidaire. De Rochebrune et Stora en pointant, côté algérien, les bifurcations de l’histoire, les choix retenus, les rivalités de personnes, de pouvoir, d’orientation, le parti pris de la violence, l’instrumentalisation sacrificielle du peuple, les mystères qui entourent encore certaines dates et certains événements, montrent que la société algérienne a sans doute aussi hérité d’un art particulier de faire la guerre. L’histoire rejoint ici la littérature dans le processus d’édification démocratique. Et ce par delà les frontières.
Sans doute ce ne sont ni les mêmes dates, ni les mêmes personnalités que l’histoire des deux pays retient. Ce ne sont pas non plus les mêmes causes qui sont associées à tel ou tel effet. En montrant où et en quoi la guerre d’Algérie ne recouvre pas, en France et en Algérie, les mêmes vérités, ce livre contribue à comprendre les différences de focale pour, peut-être, demain, contribuer au projet d’un manuel d’histoire franco-algérien, commun aux élèves des deux pays.
Préface de Mohammed Harbi. Edition Denoël, 2011, 446 pages, 23,50€
[i] Voir le livre de Jean Pierre Peyroulou, Guelma, 1945. Une subversion française dans l’Algérie coloniale. Préface de Marc Olivier Baruch, éd. La Découverte, 2009
[ii] Lire le roman de Jérôme Ferrari, Où j’ai laissé mon âme, Actes Sud 2010
[iii] Lire, une fois de plus, les pages fortes que lui consacre Alexis Jenni, dans L’Art français de la guerre, Gallimard, 2011
[iv] Voir Sylvie Thénault, Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence, éd. Odile Jacob, 2012
[v] Il faut lire là aussi le livre de Claire Mauss-Copeaux intitulé Algérie, 20 août 1955. Insurrection, répression, massacres, éd. Payot 2011.
 Ce n’est pas sans craintes que l’on aborde un roman avec un titre aussi kitsch. Kabylie Twist… Trop souvent, le clinquant n’augure rien de bon. Et pourtant dès les premières pages, l’appréhension tombe. On découvre une histoire ficelée où se croise une dizaine de personnages et, même si cela patine en cours de route, les ressorts du récit, les émotions transmises, la densité des caractères et des situations très diverses emportent l’adhésion. Kabylie Twist c’est la guerre d‘Algérie avec pour toile de fond les années 60-62 en métropole, le twist, les vinyles et autres yéyés. La nuit et le jour, l’enfer et le paradis séparés par une mer, un gouffre pour une génération d’appelés. C’est en « métropole » que s’ouvre le roman : un temps et une société parfaitement rendus par les ambiances (Saint-Tropez, la Madrague, B.B.), les dialogues, le vocabulaire... Sylvie, la jeune femme aux allures de Sagan roule en Aston Martin rouge, les cheveux au vent. Richard, alias Ricky Drums, batteur du groupe les Fury’s, espère enregistrer son premier 45 tours chez Philips. Les deux tourtereaux s’aiment. Mais voilà, feuille de route en poche, Richard doit du jour au lendemain laisser tomber ses illusions et son amour : direction l’Algérie et pas pour y maintenir un peu d’ordre, pas pour de simples « événements » mais pour tomber dans une guerre des plus atroces ; et pas pour quelques semaines, pour vingt-huit mois. Toute une vie pour une génération ! L’essentiel du roman se passe ici, en Algérie, entre les opérations dans le bled et la petite communauté pied noire de Djidjelli (l’actuelle Jijel).
Ce n’est pas sans craintes que l’on aborde un roman avec un titre aussi kitsch. Kabylie Twist… Trop souvent, le clinquant n’augure rien de bon. Et pourtant dès les premières pages, l’appréhension tombe. On découvre une histoire ficelée où se croise une dizaine de personnages et, même si cela patine en cours de route, les ressorts du récit, les émotions transmises, la densité des caractères et des situations très diverses emportent l’adhésion. Kabylie Twist c’est la guerre d‘Algérie avec pour toile de fond les années 60-62 en métropole, le twist, les vinyles et autres yéyés. La nuit et le jour, l’enfer et le paradis séparés par une mer, un gouffre pour une génération d’appelés. C’est en « métropole » que s’ouvre le roman : un temps et une société parfaitement rendus par les ambiances (Saint-Tropez, la Madrague, B.B.), les dialogues, le vocabulaire... Sylvie, la jeune femme aux allures de Sagan roule en Aston Martin rouge, les cheveux au vent. Richard, alias Ricky Drums, batteur du groupe les Fury’s, espère enregistrer son premier 45 tours chez Philips. Les deux tourtereaux s’aiment. Mais voilà, feuille de route en poche, Richard doit du jour au lendemain laisser tomber ses illusions et son amour : direction l’Algérie et pas pour y maintenir un peu d’ordre, pas pour de simples « événements » mais pour tomber dans une guerre des plus atroces ; et pas pour quelques semaines, pour vingt-huit mois. Toute une vie pour une génération ! L’essentiel du roman se passe ici, en Algérie, entre les opérations dans le bled et la petite communauté pied noire de Djidjelli (l’actuelle Jijel). Si 2013 annonçait le centenaire de la naissance d’Albert Camus, 2012 marquait le cinquantenaire de sa disparition et le soixante-dixième anniversaire de la parution du roman l’Etranger. Les éditions Gallimard et Futuropolis se sont associées à cette occasion pour en offrir une édition originale, un beau livre selon la formule consacrée, qui présente deux originalités : le grand format d’abord et un nouveau découpage du célèbre roman et surtout les dessins de l’Argentin José Muñoz qui accompagnent le texte de l’enfant de Belcourt.
Si 2013 annonçait le centenaire de la naissance d’Albert Camus, 2012 marquait le cinquantenaire de sa disparition et le soixante-dixième anniversaire de la parution du roman l’Etranger. Les éditions Gallimard et Futuropolis se sont associées à cette occasion pour en offrir une édition originale, un beau livre selon la formule consacrée, qui présente deux originalités : le grand format d’abord et un nouveau découpage du célèbre roman et surtout les dessins de l’Argentin José Muñoz qui accompagnent le texte de l’enfant de Belcourt. Une longue phrase, sans points. Comme si l’histoire ici racontée n’avait pas cessé de se poursuivre, de progresser dans les méandres d’une ponctuation toujours provisoire, jamais définitive, renouvelée, jusqu’au point d’interrogation final. La phrase pourrait commencer au temps lointain de la colonisation et de la guerre et se poursuivre jusque cinquante ans après, sur les deux rives presque voisines de la Méditerranée. Sylvain Prudhomme évoque la Guerre d’Algérie, la colonisation et ses lendemains, en France et en Algérie, avec beaucoup de finesse, de force et d’audace. Avec originalité aussi. Il y a l’Histoire et il y a la vie des hommes, aussi misérable ou modeste soit-elle. L’histoire ne retient que le rapport du maître à l’esclave. Un rapport de domination qui doit se terminer par la mort de l’un des deux. Ici, au temps de la colonisation, Bahi est au service de Malusci, le petit « indigène » et le grand colon : et bien ces deux là ne s’entretueront pas ! Ils s’aimeront tout au contraire et Malusci échappera plus d’une fois à la mort ! Trois fois miraculé au moins ! Malusci avait peut-être la baraka ! « Le cul borné de nouilles », il bénéficiait aussi de la protection de quelques « amis ». A l’heure où autour de lui les autres Pieds Noirs partent, où les autres fermes de colons brûlent, le petit Bahi tentera bien de prévenir Malusci, de le mettre en garde contre son « aveuglement », son « insouciance, en vain. Brutal et touchant à la fois, « rien ne me fera partir disait-il en me donnant une bourrade comme un père aurait dit à son fils, jamais je ne t’abandonnerai ». Jusqu’au jour où, plus personne ne pourra plus le protéger ; ni Bahi, ni son père, son oncle, le cousin Mohamed ou Kacem, l’un de ses ouvriers préférés. Il n’aura alors plus le choix : il devra partir ou mourir. Des années après, Malusci restait « exempt de reproches et de rancune » au village, chez les Algériens, ce qui n’était pas forcément le cas des autres colons.
Une longue phrase, sans points. Comme si l’histoire ici racontée n’avait pas cessé de se poursuivre, de progresser dans les méandres d’une ponctuation toujours provisoire, jamais définitive, renouvelée, jusqu’au point d’interrogation final. La phrase pourrait commencer au temps lointain de la colonisation et de la guerre et se poursuivre jusque cinquante ans après, sur les deux rives presque voisines de la Méditerranée. Sylvain Prudhomme évoque la Guerre d’Algérie, la colonisation et ses lendemains, en France et en Algérie, avec beaucoup de finesse, de force et d’audace. Avec originalité aussi. Il y a l’Histoire et il y a la vie des hommes, aussi misérable ou modeste soit-elle. L’histoire ne retient que le rapport du maître à l’esclave. Un rapport de domination qui doit se terminer par la mort de l’un des deux. Ici, au temps de la colonisation, Bahi est au service de Malusci, le petit « indigène » et le grand colon : et bien ces deux là ne s’entretueront pas ! Ils s’aimeront tout au contraire et Malusci échappera plus d’une fois à la mort ! Trois fois miraculé au moins ! Malusci avait peut-être la baraka ! « Le cul borné de nouilles », il bénéficiait aussi de la protection de quelques « amis ». A l’heure où autour de lui les autres Pieds Noirs partent, où les autres fermes de colons brûlent, le petit Bahi tentera bien de prévenir Malusci, de le mettre en garde contre son « aveuglement », son « insouciance, en vain. Brutal et touchant à la fois, « rien ne me fera partir disait-il en me donnant une bourrade comme un père aurait dit à son fils, jamais je ne t’abandonnerai ». Jusqu’au jour où, plus personne ne pourra plus le protéger ; ni Bahi, ni son père, son oncle, le cousin Mohamed ou Kacem, l’un de ses ouvriers préférés. Il n’aura alors plus le choix : il devra partir ou mourir. Des années après, Malusci restait « exempt de reproches et de rancune » au village, chez les Algériens, ce qui n’était pas forcément le cas des autres colons.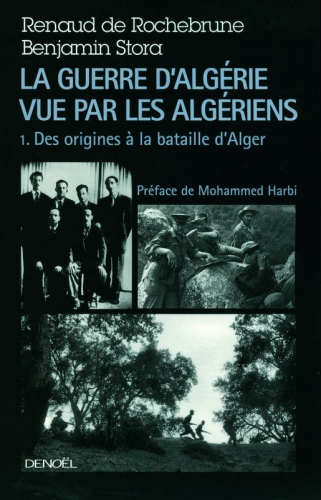 Il y aurait-il un art algérien de la guerre, pour paraphraser le remarquable L’Art français de la guerre (Gallimard 2011) signé
Il y aurait-il un art algérien de la guerre, pour paraphraser le remarquable L’Art français de la guerre (Gallimard 2011) signé  Ainsi, connaît-on en France les horreurs commises en Algérie au nom de la mission civilisatrice par les troupes de Bugeaud ? Sait-on combien de morts sont à mettre au crédit de ce que les Algériens appelèrent la « syphilisation » ? Entre les années 1830 et 1870, il y eut entre un et trois millions de morts selon les sources, soit entre un tiers et les deux tiers de la population globale, suivant là encore des estimations.
Ainsi, connaît-on en France les horreurs commises en Algérie au nom de la mission civilisatrice par les troupes de Bugeaud ? Sait-on combien de morts sont à mettre au crédit de ce que les Algériens appelèrent la « syphilisation » ? Entre les années 1830 et 1870, il y eut entre un et trois millions de morts selon les sources, soit entre un tiers et les deux tiers de la population globale, suivant là encore des estimations. Rue Darwin interpelle davantage l’Algérie que la société française. Du moins, pourrait-on le croire. Car, à bien lire, les questions migratoires et mémorielles, comme la question du lien entre les deux pays parcourent aussi le roman de Sansal. Ce texte allégorique, évoque l’histoire récente et troublée, la quête des origines, la mémoire ("Il n’y a pas d’oubli sans une vraie mémoire des choses") et les identités. Ici, elles « ne s’additionnent pas, elles se dominent. Et se détruisent »
Rue Darwin interpelle davantage l’Algérie que la société française. Du moins, pourrait-on le croire. Car, à bien lire, les questions migratoires et mémorielles, comme la question du lien entre les deux pays parcourent aussi le roman de Sansal. Ce texte allégorique, évoque l’histoire récente et troublée, la quête des origines, la mémoire ("Il n’y a pas d’oubli sans une vraie mémoire des choses") et les identités. Ici, elles « ne s’additionnent pas, elles se dominent. Et se détruisent »
 C’est un long et riche entretien que donnent ici Yves Lacoste, géographe, historien, célèbre figure de proue de la géopolitique française et fondateur en 1976 de la revue Hérodote et Pascal Lorot, président de l’institut Choiseul et directeur des revues Géoéconomie et Sécurité globale. Riche parce que les discussions portent aussi bien sur la vie d’Yves Lacoste depuis l’origine quercynoise de la famille, les amis, ses lectures jusqu’au Maroc natal et les nombreux pays visités, pays d’études ou de résidence, en passant par les domaines de recherche de l’universitaire et les controverses qui ont émaillé plus de cinquante ans de vie intellectuelle hexagonale, de la question coloniale au récent débat sur l’identité et la nation.
C’est un long et riche entretien que donnent ici Yves Lacoste, géographe, historien, célèbre figure de proue de la géopolitique française et fondateur en 1976 de la revue Hérodote et Pascal Lorot, président de l’institut Choiseul et directeur des revues Géoéconomie et Sécurité globale. Riche parce que les discussions portent aussi bien sur la vie d’Yves Lacoste depuis l’origine quercynoise de la famille, les amis, ses lectures jusqu’au Maroc natal et les nombreux pays visités, pays d’études ou de résidence, en passant par les domaines de recherche de l’universitaire et les controverses qui ont émaillé plus de cinquante ans de vie intellectuelle hexagonale, de la question coloniale au récent débat sur l’identité et la nation.  Face à face l’historien et le journaliste. Le temps long et l’actualité. Ce sont deux regards sur le monde qui se déploient ici. D’un côté l’œil pétillant, perçant, curieux de l’homme d’information, de l’autre, le regard calme, attentif, presque introspectif de l’universitaire. Deux intelligences aussi, l’une plus théorique,
Face à face l’historien et le journaliste. Le temps long et l’actualité. Ce sont deux regards sur le monde qui se déploient ici. D’un côté l’œil pétillant, perçant, curieux de l’homme d’information, de l’autre, le regard calme, attentif, presque introspectif de l’universitaire. Deux intelligences aussi, l’une plus théorique, 
 Premier roman publié pour ce prof de SVT. Premier roman et Goncourt à la clef. Pour un coup gagnant, c’était un coup gagnant. Et toc ! donc pour ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal, sans concessions, au style ondoyant dans lequel viennent s’enchâsser d’heureuses ritournelles. C’est un mille feuilles ou plutôt un plat de lasagnes que sert ici le cuistot devenu du jour au lendemain chef étoilé es littérature : il alterne les couches d’Histoire et les couches d’actualité. Le rouge sang d’une « guerre de vingt ans » - de la Libération aux guerres coloniales - imprègne le spongieux des pâtes d’une modernité pâlotte et souffreteuse.
Premier roman publié pour ce prof de SVT. Premier roman et Goncourt à la clef. Pour un coup gagnant, c’était un coup gagnant. Et toc ! donc pour ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal, sans concessions, au style ondoyant dans lequel viennent s’enchâsser d’heureuses ritournelles. C’est un mille feuilles ou plutôt un plat de lasagnes que sert ici le cuistot devenu du jour au lendemain chef étoilé es littérature : il alterne les couches d’Histoire et les couches d’actualité. Le rouge sang d’une « guerre de vingt ans » - de la Libération aux guerres coloniales - imprègne le spongieux des pâtes d’une modernité pâlotte et souffreteuse.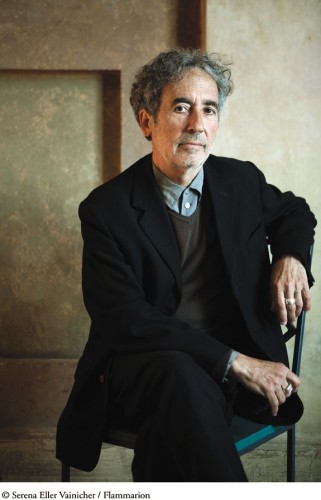 Paru un an avant les célébrations du cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne, Les Vieux fous de Mathieu Belezi expédiait une charge lourde, puissante et efficace contre ce que fut la colonisation.
Paru un an avant les célébrations du cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne, Les Vieux fous de Mathieu Belezi expédiait une charge lourde, puissante et efficace contre ce que fut la colonisation.