Lakhdar Belaïd
Sérail killers
 Les lointains et douloureux échos de la guerre d’Algérie n’en finissent pas de résonner, d’agiter les esprits, de réveiller des consciences voire de vieux démons. L’actualité fourmille d’exemples à commencer par la multiplication des colloques, articles de presse et autres publications.
Les lointains et douloureux échos de la guerre d’Algérie n’en finissent pas de résonner, d’agiter les esprits, de réveiller des consciences voire de vieux démons. L’actualité fourmille d’exemples à commencer par la multiplication des colloques, articles de presse et autres publications.
Dans ce premier roman, Sérail killers, le journaliste Lakhdar Belaïd laisse remonter à la surface un autre épisode dramatique de la guerre d’Algérie, celui qui a opposé nationalistes algériens et harkis. Le cadavre de Farid Hand-Lounis repêché dans le canal de Roubaix et une vague de meurtres visant des Algériens font craindre le retour de cette guerre intestine. Pour l’heure, de vieux et méchants souvenirs affleurent qui tentent de donner sens à ces assassinats. Les deux lascars qui mènent l’enquête portent les stigmates de ce lointain conflit. Lakhdar, le journaliste, est le fils d’un nationaliste algérien, tendance messaliste. Bensalem, le flic, est le fils d’un harki... c’est dire si la relation entre ces deux copains de la communale peut parfois être explosive. Ensemble, ils découvriront l’existence d’un incroyable “ Plan X ” visant à réveiller et instrumentaliser de vieilles haines et des blessures toujours douloureuses.
Avec doigté et subtilité, Lakhdar Belaïd met en scène les fils de l’intrigue. La vivacité et la légèreté de son écriture rendent avec délectation l’oralité d’une langue où quelques mots arabes ponctuent, pimentent un français frondeur.
Les horreurs et les corps refroidis ne parviennent pas à enfermer dans leur remugle la fraîcheur du texte. La personnalité des deux enquêteurs y contribue pour beaucoup comme celle de Dalila, la femme de Lakhdar. Tous deux forment un couple symptomatique. Musulmans (surtout elle...), ils respectent le jeûne du mois de ramadan. Sans ostentation. Dans la simplicité, loin des gesticulations religieuses ou communautaires. Leur réussite professionnelle s’est construite dans l’anonymat. Sans rien devoir à personne. Sans rien devoir prouver. Il n’y a d’ailleurs rien à prouver. Les personnages de Lakhdar Belaïd montrent une réalité par trop occultée : celle d’hommes et de femmes, français d’origine étrangère et de confession musulmane (ou pas d’ailleurs...), bien dans leur tête, complètement inscrits dans l’ici et le maintenant. Les couples s’aiment, se font l’amour, se chamaillent en toute candeur et la femme ne se voit pas reléguée dans un statut de mineur.
Un large pan de la société française est ici rapporté qui cloue le bec aux représentations fantasmées et aux discours de représentants autoproclamés d’une introuvable communauté.
La fraîcheur exhale aussi du ton. Lakhdar Belaïd, sans jamais se prendre au sérieux et sans en avoir l’air, balaie les dangereuses “ certitudes badigeonnées de bonne conscience ” et va loin dans la compréhension de sujets historiques ou d’actualités : la Guerre d’Algérie, la question harkie, les chausse-trapes réservées par les élus aux jeunes issus de l’immigration, les mœurs et les magouilles politiques, le quotidien des populations issues de l’immigration, les pratiques associatives, l’insupportable islam des convertis et le non moins insupportable islam des faux bigots mais vrais geôliers d’ “ épouses emballées sous toile cirée et embastillées à la maison ”....
Le lecteur s’amusera à tirer la morale de cette histoire. Avec l’auteur, il ne rechignera pas longtemps à se soulager d’un roboratif : “ nique les hypocrites ” à la face des tartuffes de tous poils - faux dévots musulmans, faux démocrates, algériens ou français, mais vrais magouilleurs, bonimenteurs de l’intégration et autres zappeurs idéologiques en mal de subventions. Ah, que ce livre fait du bien !
Collection Série noire, éd. Gallimard, 255 pages
-
-
Comment être autochtone. Du pur Athénien au Français raciné
Marcel Detienne
Comment être autochtone. Du pur Athénien au Français raciné
 Dans cet essai au style impertinent et inattendu, léger et souvent drôle l’auteur remonte aux sources des mythes qui fondent les autochtonies et autres identités, autrement dit la manière dont les peuples s’y prennent pour « faire leur trou ». Marcel Detienne, spécialiste de la Grèce antique, montre comment se forment les « mythidéologies », ces discours à la fois mythe et idéologie qui officialisent mordicus l’origine d’un peuple, la pureté d’un lignage, la supériorité d’une communauté. De l’autochtonie athénienne d’immaculé conception, sans mélange et sans alliage, à la terre et aux morts de Barrès, Marcel Detienne montre comment, en contrepoint, se dessine la figure de l’Autre, de l’étranger, de l’exilé, du fugitif, du citoyen adopté ou naturalisé et, pire encore, de l’immigré. De ce point de vue, la France de Sarkozy ou l’Europe qualifiée par certains de « forteresse » n’a rien inventé, il suffit de remonter aux sources, à ces idées fortes du « discours officiel » de cette mythidéologie de nos Grecs, ceux qui n’en finissent pas de nous habiter, par nos histoires nationales, en France et en Allemagne, du XIXe siècle à aujourd’hui ».
Dans cet essai au style impertinent et inattendu, léger et souvent drôle l’auteur remonte aux sources des mythes qui fondent les autochtonies et autres identités, autrement dit la manière dont les peuples s’y prennent pour « faire leur trou ». Marcel Detienne, spécialiste de la Grèce antique, montre comment se forment les « mythidéologies », ces discours à la fois mythe et idéologie qui officialisent mordicus l’origine d’un peuple, la pureté d’un lignage, la supériorité d’une communauté. De l’autochtonie athénienne d’immaculé conception, sans mélange et sans alliage, à la terre et aux morts de Barrès, Marcel Detienne montre comment, en contrepoint, se dessine la figure de l’Autre, de l’étranger, de l’exilé, du fugitif, du citoyen adopté ou naturalisé et, pire encore, de l’immigré. De ce point de vue, la France de Sarkozy ou l’Europe qualifiée par certains de « forteresse » n’a rien inventé, il suffit de remonter aux sources, à ces idées fortes du « discours officiel » de cette mythidéologie de nos Grecs, ceux qui n’en finissent pas de nous habiter, par nos histoires nationales, en France et en Allemagne, du XIXe siècle à aujourd’hui ».S’appuyant sur des auteurs qui lui sont familiers, (Euripide, Socrate, Platon, Eschyle, Pindare et des historiens, Hérodote et Thucydide) il rappelle au lecteur oublieux ou ignorant (qui court alors le risque de s’y perdre !) les mythes et légendes au commencement de deux cités grecques : Athènes la pure et Thèbes l’impure. À cette dernière va la préférence de l’érudit et impertinent professeur qui, sur sa lancé, démonte le dangereux mécano d’une France « racinée » et sermonne les historiens fautifs (Boulainvilliers, Barrès, Lavisse, Alphonse Dupront et même Braudel).
Cette ballade dans la Grèce antique « donne le plaisir de mettre le « naître impur » dans la maison de Cadmos [Thèbes] en face de la belle autochtonie athénienne, tout en découvrant combien la hantise du sang épuré de la vieille France alterne aimablement avec la satisfaction du bel enraciné d’hier et d’aujourd’hui sur l’Hexagone d’après-guerre ». Car l’objectif n’est pas de faire œuvre d’érudition ou de conjuguer au passé l’intérêt de cette passionnante réflexion. Ce travail comparé sur les différentes manières de se dire autochtone ou de se vouloir « de souche » - il est question de la Grèce du Ve siècle et de la France mais aussi des mythes de populations africaines et amérindiennes – vise à une autre enquête comparative : « comment dénationaliser les histoires nationales ? ». Au passage, elle rappelle aussi une exclusion à l’œuvre dans la plupart de ces « mythidéologies » : « que de déceptions, d’humiliations !, ces récits, ces discours sur l’autochtonie, car de quoi s’agit-il sinon de « dénier le ventre féminin ».
Ainsi va le monde qui, face à la montée des périls, des fermetures chauvines et du racisme voit se multiplier les métissages et les identités plurielles et partant, la nécessité de fonder de nouveaux repères, de nouvelles raisons de vivre ensemble et d’appréhender l’Autre. Autant d’interrogations qui débouchent sur la remise en cause des histoires nationales, ce qui conduit d’ailleurs l’éminent helléniste à suggérer de voir l’histoire de la France en dehors de l’hexagone.
Pour renforcer son pertinent point de vue, Marcel Detienne invite un publiciste (sans doute parce qu’ils sont aujourd’hui, et trop souvent, les nouveaux maîtres à penser). Mais pas n’importe lequel, un petit jeune, plein de promesses qui lui, à la différence de ses confrères halés et dorés à souhait, bien mis et bien pensants, Rolex au poignet, vaut le détour. La pub dit : « Personne n’a originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu’à un autre ». Elle est signée, Kant !
Edition du Seuil, 2003, 174 pages, 16 euros
-
Les Paludiques
Mourad Djebel
Les Paludiques
 Les lecteurs de Sens interdits et des Cinq et une nuits de Shahrazède, les deux romans de l’Algérien Mourad Djebel ne seront pas étonnés de découvrir Les Paludiques, son premier recueil de poèmes, tant son écriture était déjà empreinte d’une force poétique et d’une légitime virulence concentrée dans une langue furibarde, malaxée, triturée et malmenée ad libitum. Les Paludiques, brûle de la même fièvre, celle du poète en proie au délire, aux fulgurances, celle du veilleur insomniaque qui connaît les affres de l’angoisse et des pensées qui pèsent tandis que tous dorment en paix. Classique « fonction apodictique » de l’aède qui ausculte « cette plaie du monde cette plaie de soi », « ce nœud goitreux / Entre soi et le monde. »
Les lecteurs de Sens interdits et des Cinq et une nuits de Shahrazède, les deux romans de l’Algérien Mourad Djebel ne seront pas étonnés de découvrir Les Paludiques, son premier recueil de poèmes, tant son écriture était déjà empreinte d’une force poétique et d’une légitime virulence concentrée dans une langue furibarde, malaxée, triturée et malmenée ad libitum. Les Paludiques, brûle de la même fièvre, celle du poète en proie au délire, aux fulgurances, celle du veilleur insomniaque qui connaît les affres de l’angoisse et des pensées qui pèsent tandis que tous dorment en paix. Classique « fonction apodictique » de l’aède qui ausculte « cette plaie du monde cette plaie de soi », « ce nœud goitreux / Entre soi et le monde. »Mourad Djebel appartient à cette génération d’écrivains et d’artistes algériens, auteurs d’une œuvre « tangente à l’opposé du degré quatre-vingt-dix et au cercle des portes bannières ». Démiurges d’une littérature incandescente où brûleraient d’un feu salvateur les démons qui hantent cette terre-carrefour plusieurs fois martyre et cependant toujours féconde. Cette incandescence brûle d’abord les tripes du poète fiévreux, « grelottant » d’une « pyrexie protéiforme » de sorte que l’écriture est une conséquence paludique : « la garde rouge-artillerie / des verbes suppurant le pus ».
« Préparant un babil-Esperanto qui écorche de stridence vos sensibles âmes télégéniques », l’auteur tient en réserve « des kilomètres de fureurs : configuration improbable étanche à la beauté consensuelle / je me biffe de tous les registres / me corne et m’improvise en barbare à moins d’incarner Satan / (somme toute) il est dit qu’il fut le premier réfractaire ». Langue réfractaire donc, voulue, revendiquée même, « obscure et difforme ».
Certes, cette « bile » suppurent des massacres, celui de Bentalha et de tant d’autres. Mais ces fièvres paludéennes sont le triste héritage d’« hypermnésies » et d’une « crasse millénaire » incarnée par un corps lui-même « territoire mnémonique tant razzié ». Que « L’HISTOIRE de nous s’abstienne » crie Mourad Djebel, car le passé « crible l’instant de shrapnells ». De ce côté-ci de Mare Nostrum aussi : « Vos tentatives d’identifications laconiques – à entêtes réglementaires – policière / mes empreintes génitales / genèse de vos geignement passés et à venir / s’y refusent / qu’ils me classent / sans ma participation me répartissent / dans toutes les cases pré ou post mortem ». M.Djebel n’a que faire de la fausse bonne conscience et des sentiments à deux sous. Peut lui chaut l’hypocrisie, des « on reste solidaire du peuple machin chouette » : « des vies par contingents, par containers, par concomitance d’essaims et de destins, filaient à l’anglaise en passant par la case indienne pour ne pas filer le mauvais coton celluloïd hémophile des linceuls. Mais les filières furent écourtées de cul-de-sac aux guérites consulaires. »
Assez dit le poète : « stoppez ce monde / cette terre / je veux prendre la prochaine ». Il se réfugie dans les nuits votives, l’ivresse, l’amour - « et j’ai pris ta peau pour religion et territoire ». Mais point d’échappatoire sauf à dénicher ce « plus petit – devis divin – diviseur commun au genre humain » qui permettra au « temps » et à « l’Histoire » d’improviser « sans guide d’ailleurs/ une hyperbole soluble autrement que par la revanche le suicide ou la guerre. »

Avec le « petit-fils des transhumances – enfants des salsugineux scarifié au cœur », « barbaresque de naissance comme toutes les convergences », il faut (ré)apprendre l’instant présent, un temps « décontaminé » de « fut » et de « devenir. Le suivre « pour trouver le chemin du / Recommencement ». Et, après Machado ou Pessoa, retrouver cette vérité universelle déclinée depuis des siècles par toutes les sagesses du monde : « Le chemin m’indiques-tu / Celui qui s’en va doit savoir / Qu’il ne saurait / Retrouver intact / Ni le seuil ni la lumière ni les sourires / Mais le chemin / Comme les lignes de la main / (est) Demeure ».
La Différence, 2006, 77 pages, 12 €
-
Les Cinq et une nuits de Shahrazède
Mourad Djebel
Les Cinq et une nuits de Shahrazède
 « Nous sommes issus de tant de brassages, de métissages, certes dans la violence et l’invasion, mais ils sont réels et constituent un rempart contre l’hégémonisme, contre le fanatisme, et un chemin à creuser pour peu qu’on cultive cette diversité pour asseoir un autre type, un nouveau type de légitimité de l’État. Si l’on n’infléchit pas la tendance de l’Unique, nous courons à la catastrophe (…) ». Ainsi, tandis que le pouvoir algérien interdisait à son peuple le droit de lire le dernier Boualem Sansal (Poste restante paru chez Gallimard) et que son vieux dirigeant renouait avec les non moins vieux démons d’une conception figée et exclusive de l’identité algérienne, les romanciers du cru continuent eux, contre vents et marées, de disséquer la « monstruosité nés des humiliations et des défaites de l’Histoire », une « monstruosité » qui aujourd’hui « se nourrit des modernes frustrations ». Mourad Djebel appartient à cette génération-lotus d’écrivains algériens, sortie du bourbier des années 90. On lui doit déjà Sens interdits, paru en 2001 chez le même éditeur. L’Algérie demeure au cœur de son texte, une Algérie kaléidoscopique, débarrassée des pesanteurs spatiales et temporelles, une Algérie à plusieurs voix, déployée en plusieurs registres et langues. Plus encore que ses aînés, Kateb Yacine, Rachid Boudjedra ou le premier Boualem Sansal, celui du Serment des barbares, Mourad Djebel bouscule le cadre narratif pour rendre au plus près cette Algérie entre diversité et cauchemars…
« Nous sommes issus de tant de brassages, de métissages, certes dans la violence et l’invasion, mais ils sont réels et constituent un rempart contre l’hégémonisme, contre le fanatisme, et un chemin à creuser pour peu qu’on cultive cette diversité pour asseoir un autre type, un nouveau type de légitimité de l’État. Si l’on n’infléchit pas la tendance de l’Unique, nous courons à la catastrophe (…) ». Ainsi, tandis que le pouvoir algérien interdisait à son peuple le droit de lire le dernier Boualem Sansal (Poste restante paru chez Gallimard) et que son vieux dirigeant renouait avec les non moins vieux démons d’une conception figée et exclusive de l’identité algérienne, les romanciers du cru continuent eux, contre vents et marées, de disséquer la « monstruosité nés des humiliations et des défaites de l’Histoire », une « monstruosité » qui aujourd’hui « se nourrit des modernes frustrations ». Mourad Djebel appartient à cette génération-lotus d’écrivains algériens, sortie du bourbier des années 90. On lui doit déjà Sens interdits, paru en 2001 chez le même éditeur. L’Algérie demeure au cœur de son texte, une Algérie kaléidoscopique, débarrassée des pesanteurs spatiales et temporelles, une Algérie à plusieurs voix, déployée en plusieurs registres et langues. Plus encore que ses aînés, Kateb Yacine, Rachid Boudjedra ou le premier Boualem Sansal, celui du Serment des barbares, Mourad Djebel bouscule le cadre narratif pour rendre au plus près cette Algérie entre diversité et cauchemars…Au centre du roman il y a le cycle des cinq nuits, ces cinq nuits durant lesquelles Loundja alias Shahrazède tente de dévier de sa « trajectoire autodestructrice » son ancien élève et ami, Shahriyar. Comme dans Les 1001 et une nuits, le conte, la littérature - ici le récit fondateur du Voyageur et de la Sahélienne - pourrait-elle être une arme de combat pour échapper « à la folie d’une réalité cauchemardesque », une arme contre la mort ?
Au cours de ces cinq nuits, le passé, les espoirs et les désillusions des deux amants défilent sur fond d’histoire algérienne, depuis les promesses trahies d’un « avenir radieux » en juillet 1962 jusqu’à « cette folie de sang qui se pare, comme une putain fardée, de principes humains ou divins » en passant par les massacres et tortures d’octobre 1988. Ces journées charnières où l’armée a tiré sur « une foule d’enfants » : « des enfants en garderont des séquelles à vie, des enfants qui ont été violés, sodomisés, papa, la baignoire, les coups, les brûlures, les blessures, tu connais le catalogue, papa, c’est le même que celui des paras de l’armée française » dit, peccamineuse, Loundja à son père, ancien héros de la lutte pour l’indépendance du pays.
Mais cette « monstruosité » qui ronge le pays n’est pas une fatalité. Loundja-Shahrazède « dit qu’elle en a marre du couplet qui court sur toutes les lèvres stipulant que cette terre est trop passionnée et tout ce qui s’y entreprend trop passionnel, « D’où l’attrait pour la tragédie, les harangueurs de foules, la lutte entre les dieux, l’apostasie, l’invasion, la guerre (…) ».
Deux autres voix se font entendre. Celle d’abord de Shahriyar à travers ses Carnets, des écrits hallucinés, parfois hermétiques, qui donnent à lire le regard de l’ami et de l’amant sur ces cinq nuits passées dans un hôtel de la corniche constantinoise.
Il y a enfin cette narratrice dont l’identité ne sera révélée qu’à la fin du roman et qui s’inscrit dans une longue chaîne de conteuses. Elle est celle qui, sans avoir retrouvé le manuscrit-fondateur du Voyageur, restitue l’ensemble de l’histoire, l’origine et la naissance d’« une branche nouvelle de sang mêlé », sur laquelle elle compte bien, elle aussi, inscrire sa marque.
Le livre brille d’un foisonnement de thèmes, de fulgurances littéraires, d’émotions et de références historiques : l’histoire algérienne qui, à partir d’une « matrice mère amazigh », est l’histoire des métissages nés des invasions diverses ; l’histoire de la pénétration militaire française, des fantasmes et de l’érotisation de l’Orient mais aussi la place de l’individu au sein de la société algérienne ; l’autonomie de la femme ; les questions de l’homosexualité, de la sexualité ou du racisme anti-noir.
La clef de cette construction littéraire bigarrée, un brin complexe, se niche peut-être dans une quête de l’universel, un éloge de la diversité et du métissage même si sa naissance sur la terre algérienne a été traumatisante : « Même si elle est violente, cette origine pour le pire, elle n’en demeure pas moins métisse pour le meilleur », de sorte que Mourad Djebel invite à se détourner de cette « tendance de l’Unique » pour retrouver un chemin emprunté déjà par un Ibn Arabi, un chemin qui mène à « croire que l’homme est autant que le langage, médiation des mondes, médiations de tous les mondes, porteurs d’essences premières communes à tous les êtres (…) »
Edition La Différence, 2005, 364 pages, 23 €
-
Sens Interdits
Mourad Djebel
Sens Interdits
 Chez Mourad Djebel, « le temps (et même l’espace géographique), (...) ne se retrouve plus dans des repères linéaires (...), ne construit plus mais déconstruit et s’empêtre dans une inconsistance et une inconstance où les objets et les êtres affluent et refluent sans cheminement précis (...) ». Voilà le plus caractéristique de ce roman dont l’originalité est tout entière contenue dans l’écriture et dans la mise en scène d’un récit centré sur la disparition de Yasmina. Autour d’une scène cruciale, récurrente, se tissent les fils d’une histoire livrée par bouffées, en épisodes brusques et parfois inattendus. L’histoire de Maroued et de Yasmina mais aussi celle de trois adolescents, Larbi, Nabile et le même Maroued, liées par un pacte tacite scellé en octobre 1986 dans les odeurs des lacrymogènes et le sifflement des balles des militaires dépêchés pour réprimer des manifestations à Constantine. C’est sur un pont de cette ville, que les trois camarades marcheront « dans les deux sens en faisant des allers-retours ininterrompus pendant plusieurs heures, jouant aux sentinelles ou nous livrant en prisonniers au pont, aux deux abstractions du code de la route (le Sens interdit et le Stop)... ».
Chez Mourad Djebel, « le temps (et même l’espace géographique), (...) ne se retrouve plus dans des repères linéaires (...), ne construit plus mais déconstruit et s’empêtre dans une inconsistance et une inconstance où les objets et les êtres affluent et refluent sans cheminement précis (...) ». Voilà le plus caractéristique de ce roman dont l’originalité est tout entière contenue dans l’écriture et dans la mise en scène d’un récit centré sur la disparition de Yasmina. Autour d’une scène cruciale, récurrente, se tissent les fils d’une histoire livrée par bouffées, en épisodes brusques et parfois inattendus. L’histoire de Maroued et de Yasmina mais aussi celle de trois adolescents, Larbi, Nabile et le même Maroued, liées par un pacte tacite scellé en octobre 1986 dans les odeurs des lacrymogènes et le sifflement des balles des militaires dépêchés pour réprimer des manifestations à Constantine. C’est sur un pont de cette ville, que les trois camarades marcheront « dans les deux sens en faisant des allers-retours ininterrompus pendant plusieurs heures, jouant aux sentinelles ou nous livrant en prisonniers au pont, aux deux abstractions du code de la route (le Sens interdit et le Stop)... ».Dans ce premier roman, l’auteur mettait toutes les palettes du langage au service d’une « boulimie des mots, des analogies et des fils enchevêtrés de l’histoire » mais aussi d’une remarquable et parfois déroutante « ivresse verbeuse ». Elle était néanmoins et déjà une marque de fabrique certaine, riche de nombreuses originalités stylistiques, poétiques autant que romanesques.
Edition La Différence, 2001, 332 pages, 20,58€
-
Hanan El-Cheikh
Hanan El-Cheikh
Londres, mon amour
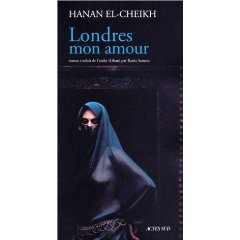 Avec sa nouvelle « Je balaie les terrasses du soleil » parue en 2000 dans le recueil intitulé « Le Cimetière des rêves », la romancière libanaise installée à Londres, abordait pour la première fois l’univers de l’immigration. Elle y revient avec ce roman drôle et tendre, parfois un peu long, qui met en scène quatre personnages exilés dans la capitale anglaise évoluant dans le microcosme de la diaspora arabe, davantage levantine que maghrébine, plus magnats du pétrole et de la finance ou familles princières adeptes des palaces que pauvres bougres et autres drilles réduits aux bouis-bouis communautaires.
Avec sa nouvelle « Je balaie les terrasses du soleil » parue en 2000 dans le recueil intitulé « Le Cimetière des rêves », la romancière libanaise installée à Londres, abordait pour la première fois l’univers de l’immigration. Elle y revient avec ce roman drôle et tendre, parfois un peu long, qui met en scène quatre personnages exilés dans la capitale anglaise évoluant dans le microcosme de la diaspora arabe, davantage levantine que maghrébine, plus magnats du pétrole et de la finance ou familles princières adeptes des palaces que pauvres bougres et autres drilles réduits aux bouis-bouis communautaires.Amira, la Marocaine, est la plus volubile. Prostituée de luxe au grand cœur, en stratège et comédienne elle s’applique à berner « son » monde aristocratique - bien plus lucratif - en se faisant passer pour une princesse. Son amie Nahed vient d’Egypte. Elle a laissé tomber la danse pour, elle aussi, faire commerce de ses charmes. Mais, ravagée par l’alcool, la dépression et la maladie, son crédit s’amenuise chaque jour un peu plus. Samir, tout juste débarqué du Liban, s’adonne, en toute liberté, à assouvir une insatiable et dévorante passion homosexuelle au point que notre joli et fantasque mignon en oublie, qu’à Beyrouth, il est marié et plusieurs fois père. Lamis est Irakienne et, ne supportant plus sa condition d’épouse arabe, a bravé interdits et pressions familiales pour divorcer. Femme seule dans Londres, Lamis, dont les relations avec les Anglais pur sucre se limitaient à quelques médecins, rencontre Nicholas, un spécialiste en arts islamiques. Ce petit monde évolue avec ses soucis et ses petits bonheurs. L’exil n’est pas rose et la jovialité d’Amira ou l’insouciance de Samir ne peuvent faire oublier la solitude et les incertitudes du lendemain. Sans complaisance, Hanan El-Cheikh brosse un tableau mi-figue, mi-raisin de cette immigration particulière. Après s’être affranchie des contraintes imposée par sa société d’origine, Lamis s’efforce à s’intégrer totalement à l’Angleterre et à sa capitale quitte à renier une partie d’elle-même. Londres devient alors l’autre personnage du récit. L’acculturation s’accompagne bien évidemment d’interrogations et de doutes identitaires, de même que la relation amoureuse entre Lamis et Nicholas doit payer le prix de l’incompréhension culturelle et surmonter quelques interdits et non-dits.
Reste que, comme le dit Amira : « je suis un être humain avant d’être une femme arabe »... Que les esprits chagrins se rassurent, l’optimisme du roman n’évacue pas pour autant les obstacles que les hommes savent dresser entre eux.
Traduit de l’arabe (Liban) par Rania Samara, éd. Actes Sud, 2002, 325 pages, 21,90 euros
-
French Dream
Mohamed Hmoudane
French Dream
 Tandis qu’on traque le réfugié afghan du côté de la « jungle » de Calais pour, selon l’officielle version, le protéger des passeurs, on continue à croire ici ou là que ces hommes, ces femmes et même ces enfants qui débarquent sur le sol de l’Europe sont en quête d’un Eldorado. Certains laissent même entendre qu’ils seraient prêts à tout pour rester, bien au chaud, et profiter de la douceur de cette bonne terre de France. Mohamed Hmoudane est poète et l’auteur de plusieurs recueils, French Dream est son premier roman paru en 2005. Il y raconte les tribulations d’un candidat à l’émigration et ses galères dans cette France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n’est l’impression d’un texte qui s’essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d’une citation de Jean Genet : « les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu’il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas ». Le lecteur est ainsi, d’entrée, averti. Après des tentatives contestataires vouées à l’échec dans une société marocaine policée et cadenassée par un pouvoir autoritaire, « je n’avais plus qu’une seule idée en tête, dit le narrateur, : partir, d’autant plus que l’atmosphère chez nous était devenue de plus en plus insupportable, plus que pesante. Nous étions comme frappés par un malheur indicible ».
Tandis qu’on traque le réfugié afghan du côté de la « jungle » de Calais pour, selon l’officielle version, le protéger des passeurs, on continue à croire ici ou là que ces hommes, ces femmes et même ces enfants qui débarquent sur le sol de l’Europe sont en quête d’un Eldorado. Certains laissent même entendre qu’ils seraient prêts à tout pour rester, bien au chaud, et profiter de la douceur de cette bonne terre de France. Mohamed Hmoudane est poète et l’auteur de plusieurs recueils, French Dream est son premier roman paru en 2005. Il y raconte les tribulations d’un candidat à l’émigration et ses galères dans cette France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n’est l’impression d’un texte qui s’essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d’une citation de Jean Genet : « les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu’il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas ». Le lecteur est ainsi, d’entrée, averti. Après des tentatives contestataires vouées à l’échec dans une société marocaine policée et cadenassée par un pouvoir autoritaire, « je n’avais plus qu’une seule idée en tête, dit le narrateur, : partir, d’autant plus que l’atmosphère chez nous était devenue de plus en plus insupportable, plus que pesante. Nous étions comme frappés par un malheur indicible ».Ledit narrateur réussit à débarquer en France. Hébergé par son frère Adam, il va faire mille et un boulots pour essayer de s’en sortir. Mais notre héros qui n’a rien de vraiment positif (pour le moins) empoche la recette des ventes militantes effectuées pour le compte du Parti et n’a qu’un objectif : obtenir sa carte de dix ans. Pour ce faire, il est près à tout. Il tente sa chance avec Christelle, mais au bout de trois mois il doit déchanter : « Tous mes châteaux de sable s’effondraient l’un après l’autre brusquement. D’une naïveté extrême, je lorgnais non seulement sur la carte de dix ans mais aussi, à long terme, sur l’héritage (…) ». C’est avec Karine qu’il va convoler en justes noces et ainsi pouvoir régulariser sa situation administrative ce qui n’empêche nullement les propos critiques sur le masque de l’intégré revêtu pour faire bonne figure, dans le couple, avec les amis, avec les collègues bien évidemment laïques du collège…
Tout cela va se solder par un divorce et un retour fissa au Maroc. Après quelques illusions laissées au vestiaire et une dose supplémentaire de bile déversée, retour à Saint-Denis : « C’est là où je vis le mieux ma condition d’« indigène ». Je vous laisse cogiter cette équation trop évidente ou alors pas assez : Paris = métropole / Banlieue = ancienne colonie… ». Voilà qui est peu originale et démago à souhait. Le texte avance, un brin pompeux (« Écrire c’est aussi payer, mots et phrases sonnants, le prix fort de la liberté »). Un premier texte nourri peut-être plus par le ressentiment que par la cruauté et qui se termine sur cette confidence : noircir les pages du livre « était pour moi une question de vie ou de mort. De vie surtout. Cette dernière phrase faut peut-être tout le livre (sic) ». Fonction « vitale », prophylactique donc de la littérature. Pour l’auteur s’entend. Au centre de ce triangle souvent tragique formé par l’exil, la vie et la mort, le personnage de Bilal Kayani dans Welcome de Philippe Lioret apparaît plus consistant. Plus représentatif aussi.
Edition de la Différence, 2005, 123 pages, 14€
-
La Porte du soleil
Elias Khoury
La Porte du soleil
 Il faut lire La Porte du soleil du Libanais Elias Khoury. Ce texte sombre et incandescent, présenté comme le récit de l’odyssée tragique des Palestiniens, restitue à ce peuple son nom : « Mon Dieu, il nous faut du temps pour porter notre nom, pour que notre nom devienne vraiment notre nom. Zeineb est devenue Zeineb parce qu’elle a raconté son histoire ». Or que sait-on du drame palestinien ? L’indifférence internationale (depuis 1948 !) suppose des consciences bien peu tourmentées ou incapables de se défaire d’une seule version de l’histoire. « Tant que le lion n’aura pas d’historiens, l’histoire favorisera celle du chasseur » dit un dicton africain.
Il faut lire La Porte du soleil du Libanais Elias Khoury. Ce texte sombre et incandescent, présenté comme le récit de l’odyssée tragique des Palestiniens, restitue à ce peuple son nom : « Mon Dieu, il nous faut du temps pour porter notre nom, pour que notre nom devienne vraiment notre nom. Zeineb est devenue Zeineb parce qu’elle a raconté son histoire ». Or que sait-on du drame palestinien ? L’indifférence internationale (depuis 1948 !) suppose des consciences bien peu tourmentées ou incapables de se défaire d’une seule version de l’histoire. « Tant que le lion n’aura pas d’historiens, l’histoire favorisera celle du chasseur » dit un dicton africain.E.Khoury s’est attelé à une tâche folle : raconter l’épopée du peuple palestinien, village par village, famille par famille depuis le désastre de 1948 (la Naqba) jusqu’à nos jours. Pour qui avait lu les trois précédents romans traduits en français du même auteur, il ne sera pas surprenant de retrouver les qualités du romancier qui pousse son art vers des sommets. Mieux, il semble rompre avec tous les genres connus : la parole, rapportée ici sans guillemets, se fait écriture ; ce roman, construit autour de témoignages n’est pas un roman historique, mais il ouvre pourtant sur l’histoire ; ce récit, d’un drame collectif voit, à chaque page s’extraire de la boue de l’Histoire des hommes et des femmes jusque-là sans nom et sans voix, enfin, le souffle de la geste palestinienne est là, presque palpable mais nulle trace d’un quelconque héroïsme ou de grandiloquence.
La structure circulaire adoptée par Elias Khoury ne perturbe jamais le lecteur. Le tour de force est d’autant plus appréciable que La Porte du soleil court sur plusieurs décennies, brasse près de trois cent personnages et moult faits historiques. Cette histoire collective du peuple palestinien n’est pas écrite au détriment de l’individu. La dimension humaine de ce drame est ici magnifiquement rendue. Sans jamais céder aux sirènes de la compassion ou de l’idéologie, la litanie des expulsions, des persécutions, des exécutions sommaires, des tortures, des emprisonnement abusifs, du malheur et de la misère endurée... rompt avec le terrible anonymat des chiffres : « la terreur c’est le chiffre, et c’est pourquoi les gens portent sur eux les photos de leurs morts (...), ils en ont fait les substituts des noms ». Oui! ce livre est admirable, c’est-à-dire étonnant, par sa puissance et sa profondeur, mais aussi beau car sa matière a été malaxée dans une glaise faite d’amour et d’humanité.
Sa trame, dense, est tissée autour de deux histoires d’amour. Celle qui a uni une vie durant malgré les séparations imposées par l’exil, Younès à Nahîla et l’autre, shakespearienne, rassemble Khalil et Shams (Soleil en arabe). L’amour est donc au centre de ce récit. L’amour et la femme palestinienne.
Younès, le vieux fedayin et ex-responsable du Fatah gît sur un lit d’hôpital - le fantomatique et irréel hôpital Galilée du camps martyr de Chatila. Plongé dans un coma profond, il est condamné. Seul, Khalil croit en sa résurrection. Pour le ramener à la vie, il va des mois durant, le veiller. Comme la Shéhérazade des Mille et une nuits, il parle et raconte des histoires à ce corps végétatif. Comme elle, Khalil parle « pour acheter la vie », celle de Youcef qui est aussi la sienne et celle de tout un peuple, et ainsi sauver l’humanité tout entière car « le corps d’un seul être humain constitue l’incarnation de toute l’histoire de l’humanité ».
Le livre est un long monologue où une histoire en appelle une autre et ce jusqu’à l’infini. Où chaque récit est irréductible à une seule version. « L’histoire possède en fait des dizaines de versions différentes et, lorsqu’elle se fige en une seule version, cela ne mène qu’à la mort ».
Il faut sans doute ne pas connaître le poids de la culpabilité européenne héritée de la Shoah et ne pas subir la pression médiatico-morale quand à cette terrible page de l’histoire contemporaine pour oser, comme le fait ici Elias Khoury, comparer la tragédie palestinienne à celle dont ont été victimes les Juifs d’Europe, oser dénier aux Israéliens le statut de victime : les colons-soldats « ne ressemblent pas à ceux qui sont morts » écrit-il « tandis que ceux qui sont morts alors ressemblaient à Nahîla et Oum Hassan ».
Comme il ne faut pas que les Palestiniens deviennent eux-mêmes « une seule histoire », E. Khoury raconte aussi les dérives du mouvement de libération et le sort que les « frères » arabes ont réservé à ces réfugiés bien encombrants, la vie dans les camps, le massacre de Chatila, ce que l’on a appelé « la guerre des camps », le racisme de la société libanaise à l’égard des Palestiniens privés de tous droits et parqués dans des ghettos où, comme les Juifs de Venise entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ils sont enfermés, tenus à l’écart !
Les pages les plus poignantes portent sur l’illusion dont se bercent les Palestiniens eux-mêmes : ces histoires toujours ressassées et qui regorgent de faits héroïques, ces hommes et ces femmes qui collectionnent les clefs de leurs maisons alors que les portes ont été détruites, les cassettes vidéo, ces « rêves éveillées » d’une Galilée illusoire. Les « murs de l’histoire », « l’illusion de la mémoire » sont devenus la prison des Palestiniens. La Porte du soleil est peut-être le premier livre qui traduit avec autant de force et d’acuité la difficulté et peut être la nécessité pour ce peuple de prendre conscience de son exil.
Actes-Sud/Sindbad, Le Monde Diplomatique, 2002, 630 pages, 24,90 euros
-
L’École face à l’obscurantisme religieux
20 personnalités commentent un rapport choc de l’Education nationale
L’École face à l’obscurantisme religieux
 Osons rapporter une conversation privée. Je discutais l’autre soir, après le service, avec A. le patron d’un restaurant du XXe arrondissement parisien. A. est kabyle et en France depuis une trentaine d’années. Père de deux jeunes filles de dix et quatorze ans, il m’expliquait, lui le farouche laïque, partisan convaincu du vivre ensemble républicain hexagonal et de l’école publique avoir inscrit ses deux filles dans une école privée. Décision prise la mort dans l’âme mais nécessaire pour préserver sa progéniture des harcèlements religieux émanant d’autres élèves, en l’occurrence turcs ou africains, mais aussi des assignations à résidence cultuelle provenant du personnel scolaire soi-même qui décrétait, ad hominem, que les Yasmina ou Mohamed devaient s’abstenir de manger du porc et observer le jeûne du mois de ramadan. Il n’y a là, en ce début de XXIe siècle, dans la France républicaine et laïque, rien que de banal et le rapport Obin, puisque c’est de lui dont il est question, regorge d’exemples, autrement douloureux, de cet obscurantisme religieux agissant, subi ou complice.
Osons rapporter une conversation privée. Je discutais l’autre soir, après le service, avec A. le patron d’un restaurant du XXe arrondissement parisien. A. est kabyle et en France depuis une trentaine d’années. Père de deux jeunes filles de dix et quatorze ans, il m’expliquait, lui le farouche laïque, partisan convaincu du vivre ensemble républicain hexagonal et de l’école publique avoir inscrit ses deux filles dans une école privée. Décision prise la mort dans l’âme mais nécessaire pour préserver sa progéniture des harcèlements religieux émanant d’autres élèves, en l’occurrence turcs ou africains, mais aussi des assignations à résidence cultuelle provenant du personnel scolaire soi-même qui décrétait, ad hominem, que les Yasmina ou Mohamed devaient s’abstenir de manger du porc et observer le jeûne du mois de ramadan. Il n’y a là, en ce début de XXIe siècle, dans la France républicaine et laïque, rien que de banal et le rapport Obin, puisque c’est de lui dont il est question, regorge d’exemples, autrement douloureux, de cet obscurantisme religieux agissant, subi ou complice.Vingt personnalités sont donc réunies pour commenter ce rapport. Ils sont (ou ont été) enseignants (Alain Seksig, Barbara Lefebvre, Denis Kambouchner, Jean-Paul Brighelli, Annette Coulon, Chantal Delsol, Michèle Narvaez), romanciers, (Emilie Frèche, Thierry Jonquet, Gaston Kelman), militants laïques, (Patrick Kessel ancien grand maître du Grand Orient de France, Fadela Amara et Mohammed Abdi de l’association Ni Putes ni soumises), journaliste et/ou intellectuels (Ghaleb Bencheikh, Paul Thibaud, Jeanne-Hélène Kaltenbach), démographe (Michèle Tribalat), psychanalyste (Fethi Benslama) ou sociologues, (Jacqueline Costa-Lascoux, Esther Benbassa, Dominique Schnapper).
Tous connaissent parfaitement ces sujets et tous, à une exception, disent la pertinence du rapport et l’urgence de tirer la sonnette d’alarme face à des manifestations d’obscurantisme qui se multiplient. En nombre et en acuité. Les inquiétudes du rapport Obin sont donc partagées et corroborent les expériences des uns et les observations des autres. Certains sont alarmistes, d’autres, prenant la question très au sérieux, se montrent pugnaces. Tous enfin, constatent les désertions des établissements publics au profit d’écoles privées devenues refuges de sécurité pour les élèves juifs ; garanties de réussite pour les plus aisés ou les nantis et affres de paix pour les élèves étiquetés, malgré eux, « musulmans » et qui refusent le diktat d’une minorité et les incohérences de l’institution publique.
Beaucoup fustigent la veulerie des pouvoirs publics et autres responsables administratifs et l’aveuglement idéologique, incendiaire parfois, de certains pontes de la sociologie française. Pourquoi masquer ou taire l’ampleur du problème au point d’éviter, par exemple, de faire trop de publicité à ce rapport ? « Ne pas faire de vague » (B. Lefebvre), voilà ce qui aurait, depuis une vingtaine d’années, servi de politique à des autorités transies. Transies de culpabilité, d’ignorance, de condescendance culturelle ou par crainte du conflit. De sorte que l’école aujourd’hui doit faire avec les diktats d’une minorité sur la majorité, se dépatouiller avec ses doutes et hésitations ou, ici ou là, voir substituer de nouvelles règles à la loi commune et surtout s’interdire de comprendre que ce qui se « joue » là est une « sournoise » « partie de go » visant à « engluer l’ennemi en rognant peu à peu son domaine » (Thierry Jonquet)
 Que faire ? Tout d’abord et c’est le sens de cette publication, rendre le débat public. Ensuite, parabole martiale oblige : il ne sert à rien de s’agiter, de bomber le torse, de croire à l’efficacité d’une technique ou d’une mesure si l’ancrage au sol n’est pas sûr. L’ensemble des auteurs, à commencer par D.Schnapper, rappelle que cet « ancrage » existe et qu’il se nomme laïcité. Central sur ce point est le texte de J.Costa-Lascoux qui précise le sens de ce concept « polysémique » : « la laïcité n’est pas seulement une règle d’organisation structurelle : elle est intimement liée à la conception de la citoyenneté et aux droits fondamentaux de la personne. (…) Elle développe la logique des droits de l’homme. Elle suppose que soient intériorisées les règles de la démocratie et que les libertés soient entendues comme les droits d’un individu autonome et responsable ». Nullement figée, « la laïcité est un concept dont l’actualisation dans la vie quotidienne est sans cesse à retravailler (…) ».
Que faire ? Tout d’abord et c’est le sens de cette publication, rendre le débat public. Ensuite, parabole martiale oblige : il ne sert à rien de s’agiter, de bomber le torse, de croire à l’efficacité d’une technique ou d’une mesure si l’ancrage au sol n’est pas sûr. L’ensemble des auteurs, à commencer par D.Schnapper, rappelle que cet « ancrage » existe et qu’il se nomme laïcité. Central sur ce point est le texte de J.Costa-Lascoux qui précise le sens de ce concept « polysémique » : « la laïcité n’est pas seulement une règle d’organisation structurelle : elle est intimement liée à la conception de la citoyenneté et aux droits fondamentaux de la personne. (…) Elle développe la logique des droits de l’homme. Elle suppose que soient intériorisées les règles de la démocratie et que les libertés soient entendues comme les droits d’un individu autonome et responsable ». Nullement figée, « la laïcité est un concept dont l’actualisation dans la vie quotidienne est sans cesse à retravailler (…) ».Alors, fort de cet ancrage qui ne se limite pas à « une vague idée de tolérance », le souple pourra être plus efficace que le dur pour traiter des trois urgences ici recensées : retrouver les missions de l’école ; poser clairement la question de l’identité ; comprendre les interactions entre l’institution scolaire et son environnement social et politique.
Nombre d’erreurs passées, d’« abandons » et d’« ignorances » (J.Costa-Lascoux) ont détourné l’institution scolaire de sa fonction première : l’enseignement de la langue française et l’acquisition du bagage culturel et historique minimum qui va avec. De ce point de vue, il faut cesser de prendre à la légère, par condescendance ou exotisme social, l’appauvrissement linguistique des plus jeunes : « les barbarismes langagiers préparent le terrain conduisant aux crimes les plus barbares » (B. Lefebvre ou JP. Brighelli). L’école est un service public dont la vocation première est de dispenser de la culture, trop facilement et socialement devenue objet de mépris au point que certains remettent sur le tapis les vertus de l’élitisme, du mérite et les travers de cet « égalitarisme littéralement pourri » (P. Thibaud).
Au lieu de mettre « l’enfant au centre du système », Denis Kambouchner en appelle à « de nouvelles Lumières » plutôt qu’à « l’abdication », M.Navarez à « des décisions politiques fortes », F. Amara et M. Abdi et d’autres à l’enseignement et à la promotion de la laïcité, G.Bencheikh à « dispenser de la culture ». « Quand le sage montre la lune l’imbécile regarde le doigt » dit le fameux proverbe chinois. Ainsi, quand l’école est devenue le lieu du « droit à la réussite » et non plus le lieu où l’on doit d’abord « faire de bonnes études » (P.Thibaud) alors sans doute, l’imbécillité s’est démocratisée.
Au lieu de cela l’école se serait fourvoyée dans l’interculturelle et le droit à la différence qui pour beaucoup serait le cheval de Troie du communautarisme si ce n’est de l’intégrisme (Seksig, Kelman…). Ces assignations à résidences culturelles et religieuses, dont les ELCO ont été le prototype, n’ont fait qu’introduire au sein de l’enceinte scolaire la question de l’identité. Il conviendrait de se défaire de « l’emprise identitaire » (A.Seksig) responsable de ce climat de mépris et de méfiance propice à l’émergence d’une autre obsession, « l’obsession de la pureté » (D.Schnapper) qui, comme l’a montré ailleurs F.Benslama, va toujours de pair avec le refus de la mixité (1).
Faut-il chasser la question identitaire des préoccupations de l’institution ? Peut-être pas. En tout cas, F.Benslama la réintroduit au cœur du débat en montrant en quoi l’école est aussi le lieu où s’élabore « la constitution du sujet humain ». Dès lors et pour ne plus tomber dans les pièges des « identités meurtrières », des approximations, des confusions identitaires et autres identités de substitution, nul ne pourra faire l’économie de la complexité c’est-à-dire rompre avec les logiques binaires, essentialistes et figées et admettre avec G.Kelman que « l’enfant est un devenir et non une histoire ». Comme le dit P.Thibaud, mais aussi G.Kelman, cette question devrait être posée « en partant d’ici », en privilégiant le « où sommes-nous ? » sur le sur ssur le « d’où sommes-nous ? » et ainsi offrir un « point de vue » pour légitimer des programmes d’enseignements qui ne seraient pas des patchworks mémoriels et autres services. Pour autant nul ne pourra faire l’économie d’interroger ses propres « mythologies » (F.Fanon) car la question identitaire ne se limite pas à aider les élèves, français, « de souche ou de branche », à se dépatouiller dans une modernité où les adultes eux-mêmes se perdent, mais aussi à remettre en question la « mythologie d’une France blanche et chrétienne » et saisir les changements et évolutions de l’identité nationale et républicaine (Kelman, Bencheikh…).
Enfin, nulle avancée ne peut être envisagée sans agir sur l’environnement même des écoles, en finir avec les « capitulations » (M.Tribalat) par une volonté politique forte et sans ambiguïté, en luttant contre les discriminations et « l’indécence » (Jonquet) de la « ségrégation urbaine » (F.Benslama) ou en interrogeant la place de l’islam dans la cité (G.Bencheikh). Pour certains, dans ce contexte, la sectorisation ne serait rien d’autre que « le terreau des absolutismes religieux » et ne ferait que renforcer ou favoriser la ghettoïsation. En publiant ces contributions et en annexe le rapport Obin, ce livre pose publiquement le débat offrant à chacun, dans et hors l’enceinte scolaire, d’assumer ses responsabilités de citoyen. Nous sommes avertis : contre l’instrumentalisation de l’enfance, contre l’antisémitisme, contre la relégation des femmes, « seule la résistance paie » sachant que « la reconnaissance de la dignité égale de tous les êtres humains » est un principe universel qui ne souffre aucun relativisme culturel (D.Schnapper).
(1) Fethi Benslama, Déclaration d’insoumission à l’usage des musulmans et de ceux qui ne le sont pas, éd. Flammarion, 2005
Max Milo, 2006, 377 pages, 20€
-
Près de la mer
Abdulrazak Gurnah
Près de la mer
 « Je suis un réfugié, un demandeur d’asile. Ces mots ne sont pas simples, même si l’habitude qu’on a de les entendre les fait apparaître comme tels. J’ai débarqué à l’aéroport de Gatwick en fin d’après-midi le 23 novembre de l’an dernier. C’est un point culminant, mineur et familier de nos histoires que de quitter ce que l’on connaît pour arriver dans des lieux étranges, emportant avec soi pêle-mêle des bribes de bagages, bâillonnant des ambitions secrètes et embrouillées. » Saleh Omar, le demandeur d’asile, est un homme âgé de soixante-cinq ans ! Singulier et improbable exil que celui d’un sexagénaire déjà bien tassé. Le vénérable n’est pas sans papiers, c’est-à-dire sans identité, sans histoire, non ! mais il arrive tout de même en Occident avec de faux papiers, des papiers au nom de Rajab Shaaban. De plus, par sécurité, par peur d’un faux-pas, Saleh Omar, alias Rajab Shaaban, reste muet ; laissant aux autres, aux fonctionnaires de l’immigration comme aux travailleurs sociaux, le soin d’interpréter son silence, le soin de parler pour lui, le soin de poser les questions et d’apporter les réponses…
« Je suis un réfugié, un demandeur d’asile. Ces mots ne sont pas simples, même si l’habitude qu’on a de les entendre les fait apparaître comme tels. J’ai débarqué à l’aéroport de Gatwick en fin d’après-midi le 23 novembre de l’an dernier. C’est un point culminant, mineur et familier de nos histoires que de quitter ce que l’on connaît pour arriver dans des lieux étranges, emportant avec soi pêle-mêle des bribes de bagages, bâillonnant des ambitions secrètes et embrouillées. » Saleh Omar, le demandeur d’asile, est un homme âgé de soixante-cinq ans ! Singulier et improbable exil que celui d’un sexagénaire déjà bien tassé. Le vénérable n’est pas sans papiers, c’est-à-dire sans identité, sans histoire, non ! mais il arrive tout de même en Occident avec de faux papiers, des papiers au nom de Rajab Shaaban. De plus, par sécurité, par peur d’un faux-pas, Saleh Omar, alias Rajab Shaaban, reste muet ; laissant aux autres, aux fonctionnaires de l’immigration comme aux travailleurs sociaux, le soin d’interpréter son silence, le soin de parler pour lui, le soin de poser les questions et d’apporter les réponses…Le hasard des arcanes socio-administratives le met en relation avec Latif Mahmoud, poète et professeur de littérature installée à Londres depuis une trentaine années, qui avait, du moins le croyait-il, définitivement, coupé les ponts avec les siens. Ces deux-là viennent du même coin d’Afrique : Zanzibar.
Il y a bien longtemps les deux hommes se sont croisés. Pourquoi Saleh Omar a-t-il usurpé l’identité de Rajab Shaaban, le propre père de Latif ? Quel passé lie et quels terribles secrets opposent le vieux Saleh et le jeune Latif ? Là est l’autre thème du livre : brosser sur plusieurs décennies l’histoire de deux familles et l’histoire d’un pays. Il revient aussi sur le passé de cette côte orientale de l’Afrique. Une histoire marquée par les pénétrations étrangères depuis les Portugais jusqu’aux Français en passant par les Omanais, les Britanniques et autres Allemands et les liens commerciaux et maritimes plurimillénaires entretenus avec l’Orient - Bahreïn, l’Arabie, le Golfe Persique et l’Inde, lointaine et envoûtante.
Et oui ! semble dire Abdulrazak Gurnah, derrière ces faces apeurées de réfugiés et autres demandeurs d’asile se cachent des vies d’hommes et de femmes, des existences parfois insolites. Toujours insoupçonnées. « On se méfie généralement des choses qu’on ignore » dit un proverbe arabe. Cette ignorance et cette méfiance sont d’abord incarnées par Kevin Edelman, le fonctionnaire des douanes qui « cueille » le réfugié à sa descente d’avion : « Pourquoi ne pas être resté dans votre pays où vous pouviez vieillir en paix ? L’asile politique, c’est bon pour les jeunes, parce que ce qu’ils veulent c’est trouver du travail et gagner de l’argent, non ? Rien de moral à tout cela. La cupidité, c’est tout. On ne craint pas pour sa vie ou sa sécurité, il n’y a que la cupidité. Monsieur Shaaban, un homme de votre âge devrait se montrer plus avisé. »
Pourtant, « Kevin Edelman, le bawab d’Europe, le gardien des vergers,[ est] celui qui a ouvert toutes grandes les portes et lâché les hordes à l’assaut du monde, ces portes vers lesquelles nous rampons dans la boue en implorant qu’on nous laisse entrer. Réfugié. Demandeur d’asile. Pitié. » Abdulrazak Gurnah montre l’arbitraire, la gabegie, le pouvoir oppressif et dictatorial, la pauvreté économique et la misère sociale dont sont d’abord responsables les nouveaux maîtres des pays nouvellement indépendants. La question démocratique ne serait-elle pas finalement la grande cause des migrations et des exils ? Il ose cette phrase, à faire pâlir d’effroi nos excessifs et autrement favorisés Indigènes de la République - prononcée aussi et parfois, mezza voce bien sûr, par des Algériens, - : « Il semblerait ainsi que les Britanniques ne nous aient apporté que du bien, comparé aux brutalités que nous fûmes capables de nous infliger à nous-mêmes. »
Mais Abdulrazak Gurnah est d’abord un romancier qui ne s’embarrasse pas de démonstrations militantes et de simplifications de chapelle. Il dénonce ces « identités meurtrières » qui sommeraient Latif de devoir choisir entre « ici ou là-bas » entre « l’un ou l’autre ». Il s’irrite du mépris affiché en Occident à l’égard des cultures d’origine et de l’universalisme à géométrie variable de ces valeurs qui ne seraient réservées qu’aux seuls Européens… « mais le monde entier a payé le prix des valeurs de l’Europe, même si bien souvent l’on s’est contenté de payer et de payer encore, sans pouvoir profiter de rien. »
Professeur de littérature à l’université de Kent, installé du côté de Brighton, auteur de plusieurs romans dont Paradis (Serpent à plumes en 1999) et Adieu Zanzibar (qui vient d’être traduit chez Galaade), Abdulrazak Gurnah écrit cette histoire, à la fois conte merveilleux et tragique, sur un ton linéaire et distancé, dans une langue empreinte d’un élégant et apaisant classicisme. Point de vagues ici. Si ce n’est celles des existences et des ignorances.
Traduit de l’anglais par Sylvette Gleize. Galaade éditions, 2006, 314 pages, 19 €
(Crédit photo - Mark Pringle)