Ook Chung
Kimchi
 Il y a aujourd’hui dans le monde environ 200 millions de personnes qui vivent en dehors du pays qui les a vu naître et sans doute beaucoup plus encore d’hommes et de femmes nés de ces migrations. L’inédit n’est peut-être pas dans l’importance numérique de ces déplacements, mais tient plus à son contexte socioculturel où, pour être rapide, le champ des possibles laissé à l’individu est à la fois plus vaste (métissage culturel) et plus restreint (uniformisation culturelle transnationale). Dans cette brèche où, sur le plan romanesque, le sujet navigue entre une liberté intérieure immense et une contrainte imposée par les conditions extérieures, entre Proust et Kafka, des écrivains qui eux-mêmes font l’expérience de cette situation se sont engouffrés. Peut-être aident-ils à voir, à comprendre, à ressentir « une portion jusqu’alors inconnue de l’existence » pour reprendre Milan Kundera. Citons ici Neil Bissondath, Hanan El Cheikh, Mako Yoshikawa, Amin Maalouf, Tassadit Imache, Kazuo Ishiguro ou Ook Chung.
Il y a aujourd’hui dans le monde environ 200 millions de personnes qui vivent en dehors du pays qui les a vu naître et sans doute beaucoup plus encore d’hommes et de femmes nés de ces migrations. L’inédit n’est peut-être pas dans l’importance numérique de ces déplacements, mais tient plus à son contexte socioculturel où, pour être rapide, le champ des possibles laissé à l’individu est à la fois plus vaste (métissage culturel) et plus restreint (uniformisation culturelle transnationale). Dans cette brèche où, sur le plan romanesque, le sujet navigue entre une liberté intérieure immense et une contrainte imposée par les conditions extérieures, entre Proust et Kafka, des écrivains qui eux-mêmes font l’expérience de cette situation se sont engouffrés. Peut-être aident-ils à voir, à comprendre, à ressentir « une portion jusqu’alors inconnue de l’existence » pour reprendre Milan Kundera. Citons ici Neil Bissondath, Hanan El Cheikh, Mako Yoshikawa, Amin Maalouf, Tassadit Imache, Kazuo Ishiguro ou Ook Chung.
Il y a d’ailleurs entre le livre de Kazuo Ishiguro, Quand nous étions orphelins, et Kimchi de nombreuses similitudes. Même travail de mémoire et de filiation, le premier via une enquête policière, le second par une introspection plus franche et, à l’arrivée, le même constat sur la vanité de la quête des origines. « La recherche des racines comme panacée est une illusion » écrit Ook Chung. Chez l’un le message est indirectement délivré par une mère qui depuis longtemps a perdu la raison, chez l’autre et de manière explicite, par une lettre laissée par un père décédé.
Si sur le fond les deux romans convergent, Kimchi se révèle différent pour au moins deux raisons. D’abord par sa forme. Le récit, partiellement autobiographique, est agrémenté de réflexions diverses (sur la littérature japonaise moderne, sur le besoin d’écriture, sur le statut de l’écrivain...), de développements ou d’images symboliques (la leçon sur le butoh ou la visite des catacombes à Paris et la description d’une cloche de fontis) et de données quasi sociologiques sur le Japon et la xénophobie nippone. Thèmes déjà présents dans le premier recueil de nouvelles d’Ook Chung (1).
L’autre différence, et elle est de taille cette fois, porte sur les protagonistes des deux récits. Chez Kazuo Ishiguro, Christopher Bank est un personnage presque falot, lisse, sans vie intérieure, sans drame. Le narrateur de Kimchi est tout le contraire. L’homme est tourmenté par le secret de sa naissance que le lecteur découvre avec lui à l’occasion de cette visite à Yokohama où le narrateur retourne sur les lieux de son enfance. Il y renoue les fils rompus de l’histoire familiale et laisse remonter à la surface les souvenirs de son amour pour Hiroé, cette étudiante rencontrée dans le cadre d’un séminaire consacré à la littérature, et son impardonnable erreur , « l’une des erreurs les plus fatales de son existence ».
De plus et surtout, cet homme est rongé par les affres d’une identité incertaine. « Je suis né en plein cœur du Chinatown de Yokohama, de parents coréens. Et j’ai grandi à Montréal, la ville la plus européenne de l’Amérique ». Entre sa naissance et ce récit, il y a trente années, quatre langues, ses visites systématiques de tous les Chinatown, « ces bouées de sauvetage » ou ces « sas psychologiques », des villes où il voyage, et... le kimchi, ce condiment coréen devenu emblème national et porte-drapeau identitaire du coréen en exil.
De ce point de vue, le plus important dans Kimchi, ne réside pas dans cette abstraction intellectuelle aujourd’hui en partie convenue et ici réaffirmée par cette citation empruntée à Van Gogh : « il n’est pas possible de vivre en dehors de la patrie, et la patrie, ce n’est pas seulement un coin de terre ; c’est aussi un ensemble de cœurs humains qui recherchent et ressentent la même chose. Voilà la patrie, où l’on se sent vraiment chez soi. ». Non, le plus important est cette peine à vivre du narrateur, marquée par sa double et bien réelle quête, celle d’une filiation, et l’autre, identitaire, qui lui fait voir en Amy, cette jeune métisse autiste de huit ans, moitié américaine, moitié japonaise, le miroir de sa propre enfance. Un « miroir inversé ». Dans Kimchi, l’identité est inachevée, toujours remise en question, en ruine comme un mur écroulé : « il n’y avait pas de fin à cette identité, ou alors celle-ci était à trouver dans le chaos et son propre inachèvement ». Telle est la malédiction du déraciné, mais aussi sa bénédiction.
(1) Nouvelles orientales et désorientées, Le Serpent à plumes, 1999.
Ed. Le Serpent à plumes, 2001, 245 pages, 15,09 euros
 L’émir Abd el-Kader ! En voilà une belle figure d’exilé ! Droit, digne, sans rancune ni aigreur pour ses ennemis d’hier. Ces Français qu’il a combattus pendant quinze ans parce qu’ils voulaient lui prendre sa terre, son pays, son honneur. Ces Français qui ensuite, et pendant cinq ans, l’ont retenu prisonnier à Toulon, Pau puis Amboise, trahissant leur propre parole quand, en échange de sa reddition, ils lui avaient promis de l’exiler sur une terre musulmane. Non ! Abd el-Kader n’en veut pas à la France, à ses généraux, au duc d’Aumale pour les atrocités commises et les dévastations qu’ils ont fait subir aux siens et à ses frères musulmans, durant cette terrible conquête. Abd el-Kader n’est pas simplement un guerrier. C’est un homme de foi et de paix qui place l’Homme au centre de sa pensée et de sa croyance.
L’émir Abd el-Kader ! En voilà une belle figure d’exilé ! Droit, digne, sans rancune ni aigreur pour ses ennemis d’hier. Ces Français qu’il a combattus pendant quinze ans parce qu’ils voulaient lui prendre sa terre, son pays, son honneur. Ces Français qui ensuite, et pendant cinq ans, l’ont retenu prisonnier à Toulon, Pau puis Amboise, trahissant leur propre parole quand, en échange de sa reddition, ils lui avaient promis de l’exiler sur une terre musulmane. Non ! Abd el-Kader n’en veut pas à la France, à ses généraux, au duc d’Aumale pour les atrocités commises et les dévastations qu’ils ont fait subir aux siens et à ses frères musulmans, durant cette terrible conquête. Abd el-Kader n’est pas simplement un guerrier. C’est un homme de foi et de paix qui place l’Homme au centre de sa pensée et de sa croyance. Il n'est pas fréquent de commencer la recension d'un livre en saluant le travail du traducteur. Mais enfin il est juste de rendre hommage à René R. Khawam infatigable traducteur d'une quarantaine d'ouvrages appartenant à la littérature arabe, classique en particulier. Celui à qui l'on doit notamment une traduction des
Il n'est pas fréquent de commencer la recension d'un livre en saluant le travail du traducteur. Mais enfin il est juste de rendre hommage à René R. Khawam infatigable traducteur d'une quarantaine d'ouvrages appartenant à la littérature arabe, classique en particulier. Celui à qui l'on doit notamment une traduction des Dans ce recueil de huit nouvelles, Mercedes Deambrosis auteur de trois premiers romans (le premier paru en 1999 chez Dire éditions, les deux derniers chez le même éditeur) revient sur la guerre d'Espagne pour en montrer les retombées sur une population finalement et bien souvent vaincue, bourreaux et victimes confondus. La plume n'est jamais accusatrice. Le contraste est d'ailleurs saisissant entre la délicatesse de l'écriture et la dureté des faits, entre le rythme paisible et fluide de la phrase et les convulsions des événements rapportés. Mercedes Deambrosis ne transporte pas le lecteur au milieu des champs de bataille ou au cœur d'une embuscade. Elle ne le place pas en spectateur privilégié dans le feu de l'action et le bruit des armes. Elle préfère le silence des consciences, l'intimité des âmes, les destinés individuelles, les doutes des uns, la grandeur ou la faiblesse des autres. Ce n'est pas l'Histoire qui défile sur les grandes avenues mais le peuple d'Espagne surpris, dans sa diversité et son quotidien, dans les ruelles et les à-côtés. Ces à-côtés qui font la vie. La vraie, la seule qui vaille le coup comme peut le laisser entendre la phrase d'Andrès Trapiello choisie par l'auteur en exergue
Dans ce recueil de huit nouvelles, Mercedes Deambrosis auteur de trois premiers romans (le premier paru en 1999 chez Dire éditions, les deux derniers chez le même éditeur) revient sur la guerre d'Espagne pour en montrer les retombées sur une population finalement et bien souvent vaincue, bourreaux et victimes confondus. La plume n'est jamais accusatrice. Le contraste est d'ailleurs saisissant entre la délicatesse de l'écriture et la dureté des faits, entre le rythme paisible et fluide de la phrase et les convulsions des événements rapportés. Mercedes Deambrosis ne transporte pas le lecteur au milieu des champs de bataille ou au cœur d'une embuscade. Elle ne le place pas en spectateur privilégié dans le feu de l'action et le bruit des armes. Elle préfère le silence des consciences, l'intimité des âmes, les destinés individuelles, les doutes des uns, la grandeur ou la faiblesse des autres. Ce n'est pas l'Histoire qui défile sur les grandes avenues mais le peuple d'Espagne surpris, dans sa diversité et son quotidien, dans les ruelles et les à-côtés. Ces à-côtés qui font la vie. La vraie, la seule qui vaille le coup comme peut le laisser entendre la phrase d'Andrès Trapiello choisie par l'auteur en exergue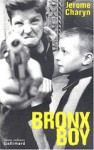 Dans cette belle collection qui invite les auteurs à livrer quelques mémoires tirées des nimbes de l'enfance, Jérôme Charyn narre l'histoire d'un jeune chevalier évoluant dans un Bronx féodal, peuplé d'émigrants russes et juifs, divisé en bandes rivales mais régies par un code de l'honneur exigeant. Chaque gang arbore son blason, qui une plume bleue au chapeau, qui une couleur noire sur noire, qui noire sur noire rehaussée de rouge coq qui enfin du jaune délavé et du marron.
Dans cette belle collection qui invite les auteurs à livrer quelques mémoires tirées des nimbes de l'enfance, Jérôme Charyn narre l'histoire d'un jeune chevalier évoluant dans un Bronx féodal, peuplé d'émigrants russes et juifs, divisé en bandes rivales mais régies par un code de l'honneur exigeant. Chaque gang arbore son blason, qui une plume bleue au chapeau, qui une couleur noire sur noire, qui noire sur noire rehaussée de rouge coq qui enfin du jaune délavé et du marron. Texte étrange que ce récit en partie autobiographique écrit par un poète, romancier, dramaturge et essayiste décédé il y a deux ans. Hussein Al-Barghouti, qui a été professeur de littérature comparée aux universités de Bir Zeit et d'Abou Dis, y raconte son séjour aux Etats-Unis, au temps où il y était étudiant. Le propos ne porte nullement sur les heurs et malheurs de l'exil estudiantin à Seattle. Pas de campus ensoleillé ici, de rencontres teintées de découvertes érotiques et d'exotisme culturel. Pas même une défense en règle des frères restés en Palestine ou un plaidoyer en faveur d'un peuple victime d'une injustice dont tout le monde se fout. En ce sens peut-être Hussein Al-Barghouti appartenait à un nouveau courant de la littérature palestinienne. En tout cas l'auteur, en ces temps de violences et d'impasse politique, n'est pas là où on l'attend. Ce qu'il décrit ici est sa rencontre, dans un milieu de marginaux, avec Bari, un "
Texte étrange que ce récit en partie autobiographique écrit par un poète, romancier, dramaturge et essayiste décédé il y a deux ans. Hussein Al-Barghouti, qui a été professeur de littérature comparée aux universités de Bir Zeit et d'Abou Dis, y raconte son séjour aux Etats-Unis, au temps où il y était étudiant. Le propos ne porte nullement sur les heurs et malheurs de l'exil estudiantin à Seattle. Pas de campus ensoleillé ici, de rencontres teintées de découvertes érotiques et d'exotisme culturel. Pas même une défense en règle des frères restés en Palestine ou un plaidoyer en faveur d'un peuple victime d'une injustice dont tout le monde se fout. En ce sens peut-être Hussein Al-Barghouti appartenait à un nouveau courant de la littérature palestinienne. En tout cas l'auteur, en ces temps de violences et d'impasse politique, n'est pas là où on l'attend. Ce qu'il décrit ici est sa rencontre, dans un milieu de marginaux, avec Bari, un " Tassadit Imache a publié en 1989 son premier récit autobiographique
Tassadit Imache a publié en 1989 son premier récit autobiographique «
«  À bord d'une vieille 504, Yasin part sur les routes d'Europe avec son fiston, Léo, âgé d'à peine huit ans. Il quitte le Danemark et son épouse où, ensemble, ils s'étaient rendus pour célébrer le centième anniversaire du grand-père d'Hélène. En fait, Hélène lui a demandé de la laisser seule, quelques jours, pour faire le point. Le couple installé en Angleterre bat de l'aile. La relation, tumultueuse et destructrice, court au divorce. Le père et son fils traversent le continent depuis les rivages nordiques jusqu'aux plages catalanes. Entre ces deux eaux, l'équipage file à travers l'Allemagne, marque une pause à Paris, s'arrête dans le Lubéron, chez Dru, une ancienne maîtresse qui vit avec Lucien, pour finalement échouer à Tossa de Mar au nord de Barcelone. Mais cet imprévu périple se termine à pied. La voiture ayant rendu l'âme dans un accident, les deux éclopés doivent gagner l'Espagne en car. Lourdement chargés de leurs sacs de voyage, dont un contenant les précieux livres de Yasin, ils progressent difficilement dans ce qui prend, pour Yasin du moins, les allures d'une fuite en avant. Une fuite arrêtée nette par un autre accident.
À bord d'une vieille 504, Yasin part sur les routes d'Europe avec son fiston, Léo, âgé d'à peine huit ans. Il quitte le Danemark et son épouse où, ensemble, ils s'étaient rendus pour célébrer le centième anniversaire du grand-père d'Hélène. En fait, Hélène lui a demandé de la laisser seule, quelques jours, pour faire le point. Le couple installé en Angleterre bat de l'aile. La relation, tumultueuse et destructrice, court au divorce. Le père et son fils traversent le continent depuis les rivages nordiques jusqu'aux plages catalanes. Entre ces deux eaux, l'équipage file à travers l'Allemagne, marque une pause à Paris, s'arrête dans le Lubéron, chez Dru, une ancienne maîtresse qui vit avec Lucien, pour finalement échouer à Tossa de Mar au nord de Barcelone. Mais cet imprévu périple se termine à pied. La voiture ayant rendu l'âme dans un accident, les deux éclopés doivent gagner l'Espagne en car. Lourdement chargés de leurs sacs de voyage, dont un contenant les précieux livres de Yasin, ils progressent difficilement dans ce qui prend, pour Yasin du moins, les allures d'une fuite en avant. Une fuite arrêtée nette par un autre accident. Raphaël Confiant dédicace son dernier livre aux “
Raphaël Confiant dédicace son dernier livre aux “