Mathieu Belezi
Les Vieux fous
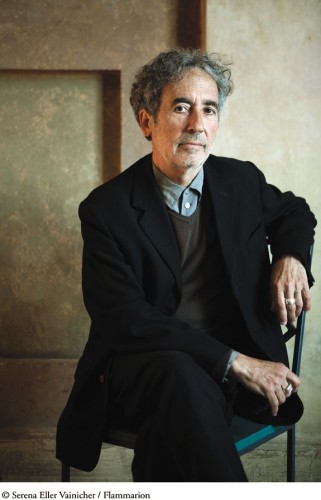 Paru un an avant les célébrations du cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne, Les Vieux fous de Mathieu Belezi expédiait une charge lourde, puissante et efficace contre ce que fut la colonisation.
Paru un an avant les célébrations du cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne, Les Vieux fous de Mathieu Belezi expédiait une charge lourde, puissante et efficace contre ce que fut la colonisation.
Dans une langue inspirée, forte, riche, portée par un souffle continu, l’auteur de C’était notre terre (Albin Michel, 2008), livre un roman étonnant, détonnant, définitif, univoque, pas tant sur la colonisation – on pourrait en décliner bien d’autres aspects - que sur l’âme coloniale, l’esprit de la présence française en Algérie, son principe et son essence. Tout le fond de commerce du parfait petit colon est inventorié. « L’impitoyable volonté du colon » plastronne ici, défile jusqu’à l’écœurement. Des bouffées délirantes de violence coloniale se répandent de page en page. Face au trop plein, il ne reste que la nausée ou l’acceptation froide d’une démonstration implacable et de haute volée littéraire.
L’incarnation du viol d’une terre et d’un peuple se nomme Albert Vandel, alias Bobby caïd, Bobby baroud, Bobby la baraka. Albert Vandel c’est 132 ans de colonisation exhibés en 140 kilos de graisse coloniale enfermée dans un « ventre coffre-fort ». Albert Vandel est un glouton, un ogre, un vorace insatiable, un cannibale qui se gorge de tout ce que porte cette terre. Un assassin aussi. Cruel, sanguinaire, tortionnaire, pétainiste, il se repaît de ratons et de juifs. Richissime, il s’est approprié, par le vol, le pays et ses hommes, l’Algérie est sa « cassette fabuleuse ». Il y fait la pluie et le beau temps et les ronds de cuir de la métropole, les ministres et même le président Doumergue viennent béqueter dans ses mimines, grassouillettes et terribles. Ce titan ne dort que quelques heures. Priapique, il enfourche à qui mieux mieux fatmas et légitimes, il glougloute à la bouteille, crucifie l’Afrique jusque dans ses assiettes. Thaumaturge et chasseur de lion, c’est à coup de trique qu’il entend arrêter le « temps barbare » africain pour le tic-tac de la civilisation blanche et moderniste. Avec cet Albert Vandel, Mathieu Belezi a inventé un personnage hors norme pour une histoire unique.
Le lecteur assiste aux derniers jours de l’Algérie française. Vandel s’est retranché avec de ci-devant satrapes de l’ordre colonial dans son bordj près d’Alger. Les Vieux fous, au nombre de onze, sont devenus des marionnettes cacochymes, fatiguées, diminuées, mal en point. Tout ce triste monde se retranche au sous sol de la villa, dans un dortoir improvisé. Pour les protéger, quinze légionnaires déserteurs surveillent la propriété et les environs et, à l’occasion, se font un ou deux bougnoules. La villa regorge d’armes et de munitions ; à table on ne sert plus que du rata. Fini le menu Napoléon III des temps heureux du Centenaire. « Je peux vous le dire ils ne m’auront pas » éructe pourtant Vandel. Mais voilà ! l’Algérie de papa se limite dorénavant au bordj Saint-Léon. Ses kilos de graisse, Vandel les déplace sur un fauteuil roulant de paralytique. C’est Ouhria, l’ultime maitresse du pachyderme qui le pousse, le coiffe et tout le toutim. Lui, raconte, encore et toujours, l’histoire de ce pays, sa geste vaine et grandiose. Elle ne demande qu’à dormir : « foutez moi la paix, monsieur Albert, je dors. »
Belezi, en quelques 400 pages, brosse l’histoire de la colonisation, depuis la conquête au nom d’une drôle de république « qui croyait aux races supérieures et aux races inférieures » jusqu’à l’exode en passant par la révolte de Mokrani, le Centenaire de présence française ou les manifestations de mai 45. L’Algérie a été violentée jusque dans ses entrailles les plus profondes, jusque dans son âme la plus sensible. La bête monstrueuse débarquée du côté de Sidi Ferruch, un certain jour de juin 1830 court encore, ici ou là.
« C’est une histoire si révoltante que plus personne ne veut en entendre parler » écrit Mathieu Belezi. Oui ! Comme en écho, Boualem Sansal dans Darwin(1) prévient : « Ce n’était pas la guerre qui se déroulait à Alger (…). On ne combattait pas, on assassinait tout bonnement (…). On dira ce qu’on voudra, on se gargarisera de mots, mais les bombes dans les cafés et la gégène dans les caves, ça n’est vraiment pas la guerre. Il n’y a pas de promesse de paix dans ces merdiers, sinon celle des charniers, et la preuve en est que jamais la paix n’a montré le bout de son nez par ici et jamais les relations entre les deux pays n’ont été sereines. Ce n’est pas qu’ils se détestent, ça ne compte pas, ils font bien des affaires ensemble, mais les deux ont failli à l’honneur, dans la guerre comme dans la paix, et la honte est une gangrène, elle ne guérit pas, se propage, si bien qu’il faut couper toujours plus haut et qu’un jour nous serons forcés de trancher à la gorge pour nous guérir du pêché originel. » Les Vieux fous de Mathieu Belezi devrait y aider.
1- Gallimard, 2011
Flammarion, 2011, 431 pages, 22 €
 La littérature et les politiques ne cessent de se pencher sur les raisons qui poussent les migrants du Sud à débarquer au Nord. Plus rares sont les enquêtes sur les motivations des pérégrins qui quittent un septentrion riche mais gris pour un méridional pauvre mais lumineux. Pas grand chose sur ces voyageurs bedonnants et grisonnants, aux poches pleines ou aux pensions de retraite ravigotées, rien sur les agités de la libido, les souffreteux aux psychés grosses de « remord » de « mal-être » ou de « culpabilité », rien sur les babas et les gogos friands d’exotisme et moins encore peut-être sur les accros à l’adrénaline en manque de frissons. Le Destin du touriste de l’écrivain et universitaire portugais Rui Zink fait de ces derniers, le sujet de son livre. Le premier traduit en français. Il s’agit d’un conte satirique et philosophique nullement fictionnel. Il suffit pour s’en rendre compte de taper sur son moteur de recherche préféré « tourisme extrême » pour s’apercevoir qu’un « concept » nouveau fleurit chez quelques agences de voyage et autres tours opérateurs : l’organisation du tourisme de l’extrême, le voyeurisme de la misère et de la guerre, le grand émoi, la grande « peupeur » des aventuriers des temps modernes. Un petit tour en Irak ou en Afghanistan, un autre à Haïti ou au Darfour et hop ! Retour au bercail. Car ils reviennent tous chez eux, dans leur « home sweet home », avec leur viatique d’esbroufes à faire pâlir la parentèle et le voisinage. Comme l’écrit Rui Zink, de ce côté de l’hémisphère et dans le sens nord-sud, le voyage « est une valeur socialement positive ».
La littérature et les politiques ne cessent de se pencher sur les raisons qui poussent les migrants du Sud à débarquer au Nord. Plus rares sont les enquêtes sur les motivations des pérégrins qui quittent un septentrion riche mais gris pour un méridional pauvre mais lumineux. Pas grand chose sur ces voyageurs bedonnants et grisonnants, aux poches pleines ou aux pensions de retraite ravigotées, rien sur les agités de la libido, les souffreteux aux psychés grosses de « remord » de « mal-être » ou de « culpabilité », rien sur les babas et les gogos friands d’exotisme et moins encore peut-être sur les accros à l’adrénaline en manque de frissons. Le Destin du touriste de l’écrivain et universitaire portugais Rui Zink fait de ces derniers, le sujet de son livre. Le premier traduit en français. Il s’agit d’un conte satirique et philosophique nullement fictionnel. Il suffit pour s’en rendre compte de taper sur son moteur de recherche préféré « tourisme extrême » pour s’apercevoir qu’un « concept » nouveau fleurit chez quelques agences de voyage et autres tours opérateurs : l’organisation du tourisme de l’extrême, le voyeurisme de la misère et de la guerre, le grand émoi, la grande « peupeur » des aventuriers des temps modernes. Un petit tour en Irak ou en Afghanistan, un autre à Haïti ou au Darfour et hop ! Retour au bercail. Car ils reviennent tous chez eux, dans leur « home sweet home », avec leur viatique d’esbroufes à faire pâlir la parentèle et le voisinage. Comme l’écrit Rui Zink, de ce côté de l’hémisphère et dans le sens nord-sud, le voyage « est une valeur socialement positive ».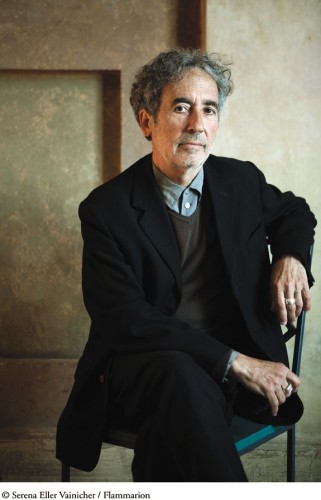 Paru un an avant les célébrations du cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne, Les Vieux fous de Mathieu Belezi expédiait une charge lourde, puissante et efficace contre ce que fut la colonisation.
Paru un an avant les célébrations du cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne, Les Vieux fous de Mathieu Belezi expédiait une charge lourde, puissante et efficace contre ce que fut la colonisation.