Philippe Rygiel (sous la direction de)
Le bon grain et l’ivraie. La sélection des migrants en occident, 1880-1939
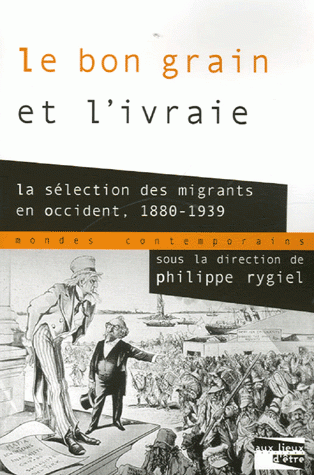 L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.
L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.
Retenons ici le lien qui se noue entre l’idée nationale et la mise en place d’une politique à tout le moins d’un cadre réglementaire visant à sélectionner les étrangers en fonction de critères particuliers. De ce point de vue, la France, à la différence du Brésil et de l’Allemagne, mais aussi de l’Angleterre (Aliens Act en 1905 mais surtout loi de 1920), des USA (Chinese exclusion Act de 1882) sans parler de l’Australie ne semble pas pratiquer une sélection ethnique. Faut-il y voir une conséquence heureuse des idéaux de 89 et d’un universalisme à la française, étrangers par exemple à la définition d’une nation ethnique allemande née de l’imaginaire d’une « nature » ou d’une « race » allemande faisant des Juifs et des Polonais des « indésirables » ? Peut-être. Comme le montre P.Rygiel les espaces politiques nationaux, produits d’histoires différentes, façonnés par des traditions culturelles et idéologiques distinctes, élaborent des systèmes législatifs différents. Pour autant, la France de la Déclaration universelle des droits de l’homme opère des distinctions parmi « ses » étrangers. Ainsi, si les ressorts ethniques et raciaux ne semblent pas être, a priori, au fondement des dispositifs de sélection, pour l’administration centrale, les populations migrantes et étrangères ne sont pas homogènes, certaines communautés jouissant d’avantages ou de privilèges dont d’autres sont privées. C’est le cas des Américains présents en France dans l’entre-deux guerres. Si selon Kant « personne n’a originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu’à un autre », en matière de migrations, certains se voient gratifier d’un surplus d’âme et donc de droits…
L’utilité économique, l’état sanitaire et l’ordre public sont au cœur des dispositifs hexagonaux, mais, la question raciale et ethnique n’est pas évacuée pour autant. Sans parler de la question noire et remonter aux mesures de contrôles des étrangers du Consulat et de l’Empire, Geneviève Massard-Guilbaud, dans une contribution centrale, souligne les responsabilités de l’Etat dans le fait que l’immigration algérienne, « aujourd’hui encore », reste une « immigration à part ». Selon l’auteur, l’immigration algérienne « a été victime, de la part de l’Etat, de discriminations comme n’en ont connu les immigrés d’aucune autre nationalité, et ceci dès les lendemains de la première guerre mondiale ». Elle innove, en relativisant la doxa qui fait de la guerre d’Algérie l’origine de cette spécificité. Elle incrimine plutôt ici la politique nationale métropolitaine qui, pour faire court, se serait calquée sur la politique coloniale : craintes et fantasmes quant à la sexualité des Algériens (se profile l’horreur d’un possible métissage ou brassage…), efficacité du lobby des colons et des milieux patronaux d’Alger, peurs enfin que ne fleurissent les fleurs de l’émancipation dans l’esprit des colonisés provoquant « une brèche dans l’apartheid de fait qui sévissait en Algérie ». G.Massard-Guilbaud précise comment l’Etat français a mis en place une politique non seulement discriminatoire mais aussi illégale et inefficace. Une politique qui aura, sur le long terme, des conséquences catastrophiques en fermant aux Algériens « l’accès à toutes les voies connues pour faciliter l’intégration ».
L’ensemble des contributions montre que la sélection, le contrôle et l’affectation des immigrés en France exigent de prendre en compte bien des critères : l’organisation du marché du travail, les besoins économiques sur le plan national mais aussi par secteurs ou régions, les dispositifs institutionnels et leurs conditions d’application, les relations diplomatiques avec les pays d’émigration, les capacités organisationnelles ou d’adaptation des migrants eux-mêmes etc. Enfin, « parce qu’une partie au moins des immigrés est appelée à se fondre dans la communauté nationale, la « question immigrée » rejoint par ailleurs le problème de la définition de la nation et de la délimitation de ses contours, question politique centrale de la période ». Question redevenue centrale aujourd’hui et qu’il est bon d’éclairer par ce retour en arrière.
Edition Aux Lieux d’être, 272 pages, 28,50 €
identité - Page 2
-
Le bon grain et l’ivraie. La sélection des migrants en occident, 1880-1939
-
Virée romanesque en 2006
Virée romanesque en 2006
 En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.
En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.
Si Pieds Blancs est plus dense et sur bien des sujets plus pénétrant que Le Poids d’une âme, ce dernier se distingue par la volonté de l’auteur d’écrire une histoire, d’écrire un roman et non un livre témoignage. M. Rachedi déroule le fil d’une enquête journalistico-policière visant à disculper et à sortir le pauvre Lounès des griffes de la machine judiciaire. Sans doute, l’histoire ne renferme pas un suspens insoutenable, mais l’auteur parvient tout de même à maintenir son lecteur en haleine. Côté écriture, M.Rachedi ne joue pas dans le démago en cherchant à écrire comme on parle (ou parlerait) dans les cités.
Sur le fond, le livre offre l’avantage de ne pas enfermer les lieux et les personnages dans des démonstrations univoques, respectant à la fois la polysémie de toute création littéraire mais aussi l’exergue taoïste placé en tête du livre. M.Rachedi rompt aussi avec la noirceur ambiante quand il est question de banlieues sans taire pour autant certains aspects négatifs et sombres. Sans se poser en donneur de leçons, il pointe du doigt les dysfonctionnements de la presse, de la police ou de la justice. Pour toutes ces raisons, il est plutôt un message d’espoir et permet de ne pas désespérer de l’humanité et de nos semblables...
 Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.
Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.
Du rêve pour les oufs, le deuxième titre publié par la célébrissime Faïza Guène (après Kiffe kiffe demain) est, disons le, moins digne d’intérêt. Entre ces copines et ses rêves d’amour, à vingt-quatre ans Alhème porte sur ses épaules ce qui lui reste de famille (un père malade et un jeune frère qui flirte avec la délinquance) et porte son regard sur le monde de oufs qui l’entoure. Pourtant, malgré un côté fabriqué (forme et fond), Faïza Guène donne à lire un texte énergique à l’unisson peut-être des banlieues : jeune, pétillant, fonceur et un brin déboussolé. En ce sens, il peut, à l’image de bien des jeunes des cités, se révéler dynamogène.
Nadia Berquet a publié La Guerre des fleurs. Cette Toulousaine en est à son troisième bouquin après deux recueils de nouvelles parus chez le même éditeur. Ce n’est pas une histoire drôle : huit enfants se retrouvent au chevet de leur mère mourante. Pas drôle du tout donc mais écrit avec des mots justes, sur un rythme lent, aux phrases courtes, à la sonorité douce et chaude. La construction, qui rappelle le Tandis que j’agonise de Faulkner, donne à entendre des monologues intérieurs qui rythment les cinq temps du roman. Récits de vies, de blessures et de non-dits. Histoire de famille. Histoire d’une famille française aux origines ensoleillées par la figure maternelle. À noter la scène douloureuse de l’enterrement qui voit les enfants dépossédés de leur mère par le groupe et les religieux. Une dépossession déjà présente chez Jamal Mahjoub (Là d’où je viens) et chez Azouz Begag (Le Marteau Pique-cœur).
Retour remarqué pour Mehdi Charef, pionnier de la première heure, gratifié du Prix Beur FM pour son nouveau roman. À bras-le-cœur revient sur l’enfance, une enfance algérienne avec à la clef l’exil dans un bidonville... rien de nouveau sous le soleil de l’immigration si ce n’est peut-être davantage de maîtrise dans l’écriture et cette sensibilité de l’auteur et cinéaste. Le grand cœur de Mehdi Charef déborde à chaque ligne.
Difficile en revanche de suivre Karim Amellal et Ahmed Djouder. Ce dernier signe ici plutôt un pamphlet qu’un roman. Un pamphlet qui n’évite pas de nombreux écueils. Quant à Cités à comparaître, récit d’ « une merde de vie » d’un paumé qui serait devenu malgré lui un terroriste, on frise la caricature, avec beaucoup de répétitions en prime. S’il s’agit là de littérature ce serait une littérature du désespoir. EN 2006, les romanciers ont souvent voulu faire parler les bourreaux (voir Salim Bachi avec Tuez les tous !, ou Jonathan Littell avec Les Bienveillants), mais n’est pas Goncourt qui veut !
Karim Amellal, Cités à comparaître, Stock, 2006, 177 pages, 15,50 €
Nadia Berquet, La Guerre des fleurs, HB Éditions, 2005, 142 pages, 14 €
Mehdi Charef, À bras-le-cœur, Mercure de France, 2006, 187 pages, 14,80 €
Ahmed Djouder, Désintégration, Stock, 2006, 157 pages, 15 €
Faïza Guène, Du rêve pour les oufs, Hachette littérature, 215 pages, 16 €
Mabrouck Rachedi, Le Poids d'une âme, JC Lattès, 2006, 214 pages, 13 €
Houda Rouane, Pieds Blancs, Éd. Philippe Rey, 2006, 314 pages, 19 €Illlustrations: Mabrouck Rachedi, Houda Rouane
-
Le Malentendu
Franco La Cecla
Le Malentendu
 L’auteur, anthropologue italien partagé entre Palerme et Paris, ancien élève d'Ivan Illich et de Michel Foucault, présente dans Le Malentendu, son premier livre traduit en français, une réflexion stimulante sur l’altérité. Partant des travaux de Vladimir Jankélévitch (celui du Le je ne sais quoi et le Presque rien), le malentendu ne se réduit pas à un défaut de la fade et triomphante communication, mais est plutôt une chance, celle de la rencontre. Cet événement, ce « lubrifiant des rapports interpersonnels », selon le mot du philosophe français, seul le temps le sauvera, en permettant aux uns et aux autres de renouer avec la « conscience de l’« expérience de l’autre ». Au temps comme solution au malentendu (V. Jankélévitch), l’auteur, en ancien urbaniste qu’il fut, ajoute une dimension spatiale. Selon lui, « on peut « habiter » le malentendu et en faire une zone de respect, un « coussinet amortisseur » de la relation à autrui ».
L’auteur, anthropologue italien partagé entre Palerme et Paris, ancien élève d'Ivan Illich et de Michel Foucault, présente dans Le Malentendu, son premier livre traduit en français, une réflexion stimulante sur l’altérité. Partant des travaux de Vladimir Jankélévitch (celui du Le je ne sais quoi et le Presque rien), le malentendu ne se réduit pas à un défaut de la fade et triomphante communication, mais est plutôt une chance, celle de la rencontre. Cet événement, ce « lubrifiant des rapports interpersonnels », selon le mot du philosophe français, seul le temps le sauvera, en permettant aux uns et aux autres de renouer avec la « conscience de l’« expérience de l’autre ». Au temps comme solution au malentendu (V. Jankélévitch), l’auteur, en ancien urbaniste qu’il fut, ajoute une dimension spatiale. Selon lui, « on peut « habiter » le malentendu et en faire une zone de respect, un « coussinet amortisseur » de la relation à autrui ».
Revenant sur les ghettos juifs et illustrant son propos par l’expérience des Littles Italies ou des Chinatown, le ghetto « est une façon de limiter le malentendu interculturel, et de le gérer en se servant de l’espace urbain ». Ainsi, serait-il « le malentendu par excellence » parce qu’il cacherait « sous un terme négatif quelque chose de très utile ».
Ce mode de gestion du rapport à l’autre, cette forme de résistance à une assimilation rapide ou ces simulations d’identité... créent « un espace pour la rencontre, pour le pacte qui doit s’en suivre ». Ce n’est pas de la fermeture et du repli sur soi mais bien de la rencontre dont l’auteur fait ici l’éloge, à travers le malentendu et ses transpositions spatiales et urbaines. Une rencontre qui ne va pas de soi et qui exige ces « acrobaties » de la part d’un groupe (minorité culturelle, linguistique, ethnique, immigrés...) pour « rendre sa présence élastique et apte à la contradiction sociale ». La « fragmentation », repérable dans les grandes villes américaines par exemple, n’est plus pour l’auteur assimilable au malentendu ; il en marque la fin, la disparition, sa mutation en « peur », alors, « l’espace physique n’est plus perçu comme seuil mais comme barrière ». Fustigeant le discours sur l’intégration, Franco La Cecla marque bien la différence entre ce qu’il nomme « ma découverte « positive » du ghetto » et « ces lieux de haine, de marginalisation et de violence » que seraient « les banlieues parisiennes ». « Une banlieue n’est pas un ghetto, c’est bien pire. C’est un lieu auquel on a soustrait le temps, c’est une périphérie où la temporalité relationnelle avec la ville est totalement impossible, c’est le lieu off limits de la réclusion, l’espace du refoulement physique des différences ». Et, sur cette question essentielle aujourd’hui, celle de la place de l’islam dans les sociétés européennes, l’auteur diagnostique que « l’islam tourne au fondamentalisme précisément là où l’Occident a perdu son caractère multiculturel et multiconfessionnel ».
Après l’éloge du ghetto, l’auteur loue la frontière. Non pas la ligne de démarcation (caractéristique du « mythe de l’intégration », ligne tracée par on ne sait quelle instance supérieure et soupçonneuse, et qui très vite se transforme en tranchée) mais la frontière comme « filtre et séparation, lieux où se présentent deux identités », « sorte de terrain vague », flou et incertain. Elle s’apparente plutôt aux marchés traditionnels comme lieux de la mise en scène et de la rencontre des différences, ou, aujourd’hui, aux villes-mondes. La frontière est alors lieu de malentendu, c’est-à-dire « un parcours de la connaissance dans le temps. Mieux, elle devient « identité » et Franco de Cecla rejoint E. Glissant, P. Chamoiseau et d’autres dans la tentative de dégager une « troisième voie entre universalisme et fanatisme localiste », celle de la « créolité » et du métissage et de la « démonstration qu’il n’y a pas d’identité fixe, que l’identité n’est pas une limite mais une ressource de vie ».
Préface de Marc Augé, édition Balland, 2002, 163 pages, 14,50 € -
30 minutes à Harlem
Jean Hubert Gailliot
30 minutes à Harlem
 Jean Hubert Gailliot, romancier et co-fondateur en 1987 des éditions Tristram sise à Auch dans le Gers donne ici, plutôt qu’un livre, un long reportage sur le Harlem nouveau ou, pour être dans l’ambiance, le New Harlem. Trois tendances émergent du ci-devant ghetto de la communauté noire new-yorkaise symbole de la relégation et fleuron d’une culture, notamment musicale, cent pour cent black.
Jean Hubert Gailliot, romancier et co-fondateur en 1987 des éditions Tristram sise à Auch dans le Gers donne ici, plutôt qu’un livre, un long reportage sur le Harlem nouveau ou, pour être dans l’ambiance, le New Harlem. Trois tendances émergent du ci-devant ghetto de la communauté noire new-yorkaise symbole de la relégation et fleuron d’une culture, notamment musicale, cent pour cent black.
Une mixité amoureuse d’un nouveau genre voit défiler nonchalamment et avec une aisance toute juvénile dans la 125e rue de jeunes blacks au bras de lolitas asiatiques peroxydées. Ces amours intercommunautaires du troisième millénaire nées avec la pub « united colors of Benetton » ouvrent les portes à une nouvelle (et problématique) mixité, à de nouveaux brassages et bouscule, non sans crânerie, la plus pure tradition harlémite. Mais, tandis qu’Harlem s’asiatise (par les cœurs mais aussi par les investissements chinois, nippons et sud-coréens), « personne ne semble s’inquiéter de la quasi-disparition des adolescentes noires dans le quartier ». Pour Meredith, mère de deux jeunes filles adeptes de traitements et d’opérations en tout genre pour ressembler à des Blanches ou à des Asiatiques, il s’agit là d’une mode, une mode pernicieuse : « vous vous rendez compte, aujourd’hui la consommation investit même les domaines de l’amour et de la foi ! Au cours des dernières années, les progrès du matérialisme ont causé ici plus de ravages dans les mentalités que l’héroïne et le crack en un demi-siècle ! ». Face à ses deux ingénues qui ne voient dans ces nouveaux comportements qu’une habile esthétique pour attirer l’attention des garçons, Meredith tonne : « se blanchir (…) cela revient, ni plus ni moins, à effacer trois siècles et demi d’esclavage (…) effacer, par la même occasion, la mauvaise conscience de ceux pour qui la couleur de notre peau devrait agir comme un rejet quotidien des injustices dont les Noirs continuent d’être les victimes ».
Avec ces unions nouvelles, des expériences musicales originales ou… incongrues (selon les points de vue) sont apparues : Harlem la black, sanctuaire de la musique noire, s’ouvre à des influences extrêmes orientales, impensables il y a encore quelques années, portées par de nouveaux groupes tels Wu-tang Clan, Tcheng-Ho Projets ou par feu Samouraï Sam, ex-« philosophe des rues ». Selon un certain Boombasstic, ingénieur du son de son état, « l’Asie par elle-même n’avait pas de musique à nous offrir, elle avait mieux que ça : sa curiosité (…) ». Pour lui, les jeunes Blacks de Harlem n’entendent pas perdre leur identité, ils refusent simplement de reproduire à l’infini une musique et des effets qu’il estime éculés.
Last but not least : le quartier, sous l’effet de la promotion immobilière et culturelle, se transforme en un vaste lupanar de la consommation, délogeant peu à peu les anciens habitants et interdisant à leurs rejetons aux amours singulières et désargentées d’y loger. Tout commence au début de l’ultime décennie du siècle dernier quand Disney Company et Cineplex Odéon s’associent pour créer à Harlem un vaste complexe de divertissement, un méga centre commercial. C’est sur l’évocation d’un Harlem incandescent et immatériel, noyé sous les lumières intemporelles des néons et autres spots, assourdi par une bande-son continue et hétérogène que se referme le livre. Ici, le jour et la nuit n’existent plus, le temps est aboli, table rase est en permanence faite du passé, l’avenir n’est plus radieux mais béance et « tyrannie du nouveau », de la vitesse, du zapping sonore et visuel au service d’un seul culte : celui de la consommation. L’auteur reprend ici le papier quelque peu « allumé » d’une journaliste londonienne entrée dans ce nouveau temple de la consommation corps et âmes, l’esprit vide et le cerveau non seulement lavé mais passablement essoré.
Dans cet Harlem bringuebalé, où les boussoles identitaires s’affolent, certains se tournent déjà vers les « léopards », les enfants nés de ces unions afro-asiatiques, dans l’espoir de trouver un sens aux bouleversements du vieux quartier. Wait and see donc : l’avenir dira si Harlem invente « une connexion neuve entre les styles, les cultures et les communautés » ou si elle n’est que le laboratoire d’un énième avatar de la marchandisation du monde, des esprits et… des cœurs.
Editions de L’Olivier, 2004, 59 pages, 8 €
-
Bretons de Paris. Des exilés en capitale
Didier Violain
Bretons de Paris. Des exilés en capitale
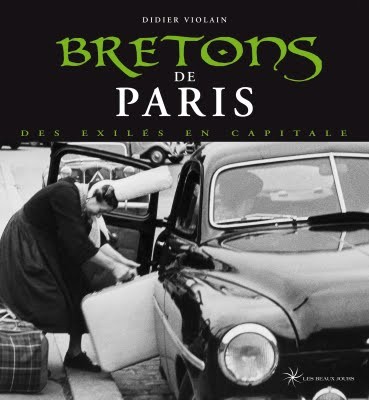 A lire le très beau livre que Didier Violain consacre aux Bretons de Paris l’on se rend vite compte que l’expérience de l’exil est, toute chose égale par ailleurs, la même, que l’on viennent de Bamako, d’Alger ou de Bretagne. Il y est là aussi question de différences, de communauté, de mémoire spécifique et même de la revendication d’une double culture, française et bretonne.
A lire le très beau livre que Didier Violain consacre aux Bretons de Paris l’on se rend vite compte que l’expérience de l’exil est, toute chose égale par ailleurs, la même, que l’on viennent de Bamako, d’Alger ou de Bretagne. Il y est là aussi question de différences, de communauté, de mémoire spécifique et même de la revendication d’une double culture, française et bretonne.
C’est souvent pour des raisons économiques que l’on décide un beau ou triste jour de quitter les siens pour aller trouver du travail à Paris, quand ce ne sont pas les entreprises elles-mêmes qui recrutent la main d’oeuvre sur place comme les usines Citroën par exemple.
Débarqué Gare Montparnasse, l’immigré breton peut compter sur la solidarité des siens : famille ou réseaux communautaires et espérer échapper aux pièges de la grande ville, cette Sodome que chante Glenmor.
Paris, qui a peut-être fait rêver, réserve pas mal de désillusions : le travail y est difficile : sans qualifications les premiers immigrés bretons trouvent à s’employer comme terrassiers, bonnes à tout faire ou OS à l’usine. « C’est au Breton que l’on donne les travaux dont personne ne veut! A l’usine, à l’atelier, au chantier, tout est assez bon pour lui. Et comme il vit au jour le jour, sans avance et que derrière lui se trouve une femme avec quatre, cinq, six enfants, ils s’attèle aux besognes les plus ingrates, quelquefois même les plus délétères. C’est vraiment le paria de Paris », ainsi s’exprime le Père Rivalin, en 1898, au congrès des associations ouvrières de Saint Brieuc. Plus tard ils seront chauffeurs de taxis, coiffeurs, restaurateurs avant de se tourner vers l’administration. La mémoire bretonne n’oublie pas non plus les moqueries, les propos xénophobes voir racistes, la solitude de l’immigré et sa nostalgie du pays et des siens...
Avec de nombreuses photos couvrant plus de cent ans d’immigration et une soixantaine de témoignages, l’auteur Didier Violain, breton lui même et parisien depuis 1980, dresse l’histoire de l’immigration bretonne à Paris. Elle a commencé avec la seconde moitié du XIXe et s'est prolongée, par vagues successives, jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Il n’était pas rare encore dans les années 50 ou 60 de croiser de vieux Bretons fraîchement arrivés dans la capitale qui ne savaient pas parler le français.
Les Bretons de Paris, du quartier Montparnasse notamment, de Saint Denis, de Versailles, de Villeneuve le roi ou d’Athis Mons ont réussi à maintenir vivant le lien avec la terre d’origine et à faire vivre une culture à laquelle des générations de Bretons, même nées à Paris, restent toujours attachées, même quand il n’est question que du souvenir des origines comme en témoigne Patrick Braouezec, le ci devant maire d’origine bretonne de Saint Denis.
Pour entretenir cette mémoire, et plus tard développer un discours revendicatif et identitaire, les Bretons de Paris et de sa région se sont dotés de nombreuses structures associatives - à l’image de La Maison de la Bretagne - et de lieux tels ces cafés et restaurants bretons qui ont été de véritables points d’ancrage de l'immigration bretonne. Il faut dire, comme le montre aussi l’expérience kabyle, que les artistes, chanteurs et poètes bretons ont beaucoup fait pour populariser et ancrer le discours identitaire. D’ailleurs, pour beaucoup, le 28 février 1978 marque le renouveau de l’identité bretonne. Ce jour-là Alan Stivell triomphait à l’Olympia.
Ainsi, et même si les conditions, les époques, les obstacles et autres cultures ne sont pas les mêmes, rien de nouveau donc sous le soleil de l’émigration qu’elle soit africaine, européenne ou bretonne.
Edition Les Beaux Jours, octobre 2009, 25€(Il s’agit de la réédition d’un livre paru en1997 aux éditions Parigramme)
-
Tous ces mondes en elle
Neil Bissoondath,
Tous ces mondes en elle
 Née dans les Caraïbes, Yasmin est arrivée très jeune au Canada avec sa mère, Shakti, qui, seule, a élevé son enfant. Yasmin est une femme de quarante ans. Mariée à Jim, ils ont une fille, Ariana. Le récit s’ouvre sur les préparatifs d’un voyage bien particulier : Yasmin part pour rapporter et disperser les cendres de sa mère sur sa terre natale.
Née dans les Caraïbes, Yasmin est arrivée très jeune au Canada avec sa mère, Shakti, qui, seule, a élevé son enfant. Yasmin est une femme de quarante ans. Mariée à Jim, ils ont une fille, Ariana. Le récit s’ouvre sur les préparatifs d’un voyage bien particulier : Yasmin part pour rapporter et disperser les cendres de sa mère sur sa terre natale.
Les seuls liens avec son pays et sa culture d’origine, mais aussi avec l’histoire familiale sont ceux que sa mère lui a transmis.
Ce retour sur le lieu de sa naissance, la rencontre avec la famille restée au pays, un oncle et une tante, vont susciter chez cette canadienne aux origines antillaises des interrogations sur sa vie et sur elle-même. Tout au long de cette introspection, Yasmin apprendra que les questions renferment plus de valeur que les réponses et les certitudes qui ont été les siennes jusqu’alors.
Plusieurs voix forment le récit : il y a celle de Yasmin qui raconte son voyage et son séjour dans cette famille qu’elle ne connaît pas, elle y ajoute des réflexions et des commentaires sur cette autre partie d’elle-même : sa vie avec Jim et leur fille ; il y a la mère qui monologue ses souvenirs à une amie alitée et malade ; de leurs côtés, sa tante et son oncle paternels évoquent le passé et notamment l’image forte et controversée de son père ; il y a le jeune Ash et ses certitudes identitaires, anticoloniales et exclusives ; il y a enfin la servante de toujours qui lui révélera avant son retour pour le Canada un lourd et significatif secret de famille.
Le passé et le présent se télescopent. Par petites touches, par l’évocation de souvenirs lointains ou proches, un « puzzle existentiel » s’ébauche. Une identité aux appartenances multiples se forme.
Cette construction, difficile et maîtrisée - même si les premières pages laissent une impression de piétinement – traduit la difficulté, la confusion parfois, à donner une cohérence à un tout hétéroclite. Tous les mondes ici évoqués sont bien en Yasmin. Le texte porté par ces voix plurielles, différentes et parfois même contradictoires rend la complexité d’une identité syncrétique et en mouvement.
Lorsque sa fille lui demande « qu’est ce que je suis vraiment ? » Yasmin n’ose pas lui dire qu’elle est « une enfant unique au monde, née de parents unis par l’histoire, la géographie et des myriades de migrations. (...) Une enfant dont l’existence n’aurait pu être prédite, et dont l’avenir attend d’être découvert ». Elle n’ose pas non plus l’avertir : « ne laisse personne te limiter à des notions convenues de ce qu’est le soi ».
A la complexité de cette réponse, Yasmin se réfugie derrière une autre réplique : « Est ce que ça ne suffit pas d’être canadienne ? ».
Sur ce point, c’est la mère de Yasmin qui, sans doute, a le dernier mot : « Je ne suis pas un produit fini (...). Je suis un processus. Même chose pour vous. Et pour chacun. C’est à mes yeux la vérité la plus dérangeante et la plus rassurante sur ce que les jeunes gens d’aujourd’hui appellent l’ « identité ». Figurez-vous, ma chère, je n’ai pas qu’une seule identité. Aucun de nous n’en a juste une. Sinon, quel drame ce serait, vous ne trouvez pas ? ».
Edition Phébus, 1999, 382p
-
L’armoire aux secrets
Mélina Gazsi
L’armoire aux secrets
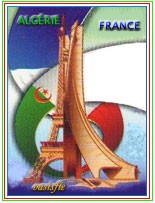 Par mille et une radicelles, la longue histoire de la France et de l’Algérie, s’enracine dans les consciences. Ces deux pays, chacun à sa manière, se réapproprient une mémoire cahotante, oubliée ou falsifiée. En France, des travaux de l’historien Benjamin Stora au tout début des années 90 ou le procès autour du 17 octobre 1961 (Einaudi c/Papon), la vérité historique paraît vouloir s’affirmer chaque jour un peu plus.
Par mille et une radicelles, la longue histoire de la France et de l’Algérie, s’enracine dans les consciences. Ces deux pays, chacun à sa manière, se réapproprient une mémoire cahotante, oubliée ou falsifiée. En France, des travaux de l’historien Benjamin Stora au tout début des années 90 ou le procès autour du 17 octobre 1961 (Einaudi c/Papon), la vérité historique paraît vouloir s’affirmer chaque jour un peu plus.
Un autre pan de cette union contrainte s’entrouvre à la connaissance : celui des amours - et désamours -, qui ont unit les hommes et les femmes de ces deux pays. Avec Elise ou la vraie vie, Michel Drach, en septembre 1970, donnait pour la première fois à l’écran, le récit de ces si particulières histoires d’amour. 20 ans plus tard, en 1989, Tassadit Imache dans Une fille sans histoire dresse le portrait de Lil, la fille d’Huguette et d’Ali. Daniel Prévost confiait il y a peu ses affres psychologiques à s’extraire du silence et des tortures maternelles pour aller à la rencontre de cette autre partie de lui même : un père algérien.
De l’autre côté de la Méditerranée, avec Les Amants désunis, le récit des amours contrariées par l’Histoire d’une Suissesse et d’un Algérien, Anouar Benmaleck offrait en 1998, une nouvelle version de ces amours des deux rives inaugurées, en 1953 (!) par La Terre et le sang de l’inestimable Mouloud Feraoun.
L’histoire remonte à la surface. Avec L’armoire aux secrets, Mélina Gazsi ajoutait une nouvelle page à ce chapitre des relations franco-algériennes qui est loin d’être écrit.
Fille d’une mère bretonne et d’un père algérien, Mélina ignore tout de ce dernier. Un secret plane sur les circonstances de son départ forcé ou de son abandon programmé. Tout cela remonte à cette période confuse et difficile de la guerre d’Algérie. Jamais Mélina ne saura vraiment. Face au silence maternel elle laissera son imaginaire donner un sens au non-dit, au mystère : elle s’invente un père héros de la guerre d’indépendance, maquisard en Algérie.
Mélina va vivre avec cette absence et se construire, en apparence du moins, de manière complètement détachée, désengagée de son origine algérienne. En apparence seulement, car et c’est l’extraordinaire de ce récit, cette origine semble, de manière souterraine, déterminer l’essentiel de l’existence de Mélina : relations, mode de vie, activité professionnelle et même cette rencontre avec Chérifa - hasard ou nécessité? - qui sera celle qui lui permettra de retrouver, de manière imprévue, involontaire, sans motivation apparente, en 1992, son père resté en Algérie. Ces retrouvailles, orchestrées par le père avec emphase à l’aéroport d’Alger, déboucheront sur bien des interrogations et une certitude : un fossé culturel sépare le père de son enfant. Les incompréhensions ne portent pas seulement sur l’histoire familiale, mais concernent aussi les comportements présents. Si le père algérien a légué un héritage à ses enfants français, il ne leurs a pas laissé de testament. A chacun échoira la lourde tâche de se construire avec, contre ou à côté de cet héritage complexe et diffus. A Alger, Mélina et son père tenteront de rattraper le temps perdu, ils se livreront l’un à l’autre. Trop vite peut-être pour pouvoir s’apprivoiser l’un l’autre.
Ainsi, par un mouvement lent, continu et significatif –, mais, a posteriori, ne fait t-on pas dire aux faits plus que ce qu’ils ont signifié réellement? – les origines algériennes de Mélina, ses origines oubliées, refoulées qu’elle a même tenté de cacher, ont rattrapé la jeune femme. “Le hasard, encore le hasard. Et l’Histoire qui danse avec la mienne, écrit Mélina Gazsi, si petite que parfois, j’en ai honte”.
L’Histoire des passions franco-algériennes a produit des milliers de ces histoires, plus ou moins lumineuses, plus ou moins sombres. Le hasard n’y tient pas une si grande place. Seulement ces existences portent en elles et avec elles un champs des possibles bien plus grand, le nombre des bifurcations potentielles y est plus élevés. Pour peu que l’Histoire écoute la mémoire de ces milliers d’histoires, s’en nourrisse alors, l’une de ces bifurcations s’appellera amitiés franco algériennes.
Edition de l’Aube, 1999 -
Les identités meurtrières
Amin Maalouf
Les identités meurtrières
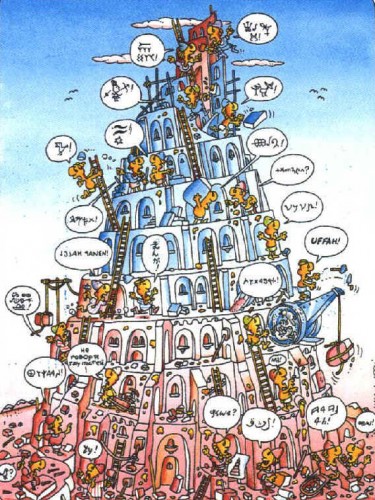 Pourquoi Amin Maalouf, ce célèbre romancier libanais qui a passé les 29 premières années de sa vie dans son pays natal et 22 autres en France (à la parution de ce livre) a t-il ressenti le besoin d’écrire un essai sur la notion d’identité? L’homme refuse de compartimenter son identité et revendique une identité et une seule mais “faite de tous les éléments qui l’ont façonnée (...)”. Cette évidence ne l’est pas pour tout le monde et surtout elle ne correspond pas à “l’air du temps”. Cela se vérifie quand ce franco-libanais, arabe, d’origine chrétienne, issu d’une minorité marginalisée dans son pays, aux riches ramifications familiales et personnelles doit répondre à l’anodine - en apparence - et récurrente question : “mais au fin fond de vous même qu’est ce que vous vous sentez?”. Ainsi, prix Goncourt ou pas, l’immigré Amin Maalouf doit justifier, défendre une autre conception de l’identité, que celle, “meurtrière” qui tend à réduire, “au fond”, à une seule appartenance l’identité des uns et des autres - entendre aussi bien celle des individus que des communautés ou des nations. “Car c’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c’est notre regard qui peut les libérer”. Il est facile d’imaginer les difficultés – voire les impasses – des jeunes issus de l’immigration pour se libérer du regard de la société française. Ce regard qui tend à les enfermer dans une identité unique ou même une identité de substitution – l’arabité ou l’islamisme par exemple – et ne les aide pas, à l’instar d’un Amin Maalouf, à se construire à partir d’une autre conception de l’identité et de leur place au sein de la société.
Pourquoi Amin Maalouf, ce célèbre romancier libanais qui a passé les 29 premières années de sa vie dans son pays natal et 22 autres en France (à la parution de ce livre) a t-il ressenti le besoin d’écrire un essai sur la notion d’identité? L’homme refuse de compartimenter son identité et revendique une identité et une seule mais “faite de tous les éléments qui l’ont façonnée (...)”. Cette évidence ne l’est pas pour tout le monde et surtout elle ne correspond pas à “l’air du temps”. Cela se vérifie quand ce franco-libanais, arabe, d’origine chrétienne, issu d’une minorité marginalisée dans son pays, aux riches ramifications familiales et personnelles doit répondre à l’anodine - en apparence - et récurrente question : “mais au fin fond de vous même qu’est ce que vous vous sentez?”. Ainsi, prix Goncourt ou pas, l’immigré Amin Maalouf doit justifier, défendre une autre conception de l’identité, que celle, “meurtrière” qui tend à réduire, “au fond”, à une seule appartenance l’identité des uns et des autres - entendre aussi bien celle des individus que des communautés ou des nations. “Car c’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c’est notre regard qui peut les libérer”. Il est facile d’imaginer les difficultés – voire les impasses – des jeunes issus de l’immigration pour se libérer du regard de la société française. Ce regard qui tend à les enfermer dans une identité unique ou même une identité de substitution – l’arabité ou l’islamisme par exemple – et ne les aide pas, à l’instar d’un Amin Maalouf, à se construire à partir d’une autre conception de l’identité et de leur place au sein de la société.L’identité complexe ici défendue n’est pas seulement une séduisante et salutaire construction théorique, elle correspond, en cette fin de siècle, à un élément essentiel de la modernité, elle est vécue, portée, avec plus ou moins de bonheur et de souffrance, par des millions d’hommes et de femmes que la vie moderne, les évolutions politiques et les révolutions dans les technologies de la communication placent à la croisée de nombreux chemins linguistiques, culturels, communautaires, nationaux ou, tout simplement, socio-professionnels.
Amin Maalouf cherche à dégager les voies d’une autre conception de l’identité. A une identité meurtrière, parce que réductrice, communautaire, tribale, etc., il témoigne, après et avec d’autres, d’une conception complexe de l’identité revendiquant des appartenances multiples, irréductibles. L’enjeu est d’importance : “ceux qui pourront assumer pleinement leur diversité serviront de “relais” entre les diverses communautés, les diverses cultures, et joueront en quelque sorte le rôle de “ciment” au sein des société où ils vivent”.
L’auteur ne limite pas sa réflexion à l’individu ou à la société. Sa pensée porte aussi sur les crises d’identité des pays du Tiers-Monde confrontés à une modernité née il y a plusieurs siècles en Occident . “Pour le reste du monde (...) la modernisation a constamment impliqué l’abandon d’une partie de soi-même”.
Il consacre de nombreuses pages à l’analyse, toujours dans une perspective historique et non idéologique ou religieuse, des différentes réponses du monde arabe à la nécessaire modernisation : nationalisme d’abord, islamisme radical ensuite.
La montée du religieux, n’est pas une spécificité musulmane. Elle correspond aussi bien à la chute du mur de Berlin, à la crise partielle du modèle occidental qu’aux impasses de nombreuses sociétés du Tiers-Monde. Elle est aussi et peut-être surtout liée au processus de “mondialisation”, à ces bouleversements en matière de communication. Alors, la montée du religieux ne serait pas, pour Amin Maalouf “une simple réaction” mais “peut-être une tentative de synthèse entre le besoin d’identité et l’exigence d’universalité”.
Dans le monde rêvé d’Amin Maalouf où “le besoin de spiritualité serait dissocié du besoin d’existence”, “séparer l’Eglise de l’Etat, ne suffit plus, tout aussi important serait de séparer le religieux de l’identitaire. (...) Il faudrait pouvoir satisfaire d’une autre manière le besoin d’identité”.
Amin Maalouf n’est pas un naïf. Il n’ignore pas les dangers de la mondialisation. Il les dénonce même : uniformisation, hégémonie idéologique, politique, économique ou médiatique, et même l’insupportable condescendance de certains en Occident...
Pourtant, cette mondialisation pourrait être une chance pour l’émergence d’une nouvelle conscience identitaire où l’appartenance humaine prendrait le pas sur la somme des appartenances.
La route est encore longue. Dans un ultime chapitre - “apprivoiser la panthère” - il explore les pistes qui pourraient aider à la naissance de cette nouvelle conscience identitaire. La connaissance - et la défense - des langues est au cœur des préoccupations de l’auteur. Les langues offrent “la merveilleuse particularité d’être à la fois facteur d’identité et instrument de communication. (...) la langue a vocation à demeurer le pivot de l’identité culturelle, et la diversité linguistique le pivot de toute diversité”.
Mais l’homme moderne ne fera pas l’économie d’une réflexion “sereine et globale” sur les moyens juridico-politiques qu’il se donne pour préserver la diversité des cultures. Le libanais Amin Maalouf met en garde contre les dangers et les dérapages du système des quotas ou du communautarisme. Il ne croit pas non plus que la loi du nombre – le suffrage universel – soit en la matière une garantie pour le maintien de cette diversité. “Ce qui est sacré, dans la démocratie, ce sont les valeurs, pas les mécanismes. (...) le mode de scrutin doit être adapté à cette exigence”. Des garde-fous institutionnels peuvent se révéler indispensables – il cite des exemples au Royaume Uni, en France, aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud - comme pourrait l’être, dans des situations extrêmes de massacres ou de graves discriminations, une “supervision active de la part de la communauté internationale”.
Edition Grasset, 1999. Réédité en poche en 2001 (LGF)