Agnès Villechaise-Dupont
Amère banlieue. Les gens des grands ensembles
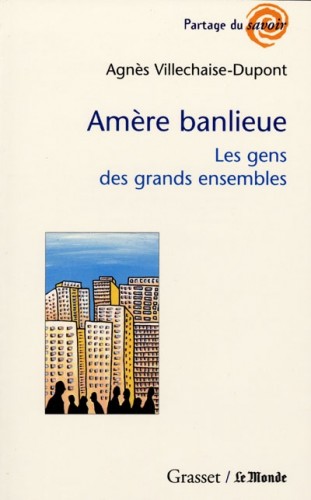 Agnès Villechaise-Dupont publie ici les résultats d'une enquête comparative qu'elle a menée sur deux sites accueillant des populations précarisées : le quartier des Hauts-de-Garonne, sur la rive droite bordelaise, et l'ancien quartier populaire Saint-Michel, au centre-ville de Bordeaux. Appuyant sa démonstration sur des témoignages variés, elle montre que les faits comme les existences ne peuvent être réduits à des interprétations univoques ou à des grilles de lecture par trop simplificatrices et dépréciatives. Elle incite les responsables politiques et autres élus à mieux écouter les femmes et les hommes des grands ensembles, à en faire les partenaires et les acteurs des mesures à prendre pour éviter la déréliction de la banlieue et de ses habitants. Pour l'auteur, les habitants des Hauts-de-Garonne ne sont pas porteurs d'une culture populaire ; ils n'appartiennent pas à la classe ouvrière mais plutôt à ce qu'elle nomme les "catégories moyennes paupérisées". Définies non pas d'après leur position dans le processus de production, mais selon "la réalisation d'un certain niveau de vie", ces catégories moyennes constitueraient un groupe hétérogène comprenant aussi bien des employés, des ouvriers qualifiés que des indépendants. A. Villechaise- Dupont a certes rencontré des gens victimes de l'exclusion économique, mais qui ont en commun avec les autres catégories moyennes - virtuellement du moins - des aspirations et des modèles. L'écart, la "discordance" entre cette intégration culturelle dans la société de consommation et le "défaut d'intégration économique" génèrent frustrations, dévalorisation et amertume. L'impossibilité de voir émerger une contestation collective et un contre-modèle culturel conduit au repli sur la sphère privée, unique attitude de résistance. "C'est bien dans cette absence d'identité collective, dans ce défaut d'appartenance, que peut se révéler un principe commun à même de définir les populations des grands ensembles urbains aujourd'hui", estime l'auteur.
Agnès Villechaise-Dupont publie ici les résultats d'une enquête comparative qu'elle a menée sur deux sites accueillant des populations précarisées : le quartier des Hauts-de-Garonne, sur la rive droite bordelaise, et l'ancien quartier populaire Saint-Michel, au centre-ville de Bordeaux. Appuyant sa démonstration sur des témoignages variés, elle montre que les faits comme les existences ne peuvent être réduits à des interprétations univoques ou à des grilles de lecture par trop simplificatrices et dépréciatives. Elle incite les responsables politiques et autres élus à mieux écouter les femmes et les hommes des grands ensembles, à en faire les partenaires et les acteurs des mesures à prendre pour éviter la déréliction de la banlieue et de ses habitants. Pour l'auteur, les habitants des Hauts-de-Garonne ne sont pas porteurs d'une culture populaire ; ils n'appartiennent pas à la classe ouvrière mais plutôt à ce qu'elle nomme les "catégories moyennes paupérisées". Définies non pas d'après leur position dans le processus de production, mais selon "la réalisation d'un certain niveau de vie", ces catégories moyennes constitueraient un groupe hétérogène comprenant aussi bien des employés, des ouvriers qualifiés que des indépendants. A. Villechaise- Dupont a certes rencontré des gens victimes de l'exclusion économique, mais qui ont en commun avec les autres catégories moyennes - virtuellement du moins - des aspirations et des modèles. L'écart, la "discordance" entre cette intégration culturelle dans la société de consommation et le "défaut d'intégration économique" génèrent frustrations, dévalorisation et amertume. L'impossibilité de voir émerger une contestation collective et un contre-modèle culturel conduit au repli sur la sphère privée, unique attitude de résistance. "C'est bien dans cette absence d'identité collective, dans ce défaut d'appartenance, que peut se révéler un principe commun à même de définir les populations des grands ensembles urbains aujourd'hui", estime l'auteur.
Voilà toute la différence entre les habitants de cette périphérie et ceux du quartier Saint-Michel. Vivre ici n'est pas perçu comme dégradant ou infamant, ni comme le résultat d'une sanction sociale. Il est de bon ton de le revendiquer et de mettre en avant la beauté du quartier, son histoire, sa mémoire, sa tradition d'accueil et même sa diversité culturelle - des cultures qui s'y côtoient plus qu'elles ne se mêlent -, donnant à ses rues et ses places une tonalité colorée et, pour certains, un parfum d'exotisme socioculturel. Malgré les profondes transformations qui, en quinze ans, ont modifié le quartier, malgré les tensions qui y existent aussi, vivre à Saint-Michel procure une identité valorisante. À l'investissement de l'espace public, qui offre ici le cadre d'une "sociabilité de proximité très dense", s'oppose le repli sur la sphère privée aux Hauts-de-Garonne, la volonté de se démarquer d'un voisinage d'autant plus méprisé qu'il reflète son propre sentiment d'échec.
Cette "individualisation" des "catégories moyennes paupérisées" comme seule réponse tactique porte en elle les dangers d'une "fragmentation", d'une "désaffiliation" avec le reste du corps social. D'une manière générale, subissant une autre forme de dépendance, les habitants des cités reprendraient le discours que le monde extérieur leur renvoie, avec pour critères récurrents l'insécurité, le chômage et l'immigration. Ils intégreraient même ces jugements de valeur qui les présentent comme passifs, assistés, voire comme des "cas sociaux". L'habitant des cités "se voit ainsi dépossédé de ses propres capacités cognitives : on lui dit l'horreur de l'endroit où il habite, et il subit ce discours". Convaincue que "les caractéristiques objectives de ces espaces sont sans doute moins importantes que le regard porté sur eux...", l'auteur invite "à encourager les timides et fragiles velléités identitaires observées en particulier chez les jeunes et les immigrés dans la cité, tout en évitant une dérive ségrégative qui réaliserait la vision pour l'instant fantasmatique de la banlieue comme "monde à part" à l'image du ghetto américain". Si de telles mesures peuvent sans doute permettre de "relativiser le sentiment de l'échec", elles peuvent aussi, et cela n'échappe pas à l'auteur, s'apparenter à l'administration d'un placebo dès lors que les causes réelles de l'échec demeurent : exclusion, chômage, précarité. Mais, reprenant à son compte les analyses présentées entre autres par Françoise Gaspard et Farhad Khosrokhavar dans Le Foulard et la République (La Découverte, 1995), A. Villechaise- Dupont présente ce qu'elle appelle, par un doux euphémisme, l'adhésion à un islam "très critique" comme une provocation volontaire des intéressés à l'exclusion dont ils seraient victimes. Tout cela ne serait qu'une "rébellion douce, qui n'est pas détachable d'une volonté d'intégration". Sur cette question, l'enquête, plus large et sur bien des aspects plus pointue, menée à Dreux par Michèle Tribalat parvenait à des conclusions bien moins optimistes et valorisait chez les jeunes des mobilisations et des contestations plus "citoyennes". L'auteur, en conclusion, ne cache pas les risques de dérives vers un "repli désabusé et hostile sur des communautés devenues fermées et intolérantes". Mais son relatif optimisme fera bondir ceux qui demeurent fermes face à l'instrumentalisation des identités ou même, refusant de jouer avec le feu, maintiennent la même fermeté face à ce qui ne serait encore qu'une tendance "douce" au repli sur des comportements ou des valeurs rattachées à un islam "très critique".
Edition Grasset-Le Monde, 2000, 329 p., 20,60 €
- Page 2
-
-
Lettre du Maroc
Christine Daure-Serfaty
Lettre du Maroc
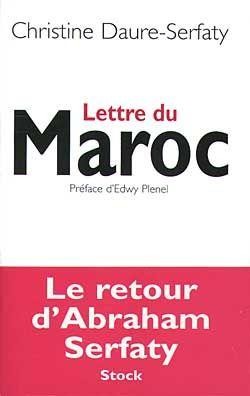 En 1999, Abraham Serfaty et sa femme Christine Daure-Serfaty rentraient au Maroc. Le plus célèbre opposant au monarque Hassan II revenait après "quinze mois au Derb Moulay Chérif, le centre de torture de Casablanca, dix-sept ans de prison à Kenitra, huit ans de bannissement en France". Sa compagne avait derrière elle des années de combat, pour son mari mais aussi pour dénoncer le régime marocain et faire connaître au monde l'horreur de ses prisons, à commencer par le bagne de Tazmamart, qui serait resté longtemps secret n'eut été le courage de Christine Daure-Serfaty. En préface, Edwy Plenel raconte comment est né le livre Notre ami le roi, de Gilles Perrault, et ce qu'il doit aux informations fournies par l'opposante marocaine. Il y a deux lectures possibles de cette Lettre du Maroc.
En 1999, Abraham Serfaty et sa femme Christine Daure-Serfaty rentraient au Maroc. Le plus célèbre opposant au monarque Hassan II revenait après "quinze mois au Derb Moulay Chérif, le centre de torture de Casablanca, dix-sept ans de prison à Kenitra, huit ans de bannissement en France". Sa compagne avait derrière elle des années de combat, pour son mari mais aussi pour dénoncer le régime marocain et faire connaître au monde l'horreur de ses prisons, à commencer par le bagne de Tazmamart, qui serait resté longtemps secret n'eut été le courage de Christine Daure-Serfaty. En préface, Edwy Plenel raconte comment est né le livre Notre ami le roi, de Gilles Perrault, et ce qu'il doit aux informations fournies par l'opposante marocaine. Il y a deux lectures possibles de cette Lettre du Maroc.
 Il y a d'abord le retour de ces deux "héros", comme l'écrit Edwy Plenel. Christine Daure-Serfaty revient sur l'engagement et le courage des "années de plomb". Le sien, celui de son mari et celui des Marocains, morts ou survivants du régime de Hassan II. Emouvantes sont les retrouvailles avec d'anciens détenus, avec des hommes et des femmes qui, refusant de plier sous le joug royal, ont connu l'humiliation, l'internement et la torture. Le récit est sobre, mesuré. Il dit, simplement, le passé, ce triste et douloureux passé : "Nous avions tous peur en ce temps-là." Les mots se suffisent à eux-mêmes pour exprimer, sans effet de style ni dithyrambe, l'héroïsme de ceux qui ont eu le cran de dire non : "Ces hommes-là [et ces femmes], je le pense profondément, sont une chance pour leurs enfants, une richesse pour leur pays, ils sont le sel de la terre...". Ce passé, si proche et déjà si lointain, est au cœur de l'actualité marocaine : "Que faire du passé, en fait, de ce passé qui à la fois date d'hier, mais a quarante ans d'âge derrière lui, dont les victimes sont là, avec nous, qui croisent dans la rue leurs bourreaux ?"
Il y a d'abord le retour de ces deux "héros", comme l'écrit Edwy Plenel. Christine Daure-Serfaty revient sur l'engagement et le courage des "années de plomb". Le sien, celui de son mari et celui des Marocains, morts ou survivants du régime de Hassan II. Emouvantes sont les retrouvailles avec d'anciens détenus, avec des hommes et des femmes qui, refusant de plier sous le joug royal, ont connu l'humiliation, l'internement et la torture. Le récit est sobre, mesuré. Il dit, simplement, le passé, ce triste et douloureux passé : "Nous avions tous peur en ce temps-là." Les mots se suffisent à eux-mêmes pour exprimer, sans effet de style ni dithyrambe, l'héroïsme de ceux qui ont eu le cran de dire non : "Ces hommes-là [et ces femmes], je le pense profondément, sont une chance pour leurs enfants, une richesse pour leur pays, ils sont le sel de la terre...". Ce passé, si proche et déjà si lointain, est au cœur de l'actualité marocaine : "Que faire du passé, en fait, de ce passé qui à la fois date d'hier, mais a quarante ans d'âge derrière lui, dont les victimes sont là, avec nous, qui croisent dans la rue leurs bourreaux ?"
L'autre lecture de cette Lettre porte justement sur la description d'un pays retrouvé et les incertitudes quant à sa démocratisation. Christine cite un ami espagnol : "Dans mon pays, la démocratisation s'est faite en cascade. Ici, c'est du goutte-à-goutte..." On la devine plus circonspecte qu'Abraham Serfaty. Certes, le Maroc change, il retrouve sa liberté de parole, le retour des exilés politiques s'accélère. La question des disparus n'est plus taboue, certains se battent pour la reconnaissance de leurs droits, des réformes sont en cours, une commission d'indemnisation pour les victimes de la détention arbitraire a vu le jour. Le tout-puissant ministre de l'Intérieur, Driss Basri - qui continuait de sévir au sein de l'université marocaine, où il enseignait le... droit -, a été limogé le 9 novembre 1999 et son "système", démantelé. Si le changement ne vient pas assez vite, c'est que la volonté royale doit composer avec les lourdeurs et les blocages du Makhzen ; écrit l'auteur, "ce noyau central du pouvoir despotique et de l'insolente richesse, porte toujours sur lui l'image sombre des décennies de plomb." Mais la situation sociale et économique est à maints égards catastrophiques. Christine Daure- Sefaty dit la pauvreté, la misère héréditaire, le chômage qui n'épargne pas les diplômés de l'université, dans ce pays où la soumission et les liens familiaux passent avant les compétences. Elle insiste sur le sort des femmes pauvres, répudiées, mères célibataires souvent condamnées à la prostitution, sur l'antisémitisme diffus ou le racisme anti-Noirs à peine caché. La popularité du roi auprès des déshérités sera-t-elle suffisante pour enrayer la montée d'un islamisme de plus en plus entreprenant ? La société civile, si dynamique aujourd'hui, pourra-t-elle s'opposer à ceux qui se sont dressés contre le Projet d'action nationale pour l'intégration de la femme au développement ? C. Daure-Serfaty ne cache pas non plus ses doutes face à la persistance de certaines vieilles habitudes policières et des pratiques de l'ombre... Dans ce panorama marocain, l'auteur n'aborde pas (ou si peu) la question, toujours délicate pour ne pas dire taboue, du Sahara occidental ou celle des relations avec le voisin algérien. Mais cette lettre n'avait pas prétention à l'exhaustivité. "Des mots tournent dans ma tête depuis des jours, autour de l'espérance, autour de l'inquiétude." Ce sont ces mots qu'en toute simplicité, Christine Daure-Serfaty adresse.
Edition Stock, 2000, 160 p., 13,57€ -
Écrivains/Sans-papiers Nouvelles
Écrivains/Sans-papiers
Nouvelles
 Sauf erreur, les sans-papiers avaient inspiré bien peu de textes littéraires à la sortie de ce recueil de nouvelles. Le livre du marocain Mahi Binebine, Cannibales (1999), étant une première exception. C'est dire si l'initiative de publier trente-quatre nouvelles sur le sujet méritait l'attention. Et si, pour reprendre Hamlet, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que la philosophie d'Horatio en puisse rêver, osons dire qu'il y a plus de vérités et d'informations dans ces nouvelles que bien des controverses ou des publications savantes, utiles mais par trop abstraites, en puissent à leur tour rêver. La qualité première de ce recueil est de (ré)introduire la dimension humaine au cœur de cette aventure migratoire souvent tragique. Côté informations, le lecteur finit par tout savoir : le déracinement et les déchirements familiaux, l'espoir aussi de fuir, qui la misère, qui l'oppression, les filières de passeurs, l'attente, l'incertitude, la
Sauf erreur, les sans-papiers avaient inspiré bien peu de textes littéraires à la sortie de ce recueil de nouvelles. Le livre du marocain Mahi Binebine, Cannibales (1999), étant une première exception. C'est dire si l'initiative de publier trente-quatre nouvelles sur le sujet méritait l'attention. Et si, pour reprendre Hamlet, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que la philosophie d'Horatio en puisse rêver, osons dire qu'il y a plus de vérités et d'informations dans ces nouvelles que bien des controverses ou des publications savantes, utiles mais par trop abstraites, en puissent à leur tour rêver. La qualité première de ce recueil est de (ré)introduire la dimension humaine au cœur de cette aventure migratoire souvent tragique. Côté informations, le lecteur finit par tout savoir : le déracinement et les déchirements familiaux, l'espoir aussi de fuir, qui la misère, qui l'oppression, les filières de passeurs, l'attente, l'incertitude, la  dépossession de soi, l'argent qu'il faut fournir sans garantie aucune, la faim, le froid, le manque de sommeil, les douleurs physiques qui s'ajoutent aux souffrances morales. Il faut, de plus, compter avec les passeurs véreux qui, après avoir empoché l'argent, vous abandonnent dans la nature, ou avec ces filières qui se chargent de placer leurs "clients" auprès d'entrepreneurs qui les réduisent à la condition d'esclave. Reste enfin le risque de se faire prendre par la police. Ceux qui réussissent à passer la frontière ne sont pas au bout de leurs peines. De ce côté-ci, la dépossession de soi se poursuit, s'accentue même au point que le corps se décompose, partie par partie, jusqu'à la mutilation ; la peur d'être victime d'un contrôle de "non-identité" ou du racisme oblige à être en permanence sur le qui-vive ; fragilisés, ces hommes et ces femmes sont à la merci des rentiers du système, propriétaires d'appartements et autres entrepreneurs-exploiteurs, quand ce n'est pas la terrible descente aux enfers de la prostitution des filles-mères abandonnées. Le tableau ne serait pas complet sans l'évocation du rapport avec l'administration ou la police, et jusqu'aux conséquences de la législation en matière de régularisation. Tout y est, rien ne manque, pas même la question culturelle du rapport à l'Autre.
dépossession de soi, l'argent qu'il faut fournir sans garantie aucune, la faim, le froid, le manque de sommeil, les douleurs physiques qui s'ajoutent aux souffrances morales. Il faut, de plus, compter avec les passeurs véreux qui, après avoir empoché l'argent, vous abandonnent dans la nature, ou avec ces filières qui se chargent de placer leurs "clients" auprès d'entrepreneurs qui les réduisent à la condition d'esclave. Reste enfin le risque de se faire prendre par la police. Ceux qui réussissent à passer la frontière ne sont pas au bout de leurs peines. De ce côté-ci, la dépossession de soi se poursuit, s'accentue même au point que le corps se décompose, partie par partie, jusqu'à la mutilation ; la peur d'être victime d'un contrôle de "non-identité" ou du racisme oblige à être en permanence sur le qui-vive ; fragilisés, ces hommes et ces femmes sont à la merci des rentiers du système, propriétaires d'appartements et autres entrepreneurs-exploiteurs, quand ce n'est pas la terrible descente aux enfers de la prostitution des filles-mères abandonnées. Le tableau ne serait pas complet sans l'évocation du rapport avec l'administration ou la police, et jusqu'aux conséquences de la législation en matière de régularisation. Tout y est, rien ne manque, pas même la question culturelle du rapport à l'Autre. Il ne faut pas pour autant en déduire que le tableau est noir et trop militant. Côté littérature, la majorité des nouvelles ici présentées brillent autant par leur contenu informatif que par leurs qualités stylistiques et romanesques. De ce point de vue, nombre de trouvailles réjouissent le lecteur. Ainsi, ces sans-papiers qui entreprennent de démolir les trottoirs parce que la terre pourrit sous le béton (J.-P. Bernède), ou la rencontre de deux enfants sans-papiers avec Zidane et Ronaldo sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde de football (D. Daeninckx). Et cette petite perle d'humour qui montre comment Achille, un frêle Zaïrois s'exprimant dans un français du XVIIe siècle, et Mikhaïl, un malabar russe, ancien instructeur des forces spéciales de la marine soviétique, s'extraient des griffes des "archers du royaume des lys" (F. H. Fajardie). De dépossession de soi, il en est question chez P. Hérault, dans le calepin d'un sans-papiers retrouvé sur un banc d'un square, ou chez A. Kalouaz, dont le personnage aura usurpé pendant quinze ans l'identité d'un autre. Humour aussi, avec G. Mazuir et son héros embarqué malgré lui dans la lutte des sans-papiers, et dont les capacités à courir et à semer la police française le conduisent à représenter la France au sein de la Fédération française d'athlétisme. A. de Montjoie brosse un autre scénario, selon lequel l'expulsion des sans-papiers et autres immigrés laisse le pays en proie à un lent et inexorable dessèchement. L'appauvrissement sera non seulement économique, mais aussi social et humain. V. Staraselski fait se rencontrer le temps d'un contrôle, sous le faible éclairage d'un réverbère et à la lumière de la philosophie, un flic et une prostituée sans-papiers... Un livre riche et dense qui, malgré le tableau souvent sombre d'une triste réalité, parvient à ne pas désespérer le lecteur des hommes et de nos concitoyens.
Il ne faut pas pour autant en déduire que le tableau est noir et trop militant. Côté littérature, la majorité des nouvelles ici présentées brillent autant par leur contenu informatif que par leurs qualités stylistiques et romanesques. De ce point de vue, nombre de trouvailles réjouissent le lecteur. Ainsi, ces sans-papiers qui entreprennent de démolir les trottoirs parce que la terre pourrit sous le béton (J.-P. Bernède), ou la rencontre de deux enfants sans-papiers avec Zidane et Ronaldo sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde de football (D. Daeninckx). Et cette petite perle d'humour qui montre comment Achille, un frêle Zaïrois s'exprimant dans un français du XVIIe siècle, et Mikhaïl, un malabar russe, ancien instructeur des forces spéciales de la marine soviétique, s'extraient des griffes des "archers du royaume des lys" (F. H. Fajardie). De dépossession de soi, il en est question chez P. Hérault, dans le calepin d'un sans-papiers retrouvé sur un banc d'un square, ou chez A. Kalouaz, dont le personnage aura usurpé pendant quinze ans l'identité d'un autre. Humour aussi, avec G. Mazuir et son héros embarqué malgré lui dans la lutte des sans-papiers, et dont les capacités à courir et à semer la police française le conduisent à représenter la France au sein de la Fédération française d'athlétisme. A. de Montjoie brosse un autre scénario, selon lequel l'expulsion des sans-papiers et autres immigrés laisse le pays en proie à un lent et inexorable dessèchement. L'appauvrissement sera non seulement économique, mais aussi social et humain. V. Staraselski fait se rencontrer le temps d'un contrôle, sous le faible éclairage d'un réverbère et à la lumière de la philosophie, un flic et une prostituée sans-papiers... Un livre riche et dense qui, malgré le tableau souvent sombre d'une triste réalité, parvient à ne pas désespérer le lecteur des hommes et de nos concitoyens.Édition Bérénice, 2000, 231 pages
Photos (dans l'ordre): F. H. Fajardie, A. Kalouaz & D. Daeninckx)
-
Presque un frère
Tassadit Imache
Presque un frère. Conte du temps présent
 Le monde de Tassadit Imache est un monde sans concession, âpre. Son parti pris est évident : décrire les laissés pour-compte. Marginalisés culturellement ou socialement, ses personnages subissent relégation et exclusion. Avant même de venir au monde, ils héritent des tares d'une famille, des dysfonctionnements d'une société, des ratés de l'Histoire. Dans Presque un frère, Tassadit Imache enfonce le clou, travaille la plaie avec une précision de chirurgien, appuie là où cela fait mal, quitte à choquer. Les "Terrains" vont-ils définitivement se détacher de la ville ? L'espace délimité, circonscrit, est le territoire des jeunes regroupés au sein du "Troupeau" et du "bétail affolé par le manque d'air, l'isolement". La description des lieux et des personnages est abrupte. Le sordide règne. Pas de pleurnicherie ni de volonté d'émouvoir pourtant. Le texte est brut, brutal et dur. Le récit n'est jamais factice. Il est construit sur un mode polyphonique, sa structure est éclatée. Ici, le gris domine, dilue les perspectives et étouffe les existences. Le brouillard est partout, jusque dans les têtes. Le banal quotidien d'une cité : les boîtes aux lettres cassées, les jeunes et leurs molosses aux crocs dissuasifs, les voitures volées ou endommagées, l'urine pestilentielle des chiens et la saleté qui obligent par endroits à se boucher le nez, le chômage, l'alcool et les trafics divers...
Le monde de Tassadit Imache est un monde sans concession, âpre. Son parti pris est évident : décrire les laissés pour-compte. Marginalisés culturellement ou socialement, ses personnages subissent relégation et exclusion. Avant même de venir au monde, ils héritent des tares d'une famille, des dysfonctionnements d'une société, des ratés de l'Histoire. Dans Presque un frère, Tassadit Imache enfonce le clou, travaille la plaie avec une précision de chirurgien, appuie là où cela fait mal, quitte à choquer. Les "Terrains" vont-ils définitivement se détacher de la ville ? L'espace délimité, circonscrit, est le territoire des jeunes regroupés au sein du "Troupeau" et du "bétail affolé par le manque d'air, l'isolement". La description des lieux et des personnages est abrupte. Le sordide règne. Pas de pleurnicherie ni de volonté d'émouvoir pourtant. Le texte est brut, brutal et dur. Le récit n'est jamais factice. Il est construit sur un mode polyphonique, sa structure est éclatée. Ici, le gris domine, dilue les perspectives et étouffe les existences. Le brouillard est partout, jusque dans les têtes. Le banal quotidien d'une cité : les boîtes aux lettres cassées, les jeunes et leurs molosses aux crocs dissuasifs, les voitures volées ou endommagées, l'urine pestilentielle des chiens et la saleté qui obligent par endroits à se boucher le nez, le chômage, l'alcool et les trafics divers...
Pour se donner bonne conscience, les "Autres", dépensent de temps à autre de l'argent ou dépêchent quelques universitaires "spécialistes" aux "Terrains". Mais les gens des cités ne sont pas dupes : "S'ils croient là-haut, dans les bureaux, que c'est en envoyant un type frapper à nos portes pour noircir gratuitement des cases sous notre nez, que nous, les z'anonymes, nous aurons un jour l'envie de repayer les impôts."
Bruno, le nouveau responsable de la sécurité du supermarché, est étranger aux "Terrains". Abandonné par son père, le "bâtard" a été placé chez les jésuites entre six ans et dix-huit ans, de sorte que pour lui, sa mère est une étrangère. Bruno attend "celle qui le ressuscitera". Serait-ce Sabrina, la nouvelle employée du supermarché ? Voire. Tant de choses séparent le mystérieux garçon, lesté d'un lourd secret, de Sabrina. Sur la carte de la vie, ils ne sont pas du même côté. Elle est une enfant des "Terrains". Famille nombreuse et déstructurée. Mère française, père algérien : c'est une "cinquante- cinquante". Comme Pascal, dont le père, M. Berkani ("noir", en kabyle) et la mère, Mme Blanchard, finissent leur vie dans les cris et l'agression. L'union des contraires, les couples mixtes finissent mal dans cet univers. Il y a aussi E'dy, dont le prénom, connu seulement de Sabrina et de Pascal, est en fait "Lumière de la religion", Nourredine. C'est le copain d'enfance, celui avec qui l'on partage quelques codes culturels. Le premier amour aussi. La crudité des descriptions chez Tassadit Imache opère tous azimuts : la misère des isolés, la détresse psychologique des plus faibles, la bonne conscience des agents du système. Elle ne prend pas de gants pour accuser, via Sabrina - dont l'autre nom est Zoubida -, le racisme d'une partie de la société : "Comment expliquer ça à mes frères : vos sœurs les font bander et leur percent le cœur. [...] Mais vous les garçons, ils vous laisseront toujours dehors ou ils vous feront enfermer. Ils regrettent que nos pères n'aient pas eu que des filles."
Avec E'dy, le presque frère, Sabrina veut quitter les "Terrains". Une obsession qui hante nombre de personnages du récit : partir au plus vite, foutre le camp en essayant de ne pas se retourner. Mais pour E'dy, la rupture est déjà entamée : "Aujourd'hui je suis comme un étranger pour vous", confie-t-il à sa mère. La structure polyphonique du récit va crescendo. La peur monte. Un drame s'annonce tandis que les préparatifs des départs-ruptures s'accélèrent. Les craintes croissent à mesure que les effectifs policiers augmentent. L'air devient irrespirable, étouffant. Quand éclatent "les événements", c'est une armée d'hommes en armes qui déboule. "Il y a la guerre. [...] Nous voilà sur le point d'être tout à fait détachés de vous", dit Hélène, la mère de Sabrina. Excessive, Tassadit Imache ? Ce livre est sorti quelques cinq ans avant les « émeutes » en banlieue. Excessivement intransigeante ? Peut-être. Mais ici réside la liberté de création. Et, derrière ce monde où la colère et la rage sont contenues, couve aussi l'espoir.
Actes Sud, 2000, 147 pages, 15,09 €
-
L'écho du silence
Jean-Pierre Robert
L'écho du silence
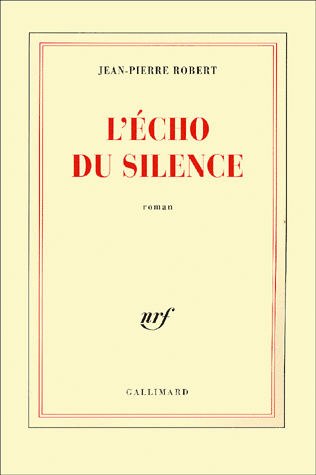 "Non, toute cette souffrance n'avait pas pu sortir et il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il pensait déjà qu'il faudrait repartir et qu'il ne fallait pas faire de peine en disant sa peine à lui, peut-être aussi parce qu'il sentait que de toute façon le père n'était pas prêt à l'entendre."
"Non, toute cette souffrance n'avait pas pu sortir et il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il pensait déjà qu'il faudrait repartir et qu'il ne fallait pas faire de peine en disant sa peine à lui, peut-être aussi parce qu'il sentait que de toute façon le père n'était pas prêt à l'entendre."
"Pas prêt à l'entendre" !, le père... pas plus que sa fiancée, d'ailleurs : "À elle non plus, il n'avait pas pu parler. Elle lui semblait trop loin de lui, inaccessible dans ses rêves d'enfant." Entendre quoi, d'ailleurs ? Les récits d'une guerre sans nom dont la majorité des Français de métropole n'avait fichtre rien à faire ?! Les crimes et abominations commis par l'armée au nom du « maintien de l'ordre » ou de la « pacification » ? Mieux valait rester loin de tout cela ! S'interroger sur la présence française en Algérie et triturer "nos" mentalités travaillées par cent trente deux ans de colonialisme ? Allons allons, il y avait mieux à faire que perdre son temps pour ces "indigènes" : ils veulent leur indépendance, qu'on la leur donne et basta ! Alors, "le Dégonfleur", en permission dans sa famille, s'était tu. Lui, comme des milliers d'autres de son âge. Avoir vingt ans dans les Aurès ! Une nouvelle fois, l'écho de ce long et lointain silence s'échappe des blessures. Une mémoire toujours tourmentée laisse remonter à la surface des souvenirs jamais disparus.
Dans ce premier roman, Jean-Pierre Robert revient donc sur cette douloureuse page de l'histoire nationale. Nous sommes en 1961. Au cœur du massif des Aurès. Tournant le dos au manichéisme, la structure romanesque met en vis-à-vis tout au long du récit deux personnages. L'un est Français, le Dégonfleur, l'autre est Algérien, on l'appelle "l'homme de Nara" - du nom de son village rasé par l'armée française - et aussi "l'Absent". Il ne dit plus rien et ne voit plus rien parce que "les Français lui avaient brûlé les yeux, [et] les djounouds lui avaient arraché la langue". Le Dégonfleur et l'Absent seront entraînés dans cette guerre, malgré eux. Ils en seront aussi les victimes. Pas celles tombées au champ d'honneur. Non, seulement celles, plus nombreuses, qui, en France mais aussi en Algérie, tairont leurs souffrances. Souvent, dans ce dernier pays, les souffrances se doublent de l'injustice. Car les exactions, les tortures, la justice expéditive ne sont pas le seul fait de l'armée française - ici des bérets verts de la Légion ou des harkis représentés entre autres par "l'Enfant". Elles sont aussi de l'autre côté, et une juste cause ne peut absoudre les mauvaises actions.
Jean-Pierre Robert décrit la vie à la caserne, l'ambiance faite d'ennui, d'attente, de petites et de grandes compromissions, de solitude, de nuits "sans rêve", de peur et de mort. Avec le Dégonfleur, il y a le caporal, cet ancien étudiant gauchiste de la Sorbonne qui cherche "à sauvegarder un peu de sa dignité perdue" ; il y a aussi le caporal-chef, qui n'est pas loin de la quille. Ensemble, ils seront témoins de tortures infligées à des prisonniers. "On savait bien que près du PC, dans l'officine du sergent harki, les interrogatoires n'étaient pas tendres. [...] Comme on n'y pouvait rien, on n'en parlait pas et d'ailleurs on préférait ne pas trop savoir." À Alger, tandis que les généraux font leur putsch, Jean-Pierre Robert tire une salve contre ceux qu'il appelle "les brailleurs" ou "les excités d'Alger" : "Dans la belle ville blanche, au bord de la Méditerranée si bleue, les vrais Français gueulaient leur enthousiasme guerrier, et ils avaient bien raison, ces héroïques civils qui ne risquaient rien." À la caserne, les officiers se déballonnent, les postes de radio grésillent, la troupe discute, les subalternes prennent les choses en main, et la légalité républicaine triomphe, "et au commando, on se disait que ça valait mieux comme ça". La guerre se poursuivant encore un temps, l'auteur montre les horreurs, dit les tortures, ne cache rien semble-t-il des exactions. Il faut en passer par là pour faire comprendre au lecteur "le mal" et "la honte" ressentis. "C'est pour des choses comme cela que les soldats, dans les guerres, ils n'écrivent rien d'intéressant à leur famille et qu'après, ils ne parlent pas". Pour ceux qui ont souffert, la paix est "une nouvelle souffrance, un nouveau coup qui coupe le souffle et fait perdre la tête. Parce que tout ce qui a été subi et qui a fait si mal devient tout à coup inutile et ridicule. [...] Il y a de quoi devenir fou. Beaucoup se protègent en faisant semblant, semblant d'oublier, semblant d'être heureux, et ils essaient de vivre. Mais pas tous. Il y a ceux qui ne peuvent pas et dont la tête éclate."
Edition Gallimard, 2002, 222 p., 15 € -
Le ghetto français, enquête sur le séparatisme français
Éric Maurin
Le ghetto français, enquête sur le séparatisme français
 Selon Éric Maurin, les Français ne se divisent plus en riches et pauvres mais en plusieurs groupes sociaux qui cherchent fébrilement et maladivement à vivre dans un "entre-soi", exclusif, confortable et prometteur. Tous, des plus riches aux classes moyennes du secteur privé, socialement menacées de déclassement et fragilisées professionnellement, en passant par les cadres, cherchent à éviter le groupe social du dessous et ahanent pour offrir à leurs chères têtes blondes des fréquentations de bon aloi et un parcours scolaire et socioprofessionnel leur permettant de monter d'un étage.
Selon Éric Maurin, les Français ne se divisent plus en riches et pauvres mais en plusieurs groupes sociaux qui cherchent fébrilement et maladivement à vivre dans un "entre-soi", exclusif, confortable et prometteur. Tous, des plus riches aux classes moyennes du secteur privé, socialement menacées de déclassement et fragilisées professionnellement, en passant par les cadres, cherchent à éviter le groupe social du dessous et ahanent pour offrir à leurs chères têtes blondes des fréquentations de bon aloi et un parcours scolaire et socioprofessionnel leur permettant de monter d'un étage.
Quant aux plus pauvres, aux immigrés et aux peu ou prou diplômés, ceux, que dans les cités et les périphéries des grandes villes on accuse de créer des ghettos ou de céder au communautarisme, ce sont justement ceux qui n'ont plus le choix : relégués, ils sont dans l'incapacité, faute de stratégies, de se projeter dans l'avenir. La ségrégation s'opère par l'argent, certes, mais aussi par la nationalité ou l'origine culturelle et surtout par le diplôme : "Le manque de diplôme et de qualification est à l'origine des formes de pauvreté les plus performantes, et donc les plus pénalisantes sur le marché du logement". Voilà qui devrait fermer le caquet des contempteurs de l'école et des diplômes ! "Le ghetto français" est une création de riches et non de déshérités. D'ailleurs les plus pauvres sont les moins concentrés sur le territoire hexagonal, tandis que "les ghettos les plus fermés sont les ghettos de riches", dixit Éric Maurin.
C'est à partir de l'enquête annuelle sur l'emploi de l'Insee, qui repose sur une série d'échantillons représentatifs formés de trente à quarante logements, qu'Éric Maurin a mesuré la constitution des différents voisinages de l'enquête et leur évolution dans le temps. Résultat, statistiques à l'appui : "le lieu de résidence est aujourd'hui plus que jamais un marqueur social. Peut-être même le principal marqueur pour beaucoup de familles". Les choix de résidences et les stratégies mises en œuvre pour éviter certains quartiers ou villes ne sont pas tant fonction d'une recherche de sécurité (le calme) ou d'une course aux meilleurs équipements (les infrastructures) que des conditions de scolarité et de socialisation des enfants et des adolescents.
Certes, cela n'est pas nouveau : tandis que les uns cumulent les facteurs d'échec, d'autres multiplient les facteurs de réussite. La nouveauté tient à la généralisation du phénomène et à l'apprêté des luttes engagées par différents acteurs sociaux. Par sa méthode, Éric Maurin en mesure l'amplitude (par groupe et par résidence) et donne à apprécier, via des études américaines, l'incidence du contexte résidentiel et démographique sur la scolarité, la santé, l'obésité... Les citoyens, censés être libres et égaux en droit, ne le sont nullement en termes de destin. Pour l'auteur, la société française n'est plus le théâtre d'une lutte frontale entre deux grandes classes sociales. "Les clivages existent toujours, mais ils sont plus nombreux et plus diffus. Surtout ils s'inscrivent ailleurs que dans l'entreprise, et notamment sur le territoire".
Partant du constat que "ce n'est pas l'immobilisme, mais la sélectivité des mobilités qui fige nos ghettos", Éric Maurin éclaire l'échec des politiques de la ville et du logement, des politiques de zones franches comme les effets réduits des politiques ZEP (il n'y a pas plus de mixité sociale aujourd'hui qu'hier). En simplifiant, ces politiques menées depuis plus de vingt ans, plutôt que de s'appliquer à corriger les flux, les mobilités - c'est-à-dire les mécanismes d'évitement et les stratégies mises en œuvre pour rester entre soi -, travaillent à la pelleteuse, déblayant ici, chargeant là, provoquant alors de nouveaux contournements sans jamais enrayer les logiques ségrégationnistes.
Pour favoriser la mixité sociale et corriger les inégalités, Éric Maurin propose, plutôt que de cibler les territoires ("ce qui ne condamne en rien l'idée qu'il faille 'donner plus à ceux qui en ont moins'"), d'agir sur les motifs qui président à ces logiques ségrégationnistes : les peurs et les ambitions de chacun, les possibilités et les impasses des autres. S'appuyant sur des exemples de politiques plus ciblées (expérimentées aux États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne), engageant les bénéficiaires eux-mêmes, il invite à substituer les individus aux territoires, à prendre en compte les ressorts de ces mobilités, les logiques de ces flux, plutôt qu'une logique de stocks et de territoires. La priorité devrait alors porter sur les actions en direction des enfants (scolarité), des adolescents (logements) et des jeunes adultes (formations). Sur ce point, la "crise de confiance" entre les jeunes et l'institution scolaire est dramatique, non seulement pour l'image injustement écornée de l'école, mais surtout parce que "la formation initiale a un impact de plus en plus décisif sur les carrières professionnelles". L'ambition de cette sociologie version taoïste (réintroduire de la fluidité et de la souplesse) ne peut se limiter au choix des lieux de résidence. Comme le montre en conclusion Éric Maurin, elle doit porter sur l'ensemble du système éducatif (de la maternelle à l'enseignement supérieur) et plus largement sur la société française. Une société qui, après que le lecteur a refermé ce livre, paraît bien anxieuse, rigide, bloquée même, fragmentée et inégalitaire.
Edition du Seuil, 2004, 96 pages, 10,50 €
photo : Léa Crespi (pour Télérama)