Serge Weber
Nouvelle Europe, nouvelles migrations. Frontières, intégration, mondialisation
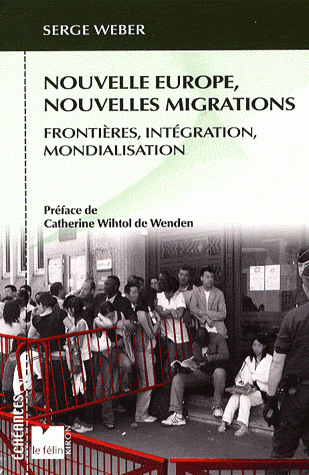 Dans ce petit livre, Serge Weber, maître de conférences en géographie à l'université de Paris-Est présente les nouvelles tendances des migrations internationales et les politiques d'immigration menées par les États européens. Il souligne surtout les contradictions de ces politiques au regard des besoins et tord le coup à quelques idées reçues qui obscurcissent l'entendement et empuantissent certains programmes électoraux.
Dans ce petit livre, Serge Weber, maître de conférences en géographie à l'université de Paris-Est présente les nouvelles tendances des migrations internationales et les politiques d'immigration menées par les États européens. Il souligne surtout les contradictions de ces politiques au regard des besoins et tord le coup à quelques idées reçues qui obscurcissent l'entendement et empuantissent certains programmes électoraux.
Ainsi, alors que l'Europe a besoin de populations immigrées, tant sur le plan économique que démographique, le continent multiplie les protections et les barrières à l'entrée au point de devenir ce que d'aucuns qualifient de « forteresse » : sécurisation de l'Espace Schengen, obstacles à la mobilité, harmonisation et inflexions du droit d'asile, multiplication des camps de rétention et des mesures d'éloignement ; constitution à la périphérie de l'Europe d'un « glacis protecteur », externalisation des contrôles et même de l'asile aux marges de l'Europe et en Afrique du Nord... « L'aspect technique de la sécurisation a pris les devants », la méfiance prévaut, privilégiant ainsi les conditions sécuritaires sur les conditions d'accès, « légitimant le règne du contrôle » et la généralisation de la suspicion au point de « soumettre la politique de l'asile à la politique migratoire. »
Ce tout sécuritaire se solde par des « excès » : les camps de rétentions et les procédures d'éloignement qui voient des hommes et des femmes privés de liberté de mouvement sans avoir commis de délit.
Pour Serge Weber, l'État n'a pas disparu avec la construction européenne. Il montre que la logique étatique (frontières, protection nationale, procédures de contrôle et d'éloignement, sélection entre les « indésirables » et les autres...) impose ses choix. La sécurisation serait dès lors davantage le fait des États-nations que du Parlement européen « qui a été tenu à l'écart du processus de Schengen. »
« À y regarder de près, la restriction des entrées est toujours beaucoup plus poussée et assortie de budgets substantiellement plus importants que les mesures de promotion de l'intégration. » Quid alors du vivre ensemble, national et européen ?
En France, cette politique a pour conséquence une augmentation de la méfiance de l'opinion envers les immigrés, elle entretient dans les esprits la confusion entre immigrés et français d'origine, d'origine certes, mais français depuis au moins une, deux voir davantage de générations, confusion aussi entre approche sociale et culturelle dans les banlieues notamment.
La politique du soupçon s'étend au point peut-être de faire système et de s'immiscer dans les mariages entre Français et étranger, de multiplier les interpellations aux guichets des préfectures, dans les logements, les foyers, les hôpitaux (circulaire du 21 février 2006), de ficher les citoyens étrangers en situation irrégulière mais aussi les Français ayant apporté une aide à ces derniers (fichier ÉLOI), etc. Paradoxe, cette politique débouche sur une augmentation du nombre de sans papiers car « contrairement aux annonces des gouvernements successifs, « serrer la vis » dans l'attribution de titres de séjour entraîne nécessairement la « fabrication de sans papiers ». »
Pourtant pour faire face aux défis du vieillissement, les pays d'Europe ont non seulement besoin d'immigration mais d'une immigration durable et non pas « choisie ». D'ailleurs la politique d'immigration choisie n'évite nullement le travail au noir et les migrations irrégulières. Les pays d'Europe ont besoin d'une immigration stable et non pas d'une immigration provisoire livrée sous la forme de quota. Ils ont enfin besoin d'une dynamique culturelle inscrivant les populations dans un vivre ensemble viable : « l'heure est au cosmopolitisme et à la non-discrimination des personnes issues de l'immigration (...) » écrit l'auteur pour qui « l'identité nationale est par définition pluraliste et interactionniste, plus encore à l'heure du projet démocratique européen. »
Reste que la nouveauté par rapport aux années soixante-dix est la reconnaissance du besoin de main d'œuvre immigrée montrant l'inanité de cette idée reçue qui voudrait que des taux de chômage élevés interdiraient de devoir recourir à un travail immigré peu qualifié. L'auteur rappelle que « les deux marchés de main d'œuvre nationale et immigrée ne sont pas en concurrence du fait de la segmentation locale et sectorielle du travail. »
Autre rejet fort d'une autre idée reçue : « le migrant n'est pas le rejeton de « la misère du monde » mais un acteur qualifié et connecté » et, comme le souligne la préfacière : « la migration est autant un effet qu'un facteur du développement » et, constate-t-elle, « celui-ci n'est pas au rendez-vous de la fin des migrations en Europe. » Au contraire serait-on tenté d'ajouter à la lecture de ce petit ouvrage (voir les corrélations entre le travail à la marge ou informel dans la confection, le BTP ou l'agriculture par exemple et la compétitivité des économies nationales).
Le migrant est un acteur social conscient, porteur d'un projet de « mobilité sociale et de changement », un entrepreneur source de développement. Comme l'écrivain en 2000 l'écrivain tunisien Fawzi Mellah dans Clandestin en Méditerranée : « l'illégal déclarant forfait n'est pas un simple voyageur annonçant bêtement son retour au bercail ; c'est une entreprise qui dépose son bilan, un entrepreneur qui reconnaît sa faillite. Qui, après y avoir tant investi, accepterait aisément la fin de son affaire ? »
Cela posé, la migration internationale est davantage diversifiée, bien plus structurée en réseau d'entraide, de solidarité et d'informations, diasporique. À la traditionnelle relation internationale (lien entre deux pays), elle préfère évoluer dans un cadre transnational évoluant au gré des opportunités. « Les nouvelles migrations dépassent largement le cadre de la victimisation, de l'intégration républicaine ou du contrôle des flux. L'espace de vie et de savoir des migrants se sont étendus et diversifiés. Étant des acteurs planétaires et transnationaux, ils constituent un enrichissement pour les sociétés d'implantation. »
Préface de Catherine Wihtol de Wenden, éd. Le Félin, 2007, 118 pages, 10,90 €
 C'est un premier roman autobiographique que donne ici Knud Romer. Danois d'origine allemande par la branche maternelle, il raconte, en bousculant la chronologie et en entremêlant l'histoire des deux branches de la famille, près de soixante ans de saga familiale (des années dix aux années soixante-dix), soixante ans d'histoire danoise et allemande, d'histoire européenne. L'irlandais Hugo Hamilton, lui aussi d'origine allemande avait en son temps raconté les déboires familiaux et l'hostilité de ces concitoyens celtes à l'égard de sa mère également teutonne. De ce point de vue, Cochons d'allemand est le versant danois de
C'est un premier roman autobiographique que donne ici Knud Romer. Danois d'origine allemande par la branche maternelle, il raconte, en bousculant la chronologie et en entremêlant l'histoire des deux branches de la famille, près de soixante ans de saga familiale (des années dix aux années soixante-dix), soixante ans d'histoire danoise et allemande, d'histoire européenne. L'irlandais Hugo Hamilton, lui aussi d'origine allemande avait en son temps raconté les déboires familiaux et l'hostilité de ces concitoyens celtes à l'égard de sa mère également teutonne. De ce point de vue, Cochons d'allemand est le versant danois de  Ce "voyage" à Dreux par l'auteur de Faire France est une enquête de terrain réalisée en 1997, un important appareil statistique doublé de plus de 200 entretiens. À ces données locales s'ajoutent de nombreuses références à d'autres travaux. Mais l'enquête, qui prend parfois une tournure journalistique, n'est pas une froide recension. Les convictions, le sens de l'engagement et les perspectives avancées par l'auteur enrichissent ce travail. Ainsi, ses critiques de la gestion municipale, de l'image et de l'action de la police, des discriminations sociales et professionnelles ou ses mises en garde, fermes et claires, contre certaines attitudes des jeunes des cités ou organisations musulmanes lui donnent plus de poids. Selon Michèle Tribalat, Dreux, déjà symbolique pour avoir la première ouvert ses portes au FN, "va plus mal que la France en général, son contexte démographique est plus exigeant, la situation sociale plus explosive et la dégradation plus marquée". Avec 36 800 habitants et un taux de chômage estimé à 24,8 % en 1997, Dreux est une ville ouvrière et jeune, marquée par une inquiétante tendance à la paupérisation. Son tissu industriel est non seulement fragile mais aussi dépendant, pour plus de deux tiers de ses emplois, de décisions extérieures. Avec 48,6 %, Dreux enregistre "la plus forte concentration de populations d'origine étrangère". Un tiers de cette population est originaire du Maghreb (19,9 % du Maroc, 8,9 % d'Algérie et 2,2 % de Tunisie), le reste se répartissant entre populations d'origine turque (5,4 %) portugaise (5 %), noire africaine (3,4 %) ou pakistanaise (1,3 %). Dixième circonscription par ordre d'importance du taux de délinquance, estimé à 116 ‰ (contre 60 ‰ en moyenne nationale), à Dreux, "tant en termes d'évolution que de niveau réel, la délinquance s'avère légitimement préoccupante". Rappelant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre immigration et délinquance, Michèle Tribalat souligne que "seule la condition objective de 'nécessité', de 'besoin' reflétée par le taux de chômage se révèle liée au niveau global de délinquance et plus particulièrement à ses composantes prédatrices". La concentration de cette "population d'origine étrangère" est variable. De 15,7 %, dont près de 9 % de population d'origine portugaise dans le centre-ville, elle est, par exemple de 79,1 % dans le quartier des Charmards, dont plus de 45 % de population d'origine marocaine. À cette "segmentation ethnique du territoire", avec au centre les "populations d'origine française" et à la périphérie celles "d'origine étrangère", s'ajoutent les oppositions entre nantis et déshérités, entre vieux et jeunes. "Dreux n'est plus le lieu d'une structure sociale collective cohérente", note Michèle Tribalat, qui montre que cette "segmentation" est devenue constitutive de "l'identité locale, individuelle et collective", au point que l'autorité publique elle-même est perçue comme partie prenante de cette opposition. Plus grave, elle alimente une dangereuse "logique de coupables-victimes" qui, ignorance aidant, conduit à la radicalisation des uns et des autres, à l'exacerbation réciproque d'un racisme anti-arabe et d'un racisme anti-français doublé d'un repli identitaire centré sur la religion musulmane. Dans un chapitre quelque peu caricatural et par trop généraliste, Michèle Tribalat analyse l'influence et la dégradation du modèle parental maghrébin - où le père fait figure de satrape domestique ! - sur le rapport des plus jeunes à l'école et à l'autorité notamment et, de façon plus pertinente, sur l'influence des valeurs transmises au sein des familles sur la vie en société. Distinguant nettement la pratique de la religion, de la "propagande active" d'une doctrine hostile à la séparation du politique et du religieux, l'enquête montre que "l'islamisme est en gestation à Dreux". À l'opposé des conclusions optimistes d'autres travaux (Isabel Taboada-Léonetti ou F. Khosrokhavar), Michèle Tribalat est extrêmement critique quant à l'influence d'associations qui, comme les Jeunes Musulmans de France, distillent "une idéologie islamiste sous le masque de la laïcité". Pour l'auteur, "ces associations n'ont abandonné ni la dimension communautaire, ni le caractère totalisant de la doctrine islamique". L'action de ces structures - comme la sous-traitance des problèmes sociaux confiée par les pouvoirs publics à des médiateurs religieux ou associatifs mal identifiés - aggrave les oppositions et la déréliction du lien social, dont les manifestations sont ici détaillées : tendance au repli sur soi, affaiblissement des contrôles sociaux, non-intériorisation des normes collectives, multiplication des incivilités, désaffiliation institutionnelle... Le tableau présenté ici est sombre, peut-être un peu trop. L'ethnicisation des rapports sociaux, si ce n'est sur Dreux, du moins en France, peut être discutée, voire contestée. Par ailleurs, de ces quartiers émergent aussi des initiatives qui justement recréent des liens sociaux, ce que montre, avec insistance aussi, Michèle Tribalat pour Dreux. Les trop noires perspectives ici esquissées ne sont pas inéluctables, semble dire l'auteur, pour peu que l'on se donne réellement les moyens de comprendre la réalité et surtout d'élaborer des politiques globales. "Penser l'avenir de Dreux, c'est faire des projets pour les jeunes Drouais, aujourd'hui majoritairement d'origine étrangère. À Dreux, on bute encore sur ce fait, qu'on n'arrive pas à dépasser. Mais il nous semble que c'est toute la société française qui bute sur cette réalité. Les enfants des immigrés maghrébins sont partie intégrante du peuple français, et ont une légitimité égale à celle des autres Français." On ne saurait être plus clair et dégager, par l'énoncé de cette évidence, qui n'est pas encore présente dans toutes les têtes, autant de perspectives nouvelles.
Ce "voyage" à Dreux par l'auteur de Faire France est une enquête de terrain réalisée en 1997, un important appareil statistique doublé de plus de 200 entretiens. À ces données locales s'ajoutent de nombreuses références à d'autres travaux. Mais l'enquête, qui prend parfois une tournure journalistique, n'est pas une froide recension. Les convictions, le sens de l'engagement et les perspectives avancées par l'auteur enrichissent ce travail. Ainsi, ses critiques de la gestion municipale, de l'image et de l'action de la police, des discriminations sociales et professionnelles ou ses mises en garde, fermes et claires, contre certaines attitudes des jeunes des cités ou organisations musulmanes lui donnent plus de poids. Selon Michèle Tribalat, Dreux, déjà symbolique pour avoir la première ouvert ses portes au FN, "va plus mal que la France en général, son contexte démographique est plus exigeant, la situation sociale plus explosive et la dégradation plus marquée". Avec 36 800 habitants et un taux de chômage estimé à 24,8 % en 1997, Dreux est une ville ouvrière et jeune, marquée par une inquiétante tendance à la paupérisation. Son tissu industriel est non seulement fragile mais aussi dépendant, pour plus de deux tiers de ses emplois, de décisions extérieures. Avec 48,6 %, Dreux enregistre "la plus forte concentration de populations d'origine étrangère". Un tiers de cette population est originaire du Maghreb (19,9 % du Maroc, 8,9 % d'Algérie et 2,2 % de Tunisie), le reste se répartissant entre populations d'origine turque (5,4 %) portugaise (5 %), noire africaine (3,4 %) ou pakistanaise (1,3 %). Dixième circonscription par ordre d'importance du taux de délinquance, estimé à 116 ‰ (contre 60 ‰ en moyenne nationale), à Dreux, "tant en termes d'évolution que de niveau réel, la délinquance s'avère légitimement préoccupante". Rappelant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre immigration et délinquance, Michèle Tribalat souligne que "seule la condition objective de 'nécessité', de 'besoin' reflétée par le taux de chômage se révèle liée au niveau global de délinquance et plus particulièrement à ses composantes prédatrices". La concentration de cette "population d'origine étrangère" est variable. De 15,7 %, dont près de 9 % de population d'origine portugaise dans le centre-ville, elle est, par exemple de 79,1 % dans le quartier des Charmards, dont plus de 45 % de population d'origine marocaine. À cette "segmentation ethnique du territoire", avec au centre les "populations d'origine française" et à la périphérie celles "d'origine étrangère", s'ajoutent les oppositions entre nantis et déshérités, entre vieux et jeunes. "Dreux n'est plus le lieu d'une structure sociale collective cohérente", note Michèle Tribalat, qui montre que cette "segmentation" est devenue constitutive de "l'identité locale, individuelle et collective", au point que l'autorité publique elle-même est perçue comme partie prenante de cette opposition. Plus grave, elle alimente une dangereuse "logique de coupables-victimes" qui, ignorance aidant, conduit à la radicalisation des uns et des autres, à l'exacerbation réciproque d'un racisme anti-arabe et d'un racisme anti-français doublé d'un repli identitaire centré sur la religion musulmane. Dans un chapitre quelque peu caricatural et par trop généraliste, Michèle Tribalat analyse l'influence et la dégradation du modèle parental maghrébin - où le père fait figure de satrape domestique ! - sur le rapport des plus jeunes à l'école et à l'autorité notamment et, de façon plus pertinente, sur l'influence des valeurs transmises au sein des familles sur la vie en société. Distinguant nettement la pratique de la religion, de la "propagande active" d'une doctrine hostile à la séparation du politique et du religieux, l'enquête montre que "l'islamisme est en gestation à Dreux". À l'opposé des conclusions optimistes d'autres travaux (Isabel Taboada-Léonetti ou F. Khosrokhavar), Michèle Tribalat est extrêmement critique quant à l'influence d'associations qui, comme les Jeunes Musulmans de France, distillent "une idéologie islamiste sous le masque de la laïcité". Pour l'auteur, "ces associations n'ont abandonné ni la dimension communautaire, ni le caractère totalisant de la doctrine islamique". L'action de ces structures - comme la sous-traitance des problèmes sociaux confiée par les pouvoirs publics à des médiateurs religieux ou associatifs mal identifiés - aggrave les oppositions et la déréliction du lien social, dont les manifestations sont ici détaillées : tendance au repli sur soi, affaiblissement des contrôles sociaux, non-intériorisation des normes collectives, multiplication des incivilités, désaffiliation institutionnelle... Le tableau présenté ici est sombre, peut-être un peu trop. L'ethnicisation des rapports sociaux, si ce n'est sur Dreux, du moins en France, peut être discutée, voire contestée. Par ailleurs, de ces quartiers émergent aussi des initiatives qui justement recréent des liens sociaux, ce que montre, avec insistance aussi, Michèle Tribalat pour Dreux. Les trop noires perspectives ici esquissées ne sont pas inéluctables, semble dire l'auteur, pour peu que l'on se donne réellement les moyens de comprendre la réalité et surtout d'élaborer des politiques globales. "Penser l'avenir de Dreux, c'est faire des projets pour les jeunes Drouais, aujourd'hui majoritairement d'origine étrangère. À Dreux, on bute encore sur ce fait, qu'on n'arrive pas à dépasser. Mais il nous semble que c'est toute la société française qui bute sur cette réalité. Les enfants des immigrés maghrébins sont partie intégrante du peuple français, et ont une légitimité égale à celle des autres Français." On ne saurait être plus clair et dégager, par l'énoncé de cette évidence, qui n'est pas encore présente dans toutes les têtes, autant de perspectives nouvelles. L'univers décrit par cet écrivain irakien né à Bassorah en 1942 est sombre. Il est marqué par la guerre contre l'Iran, la mort, la fragilité des existences et l'âcreté du quotidien. Pour rendre cette atmosphère, Mohammed Khudayyir a du talent. Son écriture suffit à plonger le lecteur dans l'inquiétude. Souvent, la première phrase de la nouvelle installe le trouble et un malaise suscité par la prémonition d'une menace, d'un danger imminent. Ainsi, pour Le royaume noir, le récit qui ouvre le recueil : "La lourde porte chargée de clous énormes, avec son heurtoir de bronze ouvragé et ses solides planches de bois noir aux bords sculptés, n'est pas fermée à clé." Ou encore : "Deux jeunes filles travaillant comme couturières dans un atelier d'État sont debout l'une à côté de l'autre en haut d'un escalier, au matin de leur jour de congé hebdomadaire." (Le rêve du singe) Le ton est toujours paisible mais des murmures, des chuchotements, des silences, un "bleu sombre", des "escaliers obscurs", une terrasse "sans parapet", une cicatrice, la pénombre, un "rêve couleur de sang" troublent cette apparente quiétude. De même, dans L'intercesseur, les allers et venues dans les escaliers d'une auberge d'une femme sur le point d'accoucher et qui se presse dans les rues de Karbala pour rattraper la procession d'Achoura. Et cette inconnue, plus ombre que femme qui, dans la gare d'Ur, remet à un soldat en permission, en guise de lettre pour son mari, une enveloppe contenant une feuille blanche (Les trains de nuit). Pour échapper à un monde tragique, ces femmes seules, ces veuves, ces adolescents en quête du père, ces orphelins, ces soldats basculent dans l'étrange ou le merveilleux. Alors les graffitis sur les murs d'une vieille demeure deviennent des chevaux ; du marbre du mausolée d'Al-Husayn à Karbala sourd un ruisseau qui emporte Naziha et lui procure un "plaisir étrange" et un "éblouissement merveilleux". D'une valise rapportée du front par un soldat sortirait le père mort à la guerre... Quand la vie devient irréelle à force de charrier trop de souffrances, tenue éloignée par des horizons bornés et noirs, elle semble pourtant vouloir se faufiler dans les dédales souterrains de l'imaginaire, dans les méandres de cerveaux fatigués, pour jaillir dans un autre monde, celui de l'étrange et du merveilleux.
L'univers décrit par cet écrivain irakien né à Bassorah en 1942 est sombre. Il est marqué par la guerre contre l'Iran, la mort, la fragilité des existences et l'âcreté du quotidien. Pour rendre cette atmosphère, Mohammed Khudayyir a du talent. Son écriture suffit à plonger le lecteur dans l'inquiétude. Souvent, la première phrase de la nouvelle installe le trouble et un malaise suscité par la prémonition d'une menace, d'un danger imminent. Ainsi, pour Le royaume noir, le récit qui ouvre le recueil : "La lourde porte chargée de clous énormes, avec son heurtoir de bronze ouvragé et ses solides planches de bois noir aux bords sculptés, n'est pas fermée à clé." Ou encore : "Deux jeunes filles travaillant comme couturières dans un atelier d'État sont debout l'une à côté de l'autre en haut d'un escalier, au matin de leur jour de congé hebdomadaire." (Le rêve du singe) Le ton est toujours paisible mais des murmures, des chuchotements, des silences, un "bleu sombre", des "escaliers obscurs", une terrasse "sans parapet", une cicatrice, la pénombre, un "rêve couleur de sang" troublent cette apparente quiétude. De même, dans L'intercesseur, les allers et venues dans les escaliers d'une auberge d'une femme sur le point d'accoucher et qui se presse dans les rues de Karbala pour rattraper la procession d'Achoura. Et cette inconnue, plus ombre que femme qui, dans la gare d'Ur, remet à un soldat en permission, en guise de lettre pour son mari, une enveloppe contenant une feuille blanche (Les trains de nuit). Pour échapper à un monde tragique, ces femmes seules, ces veuves, ces adolescents en quête du père, ces orphelins, ces soldats basculent dans l'étrange ou le merveilleux. Alors les graffitis sur les murs d'une vieille demeure deviennent des chevaux ; du marbre du mausolée d'Al-Husayn à Karbala sourd un ruisseau qui emporte Naziha et lui procure un "plaisir étrange" et un "éblouissement merveilleux". D'une valise rapportée du front par un soldat sortirait le père mort à la guerre... Quand la vie devient irréelle à force de charrier trop de souffrances, tenue éloignée par des horizons bornés et noirs, elle semble pourtant vouloir se faufiler dans les dédales souterrains de l'imaginaire, dans les méandres de cerveaux fatigués, pour jaillir dans un autre monde, celui de l'étrange et du merveilleux. Vincent Cespedes est professeur de philosophie « dans un lycée en zone sensible » comme le précise l'éditeur. Si, dans son style décapant et parfois fatigant, il rejoint certaines analyses et conclusions du livre d'Yves Michaud paru la même année (incohérence des mesures, nécessité de la sanction...), il s'en démarque en faisant de la violence la résultante de « la globalisation néo-libérale » et ses conséquences : déshumanisation des rapports ; avènement de « démocraties-marchés » et de régimes ploutocratiques où « l'argent explique, dirige, affirme, impose » ; « marchandisation de l'Etre » ; primat de l'Avoir sur l'Etre... Il y a aussi ce que l'auteur nomme l'«hamstérisation » de la jeunesse où les ravages d'une culture de masse présentée comme un mélange détonant d'américanisation, de manipulation mentale par la pub et la TV, d'idéologie consumériste et d'abrutissement par le culte des nouvelles technologies (la « cybermeute »). Ici, les médias ne sont pas épargnés qui en médiatisant les violences impunies, « loin de les congédier, les entérine et leur donne droit de cité », l'école non plus où se pratiquerait la ségrégation en faveur des élèves nantis, des « Français d'origine française » et « blancs ». Ajoutons à cette liste non exhaustive « le complexe de Brazzaville » du Français moyen « qui peine à considérer Mourad ou Fatou instantanément comme d'authentiques concitoyens, comme des gens pouvant prétendre au pouvoir, comme des supérieurs hiérarchiques légitimes ».
Vincent Cespedes est professeur de philosophie « dans un lycée en zone sensible » comme le précise l'éditeur. Si, dans son style décapant et parfois fatigant, il rejoint certaines analyses et conclusions du livre d'Yves Michaud paru la même année (incohérence des mesures, nécessité de la sanction...), il s'en démarque en faisant de la violence la résultante de « la globalisation néo-libérale » et ses conséquences : déshumanisation des rapports ; avènement de « démocraties-marchés » et de régimes ploutocratiques où « l'argent explique, dirige, affirme, impose » ; « marchandisation de l'Etre » ; primat de l'Avoir sur l'Etre... Il y a aussi ce que l'auteur nomme l'«hamstérisation » de la jeunesse où les ravages d'une culture de masse présentée comme un mélange détonant d'américanisation, de manipulation mentale par la pub et la TV, d'idéologie consumériste et d'abrutissement par le culte des nouvelles technologies (la « cybermeute »). Ici, les médias ne sont pas épargnés qui en médiatisant les violences impunies, « loin de les congédier, les entérine et leur donne droit de cité », l'école non plus où se pratiquerait la ségrégation en faveur des élèves nantis, des « Français d'origine française » et « blancs ». Ajoutons à cette liste non exhaustive « le complexe de Brazzaville » du Français moyen « qui peine à considérer Mourad ou Fatou instantanément comme d'authentiques concitoyens, comme des gens pouvant prétendre au pouvoir, comme des supérieurs hiérarchiques légitimes ». L'opinion est unanime, les violences prennent des proportions inacceptables. Toutes les violences. Des plus anodines, on parle alors d'incivilités (mais ce sont elles qui alimentent ce climat d'insécurité qui empoisonne le quotidien et empuantit les urnes) aux plus monstrueuses, les homicides, les viols et bien sûr les attentats à commencer par ce 11-Septembre. De plus comme chante le poète, « tout fout le camp » : l'autorité est bafouée, la justice encombrée patine, les valeurs sont flouées à qui mieux mieux, la famille se délite, l'école prend des allures de défouloir, les législateurs légifèrent à tire-larigot et paralysent les institutions chargées de la répression... Et comme si cela ne suffisait pas, force est de constater que ce que l'on qualifie plus ou moins pompeusement d'individualisme contemporain, hier, était tout simplement taxé d'égoïsme. Un chacun pour soi qui a tôt fait de transformer notre belle et si vertueuse société, présentée au monde comme un modèle universel, en une jungle ou tous les coups sont permis pour se faire sa petite place au soleil. Cette « impression » générale nous est servie à longueur de colonnes et de journaux télévisés. Tout cela n'est pas totalement faux. Tout cela n'est pas non plus totalement vrai. Qu'importe d'ailleurs, ce qui compte n'est pas le diagnostic - y a-t-il aujourd'hui plus ou moins d'actes violents et de délinquance qu'hier ? - mais le sens, la grille de lecture qui permet à chacun de comprendre cette violence et peut-être d'influer sur ses mécanismes générateurs.
L'opinion est unanime, les violences prennent des proportions inacceptables. Toutes les violences. Des plus anodines, on parle alors d'incivilités (mais ce sont elles qui alimentent ce climat d'insécurité qui empoisonne le quotidien et empuantit les urnes) aux plus monstrueuses, les homicides, les viols et bien sûr les attentats à commencer par ce 11-Septembre. De plus comme chante le poète, « tout fout le camp » : l'autorité est bafouée, la justice encombrée patine, les valeurs sont flouées à qui mieux mieux, la famille se délite, l'école prend des allures de défouloir, les législateurs légifèrent à tire-larigot et paralysent les institutions chargées de la répression... Et comme si cela ne suffisait pas, force est de constater que ce que l'on qualifie plus ou moins pompeusement d'individualisme contemporain, hier, était tout simplement taxé d'égoïsme. Un chacun pour soi qui a tôt fait de transformer notre belle et si vertueuse société, présentée au monde comme un modèle universel, en une jungle ou tous les coups sont permis pour se faire sa petite place au soleil. Cette « impression » générale nous est servie à longueur de colonnes et de journaux télévisés. Tout cela n'est pas totalement faux. Tout cela n'est pas non plus totalement vrai. Qu'importe d'ailleurs, ce qui compte n'est pas le diagnostic - y a-t-il aujourd'hui plus ou moins d'actes violents et de délinquance qu'hier ? - mais le sens, la grille de lecture qui permet à chacun de comprendre cette violence et peut-être d'influer sur ses mécanismes générateurs. Nadia Galy est une nouvelle venue, Alger Lavoir Galant est son premier texte. L'intrigue raconte sur un ton incisif, les déboires de Samir alias Jeha commerçant de son état, une sorte d'imbécile heureux dont la vie va basculer de la lucidité à la folie.
Nadia Galy est une nouvelle venue, Alger Lavoir Galant est son premier texte. L'intrigue raconte sur un ton incisif, les déboires de Samir alias Jeha commerçant de son état, une sorte d'imbécile heureux dont la vie va basculer de la lucidité à la folie. Fellag est connu. Humoriste, comédien, il signait ici un quatrième roman au ton léger dont l'action se situe en 1992, l'année de l'assassinat de Tahar Djaout à qui est dédié le livre. Il y raconte le cauchemar - pas seulement la violence des années 90, mais la lutte quotidienne pour survivre - et les rêves algériens.
Fellag est connu. Humoriste, comédien, il signait ici un quatrième roman au ton léger dont l'action se situe en 1992, l'année de l'assassinat de Tahar Djaout à qui est dédié le livre. Il y raconte le cauchemar - pas seulement la violence des années 90, mais la lutte quotidienne pour survivre - et les rêves algériens. Septième roman traduit en français pour cet auteur guatémaltèque proche, en son temps de Paul Bowles et qui se réclame de Borgès. Ce court texte à l'écriture limpide laisse perplexe. Une chouette en est le personnage principal : achetée, on tentera de la voler dans la médina de Tanger, blessée, elle sera soignée pour devenir objet d'un troc sexuel peu ragoûtant. Quelle histoire ! Elle sera le lien entre Hamza, jeune berger marocain et Angel touriste colombien. «Tout le monde sait que les chouettes ne dorment pas la nuit, et qu'elles voient dans l'obscurité. Donc, si l'on a décidé de veiller toute une nuit, il est bon de capturer une chouette et de lui arracher les yeux. » Hamza est justement chargé par son oncle d'une nocturne mission de surveillance sur la plage. Angel, lui, a perdu son passeport. Document officiel si l'en est... Objet de toutes les convoitises sur cette rive africaine mais dont la mystérieuse disparition sera pour notre Sud-Américain le prétexte à un nouveau départ.
Septième roman traduit en français pour cet auteur guatémaltèque proche, en son temps de Paul Bowles et qui se réclame de Borgès. Ce court texte à l'écriture limpide laisse perplexe. Une chouette en est le personnage principal : achetée, on tentera de la voler dans la médina de Tanger, blessée, elle sera soignée pour devenir objet d'un troc sexuel peu ragoûtant. Quelle histoire ! Elle sera le lien entre Hamza, jeune berger marocain et Angel touriste colombien. «Tout le monde sait que les chouettes ne dorment pas la nuit, et qu'elles voient dans l'obscurité. Donc, si l'on a décidé de veiller toute une nuit, il est bon de capturer une chouette et de lui arracher les yeux. » Hamza est justement chargé par son oncle d'une nocturne mission de surveillance sur la plage. Angel, lui, a perdu son passeport. Document officiel si l'en est... Objet de toutes les convoitises sur cette rive africaine mais dont la mystérieuse disparition sera pour notre Sud-Américain le prétexte à un nouveau départ. La littérature chinoise occupe depuis quelques années de plus en plus de place sur les rayons des librairies et des bibliothèques. La Chine étant un continent, difficile pour le non spécialiste de s'y retrouver dans ce foisonnement d'auteurs qui, pour appartenir au même pays, sont issus de régions aussi éloignées qu'Oslo et Séville - pour se faire une idée européenne - appartiennent à des cultures ou des univers socio-économiques divers, des générations, des courants littéraires, des sexes mêmes différents.
La littérature chinoise occupe depuis quelques années de plus en plus de place sur les rayons des librairies et des bibliothèques. La Chine étant un continent, difficile pour le non spécialiste de s'y retrouver dans ce foisonnement d'auteurs qui, pour appartenir au même pays, sont issus de régions aussi éloignées qu'Oslo et Séville - pour se faire une idée européenne - appartiennent à des cultures ou des univers socio-économiques divers, des générations, des courants littéraires, des sexes mêmes différents.