Karine Berger et Valérie Rabault
Les Trente glorieuses sont devant nous
 Karine Berger et Valérie Rabault sont aujourd’hui députées socialistes. La première élue des Hautes Alpes la seconde du Tarn et Garonne et tout nouveau rapporteur général du budget à l'Assemblée. Toutes deux se trouvent aux avants postes de la fronde, à tout le moins des tentatives de bémol apportées par quelques députés socialistes au plan d’économies de 50 milliards défendu par le Premier ministre. Discussion et vote prévus mardi 29 avril à l’Assemblée nationale.
Karine Berger et Valérie Rabault sont aujourd’hui députées socialistes. La première élue des Hautes Alpes la seconde du Tarn et Garonne et tout nouveau rapporteur général du budget à l'Assemblée. Toutes deux se trouvent aux avants postes de la fronde, à tout le moins des tentatives de bémol apportées par quelques députés socialistes au plan d’économies de 50 milliards défendu par le Premier ministre. Discussion et vote prévus mardi 29 avril à l’Assemblée nationale.
Il y a trois ans « nos » deux députés commettaient de concert un livre au titre prometteur et optimiste. Membres du Parti socialiste, elles n’étaient pas alors élues, mais directrice de la stratégie Etude et marketing du groupe international d’assurance Euler Hermes pour Karine Berger et spécialiste des risques de marché sur les produits dérivés chez BNP-Paribas pour Valérie Rabault .
Dans Les Trente glorieuses sont devant nous, ces deux femmes tranchent avec la sinistrose ambiante et le pessimisme responsable affiché en costume cravate. Elles montrent que ce qui a fait le succès de la France dans un passé récent c’est un modèle particulier de développement économique. Un modèle qui combine une intervention de l’Etat aux efforts et à la recherche de profit des entreprises privées, la « prise de risque économique » écrivent elles. Un modèle qui a su développer un système de protection et de solidarité sociales. Enfin un modèle ouvert sur les autres. L’identité nationale ne se limite pas ici au seul système de protection sociale. Elles y ajoutent le rôle de l’Etat (colbertisme et centralisation mais aussi éducation républicaine et laïque) et l’ouverture à l’Europe, au monde et… à l’immigration. L’immigration « est l’une des pierres angulaires du succès économique, de 1945 à 1975. Elle constitue sans conteste un élément incontournable du « modèle français ».
En trois mots, il s’agit là du triptyque républicain : « liberté, égalité et fraternité ».
La liberté est ici la liberté d’entreprendre adossée à un Etat interventionniste, la prise de risque sera collective notamment dans le domaine onéreux de la recherche et du développement. Eh oui, après notamment les travaux de l’économiste coréen Ha Joon Chang, Karine Berger et Valérie Rabault renvoient les idéologues néolibéraux à leurs chères études et remobilisent l’Etat et ses commis pour la bonne marche de l’économie.
L’égalité revient à évoquer bien sûr le modèle social français. Elle exige pour demain de mieux répartir les fruits de la croissance promise. Quant au volet fraternité, pour Karine Berger et Valérie Rabault il s’agit à la fois de plus d’Europe et d’une ouverture au monde. « Si elle [la France] ne décide pas de s’ouvrir aux autres pour relancer le renouvellement de la population, elle sera condamnée à se voir mourir, à voir sa créativité estompée, son système de protection sociale démantelé et ses villes cloisonnées. »
Or, depuis une quinzaine d’années « la France a tourné le dos à son fameux modèle. (…) Elle a tranquillement intégré l’antienne selon laquelle ses pesanteurs bureaucratiques et étatiques seraient son principal handicap (…) ». « En plébiscitant la « rupture » depuis la fin des années 90, les Français ont opté pour la dislocation de leur équilibre politique, économique et social. »
C’est à ce modèle qu’il conviendrait de revenir pour s’assurer un futur fait de nouvelles « Trente glorieuses ». La croissance oui mais sans forligner ! Après deux chapitres d’éco-fiction sur le devenir de la France en 2040 partagé entre « conte noir » et scénario de prospérité, nos auteures entrent dans le vif du sujet. Elles insistent sur l’importance des « choix de politiques économiques adoptées » et rendent à l’Etat et à ses grands commis leurs fonctions de décision et leur capacité à influer sur le devenir national. En somme, des dirigeants responsables et intéressés au seul bien commun. De la crédibilité, de l’élan et de l’allant. La quadrature du cercle de l’électeur lambda.
Le projet « France européenne 2040 » développe cinq objectifs (une croissance de 2 à 3% par an, une hausse de la productivité, du mieux en matière d’emploi et de santé et le développement énergétique du pays). Les moyens, le « business plan » ou le « management » comme l’écrivent les auteures, se déclinent en trois points : une vision collective mise en musique par la puissance publique ; une meilleure répartition du gâteau de la croissance et enfin, une ouverture à l’Europe et au monde. Il faut ici laisser de côté le chiffrage du programme et le débat sur les justifications, les finalités et les conséquences de la croissance. Le lecteur pourrait pourtant discuter le « lien étroit entre richesse économique et bonheur des sociétés ». L’optimisme et le volontarisme de ce livrene sont pas encore vendus. Pour convaincre le citoyen-électeur il faudra sans doute davantage qu’un programme. D’autant plus que nos auteures vantent les mérites de la croissance et plaident en faveur du développement du nucléaire, ce qui pourrait faire froncer quelques sourcils. Idem quant à l’action de la main visible de l’Etat (jusqu’où l’étendre ?) ou en matière éducative (l’utilitarisme ici prôné qui vise à favoriser certaines matières sur d’autres aurait de quoi inquiéter les descendants de Condorcet).
En revanche, pour ce qui est du rôle de l’immigration, les propositions des deux économistes ne surprendront pas. Du moins pas ceux qui, familiers de la littérature économique et des ouvrages d’experts montrent que la France – et l’Europe en général – devra recourir à l’immigration pour contribuer à la croissance future du pays, contribuer à résorber le déséquilibre entre actifs et inactifs et faire en sorte que le pays, sous le poids du vieillissement de sa population, ne se rabougrisse pas trop vite. Car si Sollers gratifia la France du qualificatif de « moisie », les perspectives démographiques pourraient lui adjoindre celui de « grabataire ».
Comme pour tant d’autres économistes et spécialistes de la question, l’affaire est entendue mais nos deux auteures l’expriment, elles, d’une bien étrange façon : « Pour remédier » auvieillissement et au manque de main d’œuvre « une solution sera de faire appel aux talents et à la « niaque » de populations plus jeunes hors de France. C’est le plan « fraternité » du modèle français. C’est bien évidemment la dimension la plus fragile, sans doute la plus contestable et de toute façon la plus aventureuse du business plan. Mais ne nous trompons pas : sans cette hypothèse, le modèle ne tourne pas, et le cercle vertueux de la prospérité, ne pourra pas s’enclencher. »
Ainsi dans leur scénario de croissance à 2 voir 3 % pour les trente prochaines années, le recours à l’immigration, et ce quels que soient les niveaux de qualification, est indispensable et pourtant, écrivent-elles, il s’agit de la « dimension » la plus « fragile », « contestable » et « aventureuse » du scénario. Le lecteur ignore pourquoi. Et pour enthousiasmer des troupes électorales qui trainent déjà la patte, il y a sans doute mieux. Certes l’immigration ne constitue qu’un volet d’un projet chiffré à 90 milliards d’euros sur trois ans (30 milliards pour l’Education, 21 pour les transport en commun et autant pour l’énergie, 15 milliards pour la santé et 3 milliards pour l’agriculture) et qui devra mobiliser non seulement les partenaires privés et sociaux mais aussi l’Etat, pour autant, quelques développements sur ce besoin d’immigration et ses effets escomptés n’auraient pas nuit pour convaincre le chaland. Par les temps qui courent, cela n’aurait pas été de trop…
Si après les élections présidentielles de 2012, un scénario de réduction des flux migratoires devait advenir, nos deux auteurs ne parieraient pas non plus un kopeck sur notre système de santé (pénurie de médecins, besoin de main d’œuvre dans les hôpitaux, etc.). La peur de l’autre et le repli sur soi auraient deux conséquences funestes pour le pays : se priver de l’apport de richesses et de créations venu d’ailleurs et voir son territoire abimé par le développement des « ghettos ». D’ailleurs, à partir d’une extrapolation américaine, elles estiment, toute chose égale par ailleurs selon la formule, à quelques 80 milliards d’euros le coût de la ghettoïsation en France. Les Français auront besoin demain de petits camarades venus d’ailleurs, mais alors, il faudra mettre le paquet en matière d’intégration et en premier lieu dans le domaine de l’éducation. Il faudra savoir ce que l’on veut et ne pas répéter certaines erreurs passées. Karine Berger et Valérie Rabault ont raison de prévenir leurs concitoyens.
Déjà, elles constatent que « la proportion d’étrangers dans la population active ne cesse de baisser depuis le début des années 2000, passant en 2007 de 6,2 % à 5,4 % quand tous les autres pays connaissent la tendance inverse Au royaume uni la proportion, cette année là est de 7,2 % contre 4 % en 2000, en Allemagne 9,4% contre 8,8%, en Espagne 9% contre 2,5% ». Partant d’une prévision de l’Insee selon qui d’ici à 2040, les plus de 60 ans constitueront un tiers de la population (une proportion multipliée par deux en 30 ans), nos auteures en arrivent à leur proposition. « Pour assurer un ratio population active sur la population totale à peu près stable dans les trente prochaines années, l’appel d’environ 10 millions de nouveaux arrivants sur le territoire français serait nécessaire ». 10 millions sur 30 ans revient à admettre sur le territoire national plus de 330 000 immigrés par an soit trois fois plus que le « solde migratoire net » de 2010.
Ces affirmations, à l’instar des développements sur l’Europe, la mondialisation ou la question éducative auraient mérité plus d’explications et plus de pédagogie. Tribalat par exemple a montré avec force qu’il fallait manier avec prudence la notion de « solde migratoire » lui préférant celui de « flux » des entrées d’étrangers. Idem en matière d’évaluation des besoin en immigrés. Sur ce plan, le démographe Hervé Le Bras avance d’autres données (136 000 nouveaux migrants d’ici à 2050 pour simplement maintenir le niveau actuel de la population active). En revanche en ce qui concerne le maintien du rapport actifs/inactifs, il faudrait, selon lui une immigration annuelle comprise, selon les estimations, entre 900 000 et 1,3 million de personnes d’ici à 2025. A ce niveau, il n’est pas dit que les pays du Sud puissent satisfaire à de tels besoins ou en aient seulement envie…
Tout cela pour dire que sur ce sujet il y a débat, les chiffres changent d’une prévision à l’autre, et la faisabilité de tel ou tel scénario varie en fonction de telle ou telle étude. Alors, sur ce sujet, pour convaincre une opinion publique plutôt réticente, il faudra davantage qu’une affirmation rapidement étayée et étonnamment qualifiée ici de « contestable », « fragile » et d’ « aventureuse ». Pour convaincre et taire les peurs et les démagogues, il faudra en faire un peu plus. Comme dirait Bourdieu inspiré par Spinoza : « il n’y a pas de force intrinsèque de l’idée vraie »… A peine installée dans ses nouvelles fonctions de rapporteur général du budget à l'Assemblée, Valérie Rabault, avec sa complice Karine Berger, travaillent à des scénarios alternatifs au plan d'économies présenté par Manuel Valls. Être dans le vrai ne suffira pas pour être entendues.
Edition Rue Fromentin 2011, 204 pages, 20€
 La littérature et les politiques ne cessent de se pencher sur les raisons qui poussent les migrants du Sud à débarquer au Nord. Plus rares sont les enquêtes sur les motivations des pérégrins qui quittent un septentrion riche mais gris pour un méridional pauvre mais lumineux. Pas grand chose sur ces voyageurs bedonnants et grisonnants, aux poches pleines ou aux pensions de retraite ravigotées, rien sur les agités de la libido, les souffreteux aux psychés grosses de « remord » de « mal-être » ou de « culpabilité », rien sur les babas et les gogos friands d’exotisme et moins encore peut-être sur les accros à l’adrénaline en manque de frissons. Le Destin du touriste de l’écrivain et universitaire portugais Rui Zink fait de ces derniers, le sujet de son livre. Le premier traduit en français. Il s’agit d’un conte satirique et philosophique nullement fictionnel. Il suffit pour s’en rendre compte de taper sur son moteur de recherche préféré « tourisme extrême » pour s’apercevoir qu’un « concept » nouveau fleurit chez quelques agences de voyage et autres tours opérateurs : l’organisation du tourisme de l’extrême, le voyeurisme de la misère et de la guerre, le grand émoi, la grande « peupeur » des aventuriers des temps modernes. Un petit tour en Irak ou en Afghanistan, un autre à Haïti ou au Darfour et hop ! Retour au bercail. Car ils reviennent tous chez eux, dans leur « home sweet home », avec leur viatique d’esbroufes à faire pâlir la parentèle et le voisinage. Comme l’écrit Rui Zink, de ce côté de l’hémisphère et dans le sens nord-sud, le voyage « est une valeur socialement positive ».
La littérature et les politiques ne cessent de se pencher sur les raisons qui poussent les migrants du Sud à débarquer au Nord. Plus rares sont les enquêtes sur les motivations des pérégrins qui quittent un septentrion riche mais gris pour un méridional pauvre mais lumineux. Pas grand chose sur ces voyageurs bedonnants et grisonnants, aux poches pleines ou aux pensions de retraite ravigotées, rien sur les agités de la libido, les souffreteux aux psychés grosses de « remord » de « mal-être » ou de « culpabilité », rien sur les babas et les gogos friands d’exotisme et moins encore peut-être sur les accros à l’adrénaline en manque de frissons. Le Destin du touriste de l’écrivain et universitaire portugais Rui Zink fait de ces derniers, le sujet de son livre. Le premier traduit en français. Il s’agit d’un conte satirique et philosophique nullement fictionnel. Il suffit pour s’en rendre compte de taper sur son moteur de recherche préféré « tourisme extrême » pour s’apercevoir qu’un « concept » nouveau fleurit chez quelques agences de voyage et autres tours opérateurs : l’organisation du tourisme de l’extrême, le voyeurisme de la misère et de la guerre, le grand émoi, la grande « peupeur » des aventuriers des temps modernes. Un petit tour en Irak ou en Afghanistan, un autre à Haïti ou au Darfour et hop ! Retour au bercail. Car ils reviennent tous chez eux, dans leur « home sweet home », avec leur viatique d’esbroufes à faire pâlir la parentèle et le voisinage. Comme l’écrit Rui Zink, de ce côté de l’hémisphère et dans le sens nord-sud, le voyage « est une valeur socialement positive ».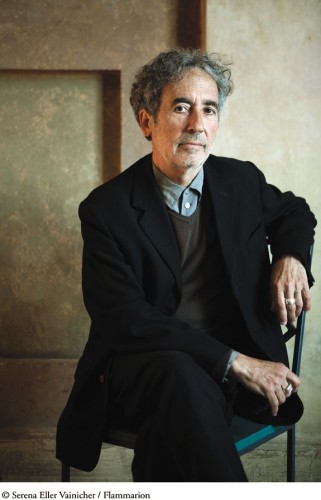 Paru un an avant les célébrations du cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne, Les Vieux fous de Mathieu Belezi expédiait une charge lourde, puissante et efficace contre ce que fut la colonisation.
Paru un an avant les célébrations du cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne, Les Vieux fous de Mathieu Belezi expédiait une charge lourde, puissante et efficace contre ce que fut la colonisation.