« Quant à moi, je n’aime pas ce qui s’élève vers le ciel, mais seulement ce qui partage la gravité. J’ose te le dire, j’ai en horreur les religions. Toutes ! Car elles faussent le poids du monde. »
Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête, Actes Sud 2014
-
-
Allée 7, rangée 38
Sophie Schulze
Allée 7, rangée 38
 Dans ce premier roman que l’on pourrait qualifier d’hybride, Sophie Schulze raconte l’histoire de Walter, jeune allemand immigré en France au lendemain de la Première Guerre mondiale, en émaillant le récit de références et de citations d’Hannah Arendt, Husserl ou Robert Schumann, mêlant petite et grande histoire. Allée 7, rangée 38 tangue entre roman, reportage journalistique et essai (nombreuses et parfois longues citations pour un récit dégraissé).
Dans ce premier roman que l’on pourrait qualifier d’hybride, Sophie Schulze raconte l’histoire de Walter, jeune allemand immigré en France au lendemain de la Première Guerre mondiale, en émaillant le récit de références et de citations d’Hannah Arendt, Husserl ou Robert Schumann, mêlant petite et grande histoire. Allée 7, rangée 38 tangue entre roman, reportage journalistique et essai (nombreuses et parfois longues citations pour un récit dégraissé).L’Histoire, la grande, n’est pas tendre pour les existences et les histoires individuelles. Quand la machine à broyer entre en action, elle ne fait pas de détails ni de sentiments : Walter, jeune immigré allemand, arrive donc à Strasbourg en 1919. Il s’engage dans la Légion étrangère, histoire d’obtenir à la clef une naturalisation bien méritée. Il rencontre Alice, une Alsacienne du cru qui bravera l’autorité parentale pour s’en aller couler le parfait amour avec son étranger de mari. Mais voilà, occupation oblige, les tourtereaux ne sont pas bien vus dans un voisinage suintant le mépris cocardier et l’éternelle suspicion (on en sait encore quelque chose aujourd’hui). Dans les années 40, il ne faisait pas bon s’accoquiner avec un immigré allemand fût-il devenu Français mais toujours… d’origine allemande ; comme il ne fera pas bon, une décennie plus tard, pour une Française de partager l’amour d’un Algérien. On ne cesse de renvoyer l’Autre dans ses cordes, réelles ou fantasmées. Walter a beau être devenu français, être passé par la Légion où « personne » n’a cherché « à connaître son passé » et où « son destin a fini par être commun » avec celui de tous, pour ses nouveaux concitoyens, il reste un Français de papiers et un Allemand pur jus, un « boche » comme d’autres sont renvoyés à leurs fatmas et à leur couscous.
L’Histoire convoque ses suspects, les enfermant dans les cordes, réelles ou fantasmées, d’une origine rédhibitoire et inconciliable. L’Histoire est en marche, et le couple puis la petite famille, s’épuise à en éviter les ornières et les chocs. La vie passe ; Walter et Alice progressent sur les chemins tortueux de l’exil, de l’intégration, des constructions identitaires, de l’amour ou de la haine des autres. Fragilité des existences et insignifiance des êtres bousculés par le froid engrenage des déraisons de l’Histoire. Après les errements d’Heidegger et le combat d’Hannah Arendt pour la vérité, les nations européennes vont apprendre à reconsidérer leurs frontières intérieures et renouer avec leur « parenté d’esprit ». En trois phrases on passe de Robert Schuman à Alice et d’Alice à l’auteur de Etre et Temps…On passe allègrement de ces pauvres hères aux considérations continentales, de la nuit de la guerre aux lumières de la construction européenne.
Un texte composite, brillant mais parfois déstabilisant, oscillant entre le roman, le reportage journalistique et l’essai. L’écriture, expurgée du superflu, est la grande originalité de ce premier roman où la littérature semble parfois à l’étroit entre le vertige des grandes idées et le prosaïque de la chronique.
Léo Scheer 2011, 93 pages, 15€
-
La citation du jour
« En étant journaliste, j’ai compris que la réalité à laquelle nous nous confrontons n’a ni valeur ni poids. C’est l’imaginaire qui commande nos actions, ou plutôt nos réactions. Nous sommes de plus en plus incertains, apeurés, vulnérables, irrationnels. Il faut qu’on m’explique, par exemple, pourquoi la majorité des Italiens considère que les immigrés sont la première cause d’insécurité, mais confient les personnes qui leur sont les plus chères, enfants et personnes âgées, et les clefs de leur maison aux dames de compagnie et aux bonnes étrangères. Qu’est ce qu’on peut faire ? Devons-nous nous contenter d’une réalité factice, fuyante, dépourvue d’éléments concrets, mais pleines de délires et de préjugés ? »
Amara Lakhous, Querelle autour d’un petit cochon italianissime à San Salvario, Actes Sud 2014
-
La citation du jour
« Oui, tout disparaîtra. Ou plutôt : par son acte – l’acte de la désaffiliation – elle fera tout disparaître et le monde tel qu’ils le connaissent, jamais plus ne sera pareil. Le sang qui coule dans les veines des pères et des fils, le sang de la vengeance, le sang de la guerre, soudain, perdra toute valeur. Et ils auront beau, ce sang, vouloir le faire couler, couler et couler encore, un jour viendra où il ne coulera plus. Car, après l’acte de la jeune femme – cet acte de la rupture -, c’en sera fini de la famille, de son honneur et de sa violence. »
Kaoutar Harchi, A l’origine notre père obscur, Actes Sud 2014
-
Parle-moi un peu de Cuba
Jesus Diaz
Parle-moi un peu de Cuba
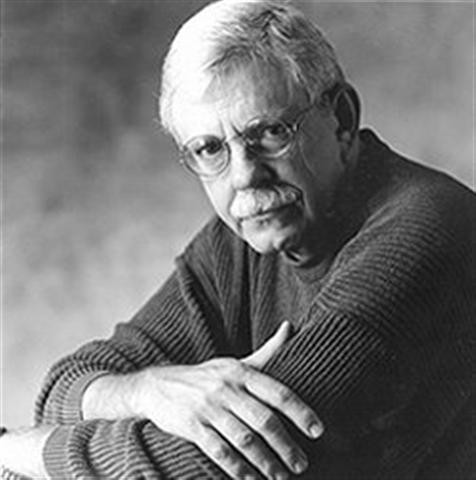 Il y aurait deux façons pour un Cubain de débarquer aux USA. Il y a la voie royale, celle où les Gringos vous déroulent le tapis rouge avec permis de séjour et autorisation de travail à la clef, et l’autre, où l’accueil se fait plus suspicieux, du bout des lèvres, comme à regret. Le même pays fera alors attendre le même exilé cubain une bonne année pour daigner le gratifier d’un permis et d’autorisations diverses. Il faut faire ses preuves. Dans le premier cas, le Cubain, perché ou vautré sur une méchante embarcation ou un radeau de fortune a réussi à s’esbigner de son île, éviter les humeurs des requins et échapper aux caprices des vents et des courants du détroit de Floride, pour s’en aller poser un pied salvateur du côté de Key West. Dans l’autre cas, le bougre est passé par le Mexique, comme le vulgum pecus des migrants de sorte qu’il sera soumis au commun législatif.
Il y aurait deux façons pour un Cubain de débarquer aux USA. Il y a la voie royale, celle où les Gringos vous déroulent le tapis rouge avec permis de séjour et autorisation de travail à la clef, et l’autre, où l’accueil se fait plus suspicieux, du bout des lèvres, comme à regret. Le même pays fera alors attendre le même exilé cubain une bonne année pour daigner le gratifier d’un permis et d’autorisations diverses. Il faut faire ses preuves. Dans le premier cas, le Cubain, perché ou vautré sur une méchante embarcation ou un radeau de fortune a réussi à s’esbigner de son île, éviter les humeurs des requins et échapper aux caprices des vents et des courants du détroit de Floride, pour s’en aller poser un pied salvateur du côté de Key West. Dans l’autre cas, le bougre est passé par le Mexique, comme le vulgum pecus des migrants de sorte qu’il sera soumis au commun législatif.Le dénommé Staline Martinez, le personnage central du roman de Jesus Diaz, peut se vanter, lui, d’avoir tâter des deux méthodes. Mais dans le mauvais ordre. Il raconte son histoire enfermé sur une terrasse de Miami, exposant sa peau aux brûlures du soleil et son corps aux rigueurs du jeun et de la déshydratation, histoire de faire croire aux autorités américaines qu’il est bien un balsero, un cubain sauvé des eaux, un Staline anadyomène qui entend bénéficier illico du statut de réfugié. Pourtant, quelques semaines plus tôt, avant son come back via la frontière mexicaine, il était bien arrivé aux Etats-Unis par la mer. Et les Yankies lui ouvraient alors grand les bras, il lui suffisait de le demander, de faire le show au micro du reporter dépêché par un des nombreux réseaux d’informations, de vanter à la caméra la liberté retrouvée et de médire du socialisme à la sauce castriste. Il n’en fit rien. Mieux - ou pire - il demanda à reprendre le premier vol pour la Havane. Incompréhensible pour un esprit cartésien, qui a biberonné à l’économie néolibérale et à l’anti communisme.
Staline Martinez, modeste dentiste de son état, anti héros par excellence, travaillé par la culpabilité, la crainte et l’indécision, déconsidéré par son entourage, demande pourtant à rentrer sur son île, pour y retrouver son quotidien terne, pauvre, fait de pénuries, retrouver Fredesvinda, sa bicyclette antédiluvienne, Pepe son ventilateur moribond et surtout Idalys, son épouse callipyge. L’enamouré croit qu’elle l’attend comme Pénélope son Ulysse - mais sur un mode mas caliente - quand Idalys a déjà délaissé Staline pour Jésus...
A son retour, les autorités font du bien nommé Staline Martinez un héros national qui se doit cette fois de vanter les mérites du « Lider Maximo » et de médire de « L’Oncle Sam »…« Les gens comme lui étaient condamnés à courir d’un côté à l’autre en se cognant la tête pour voir si par hasard ils arrivaient à sortir du labyrinthe ». Quant aux vertus des systèmes politiques, Stalina (la sœur) a sa petite théorie : « le socialisme (…) était un parc zoologique où les gens vivaient dans des cages, en attendant que les gardiens leur lancent leur pitance ; tandis que le capitalisme était une forêt vierge où il fallait chasser tous les jours ».
Staline, à demi nu, se retrouve donc perché, durant cinq jours, sur la terrasse du pavillon de son frère Lénine, alias Léo pour les Américains. Pendant que le corps de l’infortuné se détériore, empeste, se couvre de squames, son esprit se dégrade à mesure que les souvenirs se font plus pressants, plus douloureux. Staline revit son histoire : comment et pourquoi par deux fois il a réussi à rejoindre les Etats-Unis, son quotidien à Cuba partagé entre l’hôpital, sa sœur et sa mère, quelques connaissances et Idalys. Comment, pour pallier l’absence de droits, les Cubains s’adonnent à la débrouille et aux magouilles pour trouver le nécessaire ou quelques dollars quand les jinetera, prostituée occasionnelles, tapinent avec les touristes… Staline ranime sa jalousie, ses frustrations, ce mépris de soi qui tire son origine davantage d’un système et d’une organisation sociale que d’une défaillance individuelle. Etre né cubain serait alors comme une malédiction : « Ah, s’il pouvait transmettre un jour à quelqu’un l’exaspérante humiliation que signifiait être cubain à Cuba (…) » dit-il. Les Maghrébins - et les Algériens en particulier - ont un mot pour cela : la hogra ! D’ailleurs, une scène de Parle-moi un peu de Cuba en rappelle une autre tirée du Passé Simple du marocain Driss Chraïbi. Les deux auteurs font, en un acte sacrilège, « pisser » leurs personnages qui sur le royaume marocain qui sur l’île révolutionnaire.
La solitude et les souvenirs de Staline sont entrecoupés des visites de Miriam, la nièce de Christina, sa belle-sœur. « Parle-moi un peu de Cuba » lui demande Miriam, arrivée aux Etats-Unis âgée de deux ou trois ans et qui ne peut converser qu’en anglais avec Staline. Christina exprimera le même souhait, le même appel. Derrière ces demandes identiques, percent deux attentes différentes. Une quête de repères pour l’une, plongée dans une société où elle ressent l’hostilité des autres communautés à l’endroit des Cubains et demande à Staline « who am I ? ». Quant à la boulimique Christina, il y entre une part de tristesse et de mal du pays. Christina est malheureuse et sans doute vit-elle son exil comme un déracinement. Parle-moi un peu de Cuba évoque la nostalgie et le sentiment de faute qui accompagne l’exilé, y compris chez Léo, le frère de Staline et l’époux de Christina qui fait tout pour que son fils Jeff « guérisse de Cuba ».
La dernière nuit approche. Lénine, alias Léo va déposer son frère aux large des côtes américaines sur un radeau. Quelques heures suffiront à Staline pour rejoindre la terre ferme. « Mardi 28 » sera un nouveau jour. Un page encore blanche, une page à noircir. Pour une fois « l’orgueil », fut-il « stupide » de Staline, pourrait bien y tenir la première place.
Il faut se méfier de ce roman et du style magistral de Jesus Diaz. Cette histoire est racontée avec force, densité, sur un mode plaisant, l’humour s’y baguenaude et même, au détour d’une page, une scène comique surgit. La distance avec les faits est trompeuse, comme un contre-pied. Cette narration, tenue de bout en bout, a sans doute à voir avec le « comique naturel (…) de tant de Cubains » : « capables de rire du malheur dans lequel ils [vivent] ».
Jesus Diaz est né en 1941 à Cuba, en exil à Madrid depuis 1992, il y meurt en 2002. Il est l’auteur de plusieurs romans dont quatre ont été traduits en français chez Métailié et deux autres chez Gallimard.
Traduit de l’espagnol (Cuba) par Jean-Marie Saint-Lu, Métailié 2011, 237 page, 12 €
-
Vingt Sonnets à Marie Stuart
Joseph Brodsky
Vingt Sonnets à Marie Stuart
 Comme l’indique André Markowicz dans sa postface, ces Vingt sonnets à Marie Stuart écrit par le prix Nobel (1987) en hommage à la reine écossaise sont nés d’une « absurdité » : deux ans après son expulsion d’Urss, en 1974 donc, Joseph Brodsky « se retrouve à Paris, au jardin du Luxembourg, en arrêt devant la statue de Marie Stuart. Comment le « kleine nacht moukjik » qu’il n’a jamais cessé d’être, puisqu’il est russe, a-t-il pu se retrouver là, et elle, Marie Stuart, qu’a-t-elle fait au bon Dieu pour finir en statue au Luxembourg ? – Les Vingt sonnets à Marie Stuart sont nés de cette absurdité ». Il faut ajouter que la royale figure, incarnée à l’écran notamment par l’actrice Zarah Leander, rappelle au poète quelques amours d’antan.
Comme l’indique André Markowicz dans sa postface, ces Vingt sonnets à Marie Stuart écrit par le prix Nobel (1987) en hommage à la reine écossaise sont nés d’une « absurdité » : deux ans après son expulsion d’Urss, en 1974 donc, Joseph Brodsky « se retrouve à Paris, au jardin du Luxembourg, en arrêt devant la statue de Marie Stuart. Comment le « kleine nacht moukjik » qu’il n’a jamais cessé d’être, puisqu’il est russe, a-t-il pu se retrouver là, et elle, Marie Stuart, qu’a-t-elle fait au bon Dieu pour finir en statue au Luxembourg ? – Les Vingt sonnets à Marie Stuart sont nés de cette absurdité ». Il faut ajouter que la royale figure, incarnée à l’écran notamment par l’actrice Zarah Leander, rappelle au poète quelques amours d’antan.Avant d’évoquer quelques thèmes et figures poétiques du recueil, un mot sur une originalité éditoriale : cette édition quadrilingue offre aux lecteurs – et plus encore aux lecteur polyglotte – un jeu de miroir entre texte russe original et trois traductions : la traduction anglaise de Peter France revue par Joseph Brodsky soi-même, la traduction de Claude Ernoult, publiée aux éditions Gallimard, et celle d’André Markowicz. Fascinante initiative d’un livre imprimé tête-bêche qui voit le lecteur passer d’une traduction à l’autre, comparer les langues, s’arrêter sur les images et les émotions nées des mots et des rythmes propres à chacun. Les pulsations et les reliefs de ce recueil permettent de sentir, ressentir l’indispensable fonction du traducteur : comment à partir d’une langue autre, inventée, à partir d’une œuvre réinventée, originale, remonter à la source originelle, dans son fond mais aussi dans sa forme. Car pour André Markowicz, célèbre traducteur entre autres de Dostoïevski, les jeux avec les sonorités, la restitution des intonations, les transpositions des références (ici des russes aux françaises) sont mobilisés pour respecter, au plus près, la forme, « non pour s’écarter du sens mais, au contraire, pour le servir, parce que le texte est un tout organique, et qu’il n’y a aucun moyen de séparer la forme et le fond ». Fidélité d’autant plus recherchée que le choix du sonnet par Joseph Brodsky peut être reçu comme un hommage à ceux écrits par la reine décapitée mais aussi parce que le sonnet, « est pas excellence la forme de l’Europe ». Comme l’écrit l’éditeur, « le texte que le lecteur a sous les yeux est un vin miraculeux ». Autrement dit, « le vin de la traduction [n’est pas] un vin coupé d'eau ».
Ces Vingt Sonnets à Marie Stuart parlent d’amour bien sûr. Ils évoquent aussi Paris, un Paris au passé et aux usages revisités par un exilé épris de liberté et de culture, et dont les bifurcations existentielles conduisent à s’interroger sur la marche de l’Histoire, sur l’Art et sur la mémoire. La prose, ramassée, populaire, gouailleuse, enivrée ou inquiète, ironique ou lyrique, mélancolique ou clairvoyante, riche en fulgurances, sonorités et images, passe du clin d’œil au coup de gueule, du moqueur sourire à la franche rigolade, du sombre au tragique.
Extraits
« Je vous ai rencontrée, et, selon la romance / qui redonne la vie à un cœur trop usé, /j’ai retrouvé mon souffle avec plus de puissance. » (Traduction Claude Ernoult)
« Que vis-je ? Vous, et, vision divine, / vous qui ressuscitâtes le passé / en l’âme éteinte, je vous ai tressé / ce qui me reste d’une joie pouchkine, / et mes sornettes rustres, bien mesquines / bruissent pour votre buste et taille fine. » Traduction André Markowicz
***
« Et toi, Mary, « Ça va ? – Ça va. Sankion. », / cernée par tes copines de caillou, / tu trônes chez les capétiens imberbes. » (T. AM)
***
« L’Ecosse eût fait un digne matelas / pour nos amours, je t’eûs montrée aux Slaves, / Glasgow se fût, étrave sur étrave, / vue russifiée en veux-tu en voilà. / Pour nous ensemble eût résonné le glas. / « La hache – en toc… » - Bourreau, tu es bien brave. » (T. AM)
***
« La plaine. Le clairon. Deux hommes. Le fracas / du combat. – « Qui es-tu ? – Qui es-tu donc toi-même ? »/ - « Qui suis-je ? » - « oui, qui es-tu ? » - « Un protestant, mon gars. » / - « Moi catholique. » - « Ah ! Vlan ! Avale ton baptême ! » (T. CR)
« La plaine. La trompette. Nuit d’effroi. / Entrent deux hommes. « Toi, t’es quoi ? » - Clique- / tis des épées. – « En garde, catholique, / moi, je suis protestant ! » - « Or, gare à toi ! ». / Ensuite on en ramasse les reliques - / et les corbeaux croissant, croa-croa. » (T. AM)
***
« Béliers qui tremblent qu’on leur ratiboise / leurs toisons d’or ne paissent pas en paix. / Les Écossais soumirent à leur toise / ta mort. Ainsi leurs bâtons se rompaient ; / - « Ben, ils lui ont coupé la tête… » - « Eh bè… / Paris leur fera bien payer l’ardoise… » / - « Paris ? Pour une tête ?... » - Rire épais. / « C’est pour plus bas qu’ils chercheraient des noises. » / - « Mais pas un mec, quand même, et en tenue / légère… » « Y’a pas de quoi jeter l’opprobre. » / -« ce que je pense était presque tout nu… » / -« Peut-être qu’elle avait pas d’autre robe… » / - « C’est mieux en Moscovie, ils ont la mode / de l’unisexe – ni vu ni connu. » (T. AM)
« - « Hélas, hélas, on lui a coupé la tête ! » / - « De Paris la colère est à craindre, dit-on. » / - « Mais qui donc à Paris d’une tête s’inquiète, / « C’était trop haut de fendre au-dessous du menton. » (T.CR)
***
« Pour qui, Mary, t’aura fait ses adieux, / à toi – pas à n’importe qui – qu’importe / le pain sans sel et l’odeur de cloportes / des escaliers d’exil ? Tu auras mieux / senti que moi la joie d’être à la porte. / Si j’ai fauté, ne fais pas tes gros yeux. / Ma langue, comme un rat, en langue morte / cherche un semblant de vie à qui mieux-mieux. / Adieu, idole aux délices attraits. / on peut s’aimer de loin, sans doute, fût-ce / par-delà même les meilleurs barreaux / (l’éternité et l’océan, le vrai /de vrai – je pense à la censure russe / qui rend un luxe l’œuvre du bourreau). » (T. AM)
Version originale russe, version anglaise de Peter France et de l’auteur, traductions françaises de Claude Ernoult (1987) et d’André Markowicz (2013). Postface d’André Markowicz, Les doigts dans la prose 2014, 192 pages, 18 €
-
La citation du jour
« L’impression née de ce premier voyage ne m’a jamais quittée : par la suite, je me suis toujours demandé si mon père, enfant réfugié, parent pauvre, étudiant étranger, travailleur expatrié, touriste en son propre pays, s’était jamais senti à sa place quelque part. »
Minh Tran Huy, Voyageur malgré lui, Flammarion 2014
-
La citation du jour
« Je me suis souviens que quand vous êtes nées, toi et ta sœur, je me suis juré de vous donner tout ce à quoi je n’avais pas eu droit. Une vie douce, paisible, confortable, que nul fantôme, nul remords, ne viendrait hanter ; une existence sans ombres ni tourments, pareille à une page vierge. Vous n’auriez rien à faire d’autre que d’écrire votre histoire, sans devoir souffrir d’aucun poids, d’aucune entrave. Mes chaines n’étaient ni ne seraient jamais les vôtres. »
Minh Tran Huy, Voyageur malgré lui, Flammarion 2014
-
La citation du jour
« Presque malgré nous, nous commencions de nous établir en ces lieux où nous n’avions pensé que passer. Nous commencions de construire une existence, et même de la prolonger : ta sœur a vu le jour peu après l’arrivée de ta grand-mère chez nous et trois ans après, tu es née. »
Minh Tran Huy, Voyageur malgré lui, Flammarion, 2014