Abdelkader Djemaï
Le Nez sur la vitre Ce nouveau et court roman d’Abdelkader Djemaï constitue le troisième volet d’un triptyque sur les Algériens de France. Djemaï semble aimer les cycles ; peut-être est-ce dû à la précision de son style et à la brièveté de ses récits. Déjà, en 1995, il publiait le premier volet d’un autre triptyque consacré alors à l’Algérie (avec Un Été de cendres, suivi de Sable rouge et de 31, rue de l’Aigle). La France “terre d’immigration” a fait irruption dans l’oeuvre de Djemaï, en 2002, dans un camping de bord de mer sur la côte oranaise. L’ancien journaliste, lui-même natif d’Oran, décrivait dans Camping les vacances d’une famille d’émigrés algériens partageant son congé annuel avec les citoyens du cru. Dans Gare du Nord, il invitait à suivre les pas, humbles et anonymes, de trois chibanis. Trois vieux Algériens qui, après avoir donné leur vie pour une maîtresse bien ingrate, “Madame la France”, attendent, solitaires et sans but, de s’effacer complètement de nos paysages urbains. Logiquement, ouvrant Le nez sur la vitre, le lecteur pense aller à la rencontre d’une autre génération. Djemaï est en France depuis plus de dix ans, et d’ateliers d’écriture en résidences d’auteur, de rencontres débats avec ses lecteurs en séances de dédicaces, il sillonne le pays comme un paysan laboure son champ, avec méthode, finissant par en connaître les moindres aspérités. On se dit que le regard de l’écrivain sur ces jeunes qu’il croise, rencontre et observe, sera intéressant. Mais, dans Le nez sur la vitre, Djemaï semble s’être fait piégé. Le jeune est bien là et pourtant c’est son vieux père qui prend le plus de place. Au centre du récit, il y a cette relation entre un père algérien et son fils français. Une relation où les silences et les non-dits laissent au fond de la gorge une boule, une terrible boule grosse de ce trop-plein d’amour perdu, gâché, que l’un comme l’autre n’offrira jamais et ne recevra jamais. “Lui, il n’avait pas eu besoin de mots, de phrases avec son père, c’était comme ça, ça avait toujours été comme ça, ils se comprenaient malgré le dénuement et la solitude du douar. Il avait cru que les choses allaient d’elles-mêmes, que ce serait pareil avec son petit, que cela se ferait naturellement. Puis le temps avait passé et il s’était brutalement aperçu qu’une distance les avait, sans qu’ils le veuillent, peu à peu séparés, éloignés l’un de l’autre. C’était comme si son fils se tenait derrière une vitre épaisse, qu’il pouvait seulement le voir, le sentir bouger […]. Une vitre froide et impitoyable sur laquelle il avait collé son nez et qui l’empêchait de lui dire quelques mots, de le toucher, de le serrer dans ses bras.”
Ce nouveau et court roman d’Abdelkader Djemaï constitue le troisième volet d’un triptyque sur les Algériens de France. Djemaï semble aimer les cycles ; peut-être est-ce dû à la précision de son style et à la brièveté de ses récits. Déjà, en 1995, il publiait le premier volet d’un autre triptyque consacré alors à l’Algérie (avec Un Été de cendres, suivi de Sable rouge et de 31, rue de l’Aigle). La France “terre d’immigration” a fait irruption dans l’oeuvre de Djemaï, en 2002, dans un camping de bord de mer sur la côte oranaise. L’ancien journaliste, lui-même natif d’Oran, décrivait dans Camping les vacances d’une famille d’émigrés algériens partageant son congé annuel avec les citoyens du cru. Dans Gare du Nord, il invitait à suivre les pas, humbles et anonymes, de trois chibanis. Trois vieux Algériens qui, après avoir donné leur vie pour une maîtresse bien ingrate, “Madame la France”, attendent, solitaires et sans but, de s’effacer complètement de nos paysages urbains. Logiquement, ouvrant Le nez sur la vitre, le lecteur pense aller à la rencontre d’une autre génération. Djemaï est en France depuis plus de dix ans, et d’ateliers d’écriture en résidences d’auteur, de rencontres débats avec ses lecteurs en séances de dédicaces, il sillonne le pays comme un paysan laboure son champ, avec méthode, finissant par en connaître les moindres aspérités. On se dit que le regard de l’écrivain sur ces jeunes qu’il croise, rencontre et observe, sera intéressant. Mais, dans Le nez sur la vitre, Djemaï semble s’être fait piégé. Le jeune est bien là et pourtant c’est son vieux père qui prend le plus de place. Au centre du récit, il y a cette relation entre un père algérien et son fils français. Une relation où les silences et les non-dits laissent au fond de la gorge une boule, une terrible boule grosse de ce trop-plein d’amour perdu, gâché, que l’un comme l’autre n’offrira jamais et ne recevra jamais. “Lui, il n’avait pas eu besoin de mots, de phrases avec son père, c’était comme ça, ça avait toujours été comme ça, ils se comprenaient malgré le dénuement et la solitude du douar. Il avait cru que les choses allaient d’elles-mêmes, que ce serait pareil avec son petit, que cela se ferait naturellement. Puis le temps avait passé et il s’était brutalement aperçu qu’une distance les avait, sans qu’ils le veuillent, peu à peu séparés, éloignés l’un de l’autre. C’était comme si son fils se tenait derrière une vitre épaisse, qu’il pouvait seulement le voir, le sentir bouger […]. Une vitre froide et impitoyable sur laquelle il avait collé son nez et qui l’empêchait de lui dire quelques mots, de le toucher, de le serrer dans ses bras.”
Depuis trop longtemps, le père et la mère sont sans nouvelles de leur aîné. Il ne répond plus aux lettres qui lui sont adressées. Alors, le vieil homme décide de partir à sa recherche. Le voyage à destination d’une lointaine ville du Nord se fera en car (un Setra Kassbohrer 215 HD avec 320 chevaux sous le capot). En contrepoint de la banalité du voyage (la description des arrêts, les pauses déjeuner, l’épisode du couple de vieux retraités oubliés sur l’aire d’autoroute, les émissions de radio…) se raconte la vie intérieure du vieil Algérien. Une existence entière défile derrière les vitres du car et sous le crâne du vieil homme. Remonte alors le souvenir d’un autre et lointain voyage en car. Il était gamin et, avec son père, ils avaient pris place à l’intérieur d’un vieux Saviem S45. Ensemble, ils se rendaient à une visite médicale, son père souffrant des poumons. L’arrivée en ville offre à Djemaï le loisir de glisser quelques-uns de ses thèmes de prédilection : la ville, le cinéma, la cuisine (ici des sardines à la tomate et à l’ail), l’enfance et le premier émoi sentimental sur fond de guerre… Deux cars donc pour deux trajets différents mais un seul homme, ce presque retraité parti en quête de son rejeton qui se souvient de sa propre enfance et de son propre père. Le car avance. Les voyageurs vaquent à leurs occupations, certains s’enlacent, se prennent tendrement la main, s’embrassent. Lui pense qu’avec sa femme “après presque trente ans de vie commune, ils n’avaient pas osé se dire, devant leurs enfants ou en public, leur amour et, encore moins, se toucher, s’embrasser”. Sa femme, son fils, la vie elle-même ne serait-elle qu’une douleur ? Un regret ? Allez donc savoir. Djemaï utilise la palette de l’impressionnisme, il suggère, livre les émotions et les sentiments par petites touches, ouvre le champ des possibles et n’enferme pas ses personnages.
Muni d’une simple adresse griffonnée sur un méchant papier, le vieil homme retrouvera son fils. Fiancé avec la fille d’un Charentais, il s’apprête justement à renouer avec les siens. Il veut réparer les erreurs passées et faire que son père soit, à nouveau, fier de lui. Peut-être que cette “muraille” qui sépare les deux hommes finira par tomber. Comme sur cette photo qui ouvre et referme le livre : l’unique photo où le père est avec son fils. On y voit le gamin, “en pantalon kaki et en sandalettes, serré contre lui comme s’il voulait qu’il le protège contre le malheur”.
Edition du Seuil, 2004
Paru en poche, Point Seuil, 2006
DJEMAÏ Abdelkader
-
Le Nez sur la vitre
-
Un moment d’oubli
Abdelkader Djemaï
Un moment d’oubli Djemaï, l’auteur, en son temps et avec cette économie de moyen caractéristique de son œuvre, fit respirer la société algérienne jusque dans ses remugles et son étouffement les plus secrets. Plus tard, après des années d’exil forcé, effleurant avec sensibilité la fragilité des êtres, il raconta la solitude et les blessures silencieuses des vieux immigrés. Aujourd’hui, l’Algérien, exilé, qui ne cesse de sillonner la France du Nord au Sud et d’Est en Ouest pose ses yeux sur les fantômes de nos rues : les SDF, les laissés-pour-compte, ceux qui effraient autant qu’ils blessent les consciences. C’est « à tous ceux qui sont dehors » qu’il dédie son livre. « Ton cas, tu le sais bien, n’a rien d’exceptionnel. Il y a de plus en plus de personnes qui errent comme toi, parfois en groupe ou avec leurs chiens, dans des cités plus dures, plus impitoyables que celle où tu as débarqué, sans le faire exprès, il y a presque deux ans. Des hommes et des femmes de plus en plus jeunes aussi (…) ». Il y a sans doute bien des raisons de se retrouver à la rue. Jean-Jacques Serrano, ce fils d’un menuisier rital et d’une « Savoyarde pur beurre », n’est pas une victime de la crise, du chômage ou du surendettement. Non, un autre drame s’est abattu sur lui.
Djemaï, l’auteur, en son temps et avec cette économie de moyen caractéristique de son œuvre, fit respirer la société algérienne jusque dans ses remugles et son étouffement les plus secrets. Plus tard, après des années d’exil forcé, effleurant avec sensibilité la fragilité des êtres, il raconta la solitude et les blessures silencieuses des vieux immigrés. Aujourd’hui, l’Algérien, exilé, qui ne cesse de sillonner la France du Nord au Sud et d’Est en Ouest pose ses yeux sur les fantômes de nos rues : les SDF, les laissés-pour-compte, ceux qui effraient autant qu’ils blessent les consciences. C’est « à tous ceux qui sont dehors » qu’il dédie son livre. « Ton cas, tu le sais bien, n’a rien d’exceptionnel. Il y a de plus en plus de personnes qui errent comme toi, parfois en groupe ou avec leurs chiens, dans des cités plus dures, plus impitoyables que celle où tu as débarqué, sans le faire exprès, il y a presque deux ans. Des hommes et des femmes de plus en plus jeunes aussi (…) ». Il y a sans doute bien des raisons de se retrouver à la rue. Jean-Jacques Serrano, ce fils d’un menuisier rital et d’une « Savoyarde pur beurre », n’est pas une victime de la crise, du chômage ou du surendettement. Non, un autre drame s’est abattu sur lui.
Tout cela est bien ficelé, la construction du récit équilibré, les rappels et les résonances fonctionnent, la curiosité – pourquoi Jean-Jacques Serrano cultive-t-il presque sa mystérieuse douleur ? – tient le lecteur en alerte. L’écriture, toujours économe, est maîtrisée. Le regard semble plus extérieur, moins intériorisé que les précédents romans sur l’Algérie ou l’immigration algérienne.
Les fidèles de Djemaï retrouveront avec félicité la gourmandise de l’auteur qui coule ad libitum au fil de sa plume. Écriture des sens et du concret qui aime à s’arrêter sur les gestes du quotidien, il n’y a qu’à lire la première phrase du livre pour s’en convaincre. Dans tous les romans de Djemaï, les plats défilent. Ici, un gâteau aux châtaignes, une viande de taureau aux abricots, un poulet aux pruneaux, du rosé de Tavel. Et toujours aussi cette place accordée au cinéma (ici bien sûr les films de Lino Ventura), à la petite reine, le Tour de France, à l’évocation nostalgique des années 50-60 ou au drame de la Guerre d’Algérie…
A.Djemaï fait plus que raconter la « longue et épuisante dérive » de cet homme, il lui redonne une identité, lui offre l’occasion de rejoindre, l’espace de quelques pages, le cercle des humains. Jean-Jacques Serrano est un ancien flic. Il n’a revu, Laure son ex-femme qu’à l’enterrement de sa mère. Ensemble, ils ont un fils, Lucas.
Avec des soldats venus d’Afrique, Roberto, son père, avait fait Monte Cassino. Il « admirait Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, dit Lino Ventura, un rital né comme lui à Parme ». Le jeune Ventura, le futur Lino, a rejoint dans les années trente, clandestinement, ses parents à Paris… « à cette époque où on continuait de taper sur les macaronis, il évitait de sortir dans la rue ou de prendre le métro, car il craignait d’être arrêté par la police. » Tiens ! Certains négligent certaines histoires. Il est bon de rafraîchir les mémoires. C’est comme l’ex-collègue de Serrano ! Un flic raciste, méchamment raciste, qui a oublié qu’il vient d’ailleurs… A.Djemaï, l’exilé algérien, attentif aux « damnés de la terre » rapproche le sort des SDF de celui des étrangers clandestins. « Personne ne sait ton nom ni d’où tu viens. Tu n’as même pas un sobriquet, méchant ou sympathique. Ni de chien ou de chat pour te tenir compagnie. Tu n’es qu’un fantôme sans prénom, une silhouette morte, une ombre creuse qui se traîne sur les trottoirs de S… (…) tu es une sorte de clandestin à visage découvert, un réfugié maigre et dépenaillé. A la différence des étrangers, tu n’as pas à te cacher (…) ». Il est vrai aussi que ce « clandestin usé comme ses semelles, enfermé en lui-même et dans les frontières de son propre pays. (…) » peut, lui, être secouru, aidé, sans que cette solidarité ne conduise nécessairement devant un tribunal.
La fin du récit de ce « clandestin usé comme ses semelles, enfermé en lui-même et dans les frontières de son propre pays. (…) » est accélérée, comme précipitée : « il nous faut à présent aller vite pour raconter ton histoire (…) ». « Vite » ! Comme des regards furtifs et fuyants ?
Edition du Seuil 2009, 86 pages, 13€ -
31 rue de l'Aigle
Abdelkader Djemaï
31 rue de l'Aigle 31 rue de l'Aigle referme la trilogie algérienne commencée avec Un Été de cendres et poursuivie avec Sable rouge. Après la ville, la terre voici venu le temps du végétal.
31 rue de l'Aigle referme la trilogie algérienne commencée avec Un Été de cendres et poursuivie avec Sable rouge. Après la ville, la terre voici venu le temps du végétal.
L'on y retrouve la même fluidité et le même souci de faire court chez l'écrivain et journaliste algérien installé en France. Ce style épuré et efficace offre au lecteur un réel plaisir de lecture. En artisan du verbe, en conteur attentif, Djemaï recherche d’abord l’agrément de ceux qui le lisent. Pour autant, il sait aussi déranger, être rude, convoquer son lecteur pour le mener là où il entend le conduire.
31 rue de l'Aigle raconte une enquête policière menée sur un certain « R.D ». Un simple citoyen. Monsieur Tout le monde réduit à de simples initiales (ce pourrait être des chiffres) que la paranoïa d'un Etat policier et de ses chiens de garde tient pour subversif, forcément dangereux. Au 31 rue de l'Aigle on traque la subversion, on arrête, on interroge, on torture. On y meurt aussi. Banal. Tristement et sordidement banal. Comme la mécanique froide de l’implacable enquêteur : "nous sommes tous d'accord : il est impératif de procéder à l'ablation des parties incurables, d'exciser les kystes, de nettoyer les mauvaises matrices, de prévenir les tumeurs malignes, d'enrayer les irruptions virales. Et d'apprendre aux mères imprudentes ou désespérément faibles à ouvrir grands les yeux sur les crimes de leurs fils, sur les péchés de leur douteuse progéniture. Oui, je crois comme le Chef Cuistot, qu'il faut vite crever l'abcès, vider tous les furoncles, une fois pour toutes. Proprement. Simplement".
Entre les lignes, entre les mots, se glisse l'univers professionnel et psychologique de cet inspecteur membre des services de sécurité d’une dictature. Un être abject sans une once d'humanité et de compassion pour la souffrance d'autrui. Si ce n'est pour ses plantes qu'il cultive amoureusement. Eh oui ! On peut, dans la journée, gazer hommes, femmes et enfants et, le soir venu, être un père de famille prévenant et un tendre époux. Ici, un « Ficus elastica robusta » remplace madame et ses rejetons ou une mère hospitalisée. Sans en avoir l'air, son caoutchouc en pot sous la plume, Abdelkader Djemaï démonte, un à un, les ressorts sur lesquels reposent les mécanismes qui permettent à un pouvoir totalitaire de terroriser sa population. S'il n'est jamais question de l'Algérie dans ce livre – comment ne pas y penser ? - c'est que le propos de l'auteur se veut plus large, plus universel. Ici ou ailleurs, les entrailles du monstre totalitaire sont les mêmes.
Michalon 1998, 138 pages
31 rue de l’Aigle est paru en poche chez Folio Gallimard -
Un Été de cendres
Abdelkader Djemaï
Un Été de cendres Si Ahmed Bendrik, fonctionnaire en disgrâce à la Direction Générale des Statistiques doit supporter une hiérarchie soumise qui refuse d’entendre la vérité sur la déplorable situation démographique de la ville. Alors, l’homme résiste, défend son réduit existentiel, « un méchant bureau », en fait, un cagibi en face des toilettes, devenu son domicile. De peur d’un « coup d’Etat », il ne prend jamais de congés et entretient sa supériorité morale en se rasant chaque matin et en cirant ses chaussures une fois par semaine. Il sait bien, lui, que ses chefs partiront et que la ville retrouvera sa sérénité. En attendant, la vie continue et « notre » fonctionnaire entretient le quotidien par des souvenirs, s’exalte des seins « gros et opulents » de la voisine d’en face, écoute la « rumeur belliqueuse et sanglante de la ville » qui monte par les cent douze fenêtres de la bâtisse. La canicule et les moustiques finissent d’accabler les plus résistants des citoyens. Un été de cendres plonge le lecteur dans un récit ou l’angoisse, le désarroi emplissent toutes les pages. Mais, grâce à l’humour, la délicatesse et un certain détachement dans l’écriture, Abdelkader Djemaï sait lui épargner et lui éviter l’oppression d’une charge émotionnelle qui se dégage de chaque ligne.
Si Ahmed Bendrik, fonctionnaire en disgrâce à la Direction Générale des Statistiques doit supporter une hiérarchie soumise qui refuse d’entendre la vérité sur la déplorable situation démographique de la ville. Alors, l’homme résiste, défend son réduit existentiel, « un méchant bureau », en fait, un cagibi en face des toilettes, devenu son domicile. De peur d’un « coup d’Etat », il ne prend jamais de congés et entretient sa supériorité morale en se rasant chaque matin et en cirant ses chaussures une fois par semaine. Il sait bien, lui, que ses chefs partiront et que la ville retrouvera sa sérénité. En attendant, la vie continue et « notre » fonctionnaire entretient le quotidien par des souvenirs, s’exalte des seins « gros et opulents » de la voisine d’en face, écoute la « rumeur belliqueuse et sanglante de la ville » qui monte par les cent douze fenêtres de la bâtisse. La canicule et les moustiques finissent d’accabler les plus résistants des citoyens. Un été de cendres plonge le lecteur dans un récit ou l’angoisse, le désarroi emplissent toutes les pages. Mais, grâce à l’humour, la délicatesse et un certain détachement dans l’écriture, Abdelkader Djemaï sait lui épargner et lui éviter l’oppression d’une charge émotionnelle qui se dégage de chaque ligne.
Ce premier livre est suivi de deux autres, Sable rouge et 31 rue de l’Aigle. L’ensemble forme une trilogie.
Edition Michalon, 1995
Un Été de cendres est paru en poche chez Folio Gallimard, 2000 -
Dites-leur de me laisser passer
Abdelkader Djemaï
Dites-leur de me laisser passer, et autres nouvelles
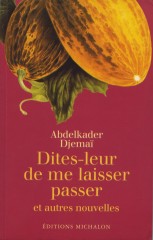 Après quatre romans et un essai consacré à Camus, Abdelkader Djemaï publiait ici son premier recueil de nouvelles. Ce nouveau genre ne surprit sans doute pas le lecteur habitué à la concision de l’écrivain oranais.
Après quatre romans et un essai consacré à Camus, Abdelkader Djemaï publiait ici son premier recueil de nouvelles. Ce nouveau genre ne surprit sans doute pas le lecteur habitué à la concision de l’écrivain oranais.
Djemaï est un malicieux. Son ton, son style sont, à bien des égards, atypiques dans la littérature algérienne des années quatre-vingt dix. Il est le seul à pouvoir décrire les pires horreurs, sans jamais se départir d’un ton serein, calme. Imperturbable, la phrase coule harmonieuse et dégraissée. Avec distance, voire une indifférence feinte, A.Djemai rapporte l’absurdité tragique de la condition humaine.
L’Algérie sert de toile de fond à la plupart des quinze nouvelles de ce recueil. Les violences des dernières années hantent toujours la plume de l’écrivain. « Côté jardin » raconte la fin tragique d’un auteur de théâtre et metteur en scène refroidit par un commando de tueurs alors qu’il peaufinait une scène d’amour.
« Les Prunes », brosse les fatales vicissitudes d’un poseur de bombe indisposé par une consommation excessive de prunes. « Une Drôle de tête » rapporte les déboires et les sueurs froides d’un chauffeur de taxi qui croit transporter dans un sac, laissé en gage de bonne foi par un client désargenté, la tête d’un riche commerçant décapité le matin même.
Avec « Les chevilles », Abdelkader Djemaï revient sur un thème présent dans nombre de ces romans, celui de la décomposition, de la décadence de la ville.
L’Algérie, encore et toujours, mais cette fois A.Djemaï s’attarde sur des maux endémiques qui rongent le pays et ses hommes. L’absurde machisme aux tragiques conséquences dans « La Guêpe » ; la sexualité dans « Une certaine hauteur » et son lot de frustrations, de crainte et de honte qui ne trouve pour expédient que le refuge dans une religion hostile à la gent féminine ; la suspicion dans « L’Accident » où un banal accident de la circulation devient une intrigue politique où baigneraient différents clans du pouvoir ; ou encore avec « Chers Frères, Chères Sœurs », pastiche d’une lettre de remerciement pour l’invitation adressée par les organisateurs d’un congrès politique à... un défunt ! Quand la mémoire algérienne a des ratés…
Avec « Dites-leur de me laisser passer », la nouvelle éponyme de ce recueil, A.Djemaï se glisse dans la peau d’un candidat à l’émigration clandestine. Placé à distance d’un poste frontière, l’homme attend la nuit pour tenter sa chance. « La Balade » permet à l’auteur de promener son œil mi-ironique mi-malicieux sur l’exil et le regard teinté d’exotisme que l’on pose sur ce qui vient d’ailleurs.
Enfin, « La Fugue » la plus longue et peut-être la plus imaginative de ces nouvelles. A.Djemaï y fait, dans une certaine mesure, plus fort qu’Amélie Nothomb. Il remonte dans les souvenirs d’une petite fille âgée de seulement quelques heures.
Après ses trois premiers romans qui forment un triptyque, A. Djemaï s’extraie, du moins sur un plan littéraire, du drame algérien. Il renouvelle le genre et n’entend pas confiner ses écrits aux dix dernières années algériennes. Le mouvement est perceptible chez d’autres auteurs algériens. Les thèmes s’enrichissent, la prise de distance permet des approches innovantes, des tonalités autres. L’écrivain tend à se transformer en romancier. A ce jeu, A. Djemaï a des atouts certains et maîtrise de mieux en mieux son sujet comme le montrent ses nouvelles.
Edition Michalon, 2000, 164 pages
-
Camping
Abdelkader Djemaï
Camping
 On sait la gourmandise d’Abdelkader Djemaï pour les mots et son souci de partager ce plaisir avec le lecteur. Il se refuse à l’ennuyer et s’applique à faire passer sa malice, sa bonhomie et une dose d’hédonisme salutaire dans le maelström de la littérature algérienne.
On sait la gourmandise d’Abdelkader Djemaï pour les mots et son souci de partager ce plaisir avec le lecteur. Il se refuse à l’ennuyer et s’applique à faire passer sa malice, sa bonhomie et une dose d’hédonisme salutaire dans le maelström de la littérature algérienne.Prenez ce livre. Le texte, court, est sans véritable intrigue et pourtant le charme opère, l’art du conteur ravi le lecteur d’un récit qu’il faudrait autant entendre que lire. En deux temps et trois mouvements, sans en avoir l’air, Djemaï brosse le tableau d’une société, de son l’histoire et, en quelques subreptices esquisses, laisse deviner tel ou tel événement. Comme rien de ce qui est humain n’est étranger à cet écrivain, il laisse s’échapper d’entre les lignes les effluves d’une calentina au cumin (la recette est dans le livre !), quelques notes de raï chantées par la grande Remitti ou quelques scènes d’un bon vieux Barabbas avec Anthony Quinn. L’amour aussi est rarement absent. Ici Aphrodite a soufflé sur le cœur d’un gamin : « J’allais bientôt avoir onze ans et mes premiers poils. C’étaient aussi les premières vacances de ma vie ». Un mois entier de juillet au « camping zéro étoile » de Salamane surnommé « La Marmite » par ses habitants. Là, il tombe amoureux de Yasmina, la sœur de « Kinder Bueno » celui qu’il ne peut souffrir mais dont il finira par se faire un copain : « Il ne faut pas croire que j’étais un hypocrite ou un petit malin mais j’en ais fait – par la force des choses – mon copain bien qu’il continuât à me les gonfler avec ses Adidas à trois bandes et sa casquette qui s’allumait (...). Il ne faut pas non plus penser que je tournais (...) autour de la petite pour qu’elle me fasse les papiers, comme ça je pourrais facilement venir chez elle, à Aubervilliers ». Car la famille de Kinder Bueno vient de France. Ce sont des émigrés ! Sa grand-mère a transformé sa tente en un supermarché et un bureau de change. Pistonné par un sien neveu, officier des douanes, « toute l’année, elle était approvisionnée par sa fille aînée » qui réside à Aubervilliers. Pas très sympa (ni forcément très juste) pour les émigrés mais, en contrepoint, déambule la silhouette tragique de Cassidy, par deux fois expulsé de France faute de papiers et qui « rêvait à voix haute de retraverser cette mer ». Car derrière l’anodin, l’anecdote, le ton distancé, se dissimule le sens. Il y a la vie à l’intérieur du camping, ses personnages plus ou moins pittoresques qui campent à eux seuls la société algérienne. Cette société où se préparent les municipales de 1991. Les partis pullulent, la mascarade tourne à la grosse blague. Pourtant, « personne, encore moins les morts, n’aurait imaginé que cette sinistre rigolade nous conduirait au cimetière (...) ».
Face au camping, surplombant « La Marmite », se dresse la villa du colonel « naturellement originaire de l’Est ». Les proprios et leur jeunesse dorée ne manifestent que mépris pour ce peuple qui assiste au défilé de la clientèle du régime : « des prétentieux, voleurs ou lécheurs de babouches ».
Après les élections et le débarquement des « Martiens » sur toutes les plages du pays, tout a changé. Au camping, l’année suivante, l’atmosphère est plus lourde. La mort rôde. Cassidy n’est plus là. Yasmina non plus. Le gamin aurait aimé lui faire découvrir sa ville, partager avec elle sa passion pour la géographie... Il avait douze ans. C’étaient ses deuxièmes vacances. « Ses dernières aussi. L’été qui s’annonçait était une été de cendres »
Ed. du Seuil, 2002, 124 pages, 12 euros.
(Photo : Cheikha Remitti )
-
Gare du Nord
Abdelkader Djemaï
Gare du Nord
 L’écrivain algérien auteur en 1995 d’Un Été de cendres donne avec Gare du Nord un roman au style minimaliste où, sans jamais en avoir l’air, par touches légères et successives, il finit par brosser le tableau d’une vie, d’une situation ou d’une société. L’histoire elle-même est épurée, dégraissée, au point de laisser disparaître toute trame ou suspens romanesque. Le risque d’inconsistance pourrait guetter n’était l’importance ici de la langue et cette faculté de l’auteur à faire partager son adoration gourmande pour les mots.
L’écrivain algérien auteur en 1995 d’Un Été de cendres donne avec Gare du Nord un roman au style minimaliste où, sans jamais en avoir l’air, par touches légères et successives, il finit par brosser le tableau d’une vie, d’une situation ou d’une société. L’histoire elle-même est épurée, dégraissée, au point de laisser disparaître toute trame ou suspens romanesque. Le risque d’inconsistance pourrait guetter n’était l’importance ici de la langue et cette faculté de l’auteur à faire partager son adoration gourmande pour les mots.Gare du Nord. Parmi les milliers de voyageurs, pressés de prendre un train pour aller quelque part ; entre des hommes et des femmes qui attendent un être cher, impatients à l’idée d’enlacer l’être aimé ou heureux de retrouver un proche ; au milieu de cette cohue sans nom, impérieuse et indifférente, déambulent trois solitudes. Ce sont trois chibanis, de vieux immigrés algériens qui, chaque jour, effectuent la même ballade. Sans but ni personne à retrouver. Des vieux « sans histoire » pour s’inspirer du titre du premier roman de Tassadit Imache. C’est pourtant à ces histoires-là qu’Abdelkader Djemaï a décidé de s’intéresser. Tout au long du roman, ils ne seront désignés que par leur sobriquet, Bonbon, Bartolo et Zalamite. Usage courant dans l’immigration algérienne, le sobriquet n’est pas seulement ici marque de réalisme. Bonbon, Bartolo et Zalamite sont à deux doigts de refermer la boucle d’une vie passée sans avoir fait de bruit et sans laisser de traces. Ou presque.
Un triple portrait tendre comme pour tirer de l’oubli ces chibanis qui ont donné leur vie, moins pour les leurs que pour une amante bien exigeante et au final bien ingrate : « Madame la France ». Et lorsque la mort implacable fauche une à une ces existences, l’orage peut bien éclater dans le ciel, « comme un sanglot » sur des patronymes enfin retrouvés, la pluie, elle, efface les traces des pas des chibanis laissés sur l’asphalte des villes de France. Efface jusqu’à leur souvenir. Ou presque.
Ed. du Seuil, 2003, 91 pages, 11 euros.