Mohamed Kacimi
L’Orient après l’amour
 L’Orient après l’amour c’est, après une nuit arrosée de promesses et d’arak, un réveil avec une gueule de bois à vous taper la tête contre les murs ! « Notre utopie est derrière nous. Nous étions tellement convaincus de vivre rive gauche que nous n’avons rien vu venir » écrit Mohamed Kacimi. Et oui, ce jeune quinquagénaire parle d’un temps où, à un concert de Léo Ferré à Sidi Ferruch, aux « ni Dieu ni Maître » de l’artiste, le public répondait par « la Rabi-ou-la Nabi » « Ni Dieu ni Prophète ». « C’était en 1975. » Un temps que les moins de vingt ans…
L’Orient après l’amour c’est, après une nuit arrosée de promesses et d’arak, un réveil avec une gueule de bois à vous taper la tête contre les murs ! « Notre utopie est derrière nous. Nous étions tellement convaincus de vivre rive gauche que nous n’avons rien vu venir » écrit Mohamed Kacimi. Et oui, ce jeune quinquagénaire parle d’un temps où, à un concert de Léo Ferré à Sidi Ferruch, aux « ni Dieu ni Maître » de l’artiste, le public répondait par « la Rabi-ou-la Nabi » « Ni Dieu ni Prophète ». « C’était en 1975. » Un temps que les moins de vingt ans…
Qu’importe ! il reste à vider quelques verres avec Kacimi. Et le lecteur, même abstème, en redemande. Ne serait-ce que pour la vivacité et l’impertinence de sa langue pétrie d’un humanisme aux accents soufis et de cet humour qui depuis le lointain Mouchoir jusqu’à La Confession d’Abraham traverse l’œuvre du poète et romancier né du côté d’El Hamel en Algérie.
Sur les rayons de la bibliothèque, Kacimi voisine avec Kateb Yacine, et comme aurait dit « l’Ancien », ce livre « vaut son pesant de poudre ». M.Kacimi manipule de la dynamite. Libertés, religions, femmes…tout y passe et sans faux-semblants. Souvent même avec courage. M. Kacimi raconte sa jeunesse algérienne et ses pérégrinations dans le monde arabe, de Djeddah à Fès en passant par Sanaa, Beyrouth, Jérusalem, Le Caire ou Alger. Il ne tergiverse pas : « Ce monde arabo-musulman est un vaste Goulag, sans Zinoviev ni Soljenitsyne, où Dieu qui est grand a pris la place du Petit Père des peuples. » Partout, il décrit un islam oppressant et oppressif, vindicatif et arrogant, négatif et castrateur, amnésique et sans culture. Des sociétés sans liberté et surtout des femmes, affublées de voiles de toutes formes, et soumises au joug du premier foutriquet venu mais que Dieu, dans sa miséricorde, a fait mâle. Ces violences sont racontées avec distance et élégance. En dramaturge, il met en scène cet « orient complexe » via des petits entretiens incisifs et suggestifs et le tableau des situations typiques autant que des événements insolites.
Le co-auteur d’Arabe vous avez dit arabe est bien placé pour déconstruire la vision que ses concitoyens ont de l’islam et du monde arabe. Pour autant, il privilégie l’image que renvoient aujourd’hui les musulmans. Rien à voir avec l’islam de papa ! Justement, à propos de son père : « Je l’ai entendu un soir, à une fête à la gare du Nord, dire à une amie parisienne qui lui précisait que, eu égard à sa présence, elle se refusait à servir du vin à ses invités :
- Mademoiselle, si ma présence restreint votre liberté, je préfère prendre congé.
Il était alors inspecteur général des affaires religieuses. »
Pas étonnant alors qu’en France il fasse partie de ceux qui refusent de tomber dans le panneau : qu’il s’agisse de l’affaire des caricatures ou du voile, il ne mâche pas ses mots et ses démonstrations pour ce qui n’est rien d’autre qu’un « signe d’avilissement », un « instrument d’aliénation ».
Mais, quand en 2005, il voit « ressortir une loi de la guerre d’Algérie pour pacifier la banlieue », il fulmine et pose un méchant regard sur l’intégration. Il sert alors une autre version de la France « moisie » : « ce pays a trop écrit, trop vécu, trop rêvé, trop guerroyé, trop inventé, trop pillé, trop travaillé. C’est le temps du troisième âge et il faudra s’y faire. »
Cela est peut-être excessif, mais cela vient d’une voix qui jamais n’a crié avec les loups. Kacimi qui a placé en exergue une citation de rabbi Nahman - « Plus les temps seront durs, plus notre rire sera fort » - semble comme impuissant et désarçonné : « que ferons-nous demain, nous, citoyens de culture musulmane ayant fui nos pays d’origine en raison de la dictature du religieux, de l’absence de démocratie, et qui avons choisi la France comme terre d’accueil ou comme patrie, que ferons-nous quand nos filles à l’école publique se feront traiter de putes et traîner dans les caves parce qu’elles n’auront pas porté de voile, et que nos garçons se feront traiter de mécréants car ils n’auront pas respecté le ramadan dans les cantines ? Ne pas céder sur l’affaire du voile, c’est rendre un immense service à l’islam, lui apprendre qu’il n’est pas la religion unique mais une parmi les autres et que la France ou l’Europe ne sont pas des terres de conquête mais des territoires de partage. » Kacimi n’a pas envie de devoir écrire demain : La France après l’amour !
Editions Actes Sud, 2008, 205 pages, 19 €
 « Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges de la vie, et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années ». Cette réflexion de La Rochefoucauld pourrait servir d’illustration au nouveau roman de Mabrouck Rachedi qui avait publié
« Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges de la vie, et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années ». Cette réflexion de La Rochefoucauld pourrait servir d’illustration au nouveau roman de Mabrouck Rachedi qui avait publié 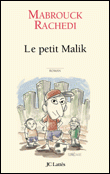
 A l’heure du règne de « l’immigration choisie », de la suspicion généralisée à l’endroit du modeste voyageur simplement épris de culture, de découverte, d’échange et peut-être d’amour, il n’est pas aisé de passer les frontières. D’accord ! Certaines frontières et certains voyageurs… Mais la mésaventure peut aussi arriver à une charmante française désireuse de retrouver son amour installé au Japon. C’est ce que raconte la mangaka française Aurélie Aurita dans Je ne verrai pas Okinawa. L’expérience est autobiographique. L’auteure signait là sa troisième Bd après Fraise et Chocolat, diptyque polisson et même torride paru chez le même éditeur.
A l’heure du règne de « l’immigration choisie », de la suspicion généralisée à l’endroit du modeste voyageur simplement épris de culture, de découverte, d’échange et peut-être d’amour, il n’est pas aisé de passer les frontières. D’accord ! Certaines frontières et certains voyageurs… Mais la mésaventure peut aussi arriver à une charmante française désireuse de retrouver son amour installé au Japon. C’est ce que raconte la mangaka française Aurélie Aurita dans Je ne verrai pas Okinawa. L’expérience est autobiographique. L’auteure signait là sa troisième Bd après Fraise et Chocolat, diptyque polisson et même torride paru chez le même éditeur. 
 Une fois de plus, dans ce roman chinois, il est question de Révolution culturelle. Mais ici nous sommes à Urumqi, au pied du Tianshan, en pays ouighour, dans la province de Xinjiang à l’extrême ouest de la Chine, bien loin de Pékin. Si cette période « où le bonheur était rouge du sang versé » imprime sa marque sur les êtres et les événements, ce qui compte ici est la relation qu’un gamin, Liu Aï, entretient avec un dictionnaire de langue anglaise et son propriétaire, Wang Yajun, le professeur d’anglais tout juste débarqué de Shanghai. « Lorsque Wang Yajun était passé pour la première fois près de moi, cette odeur prenante m’avait soudain fait comprendre qu’il pouvait y avoir de belles choses au monde. »
Une fois de plus, dans ce roman chinois, il est question de Révolution culturelle. Mais ici nous sommes à Urumqi, au pied du Tianshan, en pays ouighour, dans la province de Xinjiang à l’extrême ouest de la Chine, bien loin de Pékin. Si cette période « où le bonheur était rouge du sang versé » imprime sa marque sur les êtres et les événements, ce qui compte ici est la relation qu’un gamin, Liu Aï, entretient avec un dictionnaire de langue anglaise et son propriétaire, Wang Yajun, le professeur d’anglais tout juste débarqué de Shanghai. « Lorsque Wang Yajun était passé pour la première fois près de moi, cette odeur prenante m’avait soudain fait comprendre qu’il pouvait y avoir de belles choses au monde. »