Ook Chung
Kimchi
 Il y a aujourd’hui dans le monde environ 200 millions de personnes qui vivent en dehors du pays qui les a vu naître et sans doute beaucoup plus encore d’hommes et de femmes nés de ces migrations. L’inédit n’est peut-être pas dans l’importance numérique de ces déplacements, mais tient plus à son contexte socioculturel où, pour être rapide, le champ des possibles laissé à l’individu est à la fois plus vaste (métissage culturel) et plus restreint (uniformisation culturelle transnationale). Dans cette brèche où, sur le plan romanesque, le sujet navigue entre une liberté intérieure immense et une contrainte imposée par les conditions extérieures, entre Proust et Kafka, des écrivains qui eux-mêmes font l’expérience de cette situation se sont engouffrés. Peut-être aident-ils à voir, à comprendre, à ressentir « une portion jusqu’alors inconnue de l’existence » pour reprendre Milan Kundera. Citons ici Neil Bissondath, Hanan El Cheikh, Mako Yoshikawa, Amin Maalouf, Tassadit Imache, Kazuo Ishiguro ou Ook Chung.
Il y a aujourd’hui dans le monde environ 200 millions de personnes qui vivent en dehors du pays qui les a vu naître et sans doute beaucoup plus encore d’hommes et de femmes nés de ces migrations. L’inédit n’est peut-être pas dans l’importance numérique de ces déplacements, mais tient plus à son contexte socioculturel où, pour être rapide, le champ des possibles laissé à l’individu est à la fois plus vaste (métissage culturel) et plus restreint (uniformisation culturelle transnationale). Dans cette brèche où, sur le plan romanesque, le sujet navigue entre une liberté intérieure immense et une contrainte imposée par les conditions extérieures, entre Proust et Kafka, des écrivains qui eux-mêmes font l’expérience de cette situation se sont engouffrés. Peut-être aident-ils à voir, à comprendre, à ressentir « une portion jusqu’alors inconnue de l’existence » pour reprendre Milan Kundera. Citons ici Neil Bissondath, Hanan El Cheikh, Mako Yoshikawa, Amin Maalouf, Tassadit Imache, Kazuo Ishiguro ou Ook Chung.
Il y a d’ailleurs entre le livre de Kazuo Ishiguro, Quand nous étions orphelins, et Kimchi de nombreuses similitudes. Même travail de mémoire et de filiation, le premier via une enquête policière, le second par une introspection plus franche et, à l’arrivée, le même constat sur la vanité de la quête des origines. « La recherche des racines comme panacée est une illusion » écrit Ook Chung. Chez l’un le message est indirectement délivré par une mère qui depuis longtemps a perdu la raison, chez l’autre et de manière explicite, par une lettre laissée par un père décédé.
Si sur le fond les deux romans convergent, Kimchi se révèle différent pour au moins deux raisons. D’abord par sa forme. Le récit, partiellement autobiographique, est agrémenté de réflexions diverses (sur la littérature japonaise moderne, sur le besoin d’écriture, sur le statut de l’écrivain...), de développements ou d’images symboliques (la leçon sur le butoh ou la visite des catacombes à Paris et la description d’une cloche de fontis) et de données quasi sociologiques sur le Japon et la xénophobie nippone. Thèmes déjà présents dans le premier recueil de nouvelles d’Ook Chung (1).
L’autre différence, et elle est de taille cette fois, porte sur les protagonistes des deux récits. Chez Kazuo Ishiguro, Christopher Bank est un personnage presque falot, lisse, sans vie intérieure, sans drame. Le narrateur de Kimchi est tout le contraire. L’homme est tourmenté par le secret de sa naissance que le lecteur découvre avec lui à l’occasion de cette visite à Yokohama où le narrateur retourne sur les lieux de son enfance. Il y renoue les fils rompus de l’histoire familiale et laisse remonter à la surface les souvenirs de son amour pour Hiroé, cette étudiante rencontrée dans le cadre d’un séminaire consacré à la littérature, et son impardonnable erreur , « l’une des erreurs les plus fatales de son existence ».
De plus et surtout, cet homme est rongé par les affres d’une identité incertaine. « Je suis né en plein cœur du Chinatown de Yokohama, de parents coréens. Et j’ai grandi à Montréal, la ville la plus européenne de l’Amérique ». Entre sa naissance et ce récit, il y a trente années, quatre langues, ses visites systématiques de tous les Chinatown, « ces bouées de sauvetage » ou ces « sas psychologiques », des villes où il voyage, et... le kimchi, ce condiment coréen devenu emblème national et porte-drapeau identitaire du coréen en exil.
De ce point de vue, le plus important dans Kimchi, ne réside pas dans cette abstraction intellectuelle aujourd’hui en partie convenue et ici réaffirmée par cette citation empruntée à Van Gogh : « il n’est pas possible de vivre en dehors de la patrie, et la patrie, ce n’est pas seulement un coin de terre ; c’est aussi un ensemble de cœurs humains qui recherchent et ressentent la même chose. Voilà la patrie, où l’on se sent vraiment chez soi. ». Non, le plus important est cette peine à vivre du narrateur, marquée par sa double et bien réelle quête, celle d’une filiation, et l’autre, identitaire, qui lui fait voir en Amy, cette jeune métisse autiste de huit ans, moitié américaine, moitié japonaise, le miroir de sa propre enfance. Un « miroir inversé ». Dans Kimchi, l’identité est inachevée, toujours remise en question, en ruine comme un mur écroulé : « il n’y avait pas de fin à cette identité, ou alors celle-ci était à trouver dans le chaos et son propre inachèvement ». Telle est la malédiction du déraciné, mais aussi sa bénédiction.
(1) Nouvelles orientales et désorientées, Le Serpent à plumes, 1999.
Ed. Le Serpent à plumes, 2001, 245 pages, 15,09 euros
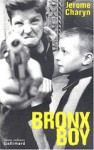 Dans cette belle collection qui invite les auteurs à livrer quelques mémoires tirées des nimbes de l'enfance, Jérôme Charyn narre l'histoire d'un jeune chevalier évoluant dans un Bronx féodal, peuplé d'émigrants russes et juifs, divisé en bandes rivales mais régies par un code de l'honneur exigeant. Chaque gang arbore son blason, qui une plume bleue au chapeau, qui une couleur noire sur noire, qui noire sur noire rehaussée de rouge coq qui enfin du jaune délavé et du marron.
Dans cette belle collection qui invite les auteurs à livrer quelques mémoires tirées des nimbes de l'enfance, Jérôme Charyn narre l'histoire d'un jeune chevalier évoluant dans un Bronx féodal, peuplé d'émigrants russes et juifs, divisé en bandes rivales mais régies par un code de l'honneur exigeant. Chaque gang arbore son blason, qui une plume bleue au chapeau, qui une couleur noire sur noire, qui noire sur noire rehaussée de rouge coq qui enfin du jaune délavé et du marron. Jeffrey
Jeffrey