Mako Yoshikawa
Vos désirs sont désordres
 Mako Yoshikawa est née aux États-Unis. New-yorkaise, elle est l'arrière-petite-fille d'une geisha et signe là son premier roman. Elle y démonte les ressorts secrets du désir au féminin à travers trois générations de femmes. Il y a d'abord Yukiko, la grand-mère, ancienne geisha, vivant toujours au Japon, qui par amour a épousé Sekiguchi, accédant ainsi au statut de femme respectable ; la mère, Akiko, qui s'est enfuie aux États-Unis avec Kenji, son amant, un cousin d'origine coréenne, lequel a fini par l'abandonner, la laissant seule avec une fillette de neuf ans. Cette fille, c'est Kiki Takehashi, la narratrice. Elle s'apprête à épouser Eric, un jeune avocat, dynamique et sûr de lui, autoritaire mais si prévenant et rassurant... Pourtant, tout ne va pas de soi. Kiki ne parvient pas à oublier Phillip, qui a trouvé la mort au Népal au cours de l'un de ses nombreux voyages à l'étranger. Phillip, ou plutôt son fantôme, continue, plusieurs mois après sa disparition, de lui apparaître. Kiki attend avec impatience la venue annoncée de sa grand-mère pour lui poser moult questions et recueillir l'avis de son aïeule sur des sujets - désir, relation amoureuse - qu'elle connaît bien, et pour cause. À l'aide de l'histoire et de l'expérience de ses deux aînées, Kiki tente de retrouver son propre chemin et peut-être, alors, de renaître à l'amour. L'originalité de ce récit est de lier à ce thème celui de la transmission, à travers trois générations de femmes. "Que cela me plaise ou non, la vie de ma mère et celle de ma grand-mère sont les étoiles à partir desquelles j'établis mon parcours", dit Kiki. Avec la même subtilité qu'elle met à explorer les mystères du désir, Mako Yoshikawa traque les tours et les détours de la transmission. Kiki n'a pas reçu de sa mère une culture japonaise ("Je n'ai pas su me servir de baguettes avant l'âge de 24 ans, quand Phillip m'a appris à les utiliser.") et pourtant elle déclare : "Je suis peut-être plus japonaise que je ne le crois." Sans doute que les récits sur la vie de sa grand-mère que lui racontait, le soir, sa mère, ont produit là leur effet. Ces reliquats d'une mémoire familiale et culturelle rapportés par Akiko seraient "un acte de contrition pour le fossé qui s'était creusé entre elle [Akiko] et sa mère, pour le froid et le silence presque total qui allait durer vingt-neuf années". "Il m'est difficile de ne pas en vouloir à ma mère de m'avoir privée de ma grand-mère ainsi que de tant de chose", ajoute Kiki. Après le départ de Kenji, une distance s'est installée entre la mère et la fille, Akiko se repliant sur elle-même et sur sa douleur. Comme Kiki après la mort de Phillip. Mais les relations entre Akiko et Kiki sont subtiles et complexes. Leur tendre complicité ne peut éviter une distance, voire des ruptures culturelles qui inévitablement se tissent entre cette mère, Japonaise immigrée aux États-Unis, et sa fille, d'origine japonaise certes, mais américaine avant tout : "Élevée dans une culture où les membres d'une même famille se contentent généralement de se saluer d'une inclinaison de tête, ma mère est bien évidemment une personne réservée, distante même avec sa fille [...]. La chaleur d'un corps me berçant et me serrant contre lui, de même que la caresse de longs doigts frais sur ma tête ne sont pas des choses que j'attends de ma mère", dit, avec regret mais compréhension, Kiki. Une autre distance traverse la vie de Kiki. Dans ses relations avec des Américains blancs, elle montre comment elle est trop souvent renvoyée et enfermée dans ses origines, à l'exclusion de toute autre appartenance identitaire. Parfois même, le regard de l'autre ne parvient pas à se débarrasser d'un imaginaire empreint de racisme : "J'ai réfléchi intensément et depuis longtemps à notre secrète affinité [avec sa grandmère], et j'ai découvert ceci : une Japonaise est pour les Américains ce qu'une geisha est pour les Japonais." À ce propos, le titre original de ce roman est One hundred and one Ways, allusion aux cent et une manières d'aimer un homme...
Mako Yoshikawa est née aux États-Unis. New-yorkaise, elle est l'arrière-petite-fille d'une geisha et signe là son premier roman. Elle y démonte les ressorts secrets du désir au féminin à travers trois générations de femmes. Il y a d'abord Yukiko, la grand-mère, ancienne geisha, vivant toujours au Japon, qui par amour a épousé Sekiguchi, accédant ainsi au statut de femme respectable ; la mère, Akiko, qui s'est enfuie aux États-Unis avec Kenji, son amant, un cousin d'origine coréenne, lequel a fini par l'abandonner, la laissant seule avec une fillette de neuf ans. Cette fille, c'est Kiki Takehashi, la narratrice. Elle s'apprête à épouser Eric, un jeune avocat, dynamique et sûr de lui, autoritaire mais si prévenant et rassurant... Pourtant, tout ne va pas de soi. Kiki ne parvient pas à oublier Phillip, qui a trouvé la mort au Népal au cours de l'un de ses nombreux voyages à l'étranger. Phillip, ou plutôt son fantôme, continue, plusieurs mois après sa disparition, de lui apparaître. Kiki attend avec impatience la venue annoncée de sa grand-mère pour lui poser moult questions et recueillir l'avis de son aïeule sur des sujets - désir, relation amoureuse - qu'elle connaît bien, et pour cause. À l'aide de l'histoire et de l'expérience de ses deux aînées, Kiki tente de retrouver son propre chemin et peut-être, alors, de renaître à l'amour. L'originalité de ce récit est de lier à ce thème celui de la transmission, à travers trois générations de femmes. "Que cela me plaise ou non, la vie de ma mère et celle de ma grand-mère sont les étoiles à partir desquelles j'établis mon parcours", dit Kiki. Avec la même subtilité qu'elle met à explorer les mystères du désir, Mako Yoshikawa traque les tours et les détours de la transmission. Kiki n'a pas reçu de sa mère une culture japonaise ("Je n'ai pas su me servir de baguettes avant l'âge de 24 ans, quand Phillip m'a appris à les utiliser.") et pourtant elle déclare : "Je suis peut-être plus japonaise que je ne le crois." Sans doute que les récits sur la vie de sa grand-mère que lui racontait, le soir, sa mère, ont produit là leur effet. Ces reliquats d'une mémoire familiale et culturelle rapportés par Akiko seraient "un acte de contrition pour le fossé qui s'était creusé entre elle [Akiko] et sa mère, pour le froid et le silence presque total qui allait durer vingt-neuf années". "Il m'est difficile de ne pas en vouloir à ma mère de m'avoir privée de ma grand-mère ainsi que de tant de chose", ajoute Kiki. Après le départ de Kenji, une distance s'est installée entre la mère et la fille, Akiko se repliant sur elle-même et sur sa douleur. Comme Kiki après la mort de Phillip. Mais les relations entre Akiko et Kiki sont subtiles et complexes. Leur tendre complicité ne peut éviter une distance, voire des ruptures culturelles qui inévitablement se tissent entre cette mère, Japonaise immigrée aux États-Unis, et sa fille, d'origine japonaise certes, mais américaine avant tout : "Élevée dans une culture où les membres d'une même famille se contentent généralement de se saluer d'une inclinaison de tête, ma mère est bien évidemment une personne réservée, distante même avec sa fille [...]. La chaleur d'un corps me berçant et me serrant contre lui, de même que la caresse de longs doigts frais sur ma tête ne sont pas des choses que j'attends de ma mère", dit, avec regret mais compréhension, Kiki. Une autre distance traverse la vie de Kiki. Dans ses relations avec des Américains blancs, elle montre comment elle est trop souvent renvoyée et enfermée dans ses origines, à l'exclusion de toute autre appartenance identitaire. Parfois même, le regard de l'autre ne parvient pas à se débarrasser d'un imaginaire empreint de racisme : "J'ai réfléchi intensément et depuis longtemps à notre secrète affinité [avec sa grandmère], et j'ai découvert ceci : une Japonaise est pour les Américains ce qu'une geisha est pour les Japonais." À ce propos, le titre original de ce roman est One hundred and one Ways, allusion aux cent et une manières d'aimer un homme...
Traduit de l'anglais par Matine Leroy-Battistelli Flammarion, 2000, 396 pages. Réédité en poche (J'ai lu, 2002)
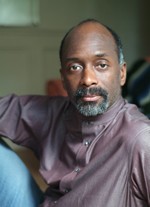 Une scène ouvre le livre et revient plusieurs fois hanter le récit : le narrateur, réveillé par des hurlements, observe de sa fenêtre, dans la nuit, un homme battre violemment une femme. « Je reste à ma fenêtre. Ce que je vois me déchire les yeux. Ce que je ressens dévoile qui je suis. » Cela se passe à Harlem. La mythique, la légendaire Harlem. Harlem « refuge », « La Mecque noire ». Comme le montre l'auteur, « il fallait que naisse Harlem, où les Noirs pourraient être loin à l'écart » de l'injustice. Mais Harlem est devenu un « ghetto », une « zone ». C'est aussi l'histoire d'Harlem que décrit ici Eddy L.Harris, de l'Harlem idéalisé - et le mythe a la vie dure - à la réalité du début des années 90 : un ghetto sordide, délabré et dangereux. « La route est longue de Harlem-lieu d'espérance à Harlem-terre de désespoir ».
Une scène ouvre le livre et revient plusieurs fois hanter le récit : le narrateur, réveillé par des hurlements, observe de sa fenêtre, dans la nuit, un homme battre violemment une femme. « Je reste à ma fenêtre. Ce que je vois me déchire les yeux. Ce que je ressens dévoile qui je suis. » Cela se passe à Harlem. La mythique, la légendaire Harlem. Harlem « refuge », « La Mecque noire ». Comme le montre l'auteur, « il fallait que naisse Harlem, où les Noirs pourraient être loin à l'écart » de l'injustice. Mais Harlem est devenu un « ghetto », une « zone ». C'est aussi l'histoire d'Harlem que décrit ici Eddy L.Harris, de l'Harlem idéalisé - et le mythe a la vie dure - à la réalité du début des années 90 : un ghetto sordide, délabré et dangereux. « La route est longue de Harlem-lieu d'espérance à Harlem-terre de désespoir ».